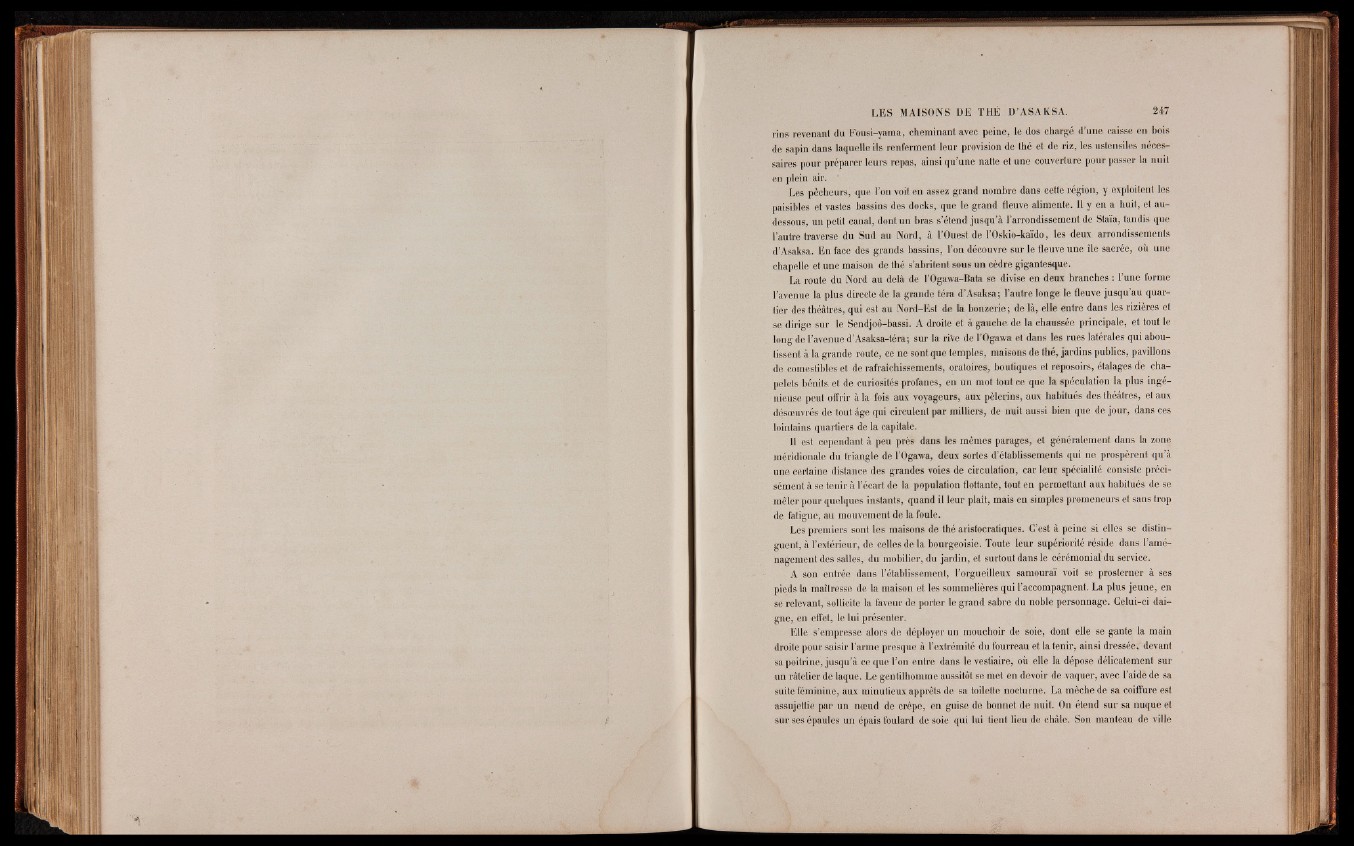
i l
rins revenant du Fousi-yama, cheminant avec peine, le dos chargé d’une caisse en bois
de sapin dans laquelle ils renferment leur provision de thé et de riz, les ustensiles nécessaires
pour préparer leurs repas, ainsi qu’une natte et une couverture pour passer la nuit
en plein air.
Les pêcheurs, que Ton voit en assez grand nombre dans cette région, y exploitent les
paisibles et vastes bassins des docks, que le grand fleuve alimente. Il y en a huit, et au-
dessous, un petit canal, dont un bras s’étend jusqu’à l’arrondissement de Staïa, tandis que
l’autre traverse du Sud au Nord, à l'Ouest de l’Oskio-kaïdo, les deux arrondissements
d’Asaksa. En face des grands bassins, Ton découvre sur le fleuve une île sacrée, où une
chapelle et une maison de thé s’abritent sous un cèdre gigantesque.
La route du Nord au delà de l’Ogawa-Bata se divise en deux branches : Tune forme
l’avenue la plus directe de la grande téra d’Asaksa; l’autre longe le fleuve jusqu’au quartier
des théâtres, qui est au Nord-Est de fa bonzerie ; de là, elle entre dans les rizières et
se dirige sur le Sendjoô-bassi. A droite et à gauche de la chaussée principale, et tout le
long de l’avenue d’Asaksa-téra; sur la riVe de l’Ogawa et dans les rues latérales qui aboutissent
à la grande route, ce ne sont que temples, maisons de thé, jardins publics, pavillons
de comestibles et de rafraîchissements, oratoires, boutiques et reposoirs, étalages dé chapelets
bénits, et de curiosités profanes, en un mot tout ce que la spéculation la plus ingénieuse
peut offrir à la fois aux voyageurs, aux pèlerins, aux habitués des théâtres, et aux
désoeuvrés de tout âge qui circulent par milliers, de nuit aussi bien que de jour, dans ces
lointains quartiers de la capitale.
11 est cependant à peu près dans les mêmes parages, et généralement dans la zone
méridionale du triangle de l’Ogawa, deux sortes d’établissements qui ne prospèrent qu’à
une certaine distance des grandes voies de circulation, car leur spécialité consiste précisément
à se tenir à l’écart de la population flottante, tout en permettant aux habitués de se
mêler pour quelques instants, quand il leur plaît, mais en simples promeneurs et sans trop
de fatigue, au mouvement de la foule.
Les premiers sont les maisons de thé aristocratiques. C’est à peine si elles se distinguent,
à l’extérieur, de celles de la bourgeoisie. Toute leur supériorité réside dans l’aménagement
des salles, du mobilier, du jardin, et surtout dans le cérémonial du service.
A son entrée dans l’établissement, l’orgueilleux samouraï voit se prosterner à ses
pieds la maîtresse de la maison et les sommelières qui l’accompagnent. La plus jeune, en
se relevant, sollicite la faveur de porter le grand sabre du noble personnage. Celui-ci daigne,
en effet, le lui présenter.
Elle s’empresse alors de déployer un mouchoir de soie, dont elle se gante la main
droite pour saisir l’arme presque à l’extrémité du fourreau et la tenir, ainsi dressée; devant
sa poitrine, jusqu’à ce que Ton entre dans le vestiaire, où elle la dépose délicatement sur
un râtelier de laque. Le gentilhomme aussitôt se met en devoir de vaquer, avec l’aide de sa
suite féminine, aux minutieux apprêts de sa toilette nocturne. La mèche de sa coiffure est
assujettie par un noeud de crêpe, en guise de bonnet de nuit. On étend sur sa nuque et
sur ses épaules un épais foulard de soie qui lui tient lieu de châle. Son manteau de ville