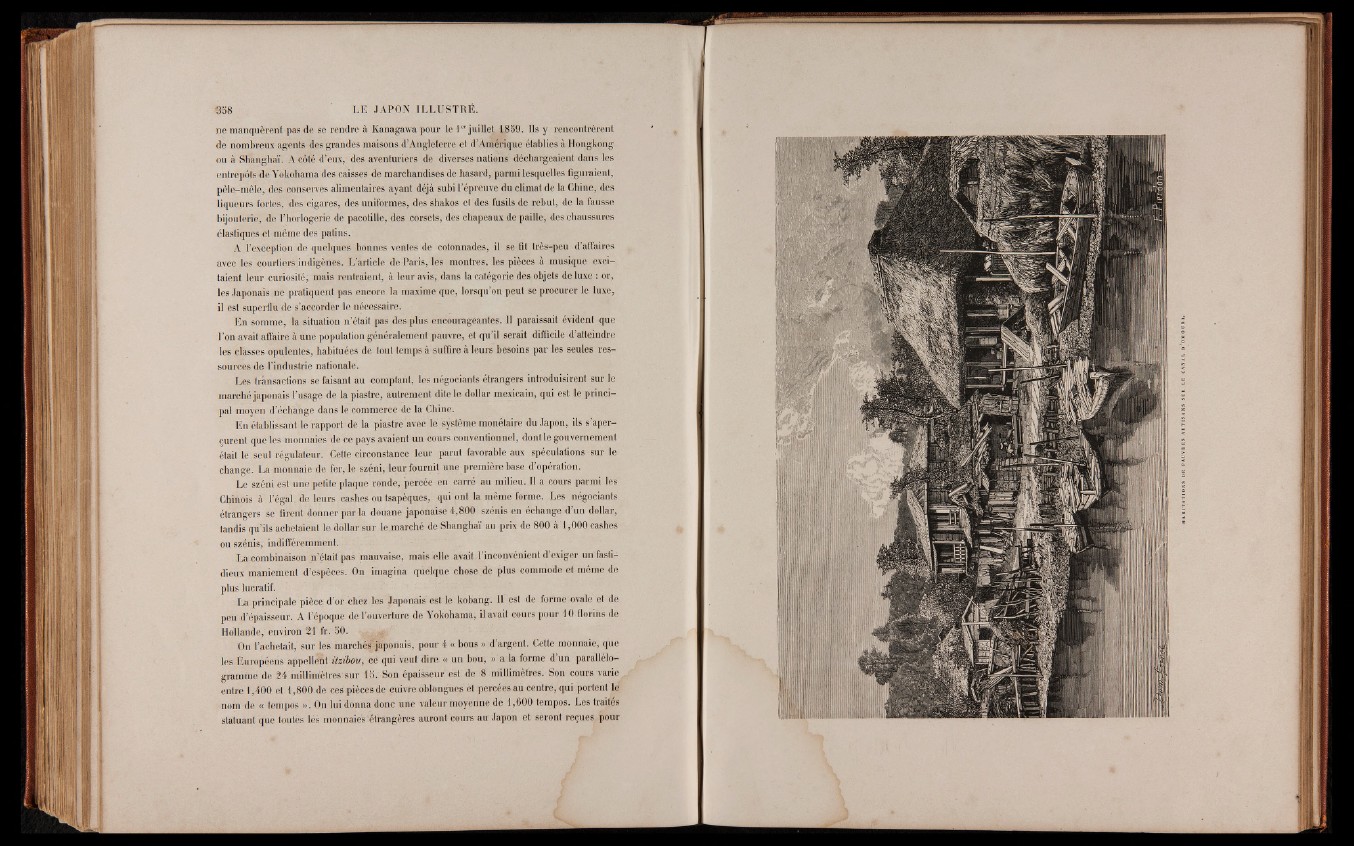
358 LE JAPON ILLUSTR É.
ne manquèrent pas de se rendre à Kanagawa pour le 1" juillet 1859. Ils y rencontrèrent
de nombreux agents des grandes maisons d’Angleterre et d’Amérique établies à Hongkong
ou à Shanghaï. A côté d’eux, des aventuriers de diverses nations déchargeaient dans les
entrepôts de Yokohama des caisses de marchandises de hasard, parmi lesquelles figuraient,
pêle-mêle, des conserves alimentaires ayant déjà subi l’épreuve du climat de la Chine, des
liqueurs fortes, des cigares, des uniformes, des shakos el des fusils de rebut, de la fausse
bijouterie, de l’horlogerie de pacotille, des corsets, des chapeaux de paille, des chaussures
élastiques et même des patins.
A l’exception de quelques bonnes ventes de cotonnades, il se fit très-peu d’affaires
avec les courtiers indigènes. L’article de Paris, les montres, les pièces à musique excitaient
leur curiosité; mais rentraient, à leur avis, dans la catégorie des objets de luxe : or,
les Japonais ne pratiquent pas encore la maxime que, lorsqu’on peut se procurer le luxe,
il est superflu de s’accorder le nécessaire.
En somme, la situation n ’était pas des plus encourageantes. 11 paraissait évident que
l ’on avait affaire à une population généralement pauvre, et qu’il serait difficile d’atteindre
les classes opulentes, habituées de tout temps à suffire à leurs besoins par les seules ressources
de l’industrie nationale.
Les transactions se faisant au comptant, les négociants étrangers introduisirent sur le
marché japonais l’usage de la piastre, autrement dite le dollar mexicain, qui est le principal
moyen d’échange dans le commerce de la Chine.
En établissant le rapport de la piastre avec le système monétaire du Japon, ils s’aperçurent
que les monnaies de ce pays avaient un cours conventionnel, dont le gouvernement
était le seul régulateur. Cette circonstance leur parut favorable aux spéculations sur le
change. La monnaie de fer, le széni, leur fournit une première base d’opération.
Le széni est une petite plaque ronde, percée en carré au milieu. Il a cours parmi les'
Chinois à l’égal, de leurs cashes ou tsapèques, qui ont la même forme. Les négociants
étrangers se firent donner par la douane japonaise 4,800 szénis en échange d’un dollar,
tandis qu’ils achetaient le dollar sur le marché de Shanghaï au prix de 800 à 1,000 cashes
ou szénis, indifféremment.
La combinaison n’était pas mauvaise, mais elle avait l’inconvénient d’exiger un fastidieux
maniement d’espèces. On imagina quelque chose de plus commode et même de
plus lucratif.
La principale pièce d’or chez les Japonais est le kobang. Il est de forme ovale et dè
peu d’épaisseur. A l’époque de l’ouverture de Yokohama, il avait cours pour 10 florins de
Hollande, environ 21 fr. 50. ,
On l’achetait, sur lès marchés japonais, pour 4 « bous» d argent. Cette monnaie, que
les Européens appellent itzibou, cë qui veut dire « un bou, » a la forme d un parallélogramme
de 24 millimétrés sur 15. Son épaissèur est de 8 millimètres. Son cours varie
entre 1,400 et 1, 800 de ces pièces de cuivre oblongues et percées au centre, qui portent le
nom de « tempos » On lui donna donc une valeur moyenne de 1,600 tempos. Les traites
statuant que toutes lés monnaies étrangères auront cours au Japon et seront reçues pour