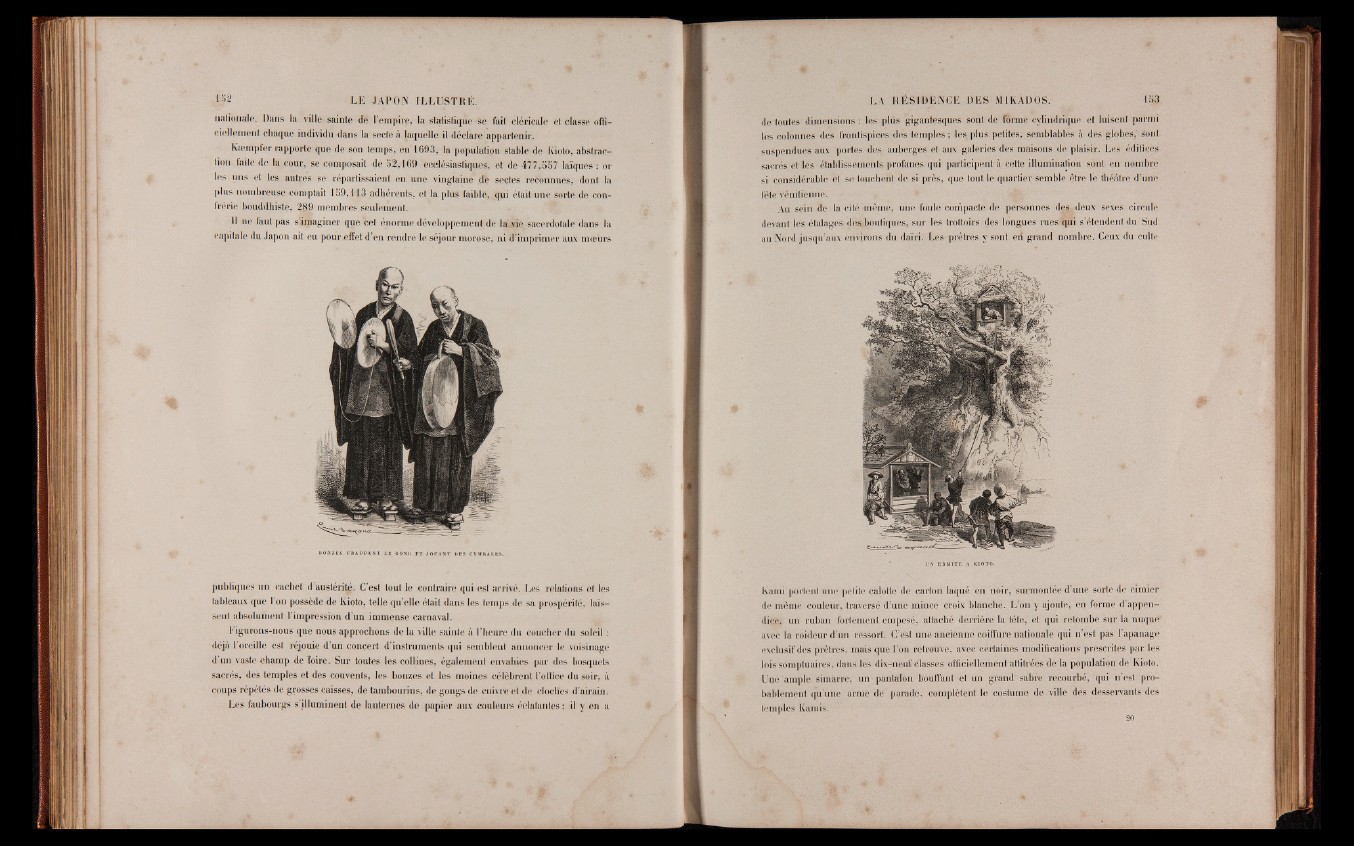
nationale. Dans la ville sainte de l’empire, la statistique se fait cléricale et classe officiellement
chaque individu dans la secte à laquelle il déclare appartenir.
Kæmpfer rapporte que de son temps, en 1693, la population stable de Ivioto, abstraction
faite de la cour, se composait de 52,169 ecclésiastiques, et de 477,557 laïques ; or
les uns et les autres se répartissaient en une vingtaine de sectes reconnues, dont la
plus nombreuse comptait 159,113 adhérents, et la plus faible, qui était une sorte de confrérie
bouddhiste, 289 membres seulement.
11 ne faut pas s’imaginer que cet énorme développement de la vie sacerdotale dans la
capitale du Japon ait eu pour effet d’en rendre le séjour morose, ni d’imprimer aux moeurs
publiques un cachet d’austérité- C’est tout le contraire qui est arrivé. Les relations et les
tableaux que l’on possède de Kioto, telle qu’elle était dans les temps de sa prospérité, laissent
absolument l’impression d’un immense carnaval.
Figurons-nous que nous approchons de la ville sainte à l’heure du coucher du soleil :
déjà l’oreille est réjouie d’un concert d’instruments qui semblent annoncer le voisinage
d'un vaste champ de ïoire. Sur toutes les collines, également envahies par des bosquets
sacrés, des temples et des couvents, les bonzes et les moines célèbrent l’office du soir, à
coups répétés de grosses caisses, de tambourins, de gongs de cuivre et de cloclies d’airain.
Les faubourgs s’illuminent de lanternes de papier aux couleurs éclatantes; il y en a
de toutes dimensions : les plus gigantesques sont de forme cylindrique et luiserït parmi
les colonnes des frontispices des temples ; les plus petites, semblables à des globes,- sont
suspendues aux portes des auberges et aux galeries des maisons de plaisir. Les édifices
sacrés et les établissements profanes qui participent à cette illumination sont en nombre
si considérable et se touchent de si près, que tout le quartier semble être le théâtre d’une
fête vénitienne.
Au sein de la cité même, une foule compacte de personnes des deux sexes circule
devant les étalages des boutiques, sur les trottoirs des longues rues qui s’étendent du Sud
au Nord jusqu’aux environs du daïri. Les prêtres y sont erî grand nombre. Ceux du culte
Kami portent une petite calotte de carton laqué en noir, surmontée d’une sorte de cimier
de même couleur, traversé d’une mince croix blanche. L’on y ajoute, en forme d’appendice,
un ruban fortement empesé, attaché derrière la tête, et qui retombe sur la nuque
avec la roideur d’un ressort. C’est une ancienne coiffure nationale qui n’est pas l’apanage
exclusif des prêtres, mais que l’on retrouve, avec certaines modifications prescrites par les
lois somptuaires, dans les dix-neuf classes officiellement attitrées de la population de Kioto.
Une ample simàrre, un pantalon bouffant et un grand sabre recourbé, qui n’est probablement
qu’une arme de parade, complètent le costume de ville des desservants des
temples Kamis.