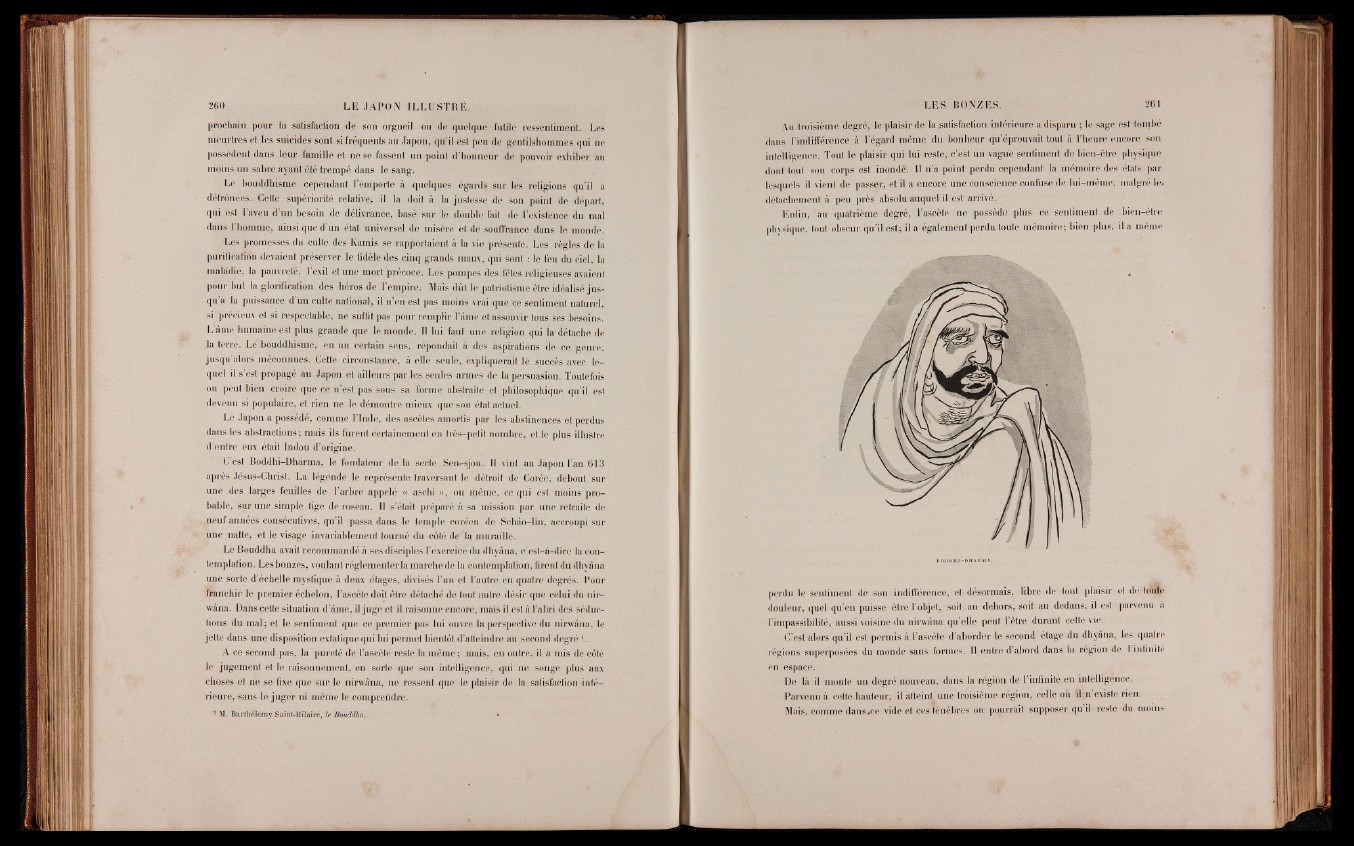
prochain pour la satisfaction de son orgueil ou de quelque futile ressentiment. Les
meurtres et les suicides sont si fréquents au Japon, qu’il est peu de gentilshommes qui ne
possèdent dans leur famille et ne se fassent un point d’honneur de pouvoir exhiber au
moins un sabre ayant été trempé dans le sang.
Le bouddhisme cependant l’emporte à quelques égards sur les religions qu’il a
détrônées. Cette supériorité relative, il la doit à la justesse de son point de départ,
qui est l’aveu d’un besoin de délivrance, basé sur le double fait de l’existence du mal
dans l’homme, ainsi que d’un état universel de misère et de souffrance dans le monde.
Les promesses du culte des Kamis se rapportaient à la vie .présente. Les règles de la
purification devaient préserver le fidèle des cinq grands maux, qui sont : le feu du ciel, la
maladie, la pauvreté, l’exil et une mort précoce. Les pompes des fêtes religieuses avaient
pour but la glorification des héros de l’empire. Mais dût le patriotisme être idéalisé jusqu’à
la puissance d’un culte national, il n’en est pas moins vrai que ce sentiment naturel,
si précieux et si respectable, ne suffit pas pour remplir l’âme et assouvir tous ses besoins.
L'âme humaine est plus grande que le monde. Il lui faut une religion qui la détache de
la terre. Le bouddhisme, en un certain sens, répondait à des aspirations de ce genre,
jusqu’alors méconnues; Cette circonstance, à elle seule, expliquerait le succès avec lequel
il s’est propagé au Japon et ailleurs par les seules armes de la persuasion. Toutefois
on peut bien croire que ce n ’est pas sous sa forme abstraite et philosophique qu’il est
devenu si populaire, et rien ne le démontre mieux que son état actuel.
Le Japon a possédé, comme l’Inde, des ascètes amortis par les abstinences et perdus
dans les abstractions; mais ils furent certainement en très-petit nombre, et le plus illustre
d’entre eux était Indou d’origine.
C’est Boddhi-Dharma, le fondateur de la secte Sen«-sjou. Il vint au Japon l’an 613
après Jésus-Christ. La légende le représente traversant le détroit de Corée, debout sur
une des larges feuilles de l’arbre appelé « aschi », ou même, ce qui est moins probable,
sur une simple tige de roseau. Il s’était préparé à sa mission par une retraite de
neuf années consécutives, qu’il passa dans le temple coréen de Schâo-lin, accroupi sur
une natte, et le visage invariablement tourné du côté de la muraille.
Le Bouddha avait recommandé à ses disciples l’exercice du dhyàna, c’est-à-dire la contemplation.
Les bonzes, voulant réglementer la marche de la contemplation, firent du dhyàna
une sorte d’échelle mystique à deux étages, divisés l’un et l’autre en quatre degrés. Pour
franchir le premier échelon, l’ascète doit être détaché de tout autre désir que celui du nir-
wâna. Dans.cette situation d’âme, il juge et il raisonne encore, mais il est à l’abri des séductions
du mal; et le sentiment que ce premier pas lui ouvre la perspective du nirwàna, le
jette dans une disposition extatique qui lui permet bientôt d’atteindre au second degré *.
A ce second pas, la pureté de l’ascète reste la même ; mais, en outre, il a mis de côté
le jugement et le raisonnement, en sorte que son intelligence, qui ne songe plus aux
choses et ne se fixe que sur le nirwâna, ne ressent que le plaisir de la satisfaction intérieure,
sans le juger ni même le comprendre.
1 M. Barthélemy Saint-Hilairè, léBouddha. •
Au troisième degré, le plaisir de la satisfaction intérieure a disparu ; le sage est tombé
dans l’indifférence à l’égard même du bonheur qu’éprouvait tout à l’heure encore son
intelligence. Tout le plaisir qui lui reste, c’est un vague sentiment de bien-être physique
dont tout son corps est inondé". Il n’a point perdu cependant la mémoire des états par
lesquels il vient de passer, et il a encore une conscience confuse de lui-même, malgré le.
détachement à peu près absolu auquel il est arrivé.
Enfin, au quatrième degré, l’ascète ne possède plus ce sentiment de bien-être
physique, tout obscur qu’il est; il a également perdu toute mémoire; bien plus, il a même
perdu le sentiment de son indifférence, et désormais, libre de tout plaisir et de toute
douleur, quel qu’en puisse être l’objet, soit au dehors, soit au dedans, il est parvenu à
l’impassibilité, aussi voisine du nirwàna qu elle peut l’être durant cette vie.
C’est alors qu’il est permis à l’ascète d’aborder le second étage du dhyàna, les quatre
régions superposées du monde sans formes. 11 entre d’abord dans la région de I infinité
en espace.
De là il monte un degré nouveau, dans la région de l’infinité en intelligence.
Parvenu à cette hauteur, il atteint une troisième région, celle où il n’existe rien.
Mais, comme dans «ce vide et ces ténèbres on pourrait supposer qu il reste du moins