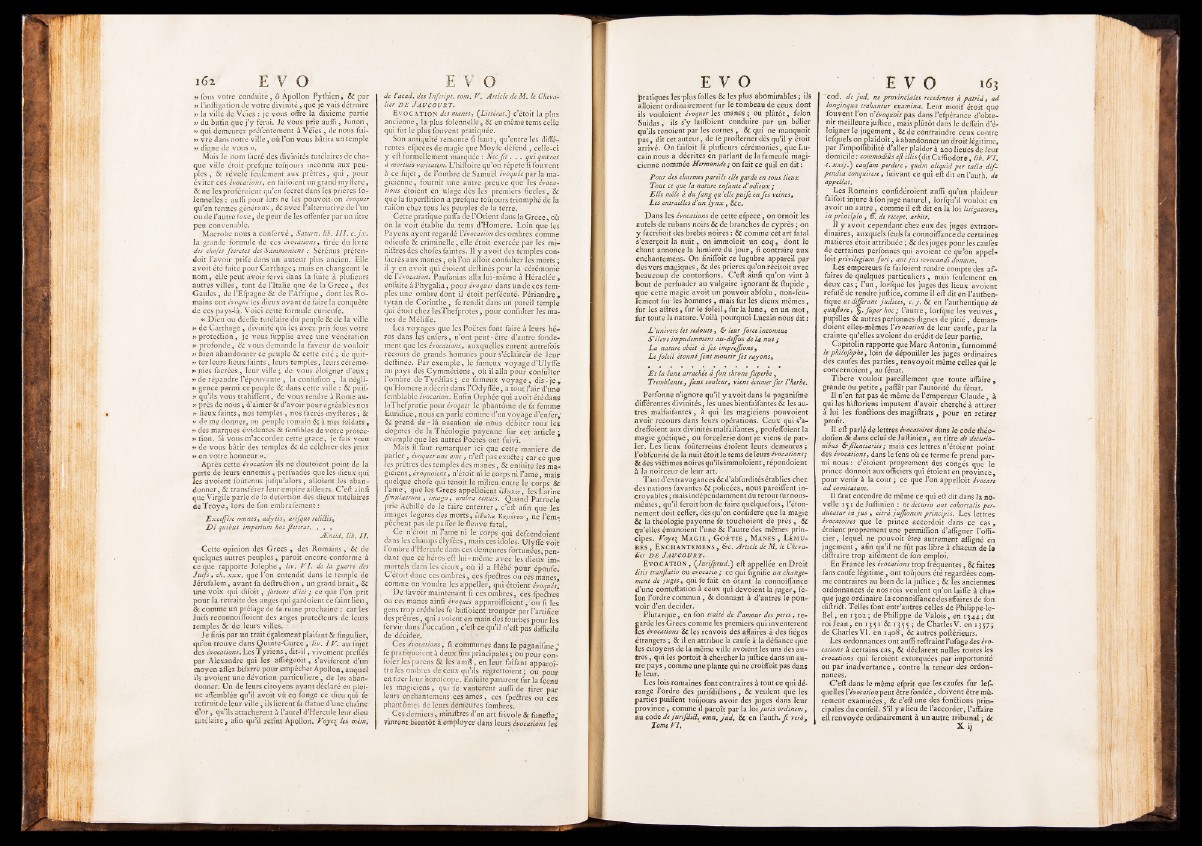
i 6 i e y o » fous votre conduite, ô Apollon Pythien, & par
» l’inftigation de votre divinité, que je vais détruire
» la ville de Véïes : je vous offre la dixième partie
» du butin que j’y ferai. Je vous prie auffi, Junon,
» qui demeurez préfentement à V éïe s , de nous fui-
» vre dans notre v ille, où l’on vous bâtira un temple
» digne de vous ».
Mais le nom facré des divinités tutélaires de chaque
ville étoit prefque toujours inconnu aux peu-
pies , & révélé feulement aux prêtres, qui , pour
éviter ces évocations, en faifoient un grand my ftere,
& ne les proféroient qu’en fecret dans les prières fo-
lennelles : auffi pour lors ne les pouvoit-on évoquer
qu’en'termes généraux, & avec l’alternative de l’un
ou de l’autre fèxe, de peur de les offenfer par un titre
peu convenable^
Macrobe nous a Cortfervé, Saturn. tib. I II. c .jx .
la grande formule de ces évocations, tirée du livre
des chofes Jecretes des Sammoniens : Sérénus préten-
doit l’avoir prife dans un auteur plus ancien. Elle
avoit été faite pour Carthage ; mais en changeant le
nom, elle peut avoir fervi dans la fuite à plufieurs
autres villes, tant de l’Italie que de la Grece , des
Gaules, de l’Efpagne & de l’Afrique, dont les Romains
ont évoqué les dieux avant de faire la conquête
de ces pays-là. Voici cette formule curieufe.
« Dieu ou déefle tutélaire du peuple & de la ville
» de Carthage, divinité qui les avez pris fous votre
» protection, je vous fupplie avec une vénération
» profonde, & vous demande la faveur de vouloir
» bien abandonner ce peuple & cette cité ; de quit-
» ter leurs lieux faints, leurs temples, leurs cérémo-
» nies facrées, leur ville ; de vous éloigner d’eux ;
» de répandre l’épouvante , la confufion , la négli-
» gence parmi ce peuple & dans cette ville : & puif-
» qu’ils vous trahiffent, de vous rendre à Rome au-
» près de nous ; d’aimer & d’avoir pour agréables nos
» lieux faints, nos temples , nos facrés myfteres ; &
» de me donner, au peuple romain & à mes foldats,
» des marques évidentes & fenfibles de votre protec-
» tion. Si vous m’accordez cette grâce, je fais voeu
» de vous bâtir des temples & de célébrer des jeux
» en votre honneur ».
Après cette évocation ils ne doutoient point de là
perte de leurs ennemis, perfuadés que les dieux qui
les a voient foûtenus jufqu’alors, alloient les abandonner,
& transférer leur empire ailleurs. C ’eft ainfi
que Virgile parle de la delertion des dieux tutélaires
d eT ro y e , lors de fon embrafement :
Exceffêre omnes, adytis, arifque relictisi
D î quibus imperium hoc fieterat. . . .
Ærîèid. lib. ÏI.
Cette opinion des Grecs , des Romains, & de
quelques autres peuples , paroît encore conforme à
ce que rapporte Jofephe, liv. F I . de la guerre des
Juifs y ch. xxx. que l ’on entendit dans le temple de
Jérufalem, avant fa deftruétion , un grand b ruit, &c
une voix qui difoit, forions d'ici ; ce que l’on prit
pour la retraite des anges qui gardoient ce faint lieu,
& comme un préfage de fa ruine prochaine : car les
Juifs recornioiffoient des anges protecteurs de leurs
temples &.de leurs villes.
Je finis par un trait également plaifant & fingulier,
qu’on trouve dans Quirite-Curee , 7iv. I F . au fujet
des évocations. Les Tyriens, d it-il, vivement preffés
par Alexandre qui les affiégeoit, s’aviferent d’un
moyen affez bifarrê pour empêcher Apollon, auquel
ils avoient une dévotion particulière, de les abandonner.
Un de leurs citoyens ayant déclaré en pleine
affemblée qu’il avoit vû eij fonge ce dieu qui fe
retiroitde leur v ille , ils lièrent fa ftatue d’une chaîne
d’o r , qu’ils attachèrent à l’autel d’Hercule leur dieu
tutélaire, afin qu’il retînt Apollon. Foye^ les mémt
E V O de l'acad. des Infcript. tom. V. Article de M. le Chevalier
D E J a U C O V R T .
E v o c a t io n d e s m aries, (’ L i t t é r a t .) c’étoit la plus
ancienne, la plus folennelle, & en même tems celle
qui fut le plus fou Vent pratiquée.
Son antiquité remonte fi haut, qu’entre les différentes
efpeces de magie que Moyfe défend , celle-ci
y eft formellement marquée : N ecfit. . . qui quarat
a mortuis véritatem. L ’hiftoire qu’on répété fi fouvent
à ce fujet, de l’ombre de Samuël évoquée par la magicienne
, fournit une autre preuve que les évocations
étoient en ufage dès les premiers fiecles, &
que la fuperftition a prefque toujours triomphé de la
raifon chez tous les peuples de la terre.
Cette pratique paffa de l’Orient dans la G rece, où
on la voit établie du tems d’Homere. Loin que les
Payens ayent regardé Révocation des ombres Comme
odieufe & criminelle, elle étoit exercée par les mi-
niftres des chofes faintes. Il y avoit des temples con-
facrés aux mânes, où l’on alloit confuiter les morts ;
il y en avoit qui étoient deftinés pour la cérémonie
de Révocation. Paufanias alla lui-même à Héraclée,
enfuite à Phygalia, pour évoquer dans un de ces temples
une ombre dont il étoit perfécuté. Périandre ,
tyran de Corinthe, fe rendit dans un pareil temple
qui étoit chez lesThefprotes, pour confuiter les mânes
de Méliffe.
Les voyages que les Poètes font faire à leurs héros
dans les enfers, n’ont peut - être d’autre fondement
que lès évocations, auxquelles eurent autrefois
recours de grands hommes pour s’éclaircir de leur
deftinée. Par exemple, le fameux voyage d’UIyfle
au pays des Cymmériens , où il alla pouf confuiter
l’ombre deTyréfias ; ce fameux v o y a g e , dis- je y
qu’Homere a décrit dans l’Ôdyffée, a tout l’air d’une
femblable évocation. Enfin Orphée qui avoit été dans
laThefprotie pour évoquer le phantôme de fa femme
Euridice, nous en parle comme d’un voyage d’enfer,'
& prend dé - là occafion de nous débiter toïis les
dogmes de la Théologie payenne fur cet article ;
exemple que les autres Poètes ont fuivi.
Mais il faut remarquer ici que cette maniéré de
parler, évoquer une ame, n’eft pas exaCte ; car ce que
les prêtres des temples des mânes, & enfuite'les mar
gieiens, évoquoient, n’ét.oit ni lé corps ni l’ame, niais
quelque chofe qui tenoit le milieu entre lé corps &
l’ame, que les Grecs appelloient üS'uXov,' lès Latins
Jimulacrum , imago y umbra tenuis. Quand Patrocie
prie Achille de le faire enterrer, c’eft afin que les
images legeres des morts, tré'aixa Ka.y.ôvTov y ne l’empêchent
pas de palier le fleuve fatal.
Ce n’é'toit ni famé ni le corps qui defcendoient
dans les champs é lyfées, mais ces idoles. Ulyfle voit
l’ombre d’Hercule dans ces demeures fortunées, pendant
que ce héros eft lui-même avec les dieux immortels
dans les cieux, où il a Hébé pour épôufe.
C ’étoit donc ces ombres,,ces fpe&res ou césnianes
comme on voudra les appeller, qui étoient évoqués;
De favoir maintenant fi ces ombres, ces fpe&res
ou ces mânes ainfi évoqués apparoifloient ,-oti fi les
gens trop crédules fe laifloient tromper par l’artifice
des prêtres, qui avoient en main des fourbès pour les
feryir dans l’occafion, c’éft ce qu’il n’eft pas difficile
de décider.
Ces' évocations, fi communes dans lé pâganifme ^
fe pratiqvroient à deux fins principales ; bu’pour con-
foler lès parens & les ami§, en leur faifant apparoî-
fre lès Ombres de ceux qu’ils regrettoient • ou pour
en tirer leur horofcope. Enfuite parurent fur la fcenë
les magiciens, qui fe vantèrent auffi de tirer par
leurs cnchantemens ces âmes, ces fpe&res ou ces
phantômes de leurs demeures fombres.
Ces derniers, miniftres d’un art frivole & funefte1
vinrent bientôt à employer dans leurs évocations lei
e y o
pratiques Ies-plus foliés &c les plus abominables ; ils
alloient ordinairement fur le tombeau de ceux dont
ils vouloient évoquer les mânes ; ou plutôt, félon
Suidas, ils s’y laifloient conduire par un bélier
qu’ils tenoient par les cornes , & qui ne manquoit
pas, dit cet auteur, de fe profterner dès qu’il y étoit
arrivé. On faifoit là plufieurs cérémonies, que Lu-
cain nous a décrites en parlant de la fameufe magicienne
nommée Hermonide; on fait ce quil en dit :
Pour des charmes pareils elle garde en tous lieux
Tout ce que la nature enfante d'odieux ;
E lit mêle à du fang qu'ellepuife en fes veines,
Les entrailles d'un lyn x, &c.
Dans les évocations de cette efpece, on ornoit les
autels de rubans noirs & de branches de cyprès ; on
y facrifioit des brebis noires : & comme cet art fatal
s’exerçoit la nu it, on immoloit un co q , dont le
chant annonce la lumière du jour, fi contraire aux
enchantemens. On finifloit ce lugubre appareil par
des vers magiques, & des prières qu’on récitoit avec
beaucoup de contorfions. C ’eft ainfi qu’on vint à
bout de perfuader au vulgaire ignorant & ftupide ,
que cette magie avoit un pouvoir abfolu, non-feulement
fur les hommes, mais fur les dieux mêmes,
fur les aftres, fur le fbleil, fur la lune, en un mot,
fur toute la nature. Voilà pourquoi Lucain nous dit :
L ’univers les redoute, & leur force inconnue
S'élève impudemment au-dejfus de la nue ;
La nature obéit à fes imprejjions y
Le foleil étonné fent mourir fes rayons,
E t la lune arrachée à fon throne fuperbe,
Tremblante , fans couleur, vient écumer fur l'herbe.
Perfonne n’ignore qu’il y avoit dans le paganifme
différentes divinités, les unes bienfaifantes & les autres
malfaifantes, à qui les magiciens pouvoient
avoir recours dans leurs opérations. Ceux qui s’a-
dreffoient aux divinités malfaifantes, profefloient la
magie goétiqué, ou forcelerie dont je viens de parler.
Les lieux foûterreins étoient leurs demeures ;
l ’obfcurité de la nuit étoit le tems de leurs évocations;
& des vi&imes noires qu’ils immoloient, répondoient
à la noirceur de leur art.
Tant d’extravagances & d ’abfurdités établies chez
des nations favantes & policées, nous paroiflent incroyables
; mais indépendamment du retour fur nous-
mêmes, qu’il feroit bon de faire quelquefois, l’étonnement
doit cefler, dès qu’on confidere que la magie
& la théologie payenne fe touchoient de près , &
qu’elles émanoient l’une & l’autre des mêmes principes.
Voye^ Magie , Goétie , Mânes , Lémures
, Enchantemens , &c. Article de M. le Chevalier
D E J A U CO U R T . Evocation, (Jurifprud.) eftappellée en Droit
litis tranjlatio ou évocation ce qui fignifie un change-
ment de juges, qui fe fait en ôtant la connoiflance
d’une conteftation à ceux qui dévoient la juger, félon
l’ordre commun, & donnant à d’autres le pouvoir
d’en décider.
Plutarque, en fon traité de P amour dés per es, regarde
les Grecs comme les premiers qui inventèrent
les évocations & les renvois des affaires à des fiéges
étrangers ; & il en attribue la caufe à la défiance que
les citoyens de la même ville avoient les uns des autres
, qui les portoit à chercher la juftice dans un autre
pays, comme une plante qui ne croiffoit pas dans
le leur.
Les lois romaines font contraires à tout ce qui dérange
l’ordre des jurifdiâions, & veulent que les
parties puiflent toujours avoir des juges dans leur
province, comme il paroît par la loi juris ordinem,
au code de jurifdicl, emn, jud. U en l’auth, f i verà,
J'orne FI»
e y o 163
cod. de jud. ne provinciales recedentes à patriâ, ad
longinqua trahantur examina. Leur motif étoit que
fouvent l’on n'évoquoit pas dans l’efpérance d’obtenir
meilleure juftice, mais plûtôt dans le deffein d’éloigner
le jugement, & de contraindre ceux contre
lefquels on plaidoit, à abandonner un droit légitime,
par l’impoflibilité d’aller plaider à 200 lieues de leur
domicile : commodiits efl illis (jdit Cafliodore, lib. F I .
c. xxij.') caufam perdere , quam aliquid per talia dif-
pendia conquirere, fuivant ce qui eft dit en l’auth. de
appellat.
Les Romains confidéroient auffi qu’un plaideur
faifoit injure à fon jugé naturel, lorfqu’il vouloit en
avoir un autre, comme il eft dit en la loi litigatores,
in principio , ff. de recept. arbitr.
Il y avoit cependant chez eux des juges extraordinaires
, auxquels feuls la connoiflance de certaines
matières étoit attribuée ; & des juges pour les caufes
de certaines perfonnes qui avoient ce qu’on appel-
loit privilegium fort, aut jus revocandi domum.
Les empereurs fe faifoient rendre compte des affaires
de quelques particuliers , mais feulement en
deux cas; l’un, lorfque les juges des lieux avoient
refufé de rendre juftice, comme il eft dit en l ’authentique
ut différant judices, c. j . & en l’authentique de
quoejlorey § . fuperhoc; l’autre, lorfque les veuves,
pupilles & autres perfonnes dignes de p itié, deman-
doient elles-mêmes Révocation de leur caufe, par la
crainte qu’elles avoient du crédit de leur partie.
Capitolin rapporte que Marc Antonin, furnommé
le philofophe, loin de dépouiller les juges ordinaires
des caufes des parties, renvoyoit même celles qui le
concernoient, au fénat.
Tibere vouloit pareillement que toute affaire ,
grande ou petite, paffât par l’autorité du fénat.
Il n’en fut pas de même de l’étnpereur Claude, à
qui les hiftoriens imputent d’avoir cherché à attirer
à lui les fondions des magiftrats , pour en retirer
profit.
II eft parlé de lettres évocatoires dans le code théo-
dofien & dans celui de Juftinien’, au titre de decurio-
nibus &filentiariis ; mais ces lettres n’étoient point
des évocations y dans lefens où ce terme fe prend parmi
nous : c’étoient proprement des congés que le
prince donnoit aux officiers qui étoient en province ,
pour venir à la cour ; ce que l’on appelloit évocare
ad comitatum.
Il faut entendre de même ce qui eft dit dans la no-
velle 151 de Juftinien : ne decurio aut cohortalis per-
ducatur in ju s , citra jujfionem principis. Les lettres
évocatoires que le prince accordoit dans ce cas ,
étoient proprement une permiflion d’affigner l’officier,
lequel ne pouvoit être autrement affigné en
jugement, afin qu’il ne fût pas libre à chacun de h
diftraire trop aifement de fon emploi.
En France les évocations trop fréquentes, & faites
fans caufe légitime, ont toujours été regardées comme
contraires au bien de la juftice ; & les anciennes
ordonnances de nos rois veulent qu’on laifle à chaque
juge ordinaire la connoiflance des affaires de fon
diftrid. Telles font entr’autres celles,de Philippe-le-
Be l, en 1302 ; de Philippe de Valois, en 1344 ; du
roi Jean, en 13 51 & 13 5 5 ; de Charles V. en 13 57;
de Charles VI. en 1408, & autres poftérieurs.
Les ordonnances ont auffi reftraint l’ufage des évocations
à certains cas, & déclarent nulles toutes les
évocations qui feroiént extorquées par importunité
ou par inadvertance, contre la teneur des ordonnances.
C ’eft dans le même efprit que les caufes fur lesquelles
Révocation peut être fondée, doivent être mûrement
examinées, & c’eft une des fondions principales
du confeil. S'il y a lieu de l’accorder, l’affaire
eft renvoyée ordinairement à un autre tribunal ; 6c
X i j