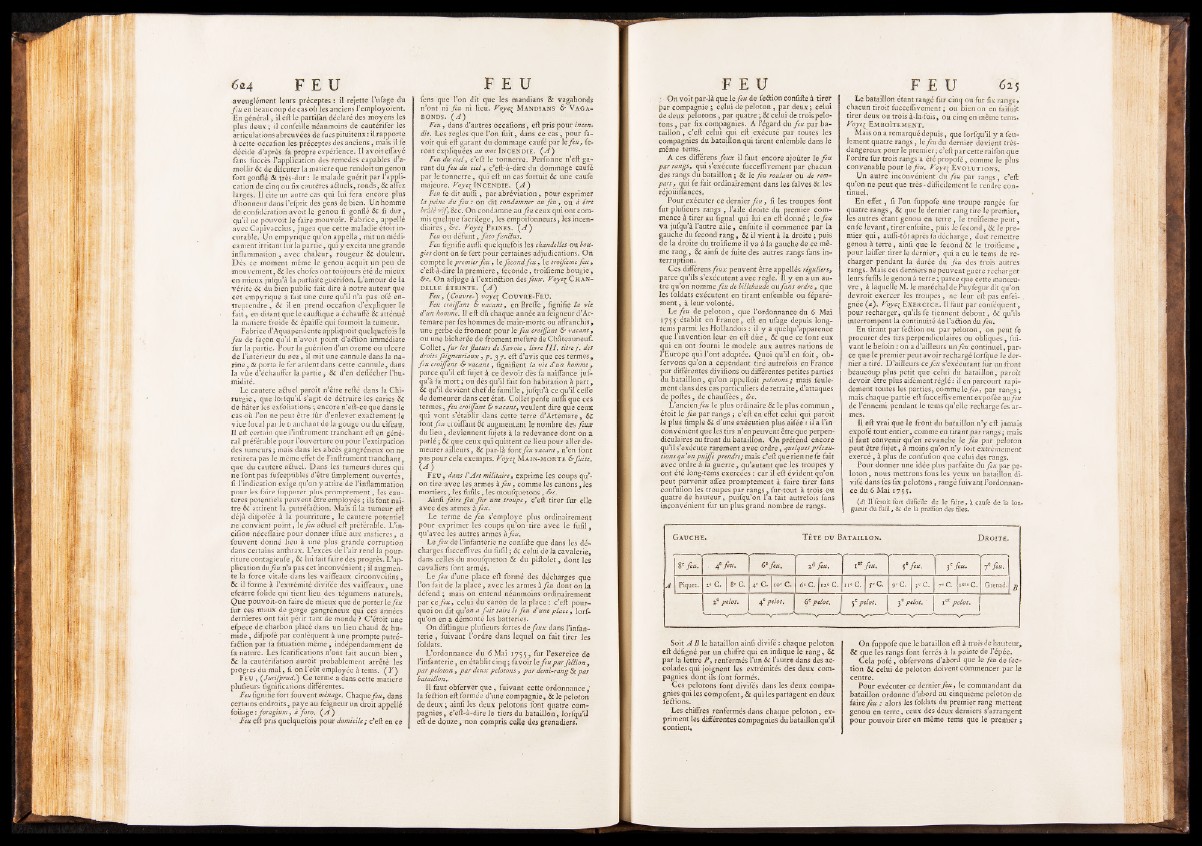
aveuglément leurs préceptes : il rejette l’ufage du
feu en beaucoup de cas où les anciens l’employoient.
En général, il eft le partifan déclaré des moyens les
plus doux ; il conseille néanmoins de cautérifer les
articulations abreuvées de fucs pituiteux : il rapporte
à cette occafion les préceptes des anciens, mais il fe
décide d’après fa propre expérience. Ilavoiteffayé
fans fuccès l’application des remedes capables d’amollir
6c de difcuter la matière que rendoitun genou
fort gonflé & très-dur : le malade guérit par l’application
de cinq ou fix cautères aftuels, ronds, 6c affez
larges. Il cite un autre cas qui lui fera encore plus
d’honneur dans l’efprit des gens de bien. Un homme
de confidération avoit le genou fi gonflé & fi dur,
qu’il ne pouvoit le faire mouvoir. Fabrice, appellé
avec Capivaccius, jugea que cette maladie étoit incurable.
Un empyrique qu’on appella, mit un médicament
irritant fur la partie, qui y excita une grande
inflammation , avec chaleur, rougeur 6c douleur.
Dès ce moment même le genou acquit un peu de
mouvement, 6c les chofes ont toujours été de mieux
en mieux jufqu’à la parfaite guérifon. L’amour de la
vérité 6c du bien public fait dire à notre auteur que
cet empyrique a fait une cure qu’il n’a pas ofé entreprendre
, & il en prend occafion d’expliquer le
fa it, en difant que le cauftique a échauffé & atténué
la matière froide &C épaiffe qui formoit la tumeur.
Fabrice d’Aquapendente appliquoit quelquefois le
feu de façon qu’il n’avoit point d’a&ion immédiate
fur la partie. Pour la guérifon d’un ozeme ou ulcéré
de l ’intérieur du nez, il mit une cannule dans la narine
, & porta Je fer ardent dans cette cannule, dans
la vue d’échauffer la partie, 6c d’en deffécher l’humidité.
Le cautere a&uel paroît n’être refté dans la Chirurgie
, que lorfqu’il s’agit de détruire les caries 6c
de hâter les exfoliations ; encore n’eft-ce que dans le
cas où l’on ne peut être fur d’enlever exactement le
vice local par le tranchant de la gouge ou du cifeau.
Il eft certain que l’inftrument tranchant eft en général
préférable pour l’ouverture ou pour l’extirpation
des tumeurs; mais dans les abcès gangréneux on ne
retirera pas le même effet de l’inftrumenttranchant,
que du cautere aftuel. Dans les tumeurs dures qui
ne font pas fufceptibles d’être fxmplement ouvertes,
fi l’indication exigé qu’on y attire de l’inflammation
pour les faire fuppurer plus promptement, les cautères
potentiels peuvent être employés ; ils font naître
6c attirent la putréfa&ion. Mais fi la tumeur eft
déjà dilpofée à la pourriture, le cautere potentiel
ne convient point, le feu aftuel eft préférable. L’in-
cifion néceffaire pour donner iflîië aux matières, a
fouvent donné lieu à une plus grande corruption
dans certains anthrax. L’excès de l’air rend la pourriture
contagieufe, 6c lui fait faire des progrès. L’application
du feu n’a pas cet inconvénient ; il augmente
la force vitale dans les vaiffeaux circonvoifins,
6c il forme à l’extrémité divifée des vaiffeaux, une
efcarre folide qui tient lieu des tégumens naturels.
Que pouvoit-on faire de mieux que de porter le feu
fur ces maux de gorge gangréneux qui ces années
dernieres ont fait périr tant de monde ? C ’étoit une
efpece de charbon placé dans un lieu chaud 6c humide
, difpofé par conféquent à une prompte putréfaction
par fa fituation même, indépendamment de
fa nature. Les fcarifîcations n’ont fait aucun bien ,
6c la cautérifation auroit probablement arrêté les
progrès du mal, fi on l’eût employée à tems. (J")
Feu , ( Jurifprud'.) Ce terme a dans cette matière
plufieurs fignifications différentes.
Feu lignine fort fouvent minage. Chaquefeu, dans
certains endroits, paye au feigneur un droit appellé
foiiage: foragium, à foro. {A )
Feu eft pris quelquefois pour domicile; c’eft en ce
fens que l’ on dit que les mandians & vagabonds
n’ont ni feu ni lieu. Voye^ Ma n d ia n s 6* V a g a b
o n d s . (A )
Feu, dans d’autres ocçafions, eft pris pour incendie.
Les réglés que l’on fuit, dans ce cas, pour fa-
voir qui eft garant du dommage caufé par le feu, feront
expliquées au mot In c e n d ie . {A )
Feu du ciel, c’eft le tonnerre. Perfonne n’eft garant
du feu du ciel, ç’eft-à-dire du dommage caufé
par le tonnerre, qui eft un cas fortuit 6c une caufe
majeure. Voye^ In c e n d ie . {A )
Feu fe dit aufli, par abréviation, pour exprimer
la peine du feu : on dit condamner au feu, ou à être
brûlé v i f 6cc. On condamne au feu ceux qui ont commis
quelque facrilege, les empoifonneurs, les incendiaires,
&c. Voye{ Pe in e s . (A )
Feu ou défunt, fato funclus.
Feu lignifie aufli quelquefois les chandelles ou bougies
dont on fe fert pour certaines adjudications. On
compte le premier feu , le fécond feu , le troijîeme feu ,
c’eft-à-dire la première, fécondé, troifieme bougie,
&c. On adjuge à l’extinftion des feux. Voye£ C h a n d
e l l e é t e in t e . {A )
Feu, {Couvre-') voye[ C o u v r e -Fe u .
Feu croijfant & vacant, en Breffe , lignifie la vie
d'un homme. Il eft dû chaque année au feigneur d’Ar-
temare par feshommes de main-morte ou affranchis,
une gerbe de froment pour le feu .croijfant & vacant,
ou une bicherée de froment mefure de Châteauneuf.
Colle t, fur les Jlatuts de Savoie, livre I I I . titre j . des
droits feigneuriaux, p . g y. eft d’avis que ces termes
feu croijfant & vacant, lignifient la vie <Tun homme ,
parce qu’il eft fujet à ce devoir dès fa naiffance juf-
qu’à fa mort ; ou dès qu’il fait fon habitation à part,
& qu’il devient chef de famille, jufqu’à ce qu’il ceffe
de demeurer dans cet état. Collet penfe aufli que ces
termes, feu croijfant & vacant, veulent dire que ceux
qui vont s’établir dans cette terre d’Artemare, 6c
font feu croiffant 6c augmentant le nombre des feux
du lieu, deviennent fujets à la redevance dont on a
parlé ; & que ceux qui quittent ce lieu pour aller demeurer
pas pour cela exempts. Voye? Ma in -m o r t e &fuite. ma mm F e u , dans l'Art militaire y exprime les coups qu’on
aifleurs, 6c par-là font feu vacant, n’en font
tire avec les armes à feu, comme les canons, les
mortiers, les funls, les moufquetons, &c.
Ainfi faire feu fur une troupe , c’eft tirer fur elle
avec des armes à feu.
Le terme de feu s’employe plus ordinairement
pour exprimer les coups qu’on-tire avec le fufil,
qu’avec les autres armes a feu.
Le feu de l’infanterie ne confifte que dans les décharges
fucceflives du fufil ; 6c celui de la cavalerie,
dans celles du moufqueton & du piftolet, dont les
cavaliers font armés.
Le feu d’une place eft formé des décharges que
l’on fait de la place, avec les armes à feu dont on la
défend ; mais on entend néanmoins ordinairement
par ce feu, celui du canon de la place : c’eft pourquoi
on dit qu’on a fait taire le feu d ’une place y lorf-
qu’on en a démonté les batteries.
On diftingue plufieurs fortes de feux dans l’infanterie
, fuivant l’ordre dans lequel on fait tirer les
foldats.
L’ordonnance du 6 Mai 1755, fur l’exercice de
l’infanterie, en établit cinq ; favoir le feu par feclion,
par peloton, par deux pelotons , par demi-rang & par
bataillon..
Il faut obferver que, fuivant cette ordonnance
la fefrion eft formée d’une compagnie, & le peloton
de deux ; ainfi les deux pelotons font quatre compagnies
, c’eft-à-dire le tiers du bataillon, lorfqu’il
eft de douze, non compris celle des grenadiers.
; On voit pardà que le feu de feâion confifte à tirer
par compagnie ; celui de peloton , par deux ; celui
de deux pelotons, par quatre ; & celui de trois pelotons
, par fix compagnies. A l’égard du feu par bataillon
, c’eft celui qui eft exécuté par toutes les
compagnies du bataillon qui tirent enfemble dans le
même tems.
A ces différens feux il faut encore ajoûter le fiu
par rangs y qui s’exécute fucceflîvement par chacun
des rangs du bataillon ; & le feu roulant ou de rem~
part , qui fe fait ordinairement dans les falves & les
réjoiiiffances.
Pour exécuter ce dernier feu , fi les troupes font
lur plufieurs rangs , l’aile droite du premier commence
à tirer au lignai qui lui en eft donné ; le feu
va jufqu’à l’autre ajle, enfuite il commence par la
gauche du fécond rang, & il vient à la droite ; puis
de la droite du troifieme il va à la gauche de ce même
rang, & ainfi de fuite des autres rangs fans interruption.
Ces différens feux peuvent être appellés réguliers,
parce qu’ils s’exécutent avec réglé. II y en a un autre
qu’on nomme feu de billebaude ou fans ordre, que
les foldats exécutent en tirant enfemble ou féparé-
ment, à leur volonté.
Le feu de peloton, que l’ordonnance du 6 Mai
1755-établit en France, eft en ufage depuis long-
tems parmi les Hollandois : il y a quelqu’apparence
que l’invention leur en eft dûe, 6c que ce font eux
qui en ont fourni le modèle aux autres nations de
l’Europe qui l’ont adoptée. Quoi qu’il en foit, ob-
fervons qu’on a cependant tiré autrefois en France
par différentes divifions ou différentes petites parties
du bataillon, qu’on appelloit pelotons; mais feulement
dans des cas particuliers de retraite, d’attaques
de poftes , de chauffées, &c.
L’ancien feu le plus ordinaire 6c le plus commun ,
étoit le feu par rangs ; c’eft en effet celui qui paroît
le plus fimple & d’une exécution plus aifée : il a l’inconvénient
que les tirs n’en peuvent être que perpendiculaires
au front du bataillon. On prétend encore
qu’il s’exécute rarement avec ordre, quelques précautions
qu'on puiffe prendre; mais c’eft que rien ne fe fait
avec ordre à la guerre, qu’autant que les troupes y
ont été long-tems exercées : car il eft évident qu’on
peut parvenir affez promptement à faire tirer fans
confùfion les troupes par rangs, fur-tout à trois ou
quatre de hauteur, puifqu’on l’a fait autrefois fans
inconvénient fur un plus grand nombre de rangs.
Le bataillon étant rangé fur cinq ou fur fix rangs >
chacun tiroit fucceflîvement ; ou bien on en faifoit
tirer deux ou trois à-la-fois, ou cinq en même tems.
Voye£ E m b o î t e m e n t .
Mais on a remarqué depuis, que lorfqu’il y a feulement
quatre rangs, le feu du dernier devient très-
dangereux pour le premier; c’eft par cette raifon que
l’ordre fur trois rangs a été propofé, comme le plus
convenable pour le feu. Voye{ Évolu tions.
Un autre inconvénient du feu par rangs c’eft:
qu’on ne peut que très-difficilement le rendre continuel.
En effet, fi l’on fuppofe une troupe rangée fur
quatre rangs, 6c que le dernier rang tire le premier,
les autres étant genou en terre, le troifieme peut,
enfe levant, tirer enfuite, puis le fécond, & le premier
qui, auflî-tôt après fa décharge, doit remettre
genou à terre, ainfi que le fécond 6c le troifieme,
pour laiffer tirer le dernier, qui a eu le tems de recharger
pendant la durée du feu -des trois autres
rangs. Mais ces derniers ne peuvent guere recharger
leurs fufils le genou à terre ; parce que cette manoeuvre
, à laquelle M. le maréchal de Puyfegur dit qu’on
devroit exercer les troupes, ne leur eft pas enfei-.
gnée (a). Voyei E x e r c i c e . II faut par conféquent,
pour recharger, qu’ils fe tiennent debout, 6c qu’ils
interrompent la continuité de l’aâion du feu.
En tirant par fe&ion ou par peloton, on peut fe
procurer des tirs perpendiculaires ou obliques, fuivant
le befoin : on a d’ailleurs un feu continuel, parce
que le premier peut a voir rechargé lorfque le dernier
a tiré. D ’ailleurs ce feu s’exécutant fur un front
beaucoup plus petit que celui du bataillon, paroît
devoir être plus aifément réglé : il en parcourt rapidement
toutes les parties, comme le feu, par rangs ;
mais chaque partie eft fucceflîvement expofée au feu
de l’énnemi pendant le tems qu’elle recharge fes armes.
Il eft vrai que le front du bataillon n’y eft jamais
expofé tout entier, comme en tirant par rangs; mais
il faut convenir qu’en revanche le feu par peloton
peut être fujet, à moins qu’on n’y foit extrêmement
exercé, à plus de confùfion que celui des rangs.
Pour donner une idée plus parfaite du feu par peloton,
nous mettrons fous les yeux un bataillon di-
vifé dans fes fix pelotons, rangé fuivant l’ordonnance
du 6 Mai 1755.
(d) Il feroit fort difficile de le faire , à caufe de la longueur
du fufil, & de la preffion des files.
G a u c h e . T ê t e d u B a t a i l l o n . D r o i t e .
\
8e feu. 4’ fiu. 6 'fiu. 2* fiu.
Y" ----
Ia fiu. 5 ° fiu- Ÿ fiu. f f i u . I
Piquet. 2* C. j 8e C. 4e C. j 10e C.
P
O
|» 'C . | j - c . 9e C* 5e C- 7 C. 1«« c . Grenad.J
Ie pelot. 4e pelot. j
-------v-------A
6e pelot. [ 5 'pelot. 3 e pelot. ' j er pelot.
Soit A B le bataillon ainfi divifé : chaque peloton
eft défigné par un chiffre qui en indique le rang, 6c
par la lettre P , renfermés l’un 6c l’autre dans des accolades
qui joignent les extrémités des deux compagnies
dont ils font formés.
Ces pelotons font divifés dans les deux compagnies
qui les compofent, & qui les partagent en deux
leôions. .
Les chiffres renfermés dans chaque peloton, expriment
les différentes compagnies du bataillon qu’il
contient*
On fuppofe que le bataillon eft à trois de hauteur,
& que les rangs font ferrés à la pointe de l’épée.
Cela pofé, obfervons d’abora que le feu de fec-
tion & celui de peloton doivent commencer par le
centre.
Pour exécuter ce dernier feu , le commandant du
bataillon ordonne d’abord au cinquième peloton de
faire feu : alors les foldats du premier rang mettent
genou en terre, ceux des deux derniers s’arrangent
pour pouvoir tirer en même tems que le premier ;