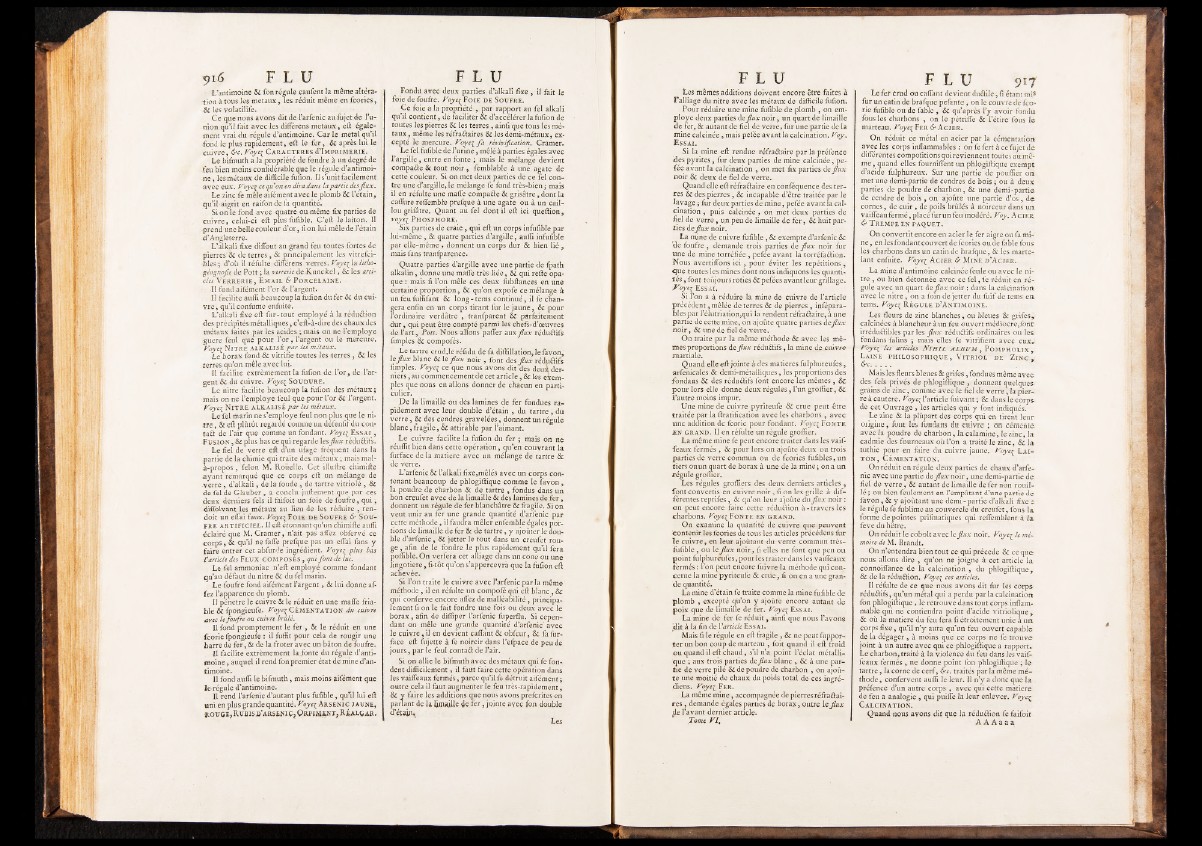
• L’antimoine Sc fon régule caufent la même altération
à tous les métaux, les réduit même en fcories,
Sc les volatilife.
Ce que nous avons dit de l’arfenic aufujet de l’u-
nion qu’il fait avec-les différens métaux, eft également
vrai du régule d’antimoine. Car le métal qu’il
-fond le plus rapidement, eft le fer, & après lui le
cuivre, &C. Voyt{ C A R A C T E R E S d’ iM PR IMERIE .
Le bifmuth a la propriété de fendre à un degré de
feu bien moins confidérable que le régule d’antimoi-
-ne, les métaux de difficile fufion. Il s’unit facilement,
avec eux. Voye%_ ce qu'on en dira dans la partie desfiux.
Le zinc fe mêle aifément avec le plomb Sc l’étain,
qu’il aigrit en raifon de fa quantité.
Si on le fond avec quatre ou même fix parties de
cuivre, celui-ci eft plus fufible. C ’eft le laiton. Il
-prend une belle couleur d’o r, lion.lui mêle de l’étain
^ ’Angleterre.
L’alkali fixe difïout au grand feu toutes fortes de
pierres' Sc de terres , & principalement les vitrefci-
Lles ; d’où il réfulte différens verres. Vqye[ la litho-
géognojie de Pott ; la verrerie de JCunckel, Sc les articles
V e r r e r i e , E m a i l & P o r c e l a i n e .
• Il fond aifément l’or & l’argent.
Il facilite auffi beaucoup la fufion du fer Sc du cuivre
, qu’ilconfume enfuite.
L’alkali fixe eft fur-tout employé à la rédu&ion
des précipités métalliques, c’eft-à-dire des chaux des
métaux faites .par les acides ; mais on ne l’employe
guere feul que pour l’o r , l’argent ou le mercure.
yoyei NlTRE ALKALïSÉ par les métaux.
Le borax fond & vitrifie toutes les terres, Sc les
terres qu’on mêle avec lui.
Il facilite extrêmement la fulion de l’o r , de l’arg
e n t & du cuivre. Voye[ S o u d u r e .
Le nitre facilite beaucoup la fulion des métaux ;
mais on ne l’employe feul que pour l’or Sc l’argent.
Voye^ NlTRE ALKALïSÉ par les métaux.
Le fel marin ne s’employe feul non plus que le nitre
, & eft plutôt regardé comme un défenlit du conta#
de l’air que comme un fondant. Voye^ E s s a i ,
F u s i o n , Sc plus bas ce qui regarde les fiux rédu&ifs.
Le fiel de verre eft d’un ufage fréquent dans la
partie de la chimie qui traite des métaux ; mais malà
propos , félon M. Rouelle. Cet illuftre chimifte
ayant remarqué que ce corps eft un mélange de
verre , d’alkali, de la foude , de tartre vitriolé , Sc
de fel de Glauber , a conclu juftement que par ces
deux derniers fels il faifoit un foie de foufre, q u i,
diffolvant les métaux au lieu de les réduire , ren-
doit un effai faux. Voye^ F o i e d e S o u f r e & S o u f
r e a r t i f i c i e l . II eft étonnant qu’un chimifte auffi
éclairé que M. Cramer, n’ait pas affez obfervé ce
corps, & qu’il ne faffe prefque pas un effai fans y
faire entrer cet abfurde ingrédient. Voye^ plus bas
Varticle des F l u x COMPOSÉS , qui font de lui.
Le fel ammoniac n’eft employé comme fondant
qu’au défaut du nitre Sc du fel marin.
Le foufre fond aifément l’argent, & lui donne affez
l’apparence du plomb.
Il pénétré le cuivre & le réduit en une maffe friable
& fpongieufe. Voye{ C é m e n t a t i o n du cuivre
avec le foufre ou cuivre brûlé.
Il fond promptement le fer , & le réduit en une
fcorie fpongieufe : il fuffit pour cela de rougir une
barre de fer, & de la froter avec un bâton de foufre.
Il facilite extrêmement lajonte du régule d’antimoine
, auquel il rend fon premier état de mine d’antimoine.
11 fond auffi le bifmuth, mais moins aifément que
lerégule d’antimoine.
11 rend l’arfenic d’autant plus fufible, qu’il lui eft
uni en plus grande quantité, Voye^ A r s e n i c j a u n e ,
r o u g e , R u b i s d ’a r s e n i c , O r p im e n t , R é a l g a r .
Fondit avec deux parties d’alkali fixe , il fait le
foie de foufre. Voye^ Fo ie de Soufre.
Ce foie a la propriété , par rapport au fel alkali
qu’il contient, de faciliter Sc d’accélérer la fufion de
toutes les pierres Sc les terres , ainfi que tous les métaux,
même les réfraûaires & les demi-métaux, excepté
le mercure. Voye£ fa révivification. Cramer.
Le fel fufible de l’urine, mêlé à parties égales avec
l’argille, entre en fonte ; mais le mélange devient
compare & tout n oir, femblable à une agate de
cette couleur. Si on met deux parties de ce fel contre
une d’argille, le mélange fe fond très-bien ; mais
il en réfulte une maffe compare & grisâtre, dont la
caffure reffemble prefque à une agate ou à un caillou
grifâtre. Quant au fel dont il eft ici queftion,
voyei Phosphore.
Six parties de craie, qui eft un corps infufible par
lui-même , & quatre parties d’argille, auffi infufible
par elle-même , donnent un corps dur & bien lié ,
mais fans tranfparence.
Quatre parties d’argille avec une partie de fpath
alkalin, donne une maffe très liée, Sc qui refte opaque
: mais fi l’on mêle ces deux fubftances en une
certaine proportion, Sc qu’on expofe ce mélange à
un feu fuffifant Sc long - tems continué, il fe changera
enfin en un corps tirant fur le jaune, Sc pour
l’ordinaire verdâtre , tranfparent & parfaitement
dur, qui peut être compté parmi les chefs-d’oeuvres
de l’art, Pott. Nous allons palier aux fiux réduûifs
fimples & compofés.
Le tartre cruel,le réfidu de fa diftillation, le favon,
le fiux blanc Sc le fiux noir , font des fiux réduâifs
fimples. Voye^ ce que nous avons dit des deux der-
niérs, au commencement de cet article, Sc les exemples
que nous en allons donner de chacun en particulier.
De la limaille ou dés lamines de fer fondues rapidement
avec leur double d’étain , du tartre, du
verre, & des cendres gravelées, donnent un régule
blanc, fragile, Sc attirable par l’aimant.
Le cuivre facilite la fufion du fer ; mais on ne
réuffit bien dans cette opération, qu’en couvrant la
furface de la matière avec un mélange de tartre &
de verre.
L’arfenic Sc l’alkali fixe,mêlés avec un corps contenant
beaucoup de phlogiftique comme le favon,
la poudre de charbon & de tartre , fondus dans un
bon creufet avec de la limaille & des lamines de fe r ,
donnent un régule de fer blanchâtre Sc fragile. Si on
veut unir au fer une grande quantité d’arfenic par
cette méthode, il faudra mêler enfemble égales portions
de limaille de fer & de tartre, y ajouter le double
d’arfenic, & jetter le tout dans un creufet rouge
, afin de le fondre le plus rapidement qu’il fera
poffible. On verfera cet alliage dans un cône ou une
lingotiere, fi-tôt qu’on s’appercevrk que la fufion eft
achevée.
Si l’on traite le cuivre avec l’arfenic par la même'
méthode, il en réfulte un compofé qui eft blanc, Sc
qui conferve encore affez de malléabilité, principalement
fi on le fait fondre une fois ou deux avec le
borax, afin de diffiper l’arfenic fuperflu. Si cependant
on mêle une grande quantité d’arfenic’ avec
le cuivre, il en devient caffant & obfcur, Sc fa fur-
face eft fujette à fe noircir dans l’efpace de peu de
jours, par le feul.conta# de l’air.
Si on allie le bifmuth avec des métaux qui fe fondent
difficilement, il faut faire cette opération dans
les vaiffeaux fermés, parce qu’il fe détruit aifément ;
outre cela il faut augmenter le feu très-rapidement,
Sc y faire les additions que nous avons preferites en
parlant de la limaille 4e 1er, jointe avec fon double
d’étain»,
Les
Les mêmes additions doivent encore être faites à
l ’alliage du nitre avec les métaux de difficile fufion.
Pour réduire une mine fufible de plomb , on employé
deux parties de fiux noir, un quart de limaille
de fer, & autant de fiel de verre, fur une partie de la
mine calcinée , mais pefée avant la calcination. Voy.
E ssai.
Si la mine eft rendue réfra#aire par la préfence
ides pyrites, fur deux parties de mine calcinée, pefée
avant la calcination , on met fix parties de fiux
noir Sc deux de fiel de verre.
Quand elle eft réfra#aire en conféquence des terres
& des pierres , Sc incapable d’être traitée par le
lavage ; fur deux parties de mine, pefée avant la calcination
, puis calcinée, on met deux parties de
fiel de verre, un peu de limaille de fer, Sc huit parties
defiux noir.
La mine de cuivre fufible, Sc exempte d’arfenic Sc
de foufre , demande trois parties de fiux noir fur
une de mine torréfiée , pefée avant la torréfa#ion.
Nous avertiffons i c i , pour éviter les répétitions,
que toutes les mines dont nous indiquons les quantités
, font toujours rôties Sc pefées avant leur grillage.
yoyt^ Essai.
Si l’on a à réduire la mine de cuivre de l’article
precedent, mêlée de terres Sc de pierres , infépara-
bles par l’élutriation,qui la rendent réfra#aire, à une
partie de cette mine, on ajoute quatre parties de fiux
n oir, Sc une de fiel de verre.
On traite par la même méthode & avec les mêmes
proportions de fiux rédu#ifs, la mine de cuivre
martiale.
Quand elle eft jointe à des matières fulphureufes,
arfenicales & demi-métalliques, les proportions des
fondans & des rédu#ifs font encore les mêmes , Sc
pour lors elle donne deux régules, l’un groffier, Sc
l ’autre moins impur.
Une mine de cuivre pyriteufe Sc crue peut être
traitée par la ftratification avec les charbons , avec
une addition de fcorie pour fondant. Voye^ Fonte
jen grand. Il en réfulte un régule groffier.
La même mine fe peut encore traiter dans les vaiffeaux
fermés , & pour lors on ajoûte deux ou trois
parties de verre commun ou de fcories fufibles, un
tiers ou un quart de borax à une de la mine; on a un
régule groffier.
Les régules groffiers des deux derniers articles ,
font convertis en cuivre noir, fi on les grille à différentes
reprifes, & qu’on leur ajoûte du fiux noir :
on peut encore faire cette réduâion à-travers les
charbons. Voye^ Fonte en grand.
On examine la quantité de cuivre que peuvent
contenir les fcories de tous les articles précédons fur
le cuivre, en leur ajoutant du verre commun très-
fufible, ou le fiu x noir, fi elles ne font que peu ou
point fulphureufes, pour les traiter dans les vaiffeaux
fermés : l’on peut encore fuivre la méthode qui concerne
la mine pyriteufe & cnie, fi on en a une grande
quantité.
La mine d’étain fe traite comme la mine fufible de
plomb , excepté qii’on y ajoute encore autant de
poix que de limaille de fer. Voye{ Essai.
La mine de fer fe réduit, ainfi que nous l’avons
jdit à la fin de l 'article Essai.
Mais fi le régule en eft fragile, & ne peut fuppor-
ter un bon coup de marteau , foit quand il eft froid
ou quand il eft chaud, s’il n’a point l’éclat métallique
; aux trois parties de fiux blanc , Sc à une partie
de verre pilé Sc de poudre de charbon , on ajoûte
une moitié de chaux du poids total de ces ingré-
diens. Voye^ FER.
La même mine, accompagnée de pierres réfra#ai-
r e s , demande égales parties de borax, outre le fiux
de l’avant dernier article.
fomc V lt
Le fer cruel ou caffant devient du#ile, fi étant mi8
fur un catin de brafque pefante, on le couvre de fcorie
fufible ou de fable , & qu’après l’y avoir fondu
fous les charbons , on le pétrifie & l’étire fous le
marteau. Voye^ F e r & A c i e r .
On réduit ce métal en acier par la cémentation
avec les corps inflammables : on fe fort à ce fujet dé
différentes compofitions qui reviennent toutes au même
, quand elles fourniffent un phlogiftique exempt
d’acide fulphureux. Sur une partie de pouffier on
met une demi-partie de cendres de bois ; ou à deux
parties de poudre de charbon, Sc une demi-partie
de cendre de bois , on ajoûte une partie d’o s , de
cornes, de cu ir, de poils brûlés à noirceur dans un.
vaiffeau fermé, placé fur un feu modéré. Voy, A c i e r .
& T r e m p e e n p a q u e t .
On convertit encore en acier le fer aigre ou fa mine
, en les fondant couvert de fcories ou de fable fous
les charbons dans un catin de brafque, & les martelant
enfuite. Voye1 A c i e r & M in e d ’A c i e r .
La mine d’antimoine calcinée feule ou avec le nitre
, ou bien détonnée avec ce f e l, fe réduit en régule
avec un quart de fiu xnoir : dans la calcination
avec le nitre, on a foin de jetter du fuif de tems en
tems. Voye^ R é g u l e d ’A n t im o i n e .
Les fleurs de zinc blanches, ou bleues & grifesy
calcinées à blancheur à un feu ouvert médiocre,font
irrédu#ibles par les fiux réductifs ordinaires ou les
fondans falins ; mais elles fe vitrifient avec euxJ
Voyel les articles N i h i l a l b u m , P o m p h o l i x ,
L a in e p h i l o s o p h i q u e , V i t r i o l d e Z i n c ,
&c. . . . .
Mais les fleurs bleues & grifes, fondues même avec
des fels privés de phlogiftique , donnent quelques’
grains de zinc, comme avec le fiel dé verre, la pierre
à cautere. Voye[ l’article fuivant ; Sc dans le corps-
de cet Ouvrage, les articles qui y font indiqués.
Le zinc & la plûpart des corps qui en tirent leur
origine, font les fondans du cuivre ; on cémente
avec la poudre de charbon, la calamine, le zinc, la
cadmie des fourneaux où l’on a traité le zinc, Sc la
tuthie pour en faire du cuivre jaune. Voye^ L a i t
o n , C ÉM EN T A T IO N .
On réduit en régule deux parties de chaux d’arfenic
avec une partie de fiux noir, une demi-partie de
fiel de verre, Sc autant de limaille de fer non rouillé
; ou bien feulement en l’empâtant d’une partie de
favon, & y ajoûtant une demi-partie d’alkali fixe t
le régule fe fublime au couvercle du creufet, fous la
forme de pointes prifmatiques qui reffemblent à la
feve du hetre.
On réduit le cobolt avec le fiux noir. Voye? le mémoire
de M. Brandt.
On n’entendra bien tout ce qui précédé Sc ce que
nous allons dire , qu’on ne joigne à cet article la
connoiffance de la calcination , du phlogiftique,
Sc de la réduftion. Vcyc{ ces articles.
Il réfulte de ce que nous avons dit fur les corps
réduftifs, qu’un métal qui a perdu par la calcination
fon phlogiftique, le retrouve dans tout corps inflammable
qui ne contiendra point d’acide vitriolique ,
& où la matière du feu fera fi étroitement unie à un
corps fixe, qu’il n’y aura qu’un feu ouvert capable
de la dégager , à moins que ce corps ne fe trouve
joint à un autre avec qui ce phlogiftique a rapport.
Le charbon, traité à la violence du feu dans les vaiffeaux
fermés , ne donne point fon phlogiftique ; le
tartre, la corne de cerf, &c. traités par la même méthode,
confervent auffi le leur. Il n’y a donc que la .
préfence d’un autre corps , avec qui cette matière
de feu a analogie , qui puiffe la leur enlever. Voye^
C a l c i n a t i o n .
Quand nous avons dit que la réduftion fe faifoit
A A A a a a