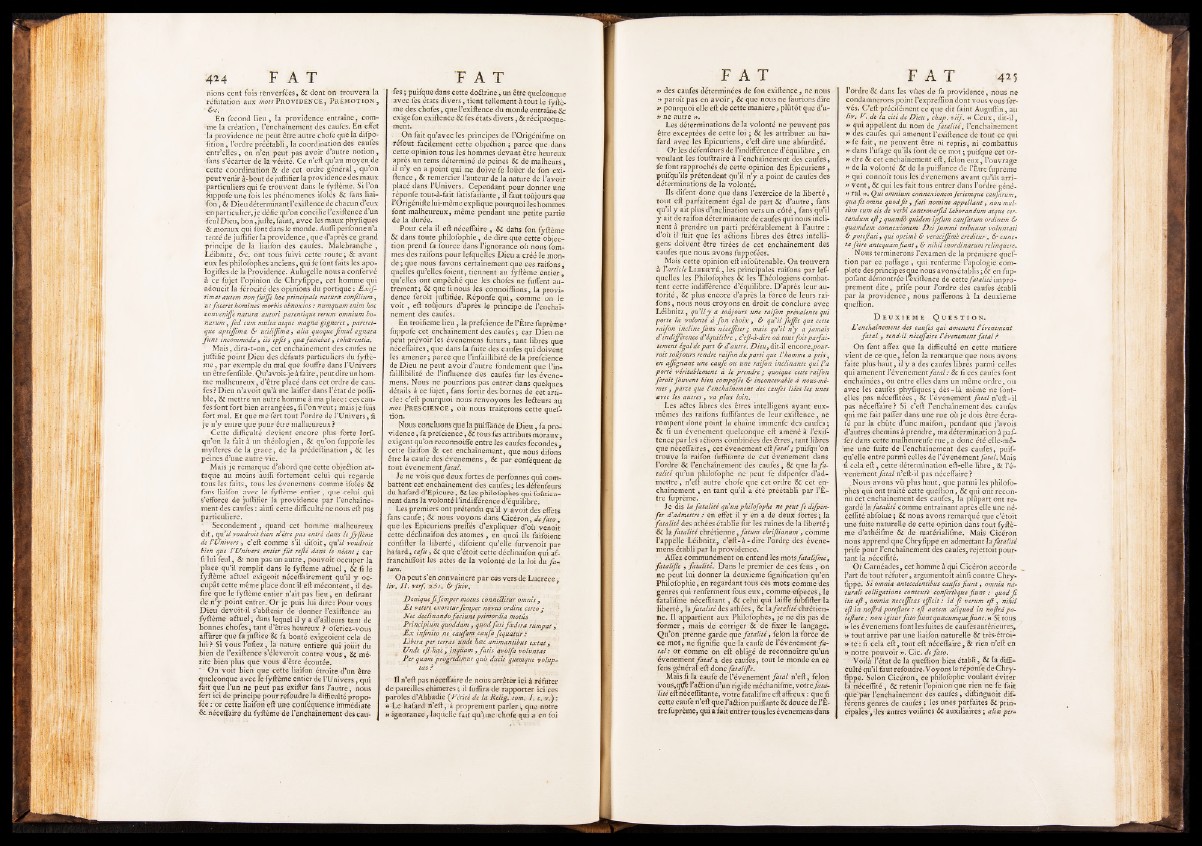
nions cent fo is ren ve rfée s , & dont on trouvera la
réfutation aux mots Pr o v id e n c e , Pr é m o t io n ,
Égg H ; ■ ■
En fécond lifeu, la providence entraîne, combine
la création, l’enchaînement des caufes. En effet
la providence ne peut être autre chofe que la difpo-
ïition, l’ordre préétabli, la coordination des caufes
entr’elles, on n’en peut pas avoir d’autre notion ,
fans s’écarter de la vérité. Ce n’eft qu’au moyen de
cette coordination & de cet ordre général, qu’on
peut venir à-bout de juftifier la providence des maux
particuliers qui fe trouvent dans le fyftème. Si l’on
fuppofe une fois les phénomènes ifolés & fans liai—
fon , & Dieu déterminant l’exiftence de chacun d’eux
en particulier, je défie qu’on concilie l’exiftence d’un
fcul Dieu, bon, jufie, faint, avec les maux phyfiques
-& moraux qui font dans le monde. Aufîi perfonne n’a
tenté de juftifier la providence, que d’après ce grand
principe de la liaifon des caufes. Malebranche ,
Léibmtz, &c. ont tous fuivi cette route; & avant
eux les philofophes anciens, qui fe font faits les apo-
îogiftes de la Providence. Aulugelle nous a confervé
à ce fujet l’opinion de Chryfippe, cet homme qui
adoucit la férocité des opinions du portique : E x p rimât
autcm non fuiffe hoc principale natures confilium ,
ut factret homines morbis obnoxios : numquam enim hoc
eonvenifi'e naturel autori parentique rerurn omnium bo-
narum, fed cum multa atque magna gignertt, pareret-
qite aptijfima & utiliffima, alla quoque Jîmul agnata
funt incommoda , iis ipfis , qua facièbat, cohoerentia.
Mais, dira-t-on, cet enchaînement des caufes ne
juftifie point D ieu des défauts particuliers du fyftème
, par exemple du mal que fouffre dans l ’Univers
un êtrefenfible. Qu’a vois-je à faire, peut dire un homme
malheureux, d’être placé dans cet ordre de caufes
? Dieu n’avoit qu’à me laiffer dans l’état de poffi-
ble, & mettre un autre homme à ma place: ces caufes
font fort bien arrangées, fi l’on veut ; mais je fuis
fort mal. Et que me fért tout l’ordre de l’Univers, fi
je n’y entre que pour être malheureux?
Cette difficulté devient encore plus-forte lorfi-
qu’on la fait à un théologien, & qu’on fuppofe les
myfteres de la grâce, de la prédeftination, & les
peines d’une autre vie.
Mais je remarque d’abord que cette objeôion attaque
au moins aufîi fortement celui qui regarde
tous les faits, tous les évenemens comme ifolés &
fans liaifon avec lë fyftème entier, que celui qui
s’efforce de juftifier la providence par l’enchaînement
des caufes : ainfi cette difficulté ne nous eft pas
particulière.
Secondement, quand cet homme malheureux
dit, qu 'il voudroit bien ri être pas entré dans le fyfilme
de ÜUnivers , c’eft comme s’il difoit, qu’/7 voudroit
bien que l'Univers entier fût refié dans le néant ; car
fi lui feul, & non pas un autre, pouvoit occuper la
place qu’il remplit dans le fyftème aétuel, & fi lé
fyftème aftuel exigeoit néceffairement qu’il y occupât
cette même place dontfl éft mécontent, il de-
fire que le fyftème entier n’ait pas lieu, en délirant
de n’y point entrer. Or je puis lui dire : Pour vous
Dieu de voit-il s’abfteriir de donner l’exiftence au
fyftème aûuel; dans lequel il y a d’ailleurs tant de
bonnes chofes, tant d’êtres heureux ? oferiez-vous
âfïïirer que fa juftice & fa bonté exigeoient cela de
lui ? Si vous l’ofiez, la nature entière qui jouit du
bien dé l’exiftence s’éléveroit contre vous, & mérite
bien plus que vous d’être écoutée.
' On voit bien que cëtte liaifon étroite d’un être
quelconque avec le fyftème entier de l’Univers, qui
fait que î’un ne peut pas exifter fans l’autre, nous
fért ici de principe pour refoudre la difficulté propo-
féé : or cette liaifon eft une coriféquence immédiate
& néceffaire du fyftème de l’enchaînement des eaufes
; puifcpie dans cette doôrine, un être quelconque
avec fes états divers, tient tellement à tout le fyftème
des chofes, que l’exiftence du monde entraîne Sc
exige fon exiftence àc fes états divers, & réciproquement.
On fait qu’avec les principes de l’Origénifme on
réfout facilement cette objection ; parce que dans
cette opinion tous les hommes devant être heureux
après un tems déterminé de peines & de malheurs,
i l n’y en a point qui ne doive fe louer de fon exiftence
, & remercier l’auteur de la nature de l’avoir
place dans l’Univèrs. Cependant pour donner une
réponfe tout-à-fait fatisfaifante, il faut toujours que
TOrigénifte lui-même explique pourquoi les hommes
font malheureux, même pendant une petite partie
de la durée.
Pour cela il eft néceffaire , & daîis fon fyftème
& dans toute philofophie, de dire que cette objection
prend fa fource dans l’ignorance où nous fom-
mes des raifons pour lefquelles Dieu a créé le monde
; que nous favons certainement que ces raifons ,
quelles qu’elles foient, tiennent au fyftème entier,
qu’elles ont empêché que les chofes ne fuffent autrement
; & que fi nous les connoiflions, la providence
feroit jnftifiée. Réponfe qui, comme on le
voit , eft toûjours d’après le principe.de l’enchaînement
des caufes.
En troifieme lieu , la prefcience de l’Être fuprème-
fuppofe cet enchaînement des caufes ; car Dieu ne
peut prévoir les évenemens futurs, tant libres que
néceffaires, que dans la fuite des caufes qui doivent
les amener ; parce que l’infaillibité de la prefcience
de Dieu ne peut avoir d’autre fondement que l’infaillibilité
de l’influence des caufes fur les évenemens.
Nous ne pourrions pas entrer dans quelques
détails à ce fujet, fans fortir des bornes de cet article
: c’eft pourquoi nous renvoyons les le&eurs au
mot- Pr e s c ie n c e , où nous traiterons cette quef-
tion.
Nous concluons que la puiffance de D ie u , fa pro-‘
vidence, fa prefcience, & tous fes attributs moraux,
exigent qu’on reconnoiffe entre les caufes fécondés ,
cette liaifon & cet enchaînement, que nous difons
être la caufe des évenemens, & par conféquent de
tout événement fatal.
Je ne vois que deux fortes de perfonnes qui combattent
cet enchaînement des caufes; les défenfeurs
du hafard d’Epicure, & les philofophes qui foûtien-
nent dans la volonté Findifference d’équilibre.
Les premiers ont prétendu qu’il y avoit des effets
fans caufe; & nous voyons dans Cicéron, defato,
que les Epicuriens preffés d’expliquer d’où venoit
cette déclinaifon des atomes , en quoi ils faifoient
confifter la liberté, difoient qu’elle fur venoit par
hafard , cafu, & que c’étoit cette déclinaifon qui af-
franchiffoit les adles de la volonté de la loi du fa tum.
On peut s’en convaincre par ces vers de Lucrèce,
Hv. II. verf. zó t. 6* fuiv.
Deniquéfi femper motus connêctitur omnis ,
E t vetere exoriturfemper noyusdrdine certo ;
Nec declinando faciunt primqrdia motûs
Prinçipium quoddam , quodfati f ceder a rumpqt,
E x infinitq jie caufam,caufq fequaiür :
Libéra perterfas ûnde hæc animantibus ex tnt,
. Unde eflthxc y inqiiam , fatis qyblfqvoluntas
, Per quant 'progfédimur quà ducit quemque volup-
tas ?
l î n’eft pas néceffaire de nous arrêter ici à réfuter
dé pareilles chimères ; il fuffira de rapporter ici. ces
paroles d’Abbadie ( Vérité de la Relig^tom. I . c. v.) :
« Le hafard ri’eft, à proprement parler i, que notre
» ignorance, laquelle fait qu’une -chofe qui a en foi
■ » des caufes déterminées de fon exiftence, ne nous
» paroît pas en a v o ir , & que nous ne faurions dire
» pourquoi elle eft de cette maniéré, plutôt que d’u-
» ne autre ».
Les déterminations de la volonté ne peuvent pas
être exceptées de cette loi ; & les attribuer au hafard
avec les Epicuriens, c’eft dire une abfurdité.
Or les défenfeurs de l’indifférence d’équilibre, en
voulant les fouftraire à l ’enchaînement des caufes,
fe font rapprochés de cette opinion des Epicuriens ,
puifqu’ils prétendent qu’il n’y a point de caufes des
déterminations de la volonté.
Ils difent donc que dans l’exercice de la liberté,
tout eft parfaitement égal de part & d’autre, fans
qu’il y ait plus d’inclination vers un cô té , fans qu’il
y ait de raifon déterminante de caufes qui nous inclinent
à prendre un parti préférablement à l’autre :
d’où il fuit que les aûions libres des êtres intelli-
gens doivent être tirées de cet enchaînement des
■ caufes que nous avons fuppofées.
Mais cette opinion eft infoûtenable. On trouvera
à l’a r t ic le L i b e r t é , les principales raifons par lefquelles
les Philofophes & les Théologiens combattent
cette indifférence d’équilibre. D ’après leur autorité
, & plus encore d’après la force de leurs raifons
, nous nous croyons en droit de conclure avec
Léibnitz, q u ' i l y a t o û jo u r s u n e r a i fo n p r é v a le n te q u i
p o r te l a v o lo n t é à f o n c h o i x , & q u ' i l f u j f i t q u e ce tte
r a i fo n in c l in e f a n s n é c e jf it e r ; m a i s q u ' i l n 'y a ja m a i s
d 'in d i f f é r e n c e d 'é q u i l ib r e , c 'e f i-à -d ir e o u t o u t f a i t p a r f a i t
em e n t é g a l d e p a r t & d a u t r e . D i e u , dit-il encore,p o u r r
a i t t o û jo u r s r en d r e r a i fo n d u p a r t i q u e l 'h om m e a p r i s ,
e n a j j ig n a n t u n e c a u fe o u u n e r a ifo n in c l in a n t e q u i l 'a
p o r t é v é r ita b lem e n t à l e p r e n d r e ; q u o iq u e ce tte r a i fo n
f e r o i t J o u v e n t b ie n c om p o fé e & in c o n c e v a b le à n o u s -m ê m
e s , p a r t e q u e l'e n c h a în em e n t d e s ca u fe s l ié e s le s u n e s
■ avec le s a u t r e s , v a p l u s lo in .
Les aftes libres des êtres intelligens ayant eux-
mêmes des raifons fuffifantes de leur êxiftehee, ne
rompent donc point la chaîne immenfe des caufes ;
& fi un événement quelconque eft arhené à l’exif-
tence par les aâions combinées des êtres, tant libres
que neceffaires, cet événement eft f a t a l ; puifqu’on
trouve la raifon fuffifante de cet événement dans
l’ordre & l’enchaînement dés caufes, & que la f a t
a l i t é qu’un philofophe ne peut fe difpenfer d’admettre
, n’eft autre chofe que cet ordre & cet enchaînement
, en tant qu’il a été préétabli par l’Être
fuprème.
Je dis l a f a t a l i t é q t é u n p h i lo fo p h e n e p e u t f e difp'en-
f e r d 'a dm e t tr e : en effet il y en a de deux fortes ; la
f a t a l i t é des athées établie fur les ruines de la liberté ;
•& la f a t a l i t é chrétienne, f a t u m c h r i j l ia n u m , comme
l’appelle Léibnitz, c’eft-à-dire l’ordrp des évenemens
établi par la providence.
Affez communément on entend les mots f a t a l i fm e ,
fa td l ï f l 'e y f a t a l i t é . Dans le premier de .ces fens , on
ne peut lui donner la deuxieme lignification qu’en
Philofophie, en regardant tous ces mots comme des
genres qui renferment fous eux, comme^efpeces, le
fatalifme néceffitant, & celui qui laiffe fubfifter la
liberté, [ a f a t a l i t é des athées, & la f a t a l i t é chrétienne.
Il appartient aux Philofophes, je ne dis pas de
former, mais dé corriger & de fixer le langage.
Qu’on prenne garde que f a t a l i t é , félon la force de
ce mot, né figmfie que la caufe de l’évenement fat
a l : or comme on eft obligé de reconnoître qu’un
événement f a t a l a des caufes, tout le monde en ce
fens général eft donc f a t a l i f ie .
Mais fi la caufe de l’évenement f a t a l n’eft, félon
vous,q\fe l’aÊtion d’un rigide méchanifme, votré f a t a l
i t é eft néceflitante, votre fatalifme eft affreux : que fi
cette caufe n’eft que l’àéfionpuiffante & douce de l’Être
fuprème, qui a fait entrer tousles évenemens dans
l’ordre & dans les Vues de fa providence, nous ne
condamnerons point l’expreflion dont vous vous fer-
ves. C ’eft précifément ce que dit faint Auguftin, au
liv. V. de la cité de Dieu , chap. viij. « Ceux, dit-il,
» qui appellent du nom de fatalité y l’enchaînement
» des caufes qui amènent l’exiftence de tout ce qui
» fe fait, ne peuvent être ni repris, ni combattus
» dans l’ufage qu’ils font de ce mot ; puifque Cet or-
» dre & cet enchaînement eft, félon eux, l’ouvrage
» de la volonté & de la puiffance de l’Être fuprème
» qui connoît tous les évenemens avant qu’ils arri-
» vent, & qui les fait tous entrer dans l’ordre géné-
>>' ral ». Qui omnium conneicionem feriemque caufarum,
quafitomne quod f i t , fati nomine appellant, non mul-
tum cum eis de verbi controverfid laborandum atque cer-
tandum ejl; quandb quidem ipfum caufarum ordinem &
quamdam connexionem Dei fummi tribuunt voluntati
& potefiati y qui optitrih & veracijjimï creditur , & cunc-
ta faire antequamfiant, & rtihil inordinàtum relinquere.
Nous terminerons l’examen de la première quef-
tion par ce paffage , qui renferme l’apologie complété
desprincipes que nous avons établis ;& en fup-
pofant démontrée l’exiftence de cette fatalité improprement
dite, prife pour l’ordre des caufes établi
par la providence, nous pafferons à la deuxieme
queftion.
D e u x i e m e Q u e s t i o n .
JJ enchaînement des caufes qui amènent C événement
fatal y rend-il nécejfaire C événement fatal?
On fent affez que la difficulté en cette matière
vient de ce que, félon la remarque que nous avons
faite plus haut, il y a des caufes libres parmi celles
qui amènent l’évenement fatal: & fi ces caufes font
enchaînées, ou entre elles dans un même ordre, ou
avec les caufes phyfiques; dès-là même ne font-
elles pas néceffitées, & Févenement^fatal n’e ft-il
pas néceffaire ? Si c’eft l’enchaînement des- caufes
qui me fait paffer dans une rue où je dois être écra-
lé par la chute d’une maifon, pendant que j ’avois
d’autres chemins à prendre, ma détermination à pa ffer
dans cette malheureufe rue, a donc été elle-mê-
me une fuite de l’enchaînement des caufes, puifi-
qu’elle entre parmi celles de l’évenement fatal. Mais
fi cela e ft , cette détermination eft-elle libre, & l’é-
venëment fatal n’eft-il pas néceffaire ?
.Nous avons vu plus haut, que parmi les philofophes
qui ont traité cette queftion, & qui ont reconnu
cet enchaînement des caufes, la plûpart ont regardé
la fatalité comme entraînant après elle une né-
ceffité abfolue ; & nous avons remarqué que c ’étoit
une füite naturelle de cette opinion dans tout fyftème
d’athéifme & de roatériâlifme. Mais Cicéron
nous apprend que Chryfippe en admettant la fatalité
prife pour l’enchaînement des caufes, rejettoit pourtant
la néceffité.
Or Carnéades, cet homme à qui Cicéron accorde
l’art de tout réfuter, argumentent ainfi contre Chryfippe.
Si omnia antecedentibus caufis fiunt, omnia na-
turali colligatione contextï confier tique fiunt : quod f i
ita éfi , Omnia neceffitas ejficit : id f i verum efi , nihil
'efi in noffrâ poteflate : efi autem aliqUod in nofirâ po-
tefiate : non igitur fato fiunt quoecumque fiunt. « Si tous
» les évenemens font les fuites de caufes antérieures,
» tout arrive par une liaifon naturelle & très-étroi-
» te : fi cela eft, tout eft néceffaire, & rien n ’eft en
» notre pouvoir ». Cic. de fato.
Voilà l’état de la queftion bien établi, & la.diffi-
culté qu’ il faut refoudre. Voyons la réponfe de Chry-
fippè. Sëlon Cicéron, ce philofophe voulant éviter
la néceffité, & retenir l’opinion que rien né fe fait
que'par l’enchaînement des caufes, diftiriguoit dif-
rérens genres de caufes ; les unes parfaites & principales,
les autres voifines & auxiliaires ; ali a per