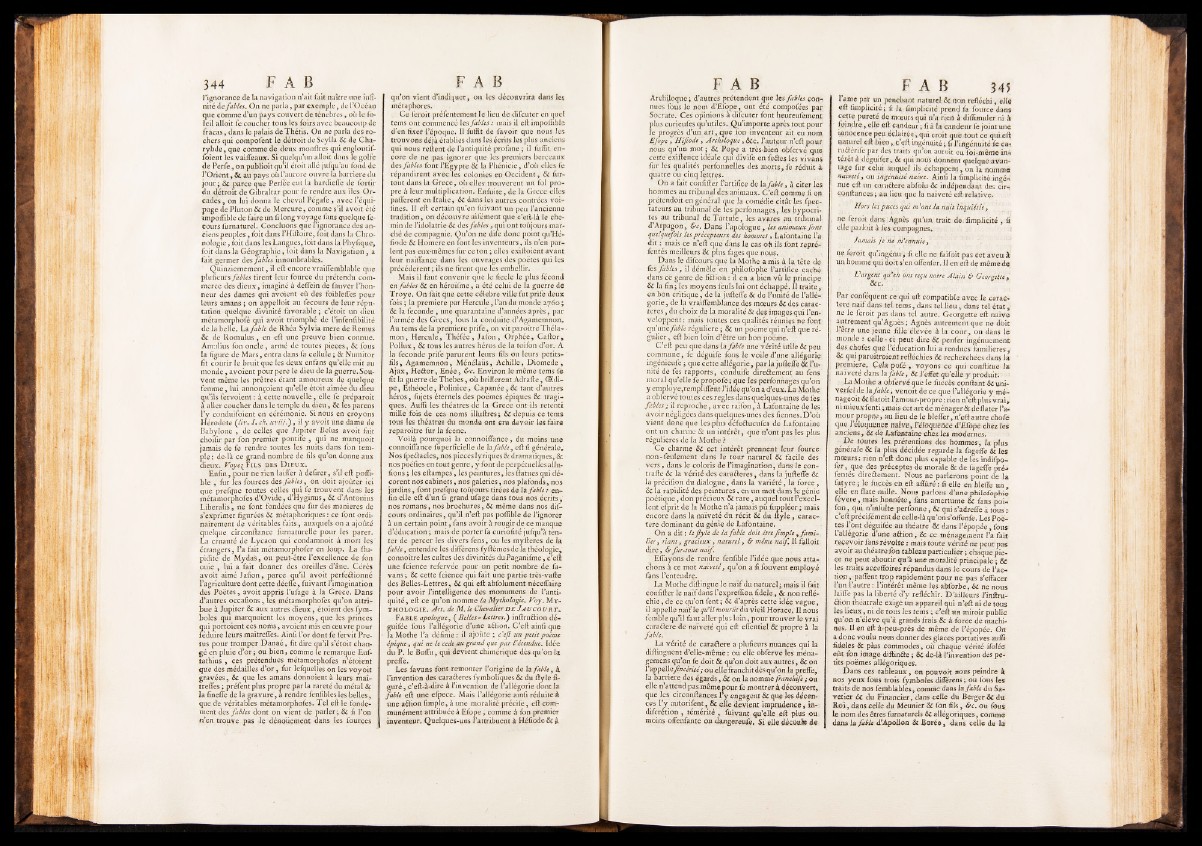
l’ignorance de la navigation n’ait fait naître une infinité
de fables. On ne parla, par exemple, de l’Océan
que comme d’un pays couvert de ténèbres, où le fo-
leil alloit fe coucher tous les foirs avec beaucoup de
fracas, dans le palais deThétis. On ne parla des rochers
qui compofent le détroit de Scylla 6c de Cha-
rybde, que comme de deux monltres qui engloutif-
foient les vaiffeaux. Si quelqu’un alloit dans le golfe
de Perfe, on publioit qu'il étoit allé jufqu’au fond de
l’Orient, & au pays ou l’aurore ouvre la barrière du
jour; 6c parce que Perfée eut la hardieffe de fortir
du détroit de Gibraltar pour fe rendre aux îles Or-
cades, on lui donna le cheval Pégafe, avec l’équipage
de Pluton 6c de Mercure, comme s’il avoit été
impofîîble de faire un fi long voyage fans quelque fe-
cours liirnaturcl. Cpncluons que l’ignorance des anciens
peuples, foit dans l’Hiftoire, l'oit dans la Chronologie
, foit dans les Langues, foit dans la Phylique,
foit dans la G éographie, foit dans la Navigation, a
fait germer des fables innombrables.
Quinzièmement, il eft encore vraiflemblable que
plufieurs fables tirent leur fource du prétendu commerce
des dieux, imaginé à defl'ein de fauver l’honneur
des dames qui avoient eû des foiblelfes pour
leurs amans ; on appelloit au fecours de leur réputation
quelque divinité favorable ; c’étoit un dieu
métamorphofé qui avoit triomphé de l’infenfibilité
de la belle. La fable de Rhéa Sylvia mere de Remus
6c de Romulus, en eft une preuve bien connue.
Amulius fon oncle, armé de toutes pièces, 6c fous
la figure de Mars, entra dans fa cellule ; & Numitor
fit courir le bruit que les deux enfans qu’elle mit au
inonde, avoient pour pere le dieu de la guerre. Souvent
même les prêtres étant amoureux de quelque
femme, lui annonçoient qu’elle étoit aimée au dieu
qu’ils fervoient : à cette nouvelle, elle fe préparoit
à aller coucher dans le temple du dieu, 6c les parens
l’y conduifoient en cérémonie. Si nous en croyons
Hérodote (liv. I. ch. xviijl) , il y avoit une dame de
Babylone , de celles que Jupiter Belus avoit fait
choifir par fon premier pontife , qui ne manquoit
jamais de fe rendre toutes les nuits dans fon temple
: de-là ce grand nombre de fils qu’on donne aux
dieux. V o y e ^ F il s des D ie u x .
Enfin, pour ne rien laiffer à defirer, s’il eft poflî-
ble , fur les fources des fables, on doit ajouter ici
que prefqüe toutes celles qui fe trouvent dans les
métamorphofes d’Ovide, d’Hyginus, 6c d’Antonius
Liberalis, ne font fondées que fur des maniérés de
s’exprimer figurées 6c métaphoriques : ce font ordinairement
de véritables faits, auxquels on a ajouté
quelque circonftance furnaturelle pour les parer.
La cruauté de Lycaon qui condamnoit à mort les-
étrangers, l’a fait métamorphofer en loup. La ftu-
pidite de Mydas, ou peut-être l’excellence de fon
ouie , lui a fait donner des oreilles d’âne. Cérès
avoit aimé Jafion, parce qu’il avoit perfectionné
l’agriculture dont cette déefle, fuivant l’imagination
des Poètes, avoit appris l’ufage à la Grece. Dans
d’autres occafions, les métamorphofes qu’on attribue
à Jupiter 6c aux autres dieux, étoient des fym-
boles qui marquoient les moyens, que les princes
qui portoient ces noms, avoient mis en oeuvre pour
léduire leurs maîtrefles. Ainfi l’or dont fe fervit Pre-
tus pour tromper Danaé, fit dire qu’il s’étoit changé
en pluie d’o r ; ou bien, comme le remarque Euf-
tathius , ces prétendues métamorphofes n’étoient
que dés médailles d’o r , fur lefquelles on les voyoit
gravées, 6c que les amans donnoient à leurs maî- i
treffes ; préfent plus propre par la rareté du métal & ;
la finefte de la gravure, a rendre fenfibles les belles, j
que de véritables métamorphofes. Tel eft le fonde- :
ment des fables dont on vient de parler ; 6c fi l’on I
n’en trouve pas le dénouement dans les fources \
qu’on vient d’indiquer, on les découvrira dans les
métaphores.
. Ce feroit préfentement lç lieu de difeuter en quel
teins ont commencé les f a b l e s : mais il eft impofïïble
d’en fixer l’époque. Il fuffit de lavoir que nous les
trouvons déjà établies dans les écrits les plus anciens
qui nous relient de l’antiquité profane ; il fuffit. encore
de ne pas ignorer que les premiers berceaux
d e s f a b l e s font l ’Egypte 6 c la Phénicie, d’où elles fe
répandirent avec les colonies en Occident, 6 c fur-
tout dans la Grece, où elles trouvèrent un fol propre
à leur multiplication. Enfuite, de la Grece elles
palTerent en Italie, 6 c dans les autres contrées voi-
fines. Il eft certain qu’en fuivant un peu l’ancienne
tradition, on découvre aifément que c’eft-là le chemin
de l’idolâtrie 6 c des f a b l e s , qui ont toujours marché
de compagnie. Qu’on ne dife donc point qu’Hé-
fiode 6 c Homere en font les inventeurs, ils n’en parlent
pas eux-mêmes fur ce ton ; elles exiftoient avant
leur naiflance dans les ouvrages des poètes qui les
précédèrent ; ils ne firent que les embellir.
Mais il faut convenir que le fiecle le plus fécond
en f a b l e s 6 c en héroilme, a été celui de la guerre de
Troye. On fait que cette célébré ville fut prife deux
fois ; la première par Hercule, l’an du monde x j6 o ;
6c la fécondé, une quarantaine d’années .après, par
l’armée des Grecs, fous la conduite d’Agamemnon.
Au tems de la première p rife, on vit paroître Théla- -
mon, Hercule, Théfée, Jalon, Orphée, Caftor,
Pollux, & tous les autres héros de la toifon d’or. A
la fécondé prife parurent leurs fils ou leurs petits- -
fils, Agamemnon, Ménélaiis, Achille, Diomede ,
Ajax, Heélor, Enée, & c . Environ le même tems fe
fit la guerre de Thebes, où brillèrent Adrafte, OEdipe,
Ethéocle, Polinice, Capanée, 6c tant d’autres
héros, fujets éternels des poèmes épiques 6 c tragiques.
Aufli les théâtres de la Grece ont-ils retenti
mille fois de ces noms illuftres ; 6c depuis ce tems
tous les théâtres du monde ont cru devoir les faire
reparoître fur la feene.
Voilà pourquoi la connoiffance, du moins une
connoiffance fuperficielle de la f a b l e , eft fi générale.’
Nos fpe&acles, nos pièces lyriques & dramatiques, &
nos poéfies en tout genre, y font de perpétuellesallu-
fions ; les eftampes, les peintures, les ftatues qui décorent
nos cabinets, nos galeries, nos plafonds, nos
jardins, font prefque toujours tirées de la f a b l e : enfin
elle eft d’un fi grand ufage dans tous nos écrits -,
nos romans, nos brochures, 6c même dans nos discours
ordinaires, qu’il n’eft pas poffible de l’ignorer
à un certain point, fans avoir à rougir de ce manque
d’éducation ; mais de porter fa curiofité jufqu’à tenter
de percer les divers fens, ou les myfteres de la
f a b l e , entendre les différens fyftèmes de la théologie,
connoître les cultes des divinités duPaganifme, c’eft
une feience refervée pour un petit nombre de fa-
vans ; & cette fcience qui fait une partie très-vafte
des Belles-Lettres, 6c qui eft abfolument néceffaire
pour avoir l’intelligence des monumens de l’antiquité,
eft ce qu’on homme l a M y t h o lo g i e . V o y . MYTHOLOGIE.
A r t . d e M . le C h e v a l ie r d e J a v c o v r t .
Fa b l e a p o lo g u e , { B e l l e s - L e t t r e s .) inftruélion dé-
guifée fous l’allégorie d’une aélion. C ’eft: ainfi que
la Mothe l’a définie: il ajoute ; c e j l u n p e t i t p o èm e
é p iq u e , q u i n e le c e d e a u g r a n d q u e p a r L’ é ten d u e . Idée
du P. le Boflii, qui devient chimérique dès qu’on la
prefle.
Les fa vans font remonter l’origine de la f a b l e , à
l’invention des caraéteres fymbohques 6 c du ftyle figuré
, c’eft-à-dire à l’invention de l’allégorie dont la
f a b l e eft une efpece. Mais l’allégorie ainfi réduite à
une aélion fimple, à une moralité p récife, eft communément
attribuée à E fope, comme à fon premier
inventeur. Quelques-uns l’attribuent à Héfiode 6 c à
Ardisloque ; d’autres prétendent que les fables connues
fous le nom d’Eiqpe, ont été compofées paf
Socrate. Ces opinions à difeuter font heureufement
plus curieufes qu’utiles. Qu’importe après tout pour
le progrès d’un art, que fon inventeur ait eu nom
Efope, Héfiode, ArchUoque , 6cc. l’autpur n’eft pour
nous qu’un mot ; 6c Pope a très-bien obfervé que
cette exiftence idéale qui divife en feétes les vivant
fur les qualités perfonnelles des morts, fe réduit à
quatre ou cinq lettres.
On a fait confifter l’artifice de la fable, à citer les
hommes au tribunal des animaux. C ’eft comme fi Oh
pretendoit en général que la comédie citât les fpec-
tateurs au tribunal de les perfonnages, les hypocrites
au tribunal de Tartufe, les avares au tribunal
d’Arpagon, &c. Dans l’apologue, les animaux font
quelquefois les précepteurs des hommes, Lafontaine l’a
dit : mais ce n’eft que dans le cas où ils font repré-
fentés meilleurs 6c plus fages que nous.
Dans le difeours que la Mothe a mis à la tête de
(es fables , il démêle en philofophe l’artifice caché
dans ce genre de fiâion : il en a bien vu le principe
6c la fin ; les moyens feuls lui ont échappé. Il traite,
en bon critique, de la juftefle & de l’unité de l’allégorie
, de la vraiflemblance des moeurs 6c des caractères
, du choix de la moralité & des images qui l’enveloppent:
mais toutes ces qualités réunies ne font
qu'une fable régulière ; 6c un poème qui n’eft que régulier
, eft bien loin d’être un bon poème.
C ’eft peu que dans la fable une vérité Utile & peu
commune, fe déguife fous le voile d’upe allégorie
ingénieufe ; que cette allégorie, par la juftefle 6c l’unité
dé fes rapports, conduife direâement au fens'
moral qu’elle fe propofe; que les perfonnages qu’on
y emploie,rempîiflent l’idee qu’on a d’eux. La Mothe
a obfervé toutes ces réglés dans quelques-unes de fes
fables ; il reproche, avec raifon, à Lafontaine de les
avoir négligées dans quelques-unes des fiennes.D’où
vient donc que les plus defeélueufes de Lafontaine
ont un charme & un intérêt, que n’ont pas les plus
régulières de la Mothe ?
Ce charme 6c cet intérêt prennent leur fource
non - feulement dans le tour naturel 6c facile des
v er s , dans le coloris de l’imagination, dans le çon-
trafte 6c la vérité des caraéleres, dans la juftefle 6c
la> précifion du dialogue, dans la variété, la force,
6c la rapidité des peintures, en un mot dans le génie
poétique, don précieux & rare, auquel tout l’excellent
elprit de la Mothe n’a jamais pu fuppléer ; mais
encore dans la naïveté du récit 6c du f ty le , caractère
dominant du génie de Lafontaine.
On a dit : le Jlyle de la fable doit être Jimple , familier
, riant y gracieux, naturel, & même ndtf. Il falloir
dire, & fur-tout naïf.
Eflayons de rendre fenfible l’idée que nous attachons
à ce mot naïveté, qu’on a fi fouvent employé
fans l’entendre.
La Mothe diftingue le naïf du naturel; mais il fait
confifter le naïf dans l’expreflion fidele, 6c non refléchie
, de ce qu’on fent ; 6c d’après cette idée vague,
il appelle naïf le qu’il mourût du vieil Horace. Il nous
femble qu’il faut aller plus loin, pour trouver le vrai
cara&ere de naïveté qui eft effentiel & propre à la
fable. • ■ •
La vérité de caraélere a plufieurs nuances qui la
diftinguent- d’elle-même : ou elle obferve les ména-
gemens qu’on fe doit & qu’on doit aux autres, 6c on
l’appeUeJé/zctfmc; ou elle franchit dès qu’on la prefle,
la barrière des égards, 6c on la nomme francJufe ; ou
elle n’attend pas même pour fe montrer à découvert,
que les circonftances l’y engagent 6c que les décen-
ces l’y autorifent, 6c elle devient imprudence, iso-
diferétion , témérité , fuivant qu’çltje eft plus ou
moins offenfante ou dangereufe. Si elle découle de
| I’ame pat un penchant naturel 6c non réfléchi, elle
I eft fimplicité ; fi la fimplicité prend fa fource dans
cette pureté de moeurs qui n’a rien à diflîmuler ni à
feindre, elle eft candeur ; fi à la candeur fe joint une
innocence peu éclairée , qui croit que tout ce qui eft
naturel eft bien v c’yft ingénuité ; fi l'ingénuité fe cai
raélerife par des traits qu’on auroit eu foi-même in4
téçêt à déguifçr, & qui nous donnent quelque avan-
: tage fur celui auquel ils échappent, on la nomma
: naïveté, ou ingénuité naïve. Ainfi la fimplicité ingén
nue eft un curaélere abfolu & indépendant des cir-,
j confiances ; au lieu que la naïveté eft relative.
Hors les, puces qui m'ont.la nuit inquiétée,
, ne feroit dans: Agnès qu’un trait de. fimplicité , û
. elle parloit à (es compagnes.
Jamais je fié hi'ènnuie , \
ne feroit qu’ingénu ÿ fi elle ne faifoit pas cet aveu à
un homme qui doit s'en offenfer. 11 en eft dç même de
L'argent qu eh o/it reçu notre Alain & Georgeitc,
& c .
Par çonfequent ce qui eft compatible avec le caractère
naïf dans tel tems, dans tel lieu , dans tel état,
ne le feroit pas dans tel autre. Georgette eft naïve
a“ trement qu’Agnès ; Agnès autrement que ne dbit
l-etre une jeune fille élevée à la cour, ou dans le
i monde : celle - ci peut dire & penfer ingénuement
: des chofes .que l’éducation lui a rendues familières j
6c qui paroîtroient refléchies 6c recherchées dans la
première. Cela pofe , voyons ce qui conftitue la
naïveté dans la fable, 6c i ’effet qu’elle y produit: ■
La Mothe a obfervé que le fuccès cpnftant 6c uni-
verfel de la fable y venoit de ce que l’allégorie y mé-
nageoit 6c flatoit l’amour-propre : rien n’eft plus vrai*
ni mieux fenti ; mais cet art de ménager & de flater l’amour
propre, au lieu de le blefîer, n’eft autre chofe
que l’eloquènce naïve, l’éloquence d'Efope chez les
; anciens, 6c de Lafontaine chez les modernes.
De toutes les. prétentions des hommes , la plus
générale 6c la plus décidée regarde la fagefle & les
moeurs ; rien n’eft donc plus capable de les indifpo-
fer, que des préceptes de morale & de fagefle pré-»
fentés dire&ement. Nous ne parlerons point de la
fatyre ; le fuccès en eft affûré : fi elle en bleffe un ,
elle en flate mille. Nous parlons d’une philofophie
fevere, mais honnête, fans amertume 6c fans poi-
fon, qui n’infuite perfonne, & qui s’adrefle à tous :
c’eft précisément de celle-là qu’on s’offenfe. Les Poètes
l’ont déguifée au théâtre & dans l’épopée, fous
l’allégorie d’une aélion, & ce ménagement l’a fait
recevoir fans révolte r mais toute vérité ne peut pas
: avoir au théâtre fon tableau particulier ; chaque pièce
ne peut aboutir qu’à une moralité principale ; 6c
les traits accefloires répandus dan6 le cours de l’action,
paflent trop rapidement pour ne pas s’effacer
i’un l’autre : l ’intérêt même les abforbe, 6c ne nous
laiffe pas la liberté d’y réfléchir. D ’ailleurs l’inftru-
âion théâtrale exige un appareil qui n’eft ni de tous
les lieux, ni de tous les tems ; c’eft un miroir public
qu’on n’éleve qu’à grands frais 6c à force de machines.
U en eft à-peu-près de même de Pépopée. On
a donc voulu nous donner des glaces portati ves aufli
fideles & plus commodes, où chaque vérité ifoiée
eut fon image diftinfte ; & do-là l’invention des petits
poèmes allégoriques. .
Dans ces tableaux, on pouvoit nous peindre à
nos yeux fous trois fymboles différens ; ou fous les
traits de nos fèmblables, comme dans la fable du Savetier
6c du Financier, dans celle du Berger & du
Roi,dans celle du Meunier 6c fon fils, Oc. ou fous
le nom des êtres fiirnaturels & allégoriques, comme
dans la fable d’Apollon 6c Borée, dans celle de la