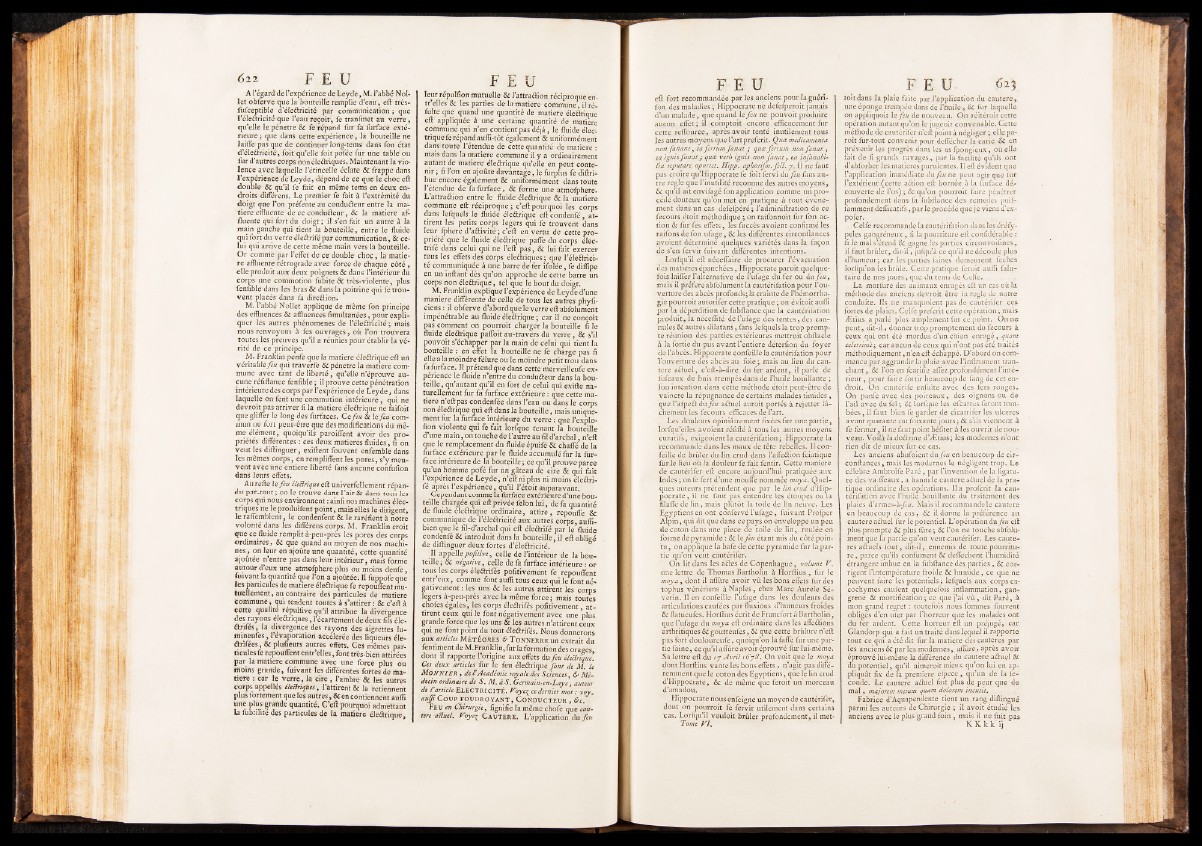
A l’égard de l’expérience de Leyde, M. l’abbé Nol-
let obferve que la bouteille remplie d’eau, eft très-
fufceptible d’éledricité par comiiiürtièâtion ; que
l’éledricité que l’eau reçoit1, fe tranfmet au verre,
qu’elle le pénétré & fe répand fur fa furface extérieure;
que dans cette expérience, là bouteille ne
laiffe pas que de continuer lon'g-tems dans fon état
d’éledricité', foit qu’elle foit pôfée fur une table ou
fur d’autres corps non électriques. Maintenant la violence
avec laquelle l’étincelle éclate & frappe dans
l ’expérience de Leyde, dépend dè ce que le choc eft
double & qu’il fe fait en même tems en deux endroits
différens. Le premier fe fait à l’extrémité du
doigt que l’on préfentë au coiïdudeur entre la matière
effluente de ce condudeur, & la matière af-
fluente qui fort du doigt ; il s’en fait un autre à la
main gauche qui tient la bouteille, entre le fluide
qui fort du verre éledrifé par communication, & celui
qui arrive de cette même main vers la bouteille.
Or comniè par l’effet de ce double choc, la matière
affluente rétrogradé avec force de chaque cô té ,
elle produit aux deux poignets & dans l’intérieur du
corps une commotion fubite & très-violente, plus
fenfible dans le's bras & dans la poitrine qui fe trouvent
placés dans fa diredion.
M. l’abbé Nollet applique-de même fon principe
des effluences & affluences fiiiiultanées, pour expliquer
lés’ autres phénomènes de l’éledWcité ;• mais
nous renvoyons à fes ouvrages , où l’on trouvera
toutes les preuves qu’il a réunies pour établir la v érité
de ce principe.
M. Franklin perife que la matière éledrique eft un
véritable^« qui traverfe & pénétré la matière commune
avec tant de liberté, qu’elle n’éprouve aucune
réfiftance fenfible ; il prouve cette pénétration
intérieure dés corps par l’expérience de Leyde, dans
laquelle on ferit une commotion intérieure, qui ne
devroit pas arriver fi la matière éledrique ne faifoit
que glifler le long des furfaces. Ce feu & le feu commun
ne fort peut-être que des modifications du même
élément, quoiqu’ils paroiffent avoir des pro-
priéfés différentes : ces deux matières fluides, fi on :
veut les diftinguer, exiftent fouvent enfemble dans
les mêmes corps, en rempliffent les pores, s’y meuvent
avec Une èntiere liberté fans aucune confufion
dans leurs effets.
Aurëfte le feu électrique eft univerfellement répandu
paf-tôüt ; on le trouve dans l ’air & dans tous les ,
corps qui nous environnent : ainfi nos machines électriques
ne le produifent point, mais elles le dirigent,
le rafiemblent, le condenfent & le raréfient à notre
volonté dans les différens corps. M. Franklin croit
que cë fluide remplit à-peu-près les pores des corps
ordinaires, & que quand au moyen de nos machines,
on leur en ajoûte une quantité, cette quantité
ajoutée n’entre pas dans leur intérieur, mais forme
autour d’eux une atmofphere plus ou moins denfe,
fuivant la quantité que l’on a ajoûtée. Il fuppofe que
les particules de matière éledrique fe repouffent mutuellement,
au contraire des particules de matière
Commune j qui tendent toutes à s’attirer : & c’eft à
cette qualité repulfive qu’il attribue la divergence
des rayons électriques, l’écartement de deüx fils éle-
arifés , la divergence des rayons des aigrettes lu-
mineufes, l’évaporation âcceleréë des liqiieurs éle-
drifées, & plufièürs antres effets. Ges mêmes particules
fe repoüffent entr’elles, font très-bien attirées
par la matière commune avec une force plus ou
moins grande, füivant les différentes fortes de matière
: car le verre, la c ire , l’àmbre & les autres
corps appêllés électriques, l’attirent & la retiennent
plus fortement que les autres, & en contiennent àuflî
une plus grande quantité. C ’eft pourquoi admettant
la fubtilité des particules de la matière éledrique,
leur répulfion mutuelle & I’attradion réciproque entr’elles
& les parties de la matière commune, il refaite
que quand une quantité de matière éledrique
eft appliquée à une certaine quantité de matière
commune qui n’en contient pas déjà, le fluide électrique
fe répand auffi-tôt également & uniformément
dans toute l ’étëndüe de cette quantité de matière:
maisdahs la matière commune il y a ordinairement
autant de matière éleCtrique qu’elle en peut contenir
; fi l’on en ajoûte davantage, le fürplus fe diftri*
bue encore également & uniformément dans toute
l’étendue de fa furface, & forme une atmofphere.
L’attradion entre le fluide éleCtrique & la matière
commune eft réciproque ; c’eft pourquoi les corps
dans Iefqüels le fluide éledrique eftcondenfé, attirent
les petits corps légers qui fe trouvent dans
leur fphere d’aCtivité; c’eft en vertu de cette propriété
que le fluide éleCtrique paffe du corps elec-
trifé dans celui qui ne l’eft pas, & lui fait exercer
tous les effets des corps électriques ; que l’éledrici-
té communiquée à une barre de fer ifolée, fe diflipe
en un inftartt dès qu’on approche de cette barre un
corps non éleCtrique, tel que le bout du doigt.
M. Franklin explique l’expérience de Leyde d’une
maniéré différente de celle de tous les autres phyfi-
ciens : il obferve d’abord que le verre eft abfolument
impénétrable au fluide éleCtrique ; car il ne conçoit
pas comment ort pourroit charger la bouteille fi le
fluide éleCtrique paffoit au-travers du verre, & s’il
pouvoit s’échapper par la main de celui qui tient la
bouteille : en effet la bouteille ne fo charge pas fi
elle a la moindre fêlure ou le moindre petit trou dans
fa furface. Il prétend que dans cette merveilleufe expérience
le fluide n’entre du conducteur dans la bouteille,
qu’autant qu’il en fort de celui qui exifte naturellement
fur fa furface extérieure : que cette matière
n’eftpas condenfée dans l’eau ou dans le corps
non éleCtrique qui eft dans la bouteille, mais uniquement
fur la furface intérieure dit verre : que l’explo-
fion violente qui fe fait lorfque tenant la bouteille
d’une main, oh touche de l ’autre au fil d’archal, n’eft
que le remplacement du fluide épuifé & chaffé de la
furface extérieure par le fluide accumulé fur la fur-
face intérieure de là bouteille ; ce qu’il prouve parce
qu’un homme pofé fur ttn gâteau de cire & qui fait
l’expérience de Leyde, n’eft ni plus ni moins éledri-
fé après l’expérience, qu’il l’étoit auparavant.
Cependant comme la furface extérieure d’une bouteille
chargée qui eft privée félon lui, de fa quantité
de fluide éleCtrique ordinaire, attire, repouffe &
communique de l’éleCtricité aux autres corps, auffi-
bien que le fil-d’archal qui eft éleCtrifé par le fluide
condenfé & introduit dans la bouteille, il eft obligé
de diftinguer deux fortes d’éledricité.
Il appelle poftive, celle de l’intérieur de la bouteille;
(k négative, celle de fa furface intérieure: or
tous les corps éleCtrifés pofitivement fe repouffent
entr’eux, comme font aufli tous ceux qui le font négativement
: les uns & les autres attirent les corps
légers à-peu-près avec la même force; mais toutes
chofes égales, les corps éleCtrifés pofitivement, attirent
ceux qui le font négativement avec une plus
grande force que les uns & les autres n’attirent ceux
qui ne font point du tout éleCtrifés. Nous donnerons
au-x. articles Météores & T onnerre un extrait du
fentiriient de M.Franklin, fur la formation des orages,
dont il rapporte l’origine aux effets du feu électrique.
Ces deux articles fur le feu éleCtrique font de M. le
Monnier , de FAcadémie royale des Sciences & Médecin
ordinaire de S. M. à S. Germain-en-Laye , auteur
dt l article ELECTRICITE. V^oye^ ce dernier mot : voy.
aujjiC oup fo u d r o y an t , C o nducteur , &c.
Feu en Chirurgie, fignifie la même cbofe que cautère
actuel. Voye{ CAUTERE. L ’application du feu
eft fort recommandée par les anciens pour la guéri-
fcm des maladies ; Hippocrate ne defefperoit jamais
d’un malade, que quand le feu ne pouvoit produire
aucun .effet; il comptoit encore efficacement fur
cette reffource , après avoir tente inutilement tous
les autres moyens que l’art prefcrit. Quce médicamenta
non fanant, ea ferrum fanat ; quce ferrum non fanat ,
ea ignis fanat ; quce verb ignis. non J'anat, ea infanabi-
lia reputare oportet. Hipp. aphorifm. fecl. y . Il ne faut
pas croire qu’Hippocrate fe foit fervi du feu i ans autre
réglé que l ’inutilité reconnue des autres moyens,
& qu’il ait envifagé fon application comme un procédé
douteux qu’on met en pratique à tout événement
dans un cas defefpéré ; l’adminiftration de ce
fecours étoit méthodique ; on raifonnoit fur fon action
& fur'fes effets , les fuccès avoient confirmé les
raifons de fon ufag'e, & les différentes circonftances
avoient détermine quelques variétés dans la façon
de s’en fervir fiiivant différentes intentions.
, Lorfqu’il eft néceffaire de procurer l’évacuation
clés matières épanchées, Hippocrate paroît quelquefois
laiffer l’alternative de l’ufage du fer ou du feu,
mais fl préféré a b f o lu m e n t la cautérifation pour l’ouverture
des abcès profonds; lâ crainte de l’hémorrhagie
pourroit autorifer cette pratique ; on évitoit aufli
par la déperdition de fubftance que la cautérifation
produit, la néceflité de l’ufage des tentes, des c a n n
u l e s & autres dilatans, fans lefquels la trop prompte
réunion des parties extérieures mettroit obftacle
à la fortie du pus avant l’entiere déterfion du foyer
de l’abcès. Hippocrate confeille la cautérifation pour
l ’ouverture des abcès au foie ; mais au lieu du cautère
a d u e l , c’eft-à-dire du fer ardent, il parle de
fufeaux de buis trempés dans de l’huile bouillante ;
fon intention dans cette méthode étoit peut-être de
vaincre la répugnance de certains malades timides ,
que l’alped du feu a c t u e l auroit portés à rejetter lâchement
les fecours efficaces de l’art.
Les douleurs opiniâtrement fixées fur une partie,
lorfqu’elles avoient réfifté à tous les autres moyens
curatifs, exigeoient la cautérifation ; Hippocrate la
recommande dans les maux de tête rebelles. II confeille
de brûler du lin crud dans l’affedion fciatique
fur le lieu où la douleur fe fait fentir. Cette maniéré
de cautérifer eft encore aujourd’hui pratiquée aux
Indes ; on fe fert d’une moufle nommée moya. Quelques
auteurs prétendent que par le lin crud d’Hippocrate,
il ne faut pas entendre les étoupes ou la
filaffe de lin, mais plutôt la toile de lin neuve. Les
Egyptiens en ont confervé l’ufage, fuivant Profper
Alpin, qui dit que dans ce pays on enveloppe un peu
de coton dans une piece dè toile de lin, roulée en
forme de pyramide : & le feu étant mis du côté pointu
, on applique la bafe de cette pyramide fur la partie
qu’on veut cautérifer.
On lit dans les ades de Copenhague, volume V.
une lettre de Thomas Bartholin à Horftius , fur le
moya, dont il affûre avoir vû les bons effets fur des
tophus vénériens à Naples, chez Marc Aurele Sé-
verin. Il en confeille l’ufage dans les douleurs des
articulations caufées par fluxions d’humeurs froides
& flatueufes. Horftius écrit de Francfort à Bartholin,
que l’ufage du moya eft ordinaire dans les affedions
arthritiques & goutteufes, & que cette brûlure n’eft
pas fort douloureufe, quoiqu’on la faffe fur une partie
faine, ce qu’il afl'ûre avoir éprouvé fur lui-même.
Sa lettre eft du /y Avril iG j8. On voit que le moya
dont Horftius vante les bons effets , n’agit pas différemment
que le coton des Egyptiens, que le lin crud
d’Hippocrate, & de même que feroit un morceau
d’amadou.
Hippocrate nous enfeigne un moyen de cautérifer,
dont on pourroit fe fervir utilement dans certains
tas. Lorfqu’il vouloit brûler profondément, il met-
Tome VI.
toit dans la plaie faite par l’application du cautère-,
une éponge trempée dans de l’huile, & fur laquelle
on appliquoit le feu de nouveau. On réitéroit cette
opération autant qu’on le jugeoit convenable. Cette
méthode de cautérifer n’eft point à négliger ;,elle paroît
fur-tout convenir pour deffécher la carie & en
prévenir les progrès dans les os fpongieux, où elle
fait de fl grands ravages, par la facilité qu’ils ont
d’abforber les matières purulentes. Il eft évident que
.l’application immédiate du feu ne peut agir que fiir
l’extérieur (cette adion eft bornée à la furface dér
couverte de l’os) ; & qu’on pourroit faire pénétrer
profondément clans fa fubftance des remedes puif-
famment delficatifs, par le procédé que je viens d’ex-
pofer.
, Celfe recommande la cautérifation dans les éréfy-
peles gangréneux, fi la pourriture eft confiçlérable :
fi le mal s’étend & gagne les parties circonvoifines ,
il faut brûler, dit-il, julqu’à ce qu’il ne découle plus
d’humeur; car les parties faines demeurent feches
lorfqu’on les brûle. Cette pratique feroit auflî falu-
taire de nos jours, que du tems de Çelfe.
La morfure des animaux enragés eft un cas où la
méthode des anciens devroit être la réglé de notre
conduite. Ils ne manquoient pas de cautérifer ces
fortes de plaies. Celfe prefcrit cette opération ; mais
Ætius a parlé plus amplement fur ce point. On ne
peut, dit-il, donner trop promptement du fecours à
ceux qui ont été mordus d’un chien enragé, quam
celerrimh ; car aucun de ceux qui n’ont pas été traités
méthodiquement, n’en eft échappé. D ’abord on commence
par aggrandir la plaie avec l’inftrument tranchant
, & l’on en fcarifie affez profondément l’intérieur
, pour faire fortir beaucoup de fang de, cet endroit.
On cautérife enfuite avec des fers rouges.
On panfe avec des poireaux, des oignons ou de
l’ail avec du fel ; &c lorfque les efcarres feront tom?
bées, il faut bien fe garder de cicatrifer les ulcérés
avant quarante ou foixante jours ; & s’ils viennent à
fe fermer, il ne faut point héfiter à les ouvrir de nouveau.
Voilà la doélrine d’Ætius ; les modernes n’ont
rien dit de mieux fur ce cas.
Les anciens abufoient du feu en beaucoup de circonftances,
mais les modernes le négligent trop. Le
célébré Ambroife Paré, par l’invention de la ligature
des Yaiffeaux, a banni le cautère adtuel de la pratique
ordinaire des opérations. Il a profcrit la cautérifation
avec l’huile bouillante du traitement des
plaies d’armes-k-feu. Mais il recommande le cautère
en beaucoup de cas, & il donne la préférence au
cautère a&uel fur le potentiel. L’opération du feu eft
plus prompte & plus fûre ; & l’on ne touche abfolument
que la partie qu’on veut cautérifer. Les cautères
a duels font, dit-il, ennemis de toute pourriture
, parce qu’ils confirment ÔC deffechent l’humidité
étrangère imbue en la fubftance des parties, & corrigent
l’intempérature froide & humide, ce que ne
peuvent faire les potentiels ; lefquels aux corps cacochymes
caufent quelquefois inflammation, gangrené
& mortification; ce que j’ai v û , dit Paré, à
mon grand regret : toutefois nous fortunes fouvent
obligés d’en uler par l’horreur que les malades ont
du fer ardent. Cette horreur eft un préjugé, car
Glandorp qui a fait un traité dans lequel il rapporte
tout ce qui a été dit fur la matière des cautères par
les anciens Sc par les modernes, affûre, après avoir
éprouvé lui-même la différence du cautere aduel &
du potentiel, qu’il aimeroit mieux qu’on lui en appliquât
fix de la première efpece, qu’un de la fécondé.
Le cauterè aduel fait plus de peur que de
mal, majorem metum quam dolorem incutit.
Fabrice d’Aquapendente tient un rang diftingué
parmi les auteurs de Chirurgie ; il avoit étudié les
anciens avec le plus grand foin , mais il ne fuit pas
K K k k i)