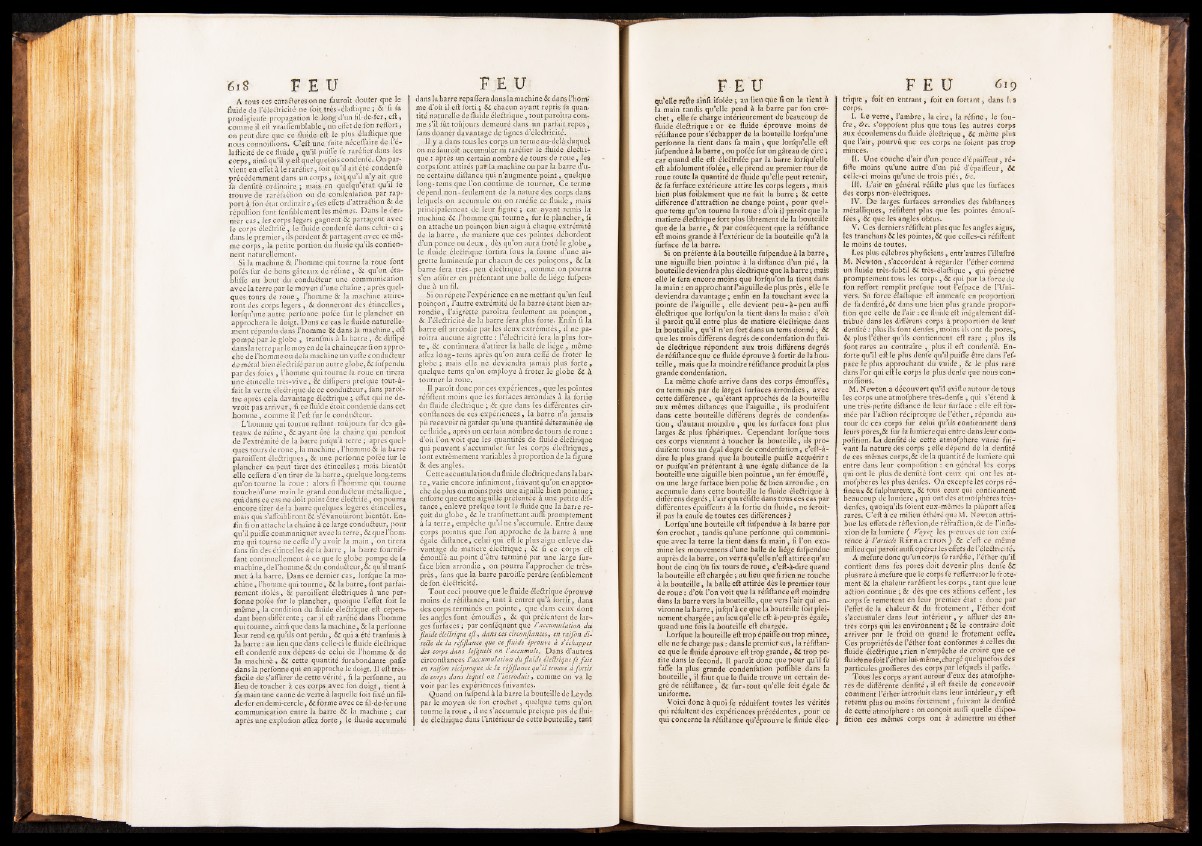
A tous ces cara&eres on ne fauroit douter que le
fluide d e l’éle&ricité ne fojttrès-élaftique ; & fi la
pro.cligieufe propagation le long d’un fib de-fer, e ft ,
comme il eft vraiffemblaMe-j- un effet de Ion reffort,
on peut .dire que ce fluide eft le plus elaftique que
nous connoiflions. C’eft une; fuite neceflaire de le -
lafticité de ce fluide, qu’il puifle le rarefier-dans les
corps, ainfi qu’il y eft quelquefois condenfe. On parvient
en effet à le raréfier, foit qu’il ait été^condenfe
précédemment dans un corps;, lbi^qu’iln ’y ait que
fa denfitë.Ordinaire,; mais..en . qüelqu’état, qu’il fe
trouve de raréfaftion ou de, condenfation par rapport
à fon état ordinaire,Fes effets d’attraftion & de
répulfion font fenfiblernent les mêmes. Dans le dernier
cas, les corps .légers gagnent 6c partagent avec
le corps éleftrifé, le fluide çondenfé dans celui-ci ;
dans le premier, ils perdent & partagent avec ce même
corps, la petite portion du fluide qu’ils contiennent
naturellement.
Si la machine & l’homme qui tourne la roue font
pofés fur dé bons gâteaux de réfine , & qu’on éta-
bliflje au bout duconduâeur une communication
avec la terre par le moyen d’une chaîne ; après quelques
tours de roue , l’homme & la machiné attireront
des corps légers, & donneront des étincelles,
lorfqu’une autre perfonne pofée fur le plancher en
approchera le doigt. Dans ce cas le fluide naturellement
répandu dans l’homme 6c dans la machine, eft
pompé par le globe , tranfmis à la barre , & diflipé
dans.la terre par le moyen de la chaîne;car fl on approche
de l’homme ou delà machine un vafte çonduéieur
de métal bienéleftrifé par un autre globe, & l’ufpendu
par des Foies, l’homme qui tourne la roue en tirera
une étincelle très-vive, 6c diflipera prefque tout-à-
fait la vertu électrique de ce conducteur, fans paroî-
tre après, cela davantage é l e c t r i q u e ; effet qui ne de-
vroit pas arriver, fl ce fluide étoit çondenfé dans cet
homme, comme il l’eft fur le conducteur.
L’homme qui tourne reftant toûjours fur des gâteaux
de -refîne, & ayant ôté la chaîne qui pendoit
de l’extrémité de la barre jufqu’à terre ; après quelques
tours de roue,. la machine , l’homme & la barre
paroiflent éleêtriques , & une perfonn.e pofée fur le
plancher en peut tirer des étincelles,; mais bientôt
elle ceffera d’en tirer de la barre, quelque long-tems
qu’on tourne la roue : alors fi l’homme qui tourne
touche d’une main le grand conduôeur métallique,
qui dans ce cas ne doit point être éleCtrifé, on pourra
encore tirer de la barre quelques legeres étincelles,
mais qui s’affoibliront & s'évanouiront bientôt. E n f
i n fi on attache la chaîne à ce large c o n d u c t e u r , pour
qu’il puiffe communiquer avec la terre, 6c que l’homme
qui tourne ne ceffe d’y avoir la main , on tirera
fans fin des étincelles de la barre , la barre fournif-
fant. continuellement à ce que le globe pompe de la
machine, de l’homme 6c du conducteur, & qu’il tranf-
met à la barre. Dans ce dernier cas, lorfque la machine
, l’homme qui tourne, 6c la barre, font parfaitement
ifolés, & paroiflent électriques à une perfonne
pofée fur le plancher, quoique l’effet foit le
même , la condition du fluide éleCtrique eft cependant
bien-differente ; car il eft raréfié dans l’homme
qui tourne, ainfi que dans la machine, & la perfonne
leur rend ce qu’ils ont perdu, 6c qui a été tranfmis à
la barre : au lieu que dans celle-ci le fluide éleCtrique
eft çondenfé aux dépens de celui de l’homme & de
la machine, 6c cette quantité furabondante paffe
.dans la perfonne qui en approche le doigt. Il eft très-
facile de s’aflïïrer de cette vérité, fi la perfonne, au
lieu de toucher à ces corps avec fon doigt, tient à
fa main une canne de verre à laquelle foit fixé un fil-
fle-fer en demi-cercle, & forme avec ce fil-de-fer une
communication entre la barre 6c la machine ; car
après une explofion a fiez forte, le fluide accumulé
dans la barre repaffera dans la machine & dans l’honvî
me d’où il eft forti ; & chacun ayant repris fa quantité
naturelle de fluide éleCtrique, tout paroîtra comme
s’il fût toûjours demeuré dans un parfait, repos,
fans donner davantage de Agnes d’éleûricite..
Il y a çjans tous les corps un terme au-delà;duquel
on ne fauroit accumuler ni raréfier le fluide, éleCtrique,:
après un certain nombre de tours de roue, le9
corps font attirés paf la machine ou par la barre d’une
certaine diftance qui n’augmente point, quelque
long-tems que l’on continue de tourner. Ce terme
dépend non - feulement de la nature des corps dans
lefquels on accumule ou on raréfie, ce fluide, mais
principalement de leur figure ; car ayant remis la
machine:6c l’homme qui tourne, fur le plancher , fi
on attache un poinçon bien aigu à chaque extrémité
de la b arre, de maniéré que ces pointes débordent
d’un pouce ou d eux, dès qu’on aura froté le globe ,
le fluide ; éleCtrique fortira fous la., forme d’une aigrette
lumineufe par chacun de ces poinçons, 6c la
barre fera très - peu éleCtrique , comme on pourra
s’en affûrer en préfentant une balle de liège fufpen-
due à un fil.
Si on répété l’expérience en ne mettant qu’un feul
poinçon, l’autre extrémité, de la barre étant bien arrondie,
l’aigrette paroîtra feulement, au poinçon,
& l’éleCtricité de la barre fera plus forte. Enfin fi la
barre eft arrondie p a r les deux extrémités, il ne paroîtra
aucune aigrette : l’éleCtricité fera la plus forte
, & continuera d’attirer la balle de lièg e , même
aflëz long-tems après qu’on aura cefle cle froter le
globe ; mais elle ne deviendra jamais plus fo r te ,
quelque tems qu’on employé à froter le globe 6c à
tourner la roue. . ..
Il paroît donc par ces expériences, que les pointes
réfiftent moins que les furfaces arrondies à la fortie
du fluide éleCtrique ; •& que dans les différentes çir-
conftances de ces expériences, la barre n’a jamais
pû recevoir ni garder qu’une quantité déterminée d©
ce fluide, après un certain nombre de tours de roue ;
d’où l’on voit que les quantités de fluide éleCtrique
qui peuvent s’accumuler fur les corps éleCtriques >
font extrêmement variables à proportion de la figure
& des angles.
Cette accumulation du fluide éleCtrique dans la barre
, varie encore infiniment, fuivant qu’on en approche
de plus ou moins près une aiguille bien pointue ;
enforte que cette aiguille préfentée ,à une petite diftance
, enleve prefque fout le fluide que la barre reçoit
du globe, 6c le tranfmettant aufli promptement
j à la terre, empêche qu’il ne s’accumule. Entre deux
I corps pointus que l’on .approche de la barre à une
égale diftance, celui qui eft le plus aigu enleve davantage
de matière éleCtrique ; & fi ce corps eft
émoufle au point d’être terminé par une large fur-
face bien arrondie , on pourra l’approcher de très-
près , fans que la barre paroiffe perdre fenfiblernent
de fon éleûricité.
Tout ceci prouve que le fluide éleCtrique éprouve
moins de réfiftance, tant à entrer qu’à fortir, dans
des corps terminés en pointe, que dans ceux dont
les angles font émoufles , & qui préfentent de larges
furfaces ; p3r conféquent que Vaccumulation du
fluide électrique efl, datis ces circonflances, en raifon directe
de la réfiflance que ce fluide éprouve à s'échapper
des corps dans lefquels on l'accumule. Dans d’autres
circonflances l'accumulation du fluide électrique fe fait
en raifon réciproque de la réfiflance qu'il trouve à fortir
du corps dans lequel on l'introduit, comme on va le
voir par les expériences fuivantes.
Quand on fufpend à la barre la bouteille de Leyde
par le moyen de fon crochet, quelque tems qu’on
tourne la roue , il ne s’accumule prefque pas de fluide
éleCtrique dans l’intérieur de cette bouteille, tant
qu'elle refte àinfi ifolée ; au üett qüé fi oh la tient à
la main tandis qu’elle pend à la barre par fon crochet
, elle fe charge intérieurement de beaucoup de
fluide éleCtrique : or Ce fluide éprouve moins de
réfiftance pour s’échapper de la bouteille lorfqu’une
perfonne la tient dans fa main > que lorfqu’elle eft
fufpendue à la barre, ou pofée fur un gâteau de cire ^
car quand elle eft éleCtrifée par la barre lûrfqu’elle
eft abfolument ifolée, elle prend au premier tour de
roue toute la quantité de fluide qu’elle peut retenir;
6c fa furfaee extérieure attire les corps légers, rhais
bien plus foiblement que ne fait la barre ; 6c cette
différence d’attraôion ne change point, pour qneU
que tems qu’on tourne la roue : d’où il paroît que la
matière éleCirique fort plus librement de la bouteille
que de la barre, & par conféquent que la réfiftance
eft moins grande à l’extérieur de la bouteille qu’à la
furfaee de la barre.
Si on préfente à la bouteille fufpendue à la barre,
une aiguille bien pointue à la diftance d’un pié , la
bouteille deviendra plus éledrique que la barre ; mais
elle le fera encore moins que lorfqu’on la tient dans
la main : en approchant l’aiguille de plus près, elle le
deviendra davantage ; enfin en la touchant avec la
pointe de l’aiguille, elle devient peu-à-peu aufli
éle&rique que lorfqu’on la tient dans la main : d’où
il paroît qu’il entre plus de matière éleCtrique dans
la bouteille, qu’il n’en fort dans un tems donné ; 6c
que les trois différens degrés de condenfation du fluide
éleCtrique répondent aux trois différens degrés
de réfiftance que ce fluide éprouve à fortir de là bouteille,
mais que la moindre réfiftance produit la plus
grande condenfation«
La même chofe arrive dans des corps émoufles ;
ou terminés par dé larges furfaces arrondies, avec
cette différence, qu’étant approchés de la bouteille
aux mêmes diftances que l'aiguille, ils produifent
dans cette bouteille différens degrés de condenfation
, d’autant moindre , que, les furfaces font plus
larges 6c plus fphériques. Cependant lorfque fous
ces corps viennent à toucher la bouteille, ils produifent
tous un égal degré de condenfation, c’eft-à-
dire le plus grand que la bouteille puiffe acquérir :
or puifqu’en préfentant à une égale diftance de la
bouteille une aiguille bien pointue, un fer émoufle,
ou une large furfaee bien polie 6c bien arrondie,- on
accumule dans cette bouteille le fluide éleCtrique à
différens degrés ; l’air qui réfifte dans tous ces cas par
differentes epaiffeuts à la fortie du fluide, ne feroit-
il pas la caufe de toutes ces différences ?
Lorfqu’une bouteille eft fufpendue à la barré par
fon crochet, tandis qu’une perfonne qui communique
avec la terre la tient dans fa main, fi l’on examine
les mouvemens d’une balle de liège fufpendue
auprès de la barre, on verra qu’elle n’eft attirée qu’au’
bout de cinq *oü fix tours de roue, c’eft-à-dire quand-
la bouteille eft chargée ; au lieu que fi rien ne touche
à la bouteille, la balle eft attirée dès le premier tour
de roue : d’où l’on voit que la réfiftance eft moindre
dans la barre vers la bouteille, que vers l’air qui environne
la barre, jufqu’à ce que la bouteille foit pleinement
chargée ; au lieu qu’elle eft à-peu-près égale,
quand une fois la bouteille eft chargée.
Lorfque la bouteille eft trop épaiffe ou trop mince,
elle ne te charge pas : dans le premier cas, la réfiftance
que le fluide éprouve eft trop grande, & trop petite
dans le fécond. Il paroît donc que pour qu’il fe
faffe la plus grande côndenfation pofîiblè dans la
bouteille , il faut que le fluide trouve un certain degré
de réfiftance, &c fur-tout qu’elle foit égale 6c
uniforme.
Voici donc à quoi fe réduifent toutes les vérités
qui réfultent des expériences précédentes, pour ce
qui concerne la réfiftance qu’éprouve le fluide électrique,
foit en entrant, foit en fortant* dans le s
corps.
I. Le verre, l’ambre, la cire, la réfine, le fou-
fre , &c> s’oppofent plus que tous les autres corps
aux écoulemens du fluide éledrique, 6c même plus
que l’ait*, poitrvû que ces corps ne foient pas trop
mine ês *
IL Une côitche d’air d’un pouce d’épaifleuf, réfifte
moins qu’une autre d’un pié d’épaiffeur, 6c
celle-ci moins qu’une de trois pies, &c;
III. L’air en général réfifte plus que les furfaces
des corps non-éledriquès«
IV. De larges furfaces arrondies des fubftances
métalliques, réfiftent plus que les pointes émouf-
fées, 6c. que les angles obtus.
V« Ces derniers réfiftent pliis que les angles aigus,
lés tranchans & les pointes, & que celles-ci réfiftent
le moins de toutes.
Les plus célébrés phyficienS, ëntr’autres l’illuftré
M# Newton , s’accordent à regarder l’éther commé
un fluide très-fubtil & très-élaftique , qui pénétré
promptement tous les corps, 6c qui par la force de
fort reflbrt remplit prefque tout l’efpace de I’Uni-
vérs. Sa forc'e élaftique eft immehfe en proportion
de fadenfité,& dans une bien plus grande proportion
que celle de l’air : ce fluide eft inégalement dif-
tribué dans les différens corps à proportion de leur
denfitéplus ils font denfes, moins ils ont de pores,
6c plusTéther qu’ils contiennent eft rare ; plus ils
font rares au contraire , plus il eft çondenfé. En-
forte qu’il eft le plus dehfe qu’il puiffe être dans l’ef-
pace le plus approchant du vuidé, & le plus rare
dans l’or qui eft le corps le pltis denfe que nous connoiflions.
M. Newton a découvert qu’il exifte autour de tous
les corps une atmofphere très-denfe ; qui s’étend à
une très-petite diftance de leiir furfaee : ellé eft formée
par l’aÊfion réciproque de l’éther, répandu autour
de cés corps fur celui qu’ils contiennent dans
lêtirs pores,& fiir la lumière qui entre dans leur com-
pofition. La denfité de cette atmofphere varie fni-
vant la nature dès ccirps ; elle dépend de la denfité
de ces mêmes corps,& de la quantité de lùmiere qui
entre dans leur compofition : eh général les corps
qui ont lé plus de denfité font ceux qui ont lés at-
mofphéres les plus denfes. On excepte les corps ré-
fineux & fulphureux, & tous ceux qui contiennent
beaucoup de lumière, qui ont des atmofpheres très-
denfes, quoiqu’ils foient eux-mêmes la plupart afîez
rares» C ’eft à ce milieu éthéréqueM. Newtoh attribue
lés effets de réflexion,de réfra&ion,& de l’inflexion
de la lumière ( Voye£ les preuves de fon exif-
ténee à l'article R é f r a c t io n ) & c’eft ce même
milieu qui paroît aufli opérer les effets de l’éle&ricité»
A mefure donc qu’un corps fé raréfie, l’éther qu’il
Contient dans fes pores doit devenir plus denfe Sc
plus rate à mefure que le corps fe refferrecor le frôlement
6c la chaleur raréfient les corps, tant que leur
a&iori côfitinue ; & dès que ces aftions ceffent, les
corps fe rémettent en l’eùf premier état : donc par
l’effet dè la chaleur & du frotement, l’éther doit
s’accumuler dans leur intérieur , y affluer des autres
corps qui les environnent ; & le contraire doit
arriver pâr le froid ou quand le frotement ceffe.
Ges propriétés de l’éther font conformes à celles du
fluide éle&rique ; rien n’empêéhe de croire que ce
fluide ne foit l’éther lui-même,chargé quelquefois des
particules groflieres des corps par lefquels il paffe.
TduS les corps ayant autour d’eux dés atmofphe-
rës de différente denfité, il eft facile de concevoir
comment l’éther introduit dans leur intérieur, y eft
retenu plus ou moins fortement, fuivant la denfité
dé cette atmofphere : on conçoit aufli quelle difpo-*
fition ces mêmes corps ont à admettre un éther