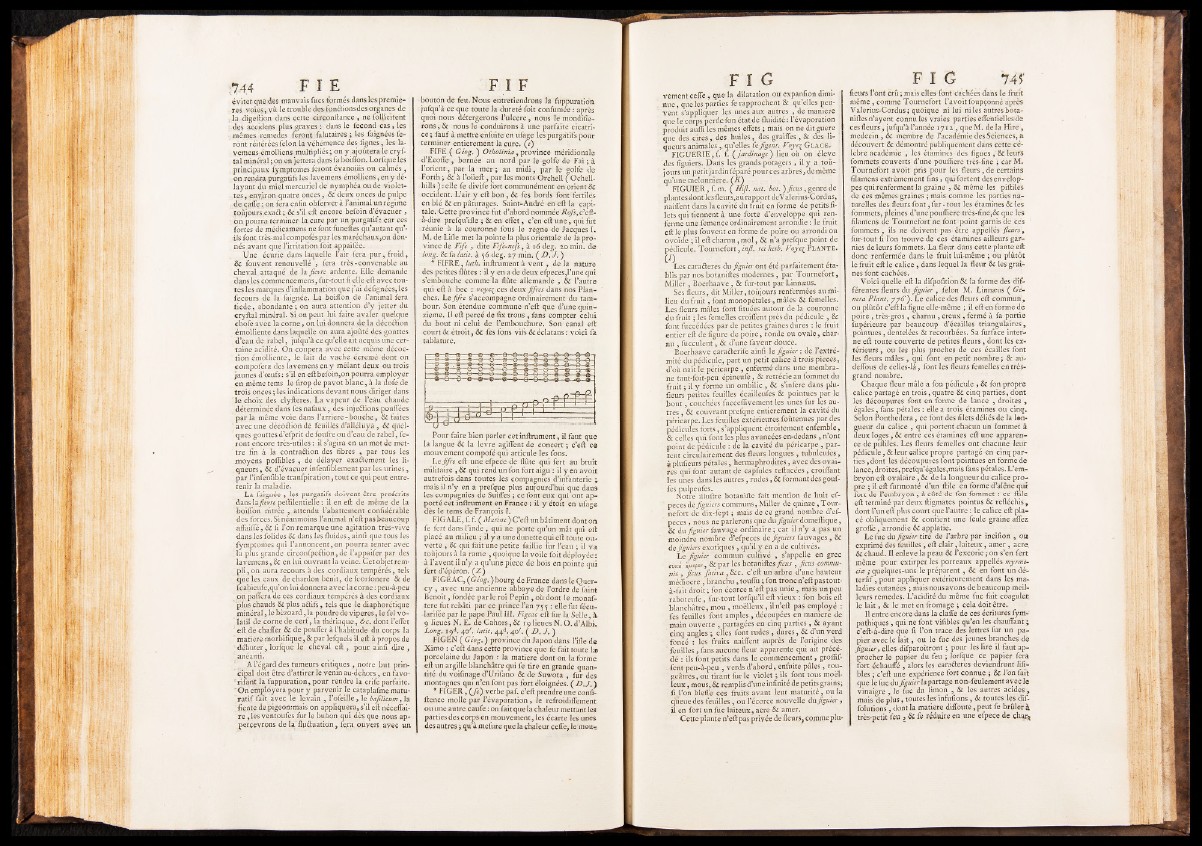
744 F I E
éviter que des mauvais fucs formés dans. les premières
ypie§;vû le trouble des fondions des organes de
la digeftion dans cette circonftance , ne foilicitent
•des accidetis plus.grayes: dans le fécond ca s , les
mêmes remedes feront fa lu ta ire sle s faignées feront
réitérées félon la véhémence des lig n e s le s la-
veme^s-émollienS' multipliés ; on y ajoutera le cryf- j
tal minéral ; on en jettera dans fa boiffpn. Lorfque les : !
principaux fymptomes feront évanouis ou calmés ,
on rep&a; purgatifs les, lavemens émplliens, en y délayant
du miel mercuriel de nymphéa ou. de violettes,
eny^ron quatre onces deux onces de pulpe
deçaffe ; on fera enfin obferver à l’animal un régime
toujoursje^aét ; & s’il eft encore befoin d’évacuer ,
on pourra terminer la cure par un purgatif : car ces
fortes de médicamens ne font funeftes qu’autant qu’ils
font, très-mal compofés par les maréchaux,ou donnés
avant que l’irritation foit appaifée.
Une écurie dans laquelle l’air fera pur, froid,
& fouyent renouvellé , fera très-convenable au
cheval, attaqué de la fièvre ardente. Elle demande
dans lès commencemens, fur-tout fi elle eft avec toutes
les marques d’inflammation que j’ai défignées, les
fecours.de la faignée. La boiflon de l’animal fera
tiede, abondante; on aura attention d’y jetter du
cryftal minéral. Si on peut lui faire avaler quelque
chofe avec la c o rn e o n lui donnera de la déco&ion
émolliente dans laquelle on aura ajouté des gouttes
d’eau de rabel, julqu’à ce qu’elle ait acquis une certaine
acidité. On coupera avec cette même décoction
émolliente, le lait de vache écrémé dont on
compofera des lavemens en y mêlant deux ou trois
jaunes d’oeufs : s’il en eft befoin,on pourra employ er
en même tems le firop de pavot blanc, à la dofe de
trois onces ; les indications devant nous diriger dans
le choix des clyfteres. La vapeur de l’eàu chaude
déterminée dans fes nafaux, des injeâions pouflées
pa rla même voie dans l’arriere-bouche, & faites
avec une déeoélion de feuilles d’alléluya , & quelques
gouttes d’efprit de fouffe ou d’eau de rabel, feront
encore très-utiles : il s’agira en un mot de mettre
fin à la contraâion des fibres , par tous les
moyens poflibles , de délayer exactement les liqueurs,
& d’évacuer infenfiblement par les urines,
par l’infenfible tranfpiration,tout ce qui peut entretenir
la maladie.
La faignée , les purgatifs doivent être proferits
dans laJîevre peftilentielle : il en eft de même de la
boiffon nitrée , attendu l’abattement confidérable
des forces. Si néanmoins Fanimal n’eft pas beaucoup
affaiffé, & 1i l’on remarque une agitation très-vive
dans les folides & dans les fluides, ainfi que tous les
fymptomes qui l’annoncent, on pourra tenter avec
la plus grande circonfpeélion, de l’appaifer par des
lavemens, & en lui ouvrant la veine. Cet objet remp
li, on aura recours à des cordiaux tempérés, tels
que les eaux de chardon bénit, de feorfonere & de
feabieufe,qu’on lui donnera avec la corne : peu-à-peu
,on paffera de ces cordiaux tempérés à des cordiaux
plus chauds & plus aélifs, tels que le diaphorétique
minéral, le bèzoard, la poudre de viperes, le fel vo latil
de corne de cerf, la thériaque, 6-c. dont l’effet
eft dè -chaffer & de pouffer à l’habitude du corps la
matière morbifique, & par lefquels il eft à propos de
; débuter, lorfque le cheval eft , pour ainfi dire ,
' anéanti.
f A l’égard des tumeurs critiques , notre but principal
doit être d’attirer le venin au-dehors, en favo-
'rifarit la fuppuration, pour rendre la crife parfaite.
'O n émployera pour y parvenir le cataplafme matu-
ratif fait avec le levain , l’ofeille, le bafdicum, la
fiente de pigeon:mais on appliquera, s’il eft néceffai-
r e , lès ventoufes fur le bubon qui dès que nous ap-
percevrons de la fluctuation, fera ouvert avec un
F I F
bouton de feu. Nous entretiendrons la fuppuration
jufqu’à ce que toute la dureté foit confumée : après
quoi nous détergerons l’ulcere, nous le mondifie-
rons, & nous le conduirons à une parfaite cicatrice
; fauf à mettre enfuite en ufage les purga'tifs pour
terminer entièrement la cure, (e)
FIFE ( Géog. ) Otlioliriia, province méridionale
d’Ecoffe , bornée au nord par le-golfe de Fai ; à
l’orient:, par la mer; au midi, par le golfe de
Forth ; & à l’oiieft, par les monts Qrchell ( Ochell-
hills ) : elle fe divife fort communément en orient &
occident. L’air y eft b on , & fes bords font fertiles
en blé & en pâturages. Saint-André en eft la capitale.
Cette province fut d’abord nommée Rofs, c’eft-
à-dire prefqu’ifle ; & en effet, c’en eft une, qui fut
.réunie à la couronne fous le régne de Jacques I.
M. de Lifle met la pointe la plus orientale de la province
de Fife , dite Fife-nefs, à 16 deg. 20 min. d©
■ long. & fa latit. à 56 deg. 27 min. ( D . J. )
* FIFRE, luth, infiniment à v e n t , .de la nature
des petites flûtes : il y en a de deux efpeces,l’une qui
s’embouche comme la flûte allemande , & l’autre
qui eft à bec : voye\-ces deux fifres dans nos Planches.
Le fifre s’accompagne ordinairement du tambour.
Son étendue commune n’eft que d’une quinzième.
Il eft percé de fix trous , fans compter celui
du bout ni celui de l’embouchure. Son canal eft
court & étroit, & fes fons vifs ôcéclatans : voici fa
tablature.
Pouf faire bien parler cet infiniment, il faut que
la langue & la levre agiffent de concert ; c’eft ce
mouvement compofé qui articule les fons.
Lz fifre eft une efpece de flûte qui fert au bruit
militaire , & qui rend un fon fort aigu : il y en avoit
autrefois dans toutes les compagnies d’infanterie ;
mais il n’y en a prefque plus aujourd’hui que dan9
les compagnies de Suiffes ; ce font eux qui ont apporté
cet infiniment en France : il y étoit en ufage
dès le tems de François I.
FIG A LE, f. f. ( Marine ) C ’eft un bâtiment dont oft
fe fert dans l’inde, qui ne porte qu’un mât qui eft
placé au milieu ; il y a une dunette qui eft toute ouverte
, & qui fait une petite faillie fur l’eau ; il v a
toûjours à la rame , quoique la voile foit déployée:
à l ’avent il n’y a qu’une piece de bois en pointe qui
fert d’épéron. (Z )
F1GÉAC, {Géog. ) bourg de France dans le Quer-
c y , avec une ancienne abbaye de l’ordre de faint
Benoît, fondée parle roi Pépin , où dont le monaf-
tere fut rebâti par ce prince l’an 75 5 : elle fut fécu-
larifée par le pape Paul III. Figeac eft fur la Selle, à
9 lieues N. E. de Cahors, & 19 lieues N. O. d’Alb»,
Long. i9 d. 40'. latit. 44e*.40'. { D . J . )
FIGEN ( Géog. ) province du Japon dans l’ifle d©
Ximo : c’eft dans cette province que fe fait toute la»
porcelaine du Japon : la matière dont on la forme
eft un argille blanchâtre qui fe tire en grande quantité
du voifinage d’Urifano & de Suwota , fur des
montagnes qui n’en font pas fort éloignées. (Z ? ./ .)
* FIGER, {Je) verbe paf. c’eft prendreune confi-
flence molle par l’évaporation, le refroidiffement
ou une autre caufe : on fait que la chaleur mettant les
parties des corps en mouvement, les écarte les unes
des autres ; qu’à mefure que la chaleur ceffe, le mouv
e m e n t c e f f e , q u e l a d i l a t a t i o n q u e x p a n f i o n d im i - ;
n u e , q u e l e s p a r t i e s f e r a p p r o c h e n t & q u e l le s p e u v
e n t s ’ a p p l i q u e r l e s u n e s a u x a u t r e s , d e m a n i é r é
q u e l e c o r p s p e r d e f o n é t a t d e f lu id i t é : l ’ é v a p o r a t i o n
p r o d u i t a u f f i l e s m ê m e s e f f e t s ; m a i s o n n e d i t g u e r e ,
q u e d e s c i r e s , d e s h u i l e s , d e s g r a i f f e s , & d e s v l i - ]
q u e u r s a n im a l e s , q u ’ e l l e s f e figent-. Foye^ G l a c e .
FIGUERIE, f. f. ( jardinage ) lieu oii on éleve
des figuiers. Dans les grands potagers , il y a toujours
un.pëtit jardin féparé pour ces arbres, de même
qu’une melonniere. {K ) -
FIGUIER, f. m. ( Hift. nat. bot. ) ficus ^ genre de
plantesdont les fleurs,au rapport deValerins-Cordus, ;
naiffent dans la cavité du fruit en formé de petits fi-
lets qui tiennent à une forte d’enveloppe qui renferme
une femence ordinairement arrondie : le fruit
eft le plus fouvent en forme de poire ou arrondi ou
ovoïde ; il eft charnu ,-mol, & n’a prefque point de
pédicule. Tournefort, injl. rei herb. Voyeç PLANTE.
CO . , . I
Les caraéleres du figuier ont été parfaitement établis
par nos botaniftes modernes , par Tournefort,
Miller , Boerhaave , & fur-tout par Linnæus.
Ses fleurs, dit Miller, toûjours renfermées au mi-.
lieu du fru it, font monopétales, mâles &c femelles.
Les fleurs mâles font fituées autour de la couronne
du fruit ; les femelles croiffent près du pédicule , &
font fuccédées par de petites graines dures : le fruit
entier eft de figure de poire, ronde ou ovale, charnu
, fucculent, & d’une faveur douce.
Boerhaave caraélerife ainfi le figuier : de. l’extrémité
du pédicule, part un petit calice à trois pièces,
d’où naît le péricarpe , enfermé dans une membrane
tant-foit-peu épineufe, & rétrécie au fommet du
fruit ; il y forme un ombilic , & s’infere dans plu-
fieurs petites feuilles écailleufes & pointues par le
b o u t , couchées’fiicceflivement les unes fur les autres
, & couvrant prefque entièrement la cavité du
péricarpe. Les feuilles extérieures foûtenues par des ,
pédicules forts, s’appliquent étroitement enfemble,
& celles qui font les plus avancées en-dedans , n’ont
point de pédicule : de la cavité du péricarpe , partent
circulairement des fleurs longues , tubuleufes,
à plufieurs pétales, hermaphrodites, avec des ovaires
qui font autant de capfules teftacées , croiffant
les unes dans les autres, rudes, formant des gouffes
pulpeufes.
Notre illuftre botanifte fait mention de huit efpeces
de figuiers communs, Miller de quinze, Tournefort
de dix-fept ; mais de ce grand nombre d’ef-
peces, nous ne parlerons que du figuier domeftique,
& du figuier fauvage ordinaire ; car il n’y a pas un
moindre nombre d’efpeces de figuiers fauvages, &
de figuiers exotiques , qu’il y en a de cultivés.
Le figuier commun cultivé , s’appelle en grec
av-Av «/Atpov., & par les botaniftes ficus , ficus commun
s , ficus fativa, S ic. c’eft un arbre d’une hauteur
médiocre , branchu, touffu ; fon tronc n’eft pas tout-
à-fait droit; fon écorce n’eft pas unie, mais un peu
raboteufe, fur-tout lorfqu’il eft vieux : fon bois eft
blanchâtre, mou , moelleux, il n’eft; pas employé :
fes feuilles font amples , découpées en maniéré de
main ouverte , partagées en cinq parties , & ayant
cinq angles ; elles font rudes , dures, & d’un verd
, foncé : les fruits naiffent auprès de l’origine des
feuilles, fans aucune fleur apparente qui ait précédé
f ils font petits dans le commencement, groflif-
fent peu-à-peu , verds d’abord, enfuite pâles , rougeâtres,
ou tirant fur le violet ; ils font tous moelleux
, mous, & remplis d’une infinité de petits grains;
fr l’on bleffe ces fruits avant leur maturité, ou la
queue des feuilles, ou l’écorce nouvelle du figuier ,
il en fort un fuc laiteux, acre & amer.
Cette plante n’eftpas privée de fleurs^ coflitne plufieurs
l’ont cru ; mais elles font Cachées dans le fruit
même , comme Tournefort l’avoit foupçonné après
Valerius-Cordus; quoique ni lui ni les autres bota-
niftesn’ayent connu les vraies parties ëffentiellesde
:ces fleurs, jufqu’à l’année 1712 , que M. de la Hire ,
médecin , & membre de l’académie des Sciences, a
découvert & démontré publiquement dans cette célèbre
académie , les étamines des figues , & leurs
fommetS'couverts d’une pouffierè très-fine ’; càr M.
Tournefort avoit pris pour les fleurs , de Certains
filamens extrêmement fins, qui fortent des enveloppes
qui renferment la graine , & même1 lès piftiles
, de ces mêmes graines ; mais-comme les parties naturelles
des fleurs font, fur - tout les étamines & les
- fommets, pleines d’une poufliere très-fine,& que les
filamens de Tournefort ne font point garnis dè ces 1
fommets , ils ne doivent pas être appellés fleurs,
fur-tout fi lbn trouve de ces étamines ailleurs garnies
de leurs fommets. La fleur dans cette plante eft
.donc renfermée dans le fruit lui-même ; où plûtôt
le fruit eft le calice , dans lequel la fleur & les graines
font cachées.
Voici quelle eft la difpofition & la forme des différentes
fleurs du figuier , félon M. Linnæus ( £«-
nera Plant. j jG ) . Le calice des fleurs eft commun ,
ou plûtôt c’eft la figue elle-même ; il eft en forme de
poire , très-gros , charnu , creux, fermé à fa partie
fupérieure par beaucoup d’écailles triangulaires,
pointues, dentelées & recourbées. Sa furfacè interne
eft toute couverte de petites fleurs, dont les extérieurs
, ou les plus proches de ces écailles font
les fleurs mâles , qui font en petit nombre ; & ati-
deffous de celles-là, font les fleurs femelles en très-
grand nombre.
Chaque fleur mâle a fon pédicule , & fon propre
calice partagé en trois, quatre & cinq parties, dont
les découpures font en forme de lance , droites ,
égalés, fans pétales : elle a trois étamines ou cinq.
Selon Ponthedera, ce font des filets déliés de la longueur
du calice , qui portent chacun un fommet à
deux loges, & entre ces étamines eft une apparence
de piftiles. Les fleurs femelles ont chacune leur
pédicule, & leur calice propre partagé en cinq part
ies, dont les découpures font pointues en forme de
lance, droites, prefqu’égates,mais fans pétales. L’embryon
eft ovalaire, & de la longueur du calice propre
; il eft furmonté d’un ftile en forme d’alêne qui
fort de l’embryon, à côté de fon fommet : ce ftile
eft terminé par deux ftigmates pointus & réfléchis ,
dont l’ùn eft plus court que l’autre : le calice eft placé
obliquement & contient une feule graine affez
grofie, arrondie & applatie.
Le fuc du figuier tiré de l’arbre par incifion , ou
exprimé des feuilles, eft c lair, laiteux, amer, acre
& chaud. Il enieve la peau & l’excorie ; on s’en fert
même pour extirper les porreaux appellés myrmè-
ciai ; quelques-uns le préparent, & en font un dé-
terfif, pour, appliquer extérieurement dans les maladies
cutanées ; mais nous avons de beaucoup meilleurs
remedes. L’acidité du même fuc fait coagulée
le la it , & le met en fromage ; cela doit être.
Il entre encore dans la claffe de ces écritures fym-
pathiqiies , qui ne font vifibles qu’en les chauffant ;
c’eft-à-dire que fi l’on trace des lettres fur un papier
avec le la it , ou le fuc des jeunes branches de
figuier, elles difparoîtront ; pour les lire il faut approcher
le papier du feu ; lorfque ce papier fera
fort échauffé , alors les caraéleres deviendront lifi-
bles ; c’eft une expérience fort connue ; & l’on fait
que le fuc du figuier la partage non-feulement avec le
vinaigre , le fuc du limon , & les autres acides,
mais de plus, toutes les infufions, & toutes les dif-
folutions , dont la matière diffoute, peut fe brûler à
très-petjt feu , & fe réduire en une efpece de çhar^