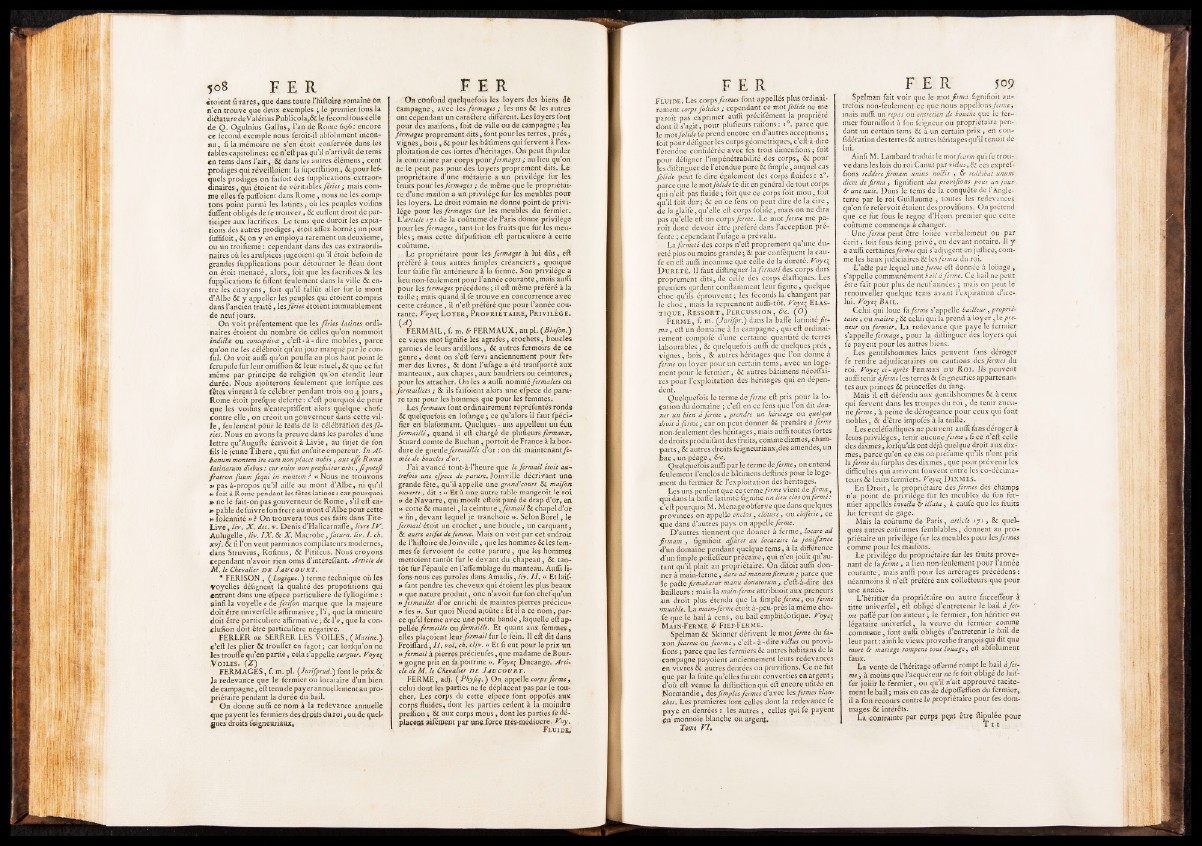
«toient fi rares, que dans toute l’hiftoîre romaînè ôn
n’en trouve que deux exemples ; le premier.fous la
diftature deValérius Publicola,,& le fécond ions-celle
de Q. Ogulnius Gallus, l’an de Rome 696 : encore
ce fécond exemple nous feroit-il abfolument inconnu,
li la, mémoire ne s’en étoit conferyée dans les
tables capitolines : ce n’eft pas qu’il n’arri:vât de temS
en tems dans l’air , & dans les autres élémens, cent
prodiges qui réveilloient la fuperftition, & pour lef-
quels prodiges on faifoit des fupplications extraordinaires
, qui étoient de véritables^râtf ■; mais comme
elles fe pafloient dans Rome, nous ne les comptons
point parmi les latines, où les peuples voifins
fuffcnt obligés de fe trouver, & eufl'ent droit de participer
aux facrifïces. Le tems que duroit les expiations
des autres prodiges, étoit aflez borné ; un jour
fuffifoit, & on y en employa rarement un deuxieme,
ou un troifieme : cependant dans des cas extraordinaires
où les arufpices jugeçient qu’il étoit befoin de
grandes fupplications pour détourner le fléau dont
on étoit menacé, alors, foit que les facrifïces & les
fupplications fe fiffent feulement dans la ville & entre
les citoyens, foit qu’il fallut aller fur le mont
d’Albe & y appeller les peuples qui étoient compris
dans l’ancien traité, les fériés étoient immuablement
de neuf jours.
On voit préfentement que les fériés latines ordinaires
étoient du nombre de celles qu’on nommoit
indiclce ou conceptiva , c’eft - à - dire mobiles, parce
qu’on ne les célébroit qu’au jour marqué par le con-
lul. On voit auflî qu’on pouffa au plus haut point le
fcrupule fur leur omiflion & leur rituel, & que ce fut
même par principe de religion qu’on étendit leur
durée. Nous ajouterons feulement que lorfque ces
fêtes vinrent à fe célébrer pendant trois ou 4 jours,
Rome étoit prefque deferte : c’eft pourquoi de peur
que les voifins n’entrepriffent alors quelque chofe
contre elle, on créoit un gouverneur dans cette ville
, feulement pour le tems de la célébration des fériés.
Nous en avons la preuve dans les paroles d’une
lettre qu’Augufte écrivoit à L iv ie , au fujet de fon
fils le jeune T ibere, qui fut enfuite empereur. In Al-
banum montent ire eum nonplacet nobis, aut ejje Romat
latinarum diebus : cur enim non prxficitur urbi , fipotefi
fratrem fuum fequi in montem ? « Nous ne trouvons
» pas à-propos qu’il aille au mont d’Albe, ni qu’il
*> foit à Rome pendant les fêtes latines : car pourquoi
» ne le fait-on pas gouverneur de Rome, s’il eft ca-
» pable de fuivre fon frere au mont d’Albe pour cette
h lolennité »? On trouvera tous ces faits dans Tite-
L iv e , liv. X . dec. v. Denis d’Halicarnaffe, livre I F '.
Aulugelle, liv. IX . & X . Macrobey fatum. liv. I. ch.
x v j . & fi l’on veut parmi nos compilateurs modernes,
dans Struvius, Rofinus, & Pitifcus. Nous croyons
cependant n’avoir rien omis d’intéreffant. Article de
M. le Chevalier D E J a ü C O U R T .
* FERISON , ( Logique. ) terme technique où les
voyelles défignent la qualité des propofitions qui
entrent dans une efpece particulière de fyllogifme :
ainfi la voyelle e de ferifon marque que la majeure
doit être univerfelle affirmative ; m , que la mineure
doit être particulière affirmative ; & 10, que la con-
clufion doit être particulière négative.
FERLER ou SERRER LES VOILES, (Marine.}.
c ’eft les plier & trouffer en fagot ; car lorfqu’on ne
les trouffe qu’en partie, cela s’appelle carguer. Foyeç
.Vo i l e s . ( Z )
FERMAGES, f. m. pl. (Jurifprud.) font le prix &
)a redevance que le fermier ou locataire d’un bien
de campagne, eft tenu de payer annuellement au propriétaire
pendant la durée du bail.
On donne auffi ce nom à la redevance annuelle
que payent les fermiers des droits du roi, ou de quelques
droits feigneuriavue*
On confond quelquefois les loyers des biefts dé
Campagne, avec les fermages ; les uns & les autres
ont cependant un caraftere différent. Les loyers font
pour des maifons, foit de ville ou de campagne ; les
fermages proprement dits, font pour les terres, prés,
vignes, bois, & pour les bâtimens qui fervent à l’exploitation
de ces fortes d’héritages. On peut ftipuler
la,contrainte par corps pour fermages ; ait lieu qu’on
ne le peut pas pour des loyers proprement dits. Le
propriétaire d’une métairie a un privilège fur les
fruits pour les fermages ; de même que le proprietaire:
d’une maifon a un privilège fur les meubles pour
les loyers. Le droit romain ne donne point de privilège
pour les fermages fur les meubles du fermier.
L’article 171 de la coutume de Paris donne privilège
pour les fermages, tant fur les fruits que fur les meubles
; mais cette difpofition eft particulière à cette
coutume. -
Le propriétaire pour les fermages à lui dûs, eft
préféré à tous autres fimples créanciers, quoique
leur faillie fût antérieure à la fienne. Son privilège a
lieu non-feulement pour l’année courante, mais aufli
pour les fermages précédens ; il eft même préféré à la
taille ; mais quand il fe trouve en concurrence avec
cette créance, il rt’eft préféré que pour l’année courante.
FoyeiL o y e r , PROPRIÉTAIRE, PRIVILÈGE.
(■ ^)
FERMAIL, f. m. & FERMAUX, au pl. (.Blafon.f
ce vieux mot fignifïe les agrafes, crochets, boucles
garnies de leurs ardillons, & autres fermoirs de ce
geijre, dont on s’eft fervi anciennement pour fermer
des livres, & dont l’ufage a été tranfporté aux
manteaux, aux chapes, aux baudriers ou ceintures ,
pour les attacher. On les a auffi nommé fermalets ou
fermaillets ; & ils faifoient alors une efpece de parure
tant pour les hommes que pour les femmes.
Les fermaux font ordinairement repréfentés ronds
& quelquefois en lofange ; ce qu’alors il faut fpéci-
fier en blafonnant. Quelques - uns appellent un écu
fer maillé} quand il eft chargé de plusieurs fermaux.
Stuard comte de Buchan, portoit de France à la bordure
de gueule fermaillée d’or : on dit maintenant filmée
de boucles d'or.
J’ai avancé tout-à-l’heure que le fermail étoit autrefois
une efpece de parure. Joinville décrivant une
grande fête, qu’il appelle une grand'court & maifon
ouverte, dit : « Et à une autre table mangeoit le roi
» de Navarre, qui mouit eftoit paré de drap d’or, en
» cotte & mantel, la ceinture f fermail & chapel d’or
» fin, devant lequel je tranchoie ». SelonBorel, le
fermail étoit un crochet, une boucle, un carquant,
& autre atifet de femme. Mais on voit par cet endroit
de l’hiftoire de Joinville, que les hommes & les femmes
fe fervoient de cette parure, que les hommes
mettoient tantôt fur le devant du chapeau, & tantôt
fur l’épaule en l’affemblage du manteau. Aufli li-
fons-nous ces paroles dans Amadis, liv. II. « Et laiR
» fant pendre fes cheveux qui étoient les plus beaux
» que nature produit, onc n’a voit fur fon chef qu’un
» fermaillet d’or enrichi de maintes pierres précieu-
» fes ». Sur quoi Nicod âjoûte : Et il a ce nom, parce
qu’il ferme avec une petite bande, laquelle eft ap-
pellée fermeille ou fcrmaillc. Et quant aux femmes ,
elles plaçoient leur fermail fur le fein. Il eft dit dans
Froifiard, II. vol. ch. cljv. « Et fi eut pour le prix un
»fermait à pierres précieufes, que madame de Bour-
» gogne prit en fa poitrine ». Foye{ Ducange. Article
de M. le Chevalier D E J AV CO U R T .
FERME, adj. ( Phyfiq. ) On appelle corps ferme ,
celui dont les parties ne fe déplacent pas par le toucher,
Les corps de cette efpece font oppofés aux
corps fluides» dont les parties cedent à la moindre
preflion ; & aux corps mous, dont les parties fe déplacent
aiférpent par una force très-médiocre. F>y*
Fluide*
F lu id e . Les corps fermes font appelles plus ordinài- I
rement corps folides ; cependant ce mot folide ne me
paroît pas exprimer aufli précifément la propriété
dont il s’agit, pour plufieurs raifons : i° . parce que
le mot folide fe prend encore en d’autres acceptions ;
foit pour défigner les corps géométriques, c’eft-à-dire
l’étendue confidérée avec fes trois dimenfions ; foit
pour défigner l’impénétrabilité des corps, & pour
les diftinguer de l’étendue pure & fimple, auquel cas
folide peut fe dire également des corps fluides : 20.
parce que le mot folide fe dit en général de tout corps
qui n’eft pas fluide ; foit que ce corps foit mou, foit
qu’il foit dur; & en ce fens on peut dire de la c ire ,
de la glaife, qu’elle eft corps folide, mais on ne dira
pas qu’elle eft un corps ferme. Le mot ferme me paroît
donc devoir être préféré dans l’acception préfente
; cependant l’ufage a prévalu.
La fermeté des corps n’eft proprement qu’une dureté
plus ou moins grande ; & par conféquent la cau-
fe en eft aufli inconnue que celle de la dureté. Vyyeç
D u r e t é . Il faut diftinguer la,fermeté des corps durs
proprement dits, de celle des corps elaftiques. Les
premiers gardent conftamment leur figure, quelque
choc qu’ils éprouvent ; les féconds la changent par
le choc, mais la reprennent aufli-tôt. Voyt{ E la s t
iq u e , R e s s o r t , P e r c u s s io n , &c. (O)
F e r m e , f. m. (Jurifpr.) dans la baffe latinité firma
y eft un domaine à la campagne, qui eft ordinairement
compofé d’une certaine quantité de terres
labourables, & quelquefois aufli de quelques prés ,
vignes, bois, & autres héritages que l’on donne à
ferme ou loyer pour un certain tems, avec un logement
pour le fermier, & aiitres bâtimens néceflai-
res pour l’exploitation des héritages qui en dépendent.
Quelquefois le terme de ferme eft pris pour la location
du domaine ; c’eft en ce fens que l’on dit donner
un bien à ferme , prendre un héritage ou quelque
droit à ferme; car on peut donner & prendre à ferme
non-feulement des héritages, mais aufli toutes fortes
de droits produifantdes fruits, comme dixmes, cham-
parts, & autres droits feigneuriaux,des amendes, un
b a c , un péage, &c.
Quelquefois aufli par le terme d e ferme, on entend
feulement l’enclos de bâtimens deftinés pour le logement
du fermier & l’exploitation des héritages.
Les uns penfent que ce term e ferme vient de firma,
qui dans la baffe latinité lignifie un lieu clos ou fermé :
c ’eft pourquoi M. Ménage obferve que dans quelques
provinces on appelle enclos, clôture, ou cloferie, ce
que dans d’autres pays on appelle firme.
D ’autres tiennent que donner à ferme, locare ad
Jirmam , fignifioit ajjûrer au locataire la joùijfance
d’un domaine pendant quelque tems, à la différence
d’un fimple poffefleur précaire, qui n’en joiiit qu’au-
tant qu’il plaît au propriétaire. On difoit aufli donner
à main-ferme, dure admanumfermant; parce que
le pafte frmabatur manu dondtorumc’eft-à-dire des
bailleurs : mais la main-ferme attribuoit aux preneurs
droit plus étendu que la fimple firme 9 ou ferme
■ >muable. La main-ferme étoit à-peu-près la même chofe
que le bail à cens, ou bail emphitéotique. Foye^
M a in -Fe rm e & F ief-Fe r m e .
Spelman & Skinner dérivent le mot firme du fa-
xon fearme ou ftorme, c’eft-à-dire victus ou provi-
fions ; parce que les fermiers & autres habitans de la
campagne payoient anciennement leurs redevances
en vivres & autres denrées ou provifions. Ce ne fut
que par la fuite qu’elles furent converties en argent ;
d’où eft venue la diftinftion qui eft encore ufitée en
Normandie, des fimples fermes d’avec les fermes blanches.
Les premières font celles dont la redevance fe
paye en denrées : les autres , celles qui fe payent
çn monnoie blanche ou argenj.
Tçmt FI«
Spelman fait voir que le mot fe rm a fignifioit autrefois
non-feulement ce que nous appelions f e rm e ,
mais aufli un r epas ou en tr e t ien d e bo u c h e que le fermier
fourniffoit à fon feigneur ou propriétaire pendant
un certain tems & à un certain prix > en con-
fidération des terres & autres héritages qu’il tenoit de
lui.A
infi M. Lambard traduit le motfearm qui fe trou-.
v e dans les lois du roi Canut par viclus, &: ces expref-
fions reddtre jirmam unius noctis , 6* reddebat ununi,
diem de ferma, fignifient des provifions pour un jour .
& une nuit. Dans le tems de la conquête de l’Angleterre
par le roi Guillaume , toutes les redevances
qu’on fe refervoit étoient des provifions. On prétend
que ce fut fous le régné d’Henri premier que cette
coûtume commença à changer.
Une f e rm e peut être loiiée verbalemeut ou par
écrit, foit fous feing privé, ou devant notaire. Il y
a aufli certaines fe rm e s qui s’adjugent en juftice, comme
les baux judiciaires & les fe rm e s du roi.
L’afte par lequel une fe rm e eft donnée à loiiage ,
s’appelle communément b a i l à fe rm e . Ce bail ne peut
être fait pour plus de neuf années ; mais on peut le
renouveller quelque tems avant l’expiration d’ice-
lui. F o y e [ B a i l .
Celui qui loue fa f e rm e s’appelle b a i l l e u r , p r o p r ié ta
ir e , ou m a îtr e ; & celui qui la prend à lo y e r , le p r e n
e u r ou f e rm ie r . La redevance que paye le fermier
s’appelle f e rm a g e , pour la diftinguer des loyers qui
fe payent pour les autres biens.
Les gentilshommes laïcs peuvent fans déroger
fe rendre adjudicataires ou cautions des fe rm e s du
roi. F o y e^ c i - a p r è s F e rm e s d u R o i . Ils peuvent
aufli tenir à fe rm e les tejres & feigneuries appartenant
tes aux princes & prineefles du fang.
Mais il eft défendu aux gentilshommes &: à ceux
qui fervent dans les troupes- du r o i , de tenir aucune
f e r m e , à peine de dérogeance pour ceux qui font
nobles, & d’être impofés à la taille.
Les eceléflaftiques ne peuvent aufli fans déroger à
leurs privilèges, tenir aucune f e rm e , fl ce n’eft celle
des dixmes, lorfqu’ils ont déjà quelque droit aux dixmes,
parce qu’en ce cas on prefume qu’ils n’ont pris
la fe rm e : du furplus des dixmes, que pour prévenir les
difficultés qui arrivent fouvent entre les ço-décima-
teurs & leurs fermiers. V o y e { D ix m e s .
En D ro it, le propriétaire des fe rm e s dés .champs
n’ a point de privilège fur les meubles, de fon fermier
appellés ih v e e la & i l l a t a , à caufe que les fruits
lui;fervent de gage.
Mais la coûtume de Paris, a r t ic le 1 7 1 , & quelques
autres coûtumes femblables, donnent au propriétaire
un privilège fur les meubles pour les./ê/væ«
comme pour les maifons.
Le privilège du propriétaire fur les fruits provenant
de fa f e r m e , a lieu non-feulement pour l’année
courante, mais aufli pour les arrérages précédens :
néanmoins il n’eft préféré aux collefteurs;que pour
une année,
L’héritier du propriétaire ou autre fuccefleur à
titre univerfel, eft obligé d’entretenir le bail à f e r m
e pafTé par fon auteur ; le fermier, fon héritier ou
légataire univerfel, la veuve du fermier comme
commune, font aufli obligés d’entretenir le bail de
leur part : ainfi le vieux proverbe françois qui dit que
m o r t & m a r ia g e r om p e n t t o u t l o u a g e , eft abfolument
faux. . (
La vente de l’héritage affermé rompt le bail a f e r m
e , à moins que l’acquéreur ne fe foit oblige de laii-
fer jouir le fermier, ou qu’il n’ait approuve tacitement
le bail ; mais en cas de dépofleflion du fermier,
il a fon recours contre le propriétaire pour fes dommages
& intérêts. f
La contrainte par corps peut être ftipulee pour
T 1 1