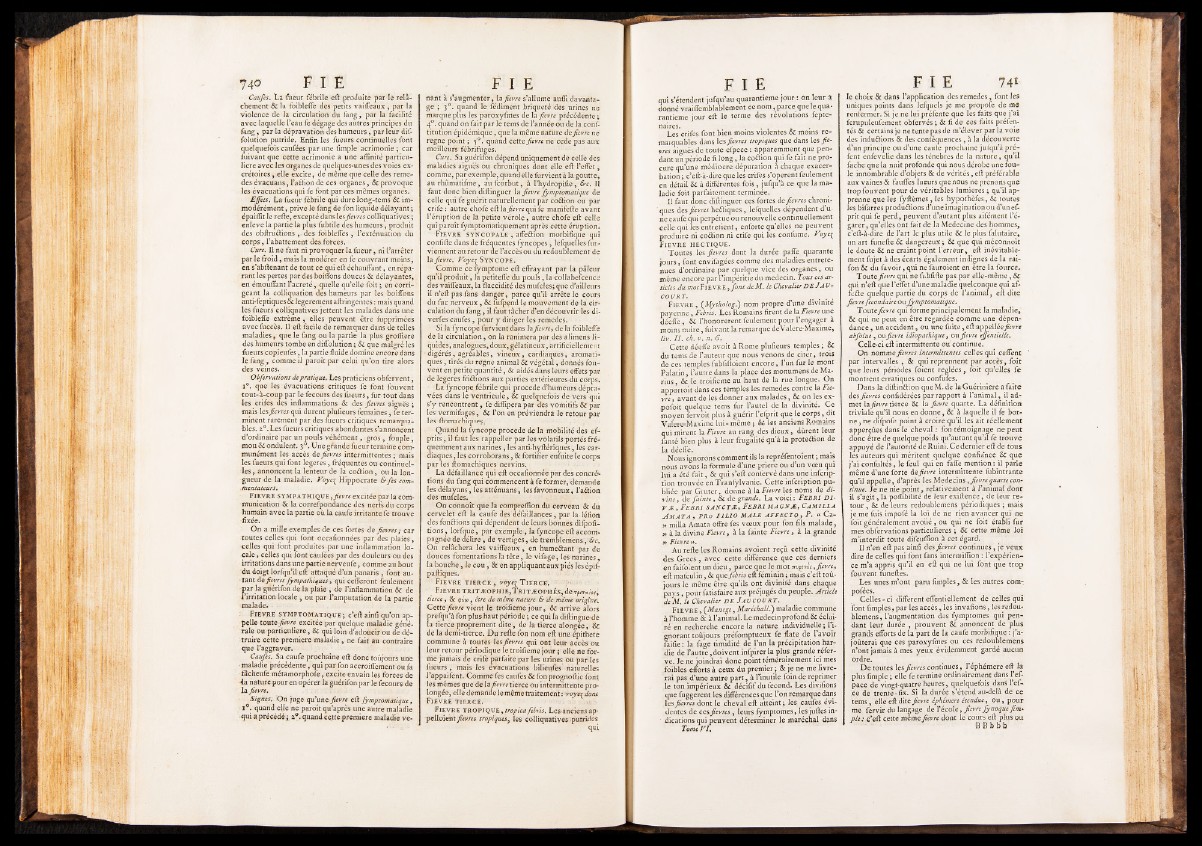
H H
740 F I Ë «
» 1 1 1 1
Caufes. La ftiëur fébrile eft produite par lé relâchement
& la foibleffe des petits vaifleaux, par la
violence de la circulation du fang, par la facilité
avec laquelle l’eau fe dégage des autres principes du
fang, par la dépravation des humeurs , par leur dif-
folution putride. Enfin les Tueurs continuelles font
quelquefois caufées par une fimple acrimonie ; car
fuivant que cette acrimonie a une affinité particulière
avec les organes de quelques-unes des voies excrétoires
, elle excite, de même que celle des reme-
des évacuans, l’a&ion de ces organes, & provoque
les évacuations qui fe font par ces mêmes organes.
Effets. La fueur fébrile qui dure long-tems & immodérément
, prive le fang de fon liquide délayant ;
épaiffit le refte, excepté dans lesfievres colliquatives ;
enleve la partie la plus fubtile des humeurs, produit
des obftru&ions ,-des foibleffes , l’exténuation du
corps, l’abattement des forces.
Cure. Il ne faut ni provoquer la fueur, ni l’arrêter
par le froid, mais la modérer en fe couvrant moins,
en s’abftenant de tout ce qui eft échauffant, en réparant
les pertes par des bornons douces & délayantes,
en émouffant l’acreté, quelle qu’elle foit; en corrigeant
la colliquation des humeurs par les boiffons
anti-feptiques legerement aftringentes : mais quand
lés Tueurs colliquatives jettent les malades dans une
foibleffe extrême, elles peuvent être fupprimées
avec fuccès. Il eft facile de remarquer dans de telles
maladies 9 que le fang ou la partie la plus grofliere
des humeurs tombe en diffolution ; & que malgré les
Tueurs copieufes, la partie fluide domine encore dans
le Tang , comme il paroît par celui qu’on tire alors
des veines.
Obfervations de pratique. Les praticiens obfervent,
i°. que les évacuations critiques fe font fouvent
•tout-à-coup par le fecours des Tueurs, fur-tout dans
les crifes des inflammations & des fievres aiguës ;
mais les fievres qui durent plufieurs femaines, le terminent
rarement par des Tueurs critiques remarquables.
20. Les Tueurs critiques abondantes s’annoncent
d’ordinaire par un pouls véhément, gros , Toupie,
mou & ondulent. 30. Une grande Tueur termine communément
les accès de fievres intermittentes ; mais
les Tueurs qui font legeres, fréquentes ou continuelles
, annoncent la lenteur de la cofrion, ou la longueur
de la maladie. Voye{ Hippocrate &fes com-
■ mentateurs.
F i e v r e s y m p a t h i q u e , fièvre excitée par la communication
& la correfpondance des nerfs.du corps
humain avec la partie où la caufe irritante fe trouve
-fixée.
On a mille exemples de ces fortes de fievres ; car
toutes celles qui font ©ccafionnées par des plaies,
-celles qui font produites par une inflammation loca
le, celles qui font caufées par des douleurs ou des
irritations dans une partie nerveufe, comme au bout
du doigt lorfqu’il eft attaqué d’un panaris , font autant
de fievres fympathiques, qui cefferont feulement
par la gùérifon de la plaie , de l’inflammation & de
l’irritation locale , ou par l’amputation de la partie
; malade.
: F i e v r e s y m p t o m a t i q u e ; c’eft ainfi qu’on appelle
toute fievre excitée par quelque maladie générale
ou particulière, & qui loin d’adoucir ou de détruire
cette première maladie, ne fait au contraire
que l’aggraver.
Caufes. Sa caufe prochaine eft donc toujours une
•maladie précédente, qui par fon accroiffement ou fa
fâcheufe métamorphofe, excite envain les forces de
-4a nature pour en opérer la gùérifon par le fecours de
la fievre.
Sighes. Oh juge qu’une-fievre eft fymptomatique ,
i ° . quand elle ne paroît qu’après une autre maladie
qui a précédé; 20. quand cette première maladie ve-
F I E
rtarit à s’augmenter, la fievre s’allume aufli davantage
; 30. quand le fédiment briqueté des . urines ne-
marque plus les paroxyfmes de la fievre précédente ;
40. quand on fait par le tems de l’année ou de la conf-
titution épidémique, que la même nature de fievre ne
régné point ; 50. quand cette fievre ne cede pas aux
meilleurs fébrifuges.
Cure. Sa gùérifon dépend uniquement de celle des
maladies aiguës ou chroniques dont elle eft l’effet,
comme, par exemple, quand elle furvient à la goutte,
au rhûmatifme, aufeorbut, à l’hydropifie, &c. Il
faut donc bien diftinguer la fievre fymptomatique de
celle qui fe guérit naturellement par cofrion ou par
crife : autre chofe eft la fievre qui fe manifefte avant
l’éruption de la petite vérole, autre chofe eft celle
qui paroît fymptomatiquement après cette éruption.
F i e v r e s y n c o p a l e ; a f f e f r i o n m o r b i f iq u e q u i
c o n f i f t e d a n s d e f r é q u e n t e s f y n c o p e s , l e f q u e l l e s f u r -
v i e n n e n t a u r e t o u r d e l ’ a c c è s o u d u r e d o u b l e m e n t d e
l a fievre. Voyt{ S Y N C O P E .
Comme ce fymptome eft effrayant par la pâleur
qu’il produit, la petiteffe du pouls, la collabefcence
des vaifleaux, la flaccidité des mufcles; que d’ailleurs
il n’eft pas fans danger, parce qu’il arrête le. cours
du fuc nerveux, & lufpend le mouvement de la circulation
du fang, il faut tâcher d’en découvrir les di-
verfes caufes, pour y diriger les remedes.
Si la Tyncope furvient dans la fievre* de la foibleffe
de. la circulation, on la ranimera par des alimens liquides,
analogues, doux, gélatineux, artificiellement
'digérés, agréables, vineux, cardiaques, aromatiques
, tirés du re'gne animal & végétal, donnés fou-
vent en petite quantité, & aidés dans leurs effets par
de legeres fri&ions aux parties extérieuresdu corps.
La Tyncope fébrile qui procédé d’humeurs dépravées
dans le ventricule, & quelquefois de vers qui
s’y rencontrent, fe diflipera par des vomitifs & par
les vermifuges, & l’on en préviendra le retour par
lés ftomachiques.
Quand la lyncope procédé de la mobilité des ef-
prits, il faut les rappeller par les volatils portés frér
quemment aux narines, lés anti-hyftériques, les cardiaques
, les corrobôrans, & fortifier enfuite le corps
par les ftomachiques nervins.
La défaillance qui eft occafionnée par des concrétions
du fang qùi commencent à fe former, demande
lesdélayans, lesatténuanS j lesfavonneux, l’a&ion
des mufcles.
On connoît que la compréflion du cerveau & dut
cervelet eft la caufe des défaillances * par la léfioii
des fondions qui dépendent de leurs bonnes difpoft-
tions, lorfque, par exemple, la fyncope eft accotm-
pagnée de délire, de vértîges, de tremblemens ,>&c.
On relâchera les vaifleaux, en hume&ant par dé
douces fomentations la tête, le vifageyles narines,
la bouche, le cou, & eh appliquant auxpiés les épif
paftiques.
F i e v r e t i e r c e , vôye^ T i e r c é . - ; - >
' F i e v r e T R iT Æ O P H iE ,T R iT Æ O P H i s ,d ë T ^ / T a / o f ,
tierce, & <pûa, être de même nature & de mêm‘e> originel
Cette fievre vient le troifieme jour, & arrive alors
prefqu’à fon plus haut période ; ce qui la diftinguedé
la tierce proprement dite, de la tierce alongee, &
dé la demi-tierce. Du refte fon nom eft une epithete
commune à toutes les fievres qui ont leur aGcès ou
leur retour périodique le troifieme jour ; elle ne forme
jamais de crifé parfaite par les urines ou pariles
Tueurs , mais les évacuations bilieufes naturelles
l’appaifent. Comme fes caufes & fon prognoftic font
les mêmes que de la fievre tierce ou intermittente prolongée,
elle demande le même traitement : voyt{ donc
F i e v r e t i e r c e .
F i e v r e t r o p i q u e , tropica febris. Les anciens ap-
p e l l o i e n t tropiques, les colliquatives «putrides
qui
iilü ii - I î
F I E qui s’étendent jufqu’au quarantième jour : on leur R
donné vraiffemblablement ce nom, pareeque le quarantième
jour eft le terme des révolutions fepte-
naires.
Les crifes font bien moins violentes & moins remarquables
dans les fievres tropiques que dans les fievres
aiguës de toute efpece : apparemment que pendant
un période fi long, la cofrion qui Te fait ne procure
qu’une médiocre dépuration à chaque exacerbation
; c’eft-à-dire que les crifes s’opèrent feulement
en détail & à différentes fois, jufqu’à ce que la maladie
foit parfaitement terminée.
Il faut donc diftinguer ces fortes de fievres chroniques
des fievres heftiques, lefquelles dépendent d’une
caufe qui perpétue ou renouvelle continuellement
celle qui les entretient, enforte qu’elles ne peuvent
produire ni coûion ni crife qui les confume. V y e [
F i e v r e h e c t i q u e .
Toutes les fievres dont la durée paffe quarante
jours, font envifagées comme des maladies entretenues
d’ordinaire par quelque vice des organes, ou
même encore par l’impéritie du médecin. Tous ces articles
du mot F i e v r e , font deM. le Chevalier DE J a u -
c o u r t .
F i e v r e , ( Mytkolog.) nom propre d’une divinité
payenne, Febris. Les Romains firent de la Fievre une
déeffe, & l’honorerent feulement pour l’engager à
moins nuire, fuivant la remarque deValere-Maxime,
liv. II. ch. v. n. (f.
Cette déeffe avoit à Rome plufieurs temples ; &
du tems de l’auteur que nous venons de citer, trois
de ces temples fubfiftoient encore, l’un fur le mont
Palatin, l’autre dans la place des monumens de Ma-
rius, & le, troifieme au haut de la rue longue. On
apportait dans ces temples les remedes contre la Fievre
, avant de les donner aux malades, & on les ex-
pofoit quelque tems fur l’autel de la divinité. Ce
moyen fervoit plus à guérir l’efprit que le corps, dit
Valere-Maxime lui-même ; & les anciens Romains
qui mirent la Fievre au rang des dieux, durent leur
fanté bien plus à leur frugalité qu’à la protection de
la déeffe.
Nous ignorons comment ils la repréfentoient ; mais
nous avons la formule d’une priere ou d’un voeu qui
lui a été fait, & qui s’eft confervé dans une inferip-
tion trouvée en Tranfylvanie. Cette infeription publiée
par Gruter, donne à la Fievre les noms de div
in e , de fa in te , 6c àe grande. La voici: F e b r i DI-
v æ , F e b r i s a n c t æ , F e b r i m a g n æ , Ca m i l l a
AMATA, PRO F1LIO MALE AFFECT O , P> « Ca-
» milia Amata offre fes voeux pour fon fils malade,
» à la divine Fievre, à la fainte Fievre, à la grande
» Fievre ».
Au refte les Romains avoient reçû cette divinité
des Grecs , avec cette différence que ces derniers
en faifoient un dieu, parce que le mot wupeToc, fievre,
eft malculin, & que febris eft féminin ; mais c’eft toujours
le même être qu’ils ont divinifé dans chaque
p a y s , pour fatisfaire aux préjugés du peuple. Article
deM. le Chevalier DE J a v COURT.
F i e v r e , (Manege, Maréchall.') maladie commune
à l’homme & à l’animal. Le médecin profond & éclairé
en recherche encore la nature individuelle; l’ignorant
toûjours préfomptueux fe flate de l’avoir
laifie : la fage timidité de l’un la précipitation hardie
de l’autre,doivent infpirer la plus grande réfer-
ve. Je ne joindrai donc point temerairement ici mes
.foibles efforts à ceux du premier ; & je ne me livrerai
pas d’une autre part, à l’inutile foin de reprimer
le ton impérieux & décifif du lecond. Les divifions
que fuggerent les différences que l’on remarque dans
les fievres dont le cheval eft atteint ; les caufes évidentes
de ces fievres, leurs fymptomes, les juftes indications
qui peuvent déterminer le maréchal dans
Tome V I,
F I E 74i le choix & dans l’application des remedes, font les
uniques points dans lefquels je me propole de me
renfermer. Si je ne lui préfente que les faits que j’ai
fcrupuleufement obfervés ; & fi de ces faits préfen-
tés & certains je ne tente pas de m’élever par la voie
des induftions & des conléquences, à la découverte
d’un principe ou d’une caufe prochaine jufqu’à pré-
fent enfevelie dans les ténèbres de la nature, qu’il
fâche que la nuit profonde qui nous dérobe une foule
innombrable d’objets & de vérités, eft préférable
aux vaines & fauffes lueurs que nous ne prenons que
trop fouvent pour de véritables lumières ; qu’il apprenne
que les fyftèmes, les hypothèfes, & toutes
les bifarres produfrions d’une imagination ou d’unef-
prit qui fe perd, peuvent d’autant plus aifément l’égarer,
qu’elles ont fait de la Medecine des hommes,
c’eft-à-dire de l’art le plus utile & le plus falutaire,
un art funefte & dangereux ; & que qui méconnoît
le doute & ne craint point l’erreur, eft inévitablement
fujet à des écarts également indignes de la rai-
fon & du favoir, qui ne fauroient en être la fource.
Toute fievre qui ne fubfifte pas par elle-même, &
qui n’eft que l’effet d’une maladie quelconque qui af-
fefre quelque partie du corps de l’animal, eft dite
fievre fecondaire ow fymptomatique.
Toute fievre qui forme principalement la maladie,
& qui ne peut en être regardée comme une dépendance
, un accident, ou une fuite, eft appelléefievre
abfolue , ou fievre idiopathique , ou fievre ejfentielle.
Celle-ci eft intermittente ou1 continue.
On nomme fievres intermittentes celles qui cefient
par intervalles , & qui reprennent par accès, foit
que leurs périodes foient réglées, foit qu’elles fe
montrent erratiques ou confufes.
Dans la diftinftion que M. de la Guériniere a faite
des fievres confidérées par rapport à l’animal, il admet
la fievre tierce & la fievre quarte. La définition
triviale qu’il nous en donne, & à laquelle il fe borne
, ne difpofe point à croire qu’il les ait réellement
apperçûes dans le cheval : fon témoignage ne peut
donc être de quelque poids qu’autant qu’il fe trouve
appuyé de l’autorité de Ruini. Ce dernier eft de tous
les auteurs qui méritent quelque confia'nce & que
j’ai confultés, le feul qui en faffe mention : il parle
même d’une forte de fievre intermittente fubintrante
qu’il appelle, d’après les Médecins, fievre quarte continue.
Je ne nie point, relativement à l’animal dont
il s’agit, la poffibilité de leur exiftence,' de leur retour
, & de leurs redoublemens périodiques ; mais
je me fuis impofé la loi de ne riën avancer qui ne
foit généralement avoué , ou qui ne foit établi fur
mes obfervations particulières ; & cette même loi
m’interdit toute difeuflion à cet égard.
Il n’en eft pas ainfi des fievres continues, je v eux
dire de celles qui font fans intermiflion : l’expérience
m’a appris qu’il en eft qui ne lui font que trop
fouvent funeftes.
Les unes m’ont paru Amples, & les autres com-
pofées.
Celles - ci different effentiellement de celles qui
font Amples, par les accès, les invafions, lesredou-»
blemens, l ’augmentation des fymptomes qui pendant
leur durée , prouvent & annoncent de plus
grands efforts de la part de la caufe morbifique : j’ajouterai
que ces paroxyfmes ou ces redoublemens
n’ont jamais à mes yeux évidemment garde aucun
Ordre.
De toutes les fievres continues, l’éphémere eft la
plus fimple ; elle fe termine ordinairement dans l’ef-
pace de vingt-quatre heures, quelquefois dans l’ef-
ce de trente - fix. Si la durée s’étend au-delà de ce
tems, elle eft dite fievre éphémère étendue, o u , pour
• me fervir du langage, de l’école, fievre Jynoque (impie
: c’eft cette meme fievre dont le cours eft plus ou
B B b b b