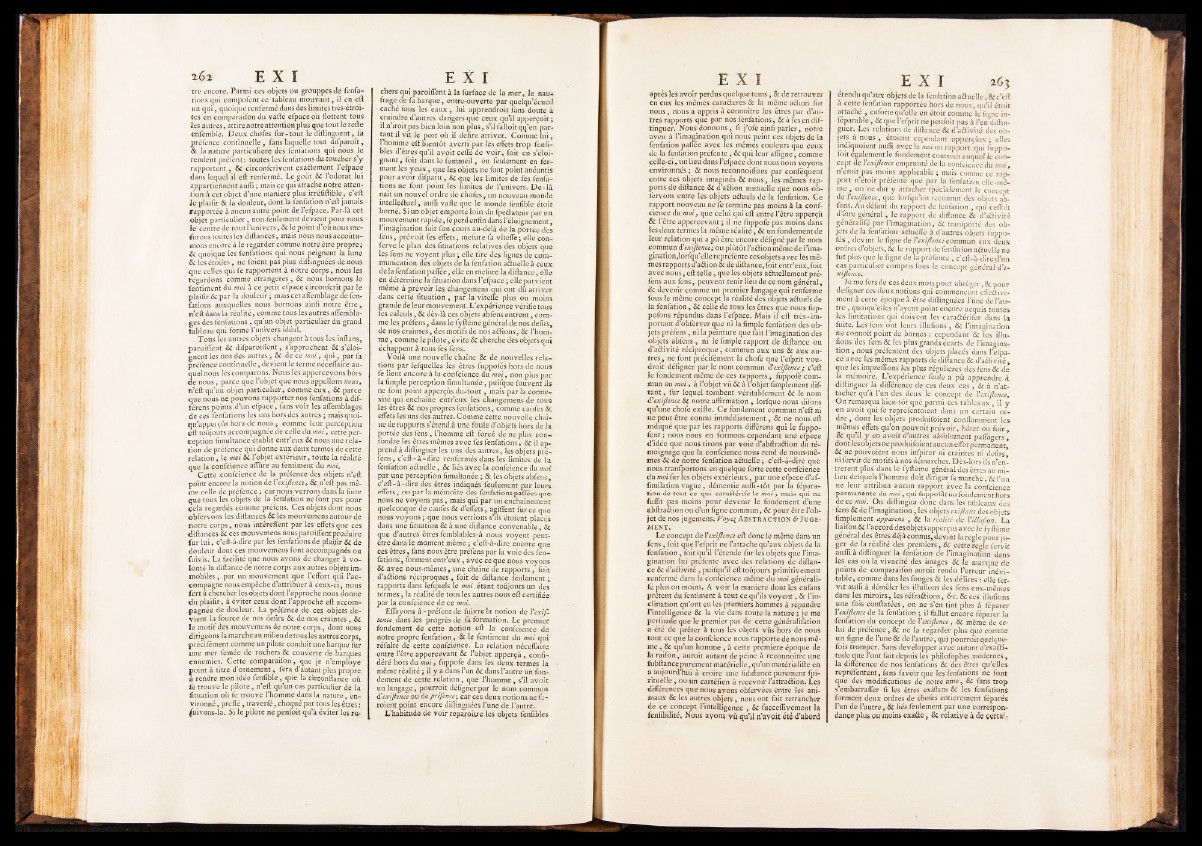
*6* E X I tre encore. Parmi ces objets ou gröuppes de fenfa-
tions qui compofent ce tableau mouvant, il en eft
un qui, quoique renfermé dans des limites très-étroites
en comparaifon du vafte efpace où flottent tous
les autres, attire notre attention plus que tout le relie
enfemble. Deux chofes fur-tout le diftinguent, fa
préfence continuelle, fans laquelle tout difparoît,
& la nature particuliere des fenfations qui nous le
rendent préfent : toutes les fenfations du toucher s’y
rapportent, & circonfcrivent exa&ement l’efpace
dans lequel il eft renfermé. Le goût &c l’odorat lui
appartiennent aulïi ; mais ce qui attache notre attention
à cet objet d’une maniéré plus irréfiftible, c’eft
le plaiflr & la douleur, dont la fenfation n’eft jamais
^apportée à aucun autre point de l’efpace. Par-là cet
objet particulier, non-feulement devient pour nous
le centre de tout l’univers, & le point d’où nous mesurons
toutes les diftances, mais nous nous accoûtu-
mons encore à le regarder comme notre être propre;
& quoique les fenfations qui nous peignent la lune
& les étoiles, ne foient pas plus diftinguées de nous
que celles qui fe rapportent à notre corps, nous les
regardons comme étrangères, & nous bornons le
fentiment du moi à ce petit efpace circonfcrit par le
plaiflr & par la douleur ; mais cet affemblage de fenfations
auxquelles nous bornons ainfi notre être,
n’eft dans la réalité, comme tous les autres affembla-
cçs des fenfations , qu’un objet particulier du grand
tableau qui forme l’univers idéal.
Tous les autres objets changent à tous les inftans,
paroiflent & difparoiffent, s’approchent & s’éloignent
les uns des autres, & de ce moi, q u i, par fa
préfence continuelle, devient le terme néceflaire auquel
nous les comparons. Nous les appercevons hors
de nous, parce que l’objet que nous appelions nous,
ti’eft qu’un objet particulier, comme eu x, & parce
que nous ne pouvons rapporter nos fenfations à dif-
ferens points d’un efpace, fans voir les affemblages
de ces fenfations les uns hors des autres ; mais quoi-
qu’apperçûs hors de nous , comme leur perception
eft toûjours accompagnée de celle du moi, cette perception
fimultanée établit entr’eux & nous une relation
de préfence qui donne aux deux termes de cette
relation, le moi &L l’objet extérieur, toute la réalité
que la confcience allure au fentiment du moi.
Cette confcience de la prélence des objets n’eft
point encore la notion de Yex ijlencc, & n’eft pas même
celle de préfence ; car nous verrons dans la fuite
que tous les objets de la fenfation ne font pas pour
cela regardés comme préfens. Ces objets dont nous
©bfervons les diftances & les mouvemens autour de
notre corps, nous intéreffent par les effets que ces
«diftances & ces mouvemens nous paroiflent produire
fur lui, c’eft-à-dire par les fenfations de plaiflr & de
douleur dont ces mouvemens font accompagnés ou
fuivis. La facilité que nous avons de changer à volonté
la diftance de notre corps aux autres objets immobiles
, par un mouvement que l’effort qui l’accompagne
nous empêche d’attribuer à ceux-ci, nous
fert à chercher les objets dont l’approche nous donne
du plaiflr, à éviter ceux dont l’approche eft accompagnée
de douleur. La préfence de ces objets devient
la fource de nos defirs & de nos craintes , &
le motif des mouvemens de notre corps, dont nous
dirigeons la marche au milieu de tous les autres corps,
précifément comme un pilote conduit une barque fur
une mer femée de rochers & couverte de barques
ennemies. Cette comparaifon, que je n’employe
point à titre d’ornement, fera d’autant plus propre
à rendre mon idée fenfible, que la circonftance oh
fe trouve le pilote, n’eft qu’un cas particulier de la
fituation où fe trouve l’homme dans la nature, environné
, preffé, traverfé, choqué par tous les êtres :
^ùivons-la. Si le pilote ne penfoit qu’à éviter les rq-
E X I chers qui paroiflent à la furface de la mer, le naufrage,
de fa barque, entre-ouverte par quelqu’écueil
caché fous les eaux , lui apprendrait fans doute à
craindre d’autres dangers que ceux qu’il apperçoit ;
il n’iroit pas bien loin non plus , s’il falloit qu’en partant
il vît le port où il déliré arriver. Comme lu i,
l’homme eft bientôt averti par les effets trop fenfi-
bles d’êtres qu’il avoit ceffé de vo ir , foit en s’éloignant
, foit dans le fommeil, ou feulement en fermant
les y e u x , que les objets ne font point anéantis
pour avoir difparu, & que les limites de fes fenfations
ne font point les limites de l’univers. D e - là
naît un nouvel ordre de chofes, un nouveau monde
intelle&uel, aufli vafte que le monde fenfible étoit
borné. Si un objet emporté loin du fpe&ateur par un
mouvement rapide, fe perd enfin dans l’éloignement,
l’imagination fuit fon cours au-delà de la portée des
fens, prévoit fes effets, mefure fa vîtefle; elle con-
ferve le plan des fituations relatives des objets que
les fens ne voyent plus ; elle tire des lignes de communication
des objets de la fenfation afruelleà ceux
delà fenfationpaffée, elle en mefure la diftance, elle
en détermine la fituation dans l’efpace ; elle parvient
même à prévoir les changemens qui ont dû arriver
dans cette fituation , par la vîtefle plus ou moins
grande de leur mouvement. L’expérience vérifie tous
les calculs, & dès-là ces objets abfens entrent, comme
les prélens, dans le fyftème général de nos defirs,
de nos crainte^, des motifs de nos actions, & l’homme
, comme le pilote, évite & cherche des objets qui
échappent à tous fes fens.
Voilà une nouvelle chaîne & de nouvelles relations
par lefquelles les êtres fuppofés hors de nous
fe lient encore à la confcience du moi, non plus par
la fimple perception fimultanée, puifque fouvent ils
ne font point apperçûs du-tout, mais par la connexité
qui enchaîne entr’eux les changemens de tous
les êtres & nos propres fenfations, comme caufes &
effets les uns des autres. Comme cette nouvelle chaîne
de rapports s’étend à une foule d’objets hors de la
portée des fens, l’homme eft forcé de ne plus con-*
fondre les êtres mêmes avec fes fenfations, & il apprend
à diftinguer les uns des autres, les objets pré-,
iens, c’eft-à-dire renfermés dans les limites de la.
fenfation a&uelle, & liés avec la confcience du moi
par une perception fimultanée ; & les objets abfens,
c’eft-à-dire des êtres indiqués feulement par leurs
effets, ou par la mémoire des fenfations paffées que.
nous ne voyons p as, mais qui par un enchaînement
quelconque de caufes & d’effets, agiffent fur ce que
nous voyons ; que nous verrions s’ils étoient placés
dans une fituation &c à une diftance convenable, &
que d’autres êtres femblables*à nous voyent peut-
être dans le moment même ; c’eft-à-dire encore que
ces êtres, fans nous être préfens par la voie des fenfations,
forment entr’eu x , avec ce que nous voyons
& avec nous-mêmes, une chaîne de rapports , foit
d’aCtions réciproques , foit de diftance feulement ;
rapports dans lefquels le moi étant toûjours un des
termes, la réalité de tous les autres nous eft certifiée,
par la confcience de ce moi.
Effayons à-préfent de fuivrela notion de Y exif-
tenu dans les progrès de fa formation. Le premier
fondement de cette notion eft la confcience de
notre propre fenfation, & le fentiment du moi qui
réfulte de cette confcience. La relation néceflaire
.entre l’être appercevant & l’objet apperçû, confi-
déré hors du moi, fuppofe dans les deux termes la
même réalité ; il y a dans l’un & dans l’autre un fondement
de cette relation, que l’homme , s’il avoit
un langage, pourroit défignerpar le nom commun
d'exiflence ou de préfence ; car ces deux notions ne feraient
point encore diftinguées l’une de l ’autre.
L ’habitude de voir reparaître les objets fenfibles
E X I après les avoir perdus quelque tems, & de retrouver
en eux les mêmes carafreres & la même aCtion fur
nous, nous a appris à connoître les êtres par d’autres
rapports que par nos fenfations, & à les en diftinguer.
Nous donnons, fi j’ofe ainfi parler, notre
aveu à l’imagination qui nous peint ces objets de la
fenfation paflee avec les mêmes couleurs que ceux
de la fenfation préfente, & qui leur afligne, comme
celle-ci, un lieu dans l’efpace dont nous nous voyons
environnés ; & nous reconnoiffons par conféquent
entre ces objets imaginés & nous, les mêmes rapports
de diftance & d’aCtion mutuelle que nous ob-
iervons entre les objets a&uels de la fenfation. Ce
rapport nouveau ne le termine pas moins à la confcience
du moi, que celui qui eft entre l’être apperçû
& l’être appercevant ; il ne fuppofe pas moins dans
les deux termes la même réalité, & Un fondement de
leur relation qui a pû être encore défigné par le nom
commun 6l exiflence; ou plûtôt l’a&ion même de l’imagination,
lorfqu’elle repréfente ces objets avec les mêmes
rapports d’aCtion & de diftance, foit entr’eux, foit
avec nous , eft telle, que les objets actuellement préfens
aux fens, peuvent tenir lieu de ce nom général,
& devenir comme un premier langage qui renferme
fous le même concept la réalité des objets aCtuels de
la fenfation, & celle de tous les êtres que nous fup-
pofons répandus dans l’efpace. Mais il eft très-important
d’obferver que ni la fimple fenfation des objets
préfens, ni la peinture que fait l ’imagination des
objets abfens , ni le fimple rapport de diftance ou
d’aûivité réciproque, commun aux uns & aux autres,
ne font précifément la çhofe que l’efprit voudrait
défigner par le nom commun d'exiflence ; c’eft
le fondement même de ces rapports, fuppofé commun
au moi , à l’objet vû & à l ’objet Amplement dif-
tan t, fur lequel tombent véritablement & le nom
dû exiflence & notre affirmation , lorfque nous difons
qu’une chofe exîfte. Ce fondement commun n’eft ni
ne peut être connu immédiatement, & ne nous eft
indiqué que par les rapports différens qui le fuppo-
fent : nous nous en formons cependant une efpece
d’idée que nous tirons par voie d’abftraCtion du témoignage
que la confcience nous rend de nous-mêmes
& de notre fenfation- aCluelle ; c’eft-à-dire què
nous tranfportons en quelque forte cette confcience
du moi fur les objets extérieurs, par une efpece d’af-
limilation vague, démentie aufli-tôt par la fépara-
tion de tout ce qui cara&érife le moi, mais qui ne
fuffit pas moins pour devenir le fondement d’une
abftraCtion ou d’un ligne commun, & pour être l’objet
de nos jugemens. Voye^ Abstraction & Jugement.
Le concept de Yexiflence eft donc le même dans un
fens, foit que l’efprit ne l’attache qu’aux objets de la
fenfation, foit qu’il l’étende fur les objets que l’imagination
lui prefente avec des relations de diftance
& d’aCtivité, puifqu’il eft toûjours primitivement
renfermé dans la confcience même du moi générali-
fé plus ou moins. A voir la maniéré dont les enfans
prêtent du fentiment à tout ce qu’ils v o y en t , & l’inclination
qu’ont eu les premiers hommes à répandre
l’intelligence & la vie dans toute la nature ; je me
perïùade que le premier pas de cette généralisation
a été de prêter à tous les objets vûs hors de nous
tout ce que la confcience nous rapporte de nous même
, & qu’un homme, à cette première époque de
la raifon, aurait autant de péinë à reconnoître une
fubftance purement matérielle, qu’un matérialifte en
a aujourd’hui à croire une fubftance purement fpi-
rituelle, ouun cartéfien à recevoir l’attraftion. Les
différences que nous avons obfervées entre les animaux
& les autres objets, nous ont fait retrancher
de ce concept l’intelligence , & fucceflivement la
fenfibilité. Nous ayons vû qu’il n’avoit été d’abord
E X I 26?
étendu qu’aux objêts de la fenfation actuelle, & c ’efl:
à cette fenfation rapportée hors de nous , qu’il étoit
attaché , enfbrte qu’elle en étoit comme le ligne in-
feparable, & que î’efprit ne penfoit pas à l’en diftinguer.
Les relations de diftance & d’aCtivité des objets
à nous ,. etoient cependant apperçûes ; elles
indiquoient aufli avec le moi un rapport qui fuppo-
foit egalement le fondement commun auquel le concept
de Yexiflence emprunté de la confcience du moi,
n’étoit pas moins applicable ; mais comme ce rapport
n’étoit préfenté que par la fenfation elle-même
, on ne dut y attacher fpécialement le concept
de Y exiflence, que lorfqu’on reconnut des objets abfens.
Au défaut du rapport de fenfation , qui ceffoit
d’être général, le rapport de diftance & d’aCtivité
generalife par l’imagination, & tranlporté des objets
de la fenfation aChielle à d’autres objets fuppo-
fes , devint le ligne de Yexiflence commun aux deux
ordres d’objets, & le rapport de fenfation a&uelle ne
fut plus que le figne de la préfence , c’eft-à^ dire d’un
cas particulier compris fous le concept général d'e-
xiflence.
Je me fers de ces deux mots pour abréger, & pour
defigner ces deux notions qui commencent effeCtive-
ment à cette époque à être diftinguées l’une de l’autre
, quoiqu’elles n’ayent point encore acquis toutes
les limitations qui doivent l'es caraCtérifer dans la
fuite. Les fens ont leurs illufions , & l’imagination
ne connoît point de bornes : cependant & les illu*
fions des fens &: les plus grands écarts de l’imagination
, nous préfentent des objets placés dans l’efpace
avec les mêmes rapports de diftance & d’a&ivité ,
que les impreflions les plus régulières des fens & de
la mémoire. L ’expérience feule a pû apprendre à
diftinguer la différence de ces deux cas , & à n’attacher
qu’à l’un des deux le concèpt de Y exiflence.
On remarqua bien-tôt qué parmi ces tableaux , il y
en avoit qui fe repréfentoient dans un certain ordre
, dont les objets produifoient conftamment les
mêmes effets qu’on pouvoit prévoir, hâter ou fuir ,
& qu’il y en avoit d’autres abfolument paflagers,
dont les objets ne produifoient aucun effet permanent
Sc ne pouvoient noiis infpirer ni craintes ni defirs,
ni fervir de motifs à nos démarches. Dès-lors ils n’en-
trerent plus dans le fyftème général des êtres au milieu
defquels l’homme doit diriger fa marche, & l ’on
ne leur attribua aucun rapport avec la confcience
permanente du moi, qui fuppofâtun fondement hors
dec émoi. On diftingua donc dans les tableaux dés
•' fens & de l’imagination, les objets exiftans des objets
Amplement apparens , & la réalité de Yilluflon. La
liaiion & l’accord des objets apperçûs avec le fyftème
général des êtres déjà connus, devint la réglé pour juger
de la réalité des premiers, & cette réglé fervit
aufli à diftinguer la fenfation de l’imagination dans
les cas où la vivacité des images & le manque de
points de comparaifon aurait rendu l’erreur inévitable,
comme dans les fonges & les délires : elle fervit
aufli à démêîer les illufions des fens eux-mêmes
dans les miroirs, les réfraftions, &c. & ces illufions
une fois conftatées, on ne s’en tint plus à féparer
Yexiflence de la fenfation ; il fallut encore féparer la
fenfation du concept de Y exiflence, & même de celui
de préfence, & ne la regarder plus que comme
un figne de l’une & de l’autre, qtii pourroit quelquefois
tromper. Sans développer avec autant d’exactitude
que l’ont fait depuis les philofophes modernes ,
la différence de nos fenfations & des êtres qu’elles
repréfentent, fans favoir que les fenfations né font
que des modifications de notre ame , & fans trop
s’embarraffer fi les êtres exiftans àc les fenfations
forment deux ordres de chofes entièrement féparés
l’un de l’autre, & liés feulement par une correl'pon-
dance plus ou moins exa&e > U relative à de çertav