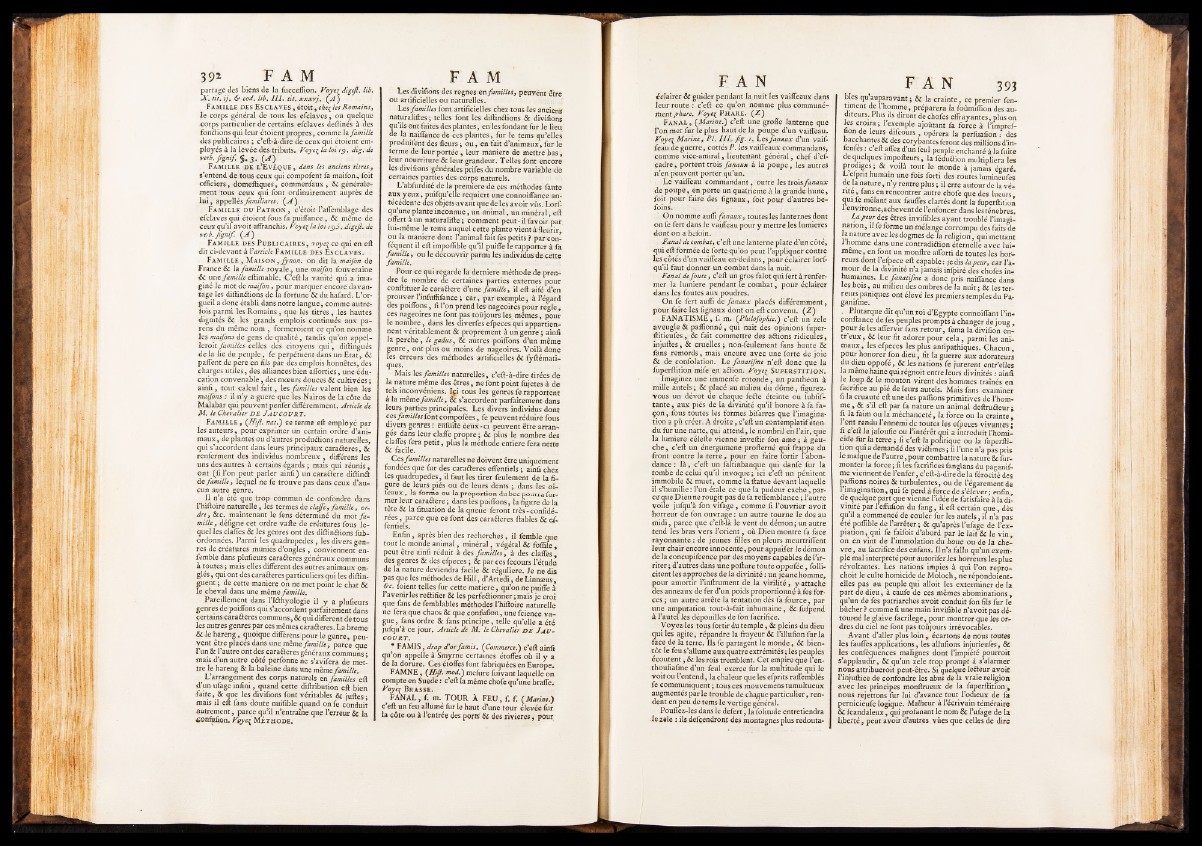
•partage d e s b ie n s d e la fu c c e f lio n . Voyt{ digeß. lib.
JC. tit. ij. & cod. Lib. I I I . tit. xxxvj. ÇA)
F a m i l l e d e s E s c l a v e s ;, étpit., cke^les Romains,
le corps général de tous les efclaves, ou quelque
Æorps particulier de certains efclaves dellinés à des
fondions qui leur étoient propres, comme la famille
des publicaires ; c’eft-à-dire de ceux qui étoient employés
à la levée des tributs. Voye[ la loi i$. dig. de
verb.fignif. § . 3 . ÇA')
F a m i l l e d e l ’E v ê q u e , dans les anciens'titres,,
s’entend de tous ceux qui compofent fa maifon., foit
officiers, domeftiques, commenfaux, & .généralement
tous ceux qui font ordinairement auprès de
lu i, appellés familiäres. ÇA )
F a m i l l e d u P a t r o n , c’étoit l’affemblage des
efclaves qui étoient fous fa puifTance, & même de
ceux qu’il avoit affranchis. Voyez la loi 10S. digeß. de
rtib.fynif. (A )
F a m i l l e d e s P u b l i c a i r e s , .voye[ c e q u i e n e ft
d i t c i -d e v a n t à l’article F a m i l l e d e s E s c l a v e s .
F a m i l l e , .Ma i s o n , Jynon. on dit la maifon de
France & la famille royale, une maifon fouveraine
& wnefamille eftimable. C’eftla vanité qui a imaginé
le mot de maifon, pour marquer encore davantage
les diftin&ions de la fortune & du hafard. L’orgueil
a donc établi dans notre langue, comme autre*
fois parmi les Romains, que les titres, les hautes
dignités & les grands emplois continués aux pa-
rens du même nom , formeroient ce qu’on nomme
les maifons de gens de qualité, tandis qu’on appellerait
familles celles des citoyens q ui, diftingués
de la lie du peuple, fe perpétuent dans un E tat, &
paffent de pere en fils par des emplois honnêtes, des
charges utiles, des alliances bien afforties, une.éducation
convenable, des moeurs douces & cultivées;
ainfi, tout calcul fait., les familles valent bien les
maifons : il n’y a guere que les Nairos de la côte de
Malabar qui peuvent penfer différemment. Article de
M. le Chevalier DE J AV COURT.
F a m i l l e , ÇHift. nat.) ce terme eft employé par
les auteurs, pour exprimer un certain ordre d’animaux,
de plantes ou d’autres productions naturelles,
qui s’accordent dans leurs principaux cara&eres, &
renferment des individus nombreux , différens les
uns des autres à certains égards ; mais qui réunis,
ont (fi l’on peut parler ainfi) un caraûere diftinfr
de famille, lequel ne fe trouve pas dans ceux d’aucun
autre genre.
Il n’a été que trop commun de confondre dans
l’hiftoire naturelle , les termes de claffe, famille, ordre,
&c. maintenant le fens déterminé du mot famille
, défigne cet ordre vafte de créatures fous lequel
les claffes & les genres ont des diftin&ions fub-
ordonnées. Parmi les quadrupèdes, les divers genres
de créatures munies d’ongles , conviennent en-
femble dans plufieurs cara&eres généraux communs
à toutes ; mais elles different des autres animaux on-
glés, qui ont des cara&eres particuliers qui les diftin-
guent ; de cette maniéré on ne met point le chat &
le cheval dans une même famille.
Pareillement dans l’Ifthyologie il y a plufieurs
genres depoiffons qui s’accordent parfaitement dans
certains cara&eres communs, & qui different de tous
les autres genres par ces mêmes cara&eres. La breme
& le hareng, quoique différens pour le genre, peuvent
être placés dans une même famille, parce que
Fun & l’autre ont des carafteres généraux communs ;
mais d’un autre côté perfonne ne s’avifera de mettre
le hareng & la baleine dans une même famille.
L’arrangement des corps naturels en familles eft
d’un ufage infini, quand cette diftribution eft bien
faite, & que les divifions font véritables & juftes ;
mais il eft fans doute nuifible quand on fe conduit
autrement, parce qu’il n’entraîne que l’erreur & la
£0nfufign. Vçye^ MÉTHODE,
Les divifions des régnés va familles, peuvent être
ou artificielles ou naturelles.
Les familles font artificielles chez tous les anciens
natura liftes ; telles font les diftinêtions & divifions
qu’ils ont faites des plantes, en les fondant fur le lieu
de la naiflancede ces plantes , fur le tems qu’elles
prodùifent des fleurs ; o u , en fait d’animaux, fur le
terme de leur'portée , leur maniéré de mettre bas ,
leur nourriture & leur grandeur. Telles font encore
les divifions générales prifes du nombre variable de
certaines parties des corps naturels.
L’abfurdité de la première de ces méthodes faute
aux y eux , puifqu’elle requiert une connoiffance antécédente
des objets avant quç de les avoir vus. Lorf-
qu’une plante inconnue, un animal, un minéral, eft
offert à un naturalifte ; comment peut - il favoir par
lui-même le tems auquel cette plante vient à fleurir,
ou la maniéré dont l’animal fait fes petits ? par confisquent
il eft impoffible qu’il puiffe le rapporter à fa
famille, ou le découvrit parmi les individus dre cètte
famille.
Pour ce qui regarde la derniere méthode de prendre
le nombre de certaines parties externes pour
conftituer le cara&ere d’une famille, il eft aifé d’en
prouver l’infuffifance ; car, par exemple, à l’égard
des poiffons, fi l’on prend les nageoires pour réglé,
ces nageoires ne font pas toûjours les mêmes, pour
le nombre, dans les diverfes efpeces qui appartiennent
véritablement & proprement à un genre ; ainfi
la perche, le gadus, & autres poiffons d’un même
genre, ont plus ou ’moins de nageoires. Voilà donc
les erreurs des méthodes artificielles & fyftémati-
ques.
Mais les familles naturelles, c’eft-à-dire tirées de
la nature même des êtres, ne font point fujetes à de
tels inconvéniens. I^i tous les genres fe rapportent
à la meme famille, & s’accordent parfaitement dans
leurs parties principales. Les divers individus dont
ces familles font compofées, fe peuvent réduire fous
divers genres : enfuite ceux-ci peuvent être arrangés
dans leur claffe propre ; & plus le nombre des
claffes fera petit, plus la méthode entière fera nette
& facile.
Ces familles naturelles ne doivent être uniquettient
fondées que fur des cara&eres effentiels ; ainfi chez
les quadrupèdes, il faut les tirer feulement de la figure
de leurs piés oii de leurs dents ; dans les oi-
feaux, la forme ou la proportion du bec pourra former
leur caraôere ; dans les poiffons, la figure de la
tête & la fituation de la queue feront très - confidé-
réés, parce que ce font des caraderes ftables & effentiels.
Enfin, après bien des recherches, il femble que
tout le monde animal, minéral, végétal & foflxle ,
peut être ainfi réduit à des familles, à des claffes-
des genres & des efpeces ; & par ces fecours l’étude
de la nature deviendra facile & régulière. Je ne dis
pas que les méthodes de Hill, d’Artedi, de Linnæus,
&c. loient telles fur cette matière, qu’on ne puiffe à
l’avenir les rectifier & les perfectionner ; mais je croi
que fans de femblables méthodes l’hiftoire naturelle
ne fera que chaos & que confufion, une fcience vague,
fans ordre & fans principe, telle qu’elle a été
jufqu’à ce jour. Article de M. le Chevalier d e J a u -
C O U R T .
* FAMIS, drap d'or famis, ÇCommerct.) c’eft ainfi
qu’on appelle à Smyrne certaines étoffes où il y a
de la dorure. Ces étoffes font fabriquées en Europe.
FAMNE, ÇHifi. mod.\ mefure fuivant laquelle on
compte en Suede : c’eft la même chofe qu’une braffe.
Voye^ Brasse.
FANAL, f. m. TOUR À FEU, f. f. ÇMarine.)
c’eft un feu allumé fur le haut d’une tour élevée fur
la côte ou à l’entrée des ports & des rivières, pour
é c la i r e r & g u id e r p en d a n t la n u i t le s V a if fe a u x dan s
l e u r r o u t e : c ’e f t c e q u ’o n n om m e p lu s com m u n é -
jn en tphare. Voyeç P h a r e . ( Z )
Fan a l , ÇMarine.) c’eft une groffe lanterne que
l’on met fur le plus haut de la poupe d’un vaiffeau.
Voye\ Marine, PI. I I I f ig . 1. Les fanaux d’un vail-
feau de guerre , cottés P. les vaiffeaux commandans,
comme vice-amiral, lieutenant général, chef d’ef-
cadre, portent trois fanaux à la poupe, les autres
n’en peuvent porter qu’un.
Le vaiffeau commandant, outre les trois fanaux
de poupe, en porte un quatrième à la grande hune,
foit pour faire des figh&ux , foit pour d’autres be-
foins.
On nomme auflî fanaux, toutes les lanternes dont
on fe fert dans le vaiffeau pour y mettre les lumières
dont on a befoin.
Fanal de combat, c’eft une lanterne plate d’un côté,
qui eft formée de forte qu’on peut l’appliquer contre
les côtés d’un vaiffeau en-dedans, pour éclairer lorfi-
qu’il faut donner un combat dans la nuit.
Fanal de foute , c’eft un gros falot qui fert à.renfer-
mer la lumière pendant le combat, pour éclairer
ci ans les foutes aux poudres.
On fe fert aufli de fanaux placés différemment,
pour faire les fignaux dont ori eft convenu. (Z )
FANATISME, f . m . ÇPhilofophie.) C’ e ft u n z e le
a v e u g l e & p a f l io n n é , qui n a ît d e s o p in io n s fu p e r -
f t i t ie u f e s , & fa i t c om m e t t r e d e s a é tions r id i c u le s ,
in ju f t e s , & c ru e lle s ; n o n - feu lem e n t fan s h o n te &
fa n s r e n tô r d s , m a is e n c o r e a v e c u n e fo r t e d e jo ie
& d e c o n fo la t io n . L e fanatifme n ’e f t d o n c q u e la
fu p e r f t it io n m ife e u àC tio n .. Voye^ S u p e r s t i t i o n .
Imaginez une iromenfe rotoiide, un panthéon à
mille autels ; & placé ;au milieu du dôme, figurez-
vous un dévot de chaque feéte éteinte ou lubfif-
tan te , aux piés de la divinité qu’il honore à fa façon
, fous toutes les formes bifarres que l’imagination
a pû créer. A droite, c’eft un contemplatif étendu
fur une natte, qui attend, le nombril en l’air, que
la lumière célefte vienne inveftir fon ame ; à gauche
, c’eft un énergumene profterné qui frappe du
front contre la terre, pour en faire lortir l’abondance
: là , c’eft un faltinbanque qui danfe fur la
tombe de celui qu’il invoque ; ic i e eft un pénitent
immobile & muet, comme la ftatue devant laquelle
il s’humilie : l’un étale ce que la pudeur cache, parce
que Dieu ne rougit pas de fa reffemblance ; l’autre
voile jufqu’à fon vifage, comme fi l’ouvrier avoit
horreur de fon ouvrage : un autre tourne le dos au
midi, parce que c’eft-là le vent du démon; un autre
tend les bras vers l’orient, où Dieu montre fa face
rayonnante : de jeunes filles en pleurs meurtriffent
leur chair encore innocente, pour appaifer le démon
de la concupifcence par des moyens capables de l’irriter
; d’autres dans une pofture toute oppofée, folli-
citent les approches de la divinité : un jeune homme,
pour amortir l’inftrument de la virilité, y attache
des anneaux de fer d’un poids proportionné à fes forces
; un autre arrête la tentation dès fa fource, par
une amputation tout-à-fait inhumaine, &c fufpend
à l’autel les dépouilles de fon facrifice.
Voyez-les tous fortir du temple, & pleins du dieu
qui les agite, répandre la frayeur & l’illufionfurla
face de la terre. Ils fe partagent le monde, & bientô
t le feu s’allume aux quatre extrémités ; les peuples
écoutent, & les rois tremblent. Cet empire que l’en-
thoufiafme d’un feul exerce fur la multitude qui le
voit ou l’entend, la chaleur que les efprits raffemblés
fe communiquent ; tous ces mouvemens tumultueux
augmentés par le trouble de chaque particulier, rendent
en peu de tems le vertige général.
Pouffez-les dans le defert, la folitude entretiendra
ie z«Ie : ils defçendront des montagnes plus redoutablés
qu’auparavânt ; & la crainte, ce premier len-
timent derhomme , préparera la foûmilîkm des au-
diteurs. Puis ils diront de choies effrayantes, plus on
les croira; 1 exemple ajoutant fa force à l’impref-
uon de leurs difcours., opérera la periuafîon : des
bacchantes & des corybantes feront des millions d’in-
ienies : C eft allez d’un feul peuple enchanté à la fuite
de quelques impofteurs, la féduSion multipliera les
prodiges ; & voilà tout le monde à jamais égaré,
i. efpnt humain une fois forti des routes lumineufes
de la nature , n’y rentré plus ; il erre autour de la vente
fans en rencontrer autre chofe-que des lueurs,
qui fe mêlant aux fauffes clartés dont la fuperftition
1 environne,achèvent de l’enfoncer dans les ténèbres.
La peur des êtres invifibles ayant troublé l’imagination,
il fe forme un mélange corrompu des faits de
janature avec les dogmes de la religion, qui mettant
ITiomme dans une contradiction éternelle avec lui—
meme, en font un monftré afforti de toutes les horreurs
dont l’efpece eft capable : je dis la peur, car l’a-
mour de la divinité n’a jamais infpiré des chofes inhumaines.
Le fanatifme a donc pris naiffance dans
les bois, au milieu des ombres de la nuit ; & les terreurs
paniques ont elevé les premiers temples du Pa-
ganifme.
. Plutarque dit qu’un roi d’Egypte connoiffant l’in—
confiance de fes peuples prompts à changer de joug ,
pour fe les affervir fans retour, fema la divifion en-
tr eu x , & leur fit adorer pour cela, parmi les animaux
, les efpeces les plus antipathiques. Chacun,
pour honorer fon dieu, fit la guerre aux adorateurs
du dieu oppofe, & les nations fe jurèrent entr’elles
la même haine qui régnoit entre leurs di vinités : ainfi
le loup & le mouton virent des hommes traînés en
facrifice au pié de leurs autels. Mais fans examiner
fi la cruauté eft une des paftions primitives de l’homme
, & s il eft par fa nature un animal deftruâeur ;
fi la faim ou la méchanceté, la force ou la crainte ,
l’ont rendu l’ennemi de toutes les efpeces vivantes ;
fi c’eft la jaloufie ou l’intérêt qui a introduit l’homicide
fur la terre ; fi c’eft la politique ou la fuperftition
quia demandé des victimes ; fi l’une n’a pas pris
le mafque de l’autre, pour combattre la nature &c fur-
monter la force ; fi les facrifices fanglans du paganif-
me viennent de l’enfer, c’eft-à-dire de la férocité des
paftions noires & turbulentes, ou de l’égarement de
l’imagination, qui fe perd à force de s’élever; enfin ,
de quelque part que vienne l’idée de fatisfaire à la divinité
par l’effiifion du fang, il eft certain que, dès
qu’il a commencé de couler fur les autels, il n’a pas
été poffible de l’arrêter; & qu’après l’ufage de l’expiation,
qui fe faifoit d’abord par le lait &c le vin ,
on en vint de l’immolation du bouc ou de la chèvre
, au facrifice des enfans. Il n’a fallu qu’un exemple
mal interprété pour autofiferles horreurs les plus
révoltantes. Les nations iitipies à qui l’on reprochoit
le culte homicide de Moloch, ne répondoient-
elles pas au peuple qui alloit les exterminer de la
part de dieu, à caufe de ces mêmes abominations,
qu’un de fes patriarches avoit conduit fon fils fur le
bûcher ? comme fi une main invifible n’avoit pas détour
né le glaive facrilege, pour montrer que les ordres
du ciel ne font pas toûjours irrévocables.
Avant d’aller plus loin , écartons de nous toutes
les fauffes applications, les allufions injurieufes, &c
les conféquences malignes dont l’impiété pourroit
s’applaudir, & qu’un zele trop prompt à s’alarmer
nous attribueroit peut-être. Si quelque leâeur avoit
l’injuftiee de confondre les abus de la vraie religion
avec les principes monftrueux de la fuperftition *
nous rejettons fur lui d’avance tout l’odieux de fa
pernicieufe logique. Malheur à l’écrivain téméraire
&c fcandaleux, qui profanant le nom & l’ufage de la
liberté , peut avoir d’autres vûes que celles de dire