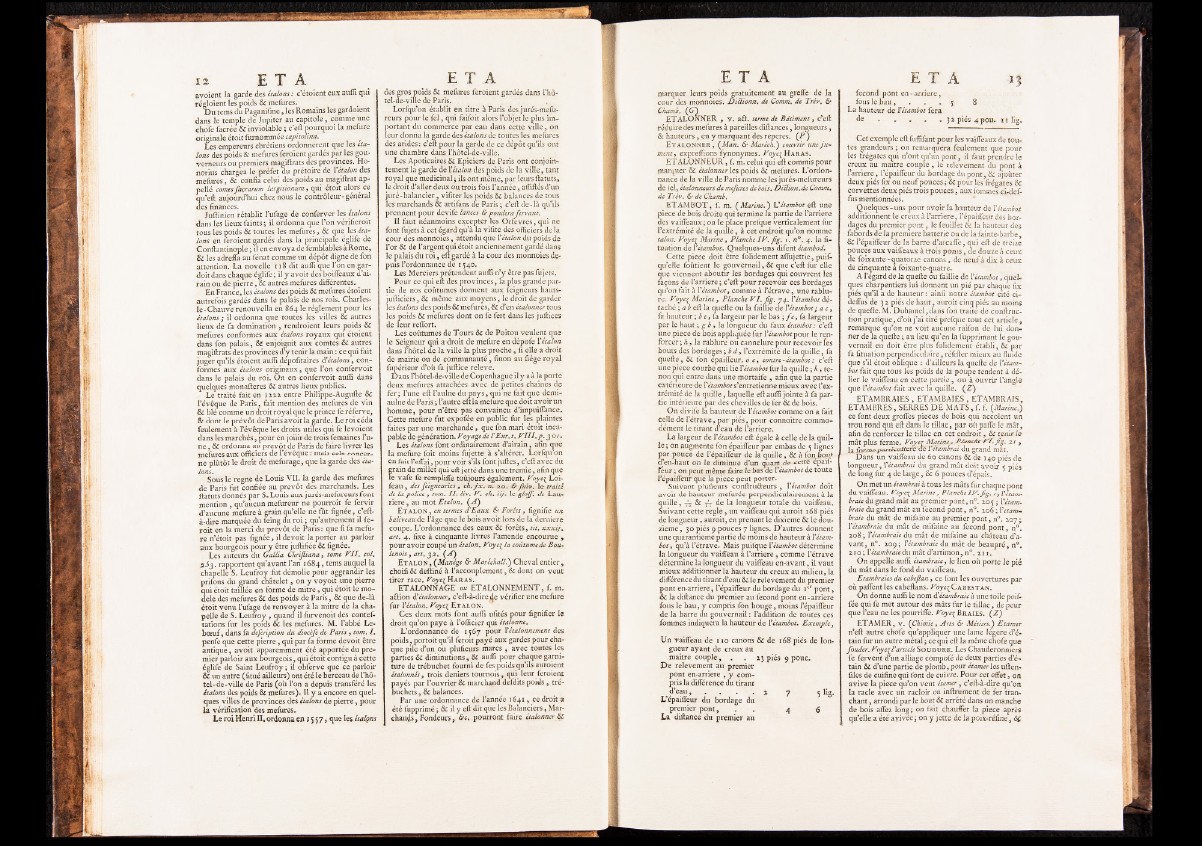
avoîent la garde des étalons : c’étoient eux auffi qui
régloient les poids 3c mefures.
D u tems du Paganifme, les Romains les gardoient
dans le temple de Jupiter au capitole, comme une
chofe facrée 3c inviolable ; c’ell pourquoi la mefure
originale étoit furnommée capitolina. f
Les empereurs chrétiens ordonnèrent que les étalons
des poids & mefures feroient gardés par les gouverneurs
ou premiers magiftrats des provinces. Ho-
norius chargea le préfet du prétoire de Vétalon des
mefures, 3c confia celui des poids au magiftrat ap-
pellé cornes facrarum largitionum, qui etoit alors ce ;
qu’eft aujourd’hui chez nous le contrôleur-général
des finances.
Jullinien rétablit l’ufage de conferver les étalons
dans les lieux faints ; il ordonna que l’on vérifieroit
tous les poids 3c toutes les mefures, 3c que les étalons
en feroient gardés dans la principale églife de
Conftantinople ; il en envoya de femblables à Rome,
& les adreffa au fénat comme un dépôt digne de fon
attention. La novelle 1 18 dit auffi que l’on en gar-
doitdans chaque églife; il y avoit des boilfeaux d’airain
ou de pierre, 3c autres mefures différentes.
En France, les étalons des poids 3c mefures étoient
autrefois gardés dans le palais de nos rois. Charles-
le-Chauve renouvella en 864 le réglement pour les
étalons ; il ordonna que toutes les villes & autres
lieux de fa domination , rendroient leurs poids 3c
mefures conformes aux étalons royaux qui étoient
dans fon palais, 3c enjoignit aux comtes 3c autres
magiftrats des provinces d’y tenir la main : ce qui fait
juger qu’ils étoient aufli depofitaires & étalons, conformes
aux étalons originaux, que l’on confervoit
dans le palais du roi. On en confervoit aufli dans
quelques monafteres 3c autres lieux publics.
Le traité fait en 1222 entre Philippe-Augufte 3c
l’évêque de Paris, fait mention des mefures de vin
& blé comme un droit royal que le prince fe réferve,
& dont le prévôt de Paris avoit la garde. Le roi céda
feulement à l’évêque les droits utiles qui fe levoient
dans les marchés, pour en jouir de trois femaines l’un
e , & ordonna au p révôt de Paris de faire livrer les
mefures aux officiers de l’évêque : mais cd a concerne
plûtôt le droit de mefurage, que la garde des étalons.
Sous le régné de Louis VII. la garde des mefures
de Paris fut confiée au prévôt des marchands. Les
ftatuts donnés par S . Louis aux jurés-mefureurs font
mention , qu’aucun mefureur ne pourrait fe fervir
d’aucune mefure à grain qu’elle ne fût {ignée, c’eft-
à-dire marquée du l'eing du roi ; qu’autrement il ferait
en la merci du prévôt de Paris : que fi fa mefure
n’étoit pas lignée, ildevoit la porter au parloir
aux bourgeois pour y être juftifiée 3c {ignée.
Les auteurs du G allia Chriftiana, tome VII. col.
3,Jj. rapportent qu’avant l’an 1684, tems auquel la
chapelle S. Leufroy fut démolie pour aggrandir les
prifons du grand châtelet, on y voyoit une pierre
qui étoit taillée en forme de mitre, qui étoit le modèle
des mefures 3c des poids de Paris, & que de-là
étoit venu l’ufage de renvoyer à la mitre de la chapelle
de S. Leufroy, quand il furvenoit des contef-
tations fur les poids oc les mefures. M. l’abbé Le-
boeuf, dans fa defcription du diocèfe de Paris , tom. I.
penfe que cette pierre, qui par fa forme devoit être
antique, avoit apparemment été apportée du premier
parloir aux bourgeois, qui étoit contigu à cette
églife de Saint Leufroy ; il obferve que ce parloir 3c un autre (fitué ailleurs) ont été le berceau de l’hôtel
de-ville de Paris (où l’on a depuis transféré les
étalons des poids & mefures). Il y a encore en quelques
villes de provinces des étalons de pierre, pour
la vérification des mefures.
Le roi Henri II. ordonna en 15 57, que les étalons
des gros poids 3c mefures feroient gardés dans rhô-
tel-de-ville de Paris.
Lorfqu’on établit en titre à Paris des jurés-mefureurs
pour le fe l, qui faifoit alors l’objet le plus important
du commerce par eau dans cette v ille , on
leur donna la garde des étalons de toutes les mefures
des arides: c’eft pour la garde de ce dépôt qu’ils ont
une chambre dans l’hôtel-de-ville.
Les Apoticaires & Epiciers de Paris ont conjointement
la garde de l’étalon des poids de la ville , tant
royal que médicinal ; ils ont même, par leurs ftatuts,
le droit d’aller deux ou trois fois l’année, affiliés d’un
juré-balancier, vifiter les poids & balances de tous
les marchands 3c artifans de Paris; c’eft de-là qu’ils
prennent pour devife lances & pondéra fervant.
Il faut néanmoins excepter les Orfèvres, qui né
font fujets à cet égard qu’à la vifite des officiers de la
cour des monnoies, attendu que V étalon du poids de
l’or 3c de l’argent qui étoit anciennement gardé dans
le palais du ro i, eft gardé à la cour des monnoies depuis
l’ordonnance de i 540.
Les Merciers prétendent auffi n’y être pas fujets.
Pour ce qui eft des provinces, la plus grande partie
de nos coutumes donnent aux feigneurs hauts-
jufticiers, 3c même aux moyens , le droit de garder
les étalons des poids 3c mefures, 3c d’en étalonner tous
les poids & mefures dont on fe fert dans les juftices
de leurreflort.
Les coûtumes de Tours & de Poitou veulent que
le Seigneur qui a droit de mefure en dépofe l'étalon
dans l’hôtel de la v ille la plus p roche, fi elle a droit
de mairie ou de communauté, finon au fiége royal
fupérieur d’oii fa juftice releve.
Dans l’hôtel-de-ville de Copenhague il y a à la porte
deux mefures attachées avec de petites chaînes de
fer ; l’une eft l’aulne du p ays, qui ne fait que demi-
aulne de Paris ; l’autre eft la mefure que doit avoir un
homme, pour n’être pas convaincu d’impuiffance.
Cette mefure fut expofée en public fur les plaintes
faites par une marchande, que. fon mari étoit incapable
de génération. Voyage de l'Eur. t. V III. p. 30/.
Les étalons font ordinairement d’airain, afin que
la mefure foit moins fujette à s’altérer. Lorfqu’on
en fait l’eflai, pour voir s’ils font juftes, c’eft avec du
grain de millet qui eft jetté dans une tremie, afin que
I le vafe fe rempliffe toujours également. Voye^ Loi-
feau , des feigneuries , ch .jx I n. 2.0. & fuiv. le traité
de la police , tom. II. liv. V. ch, iij. le glojf. de Lau-
riere, au mot Etalon. (A ) Etalon , en termes d'Eaux & Forets, lignifie un
baliveau de l’âge que le bois avoit lors de la derniere
coupe. L’ordonnance des eaux 3c forêts, tit. x x x ij.
art. 4. fixe à cinquante livres l’amende encourue ,
pour avoir coupé un étalon. Voye^ la coutume de Boulenois
, art. 32. (A ) Etalon* ('Manège & Maréchall.) Cheval entier,
choifi & deftiné à l’accouplement, 3c dont on veut
tirer race. Voye^Haras.
ETALONNAGE ou ETALONNEMENT, f. m.
aftion fur d’étalonner, c’eft-à-direde vérifier une mefure l’étalon. Voye\[ Etalon.
Ces deux mots font auffi ufités pour lignifier le
droit qu’on paye à l’officier qui étalonne.
L’ordonnance de 1567 pour l’étalonnement des
poids, portoit qu’il ferait payé aux gardes pour chaque
pile d’un ou plufieurs marcs , avec toutes les
parties 3c diminutions, 3c aufli pour chaque garniture
de trébuchet fourni de fes poids qu’ils auraient
étalonnés, trois deniers tournois, qui leur feroient
payés par l’ouvrier 3c marchand defdits poids , tré-
buchets, 3c balances.
Par une ordonnance de l’année 1641, ce droit a
été fupprimé ; 3c il y eft dit que les Balanciers, Marchands
» Fondeurs, pourront faire étalonner 3c
marquer leurs poids gratuitement au greffe de la
cour des monnoies. Dictionn. de Comrn. de Trév. &
Chamb. (G)
ETALONNER , v . a£l. terme de Bâtiment, c’eft
réduire des mefures à pareilles diftances, longueurs,
& hauteurs, en y marquant des reperes. (P )
Et a lo n n e r , (Man. & Maréck.') couvrir une ju ment,
expreflîons fynonymes. Voye^ Ha r as .
ETALONNEUR, f. m. celui qui eft commis pour
marquer 3c étalonner les poids 3c mefures. L’ordonnance
de la ville de Paris nomme les jurés-mefureurs
de lel, ètalonneurs de mefures de bois. Diction, de Comm.
de Trév. & de Chamb,
ETAMBOT, f. m. (Marine.') \I ètambot eft une
piece de bois droite qui termine la partie de l’arriere
des vaiffeaux ; on le place prefque verticalement fur
l’extrémité de la quille, à cet endroit qu’on nomme
talon. Voye^ Marine, Planche IV . fig. 1. n°. 4. la fi-
tuation de Vétambot. Quelques-uns difent ètambod.
Cette piece doit être folidement affujettie, puif-
qu’elle foûtient le gouvernail, 3c que c’eft fur elle
que viennent aboutir les bordages qui couvrent les
façons de l’arriere ; c’eft pour recevoir ces bordages
qu’on fait à Vétambot, comme à l’étrave, une rablu-
re. Vjye^ Marine , Planche V I . fig. 74. Vétambot détaché
; a b eft la quelle ou la faillie de Vétambot; a c ,
fa hauteur ; b e , la largeur par le bas ; f e , fa largeur
par le haut ; g b , la longueur du faux ètambot : c’eft
une piece de bois appliquée fur Vétambot pour le renforcer
; h , la rablure ou cannelure pour recevoir fes
bouts des bordâmes ; b d , l’extrémité de la quille, fa
quelle, 3c fon epaiffeur. o e , contre- ètambot : c’eft
une piece courbe qui lie Vétambot fur la quille ; A:, tenon
qui entre dans une mortaife , afin que la partie
extérieure de Vétambot s’entretienne mieux avec l’extrémité
de la quille, laquelle eft auffi jointe à fa partie
intérieure par des chevilles de fer 3c de bois.
On divife la hauteur de Vétambot comme on a fait
celle de l’étrave, par piés, pour connoître commodément
le tirant d’eau de l’arrie,re.
La largeur de Vétambot eft égale à celle de la quille
; on augmente fon épaiffeur par embas de 5 lignes
par pouce de l’épaiffeur de la quille, 3c à fonbon*
d’en-haut on le diminue d’un quart de cette epaiffeur
; on peut même faire le bas de Vétambot de toute
l’épaiflëur que la piece peut porter.
Suivant plufieurs conftruâeurs , Vétambot doit
avoir de hauteur mefurée perpendiculairement à la
quille, 7V & TT de la longueur totale du vaiffeau.
Suivant cette réglé, un vaiffeau qui aurait 168 piés
de longueur, aurait, en prenant le dixième & le douzième
,3 0 piés 9 pouces 7 lignes. D ’autres donnent
une quarantième partie de moins de hauteur à Vètambot,
qu’à l’étrave. Mais puifque Vétambot détermine
la longueur du vaiffeau à l’arriere, comme l’étrave
détermine la longueur du vaiffeau en-avant, il vaut
mieux additionner la hauteur du creux au milieu, la
différence du tirant d’eau 3c le relèvement du premier
pont en-arriere, l’épaiffeur du bordage du Ier pont, 3c la diftance du premier au fécond pont en-arriere
fous le bau, y compris fôn bouge, moins l’épaiffeur
de la barre du gouvernail : l’addition de toutes ces
fommes indiquera la hauteur de Vétambot. Exemple,
Un vaiffeau de 110 canons & de 168 piés de longueur
ayant de creux au
maître couple, . . 23 piés 9 pouc.
D e relèvement au premier
pont en-arriere , y compris
la différence du tirant
d’eau, . . . . 2 7 5 fig. L’épaiffeur du bordage du
premier pont, . . 4 6
La dillaftce du premier au
fécond pont en-arriere,
fous le b au , . . . 5 8
La hauteur de Vétambot fera
de • . . > . 3 1 piés 4 pou. 11 lig.
Cet exemple eft fuffifant pour les vaiffeaux de toutes
grandeurs ; on remarquera feulement que pour
les frégates qui n’ont qu’un pont, il faut prendre le
creux au maître couple, le relèvement du pont à
l’arriere, l’épaiffeur du bordage du pont, 3c ajoûter
deux piés fix ou neuf pouces ; 3c pour les frégates 3c
corvettes deux piés trois pouces, aux fommes ci-def-
fus mentionnées.
Quelques-uns pour avoir la hauteur de Vétambot
additionnent le creux à l’arriere, l’épaiffeur des bordages
du premier pont, le feuillet & la hauteur dès
fabords de la première batterie ou de la fainte-barbe, 3c l’épaiffeur de la barre d’arcaffe, qui eft de treize
pouces aux vaiffeaux à trois ponts, de douze à ceux
de foixante - quatorze canons, de neuf à dix à ceux
de cinquante à foixante-quatre.
A l’egard de la quelle ou faillie de Vétambot, quelques
charpentiers lui donnent un pié par chaque lix
piés qu’il a de hauteur : ainfi notre ètambot cité ci-
deffus de 3 2 piés de haut, aurait cinq piés au moins
de quelle. M. Duhamel,dans fon traité de conftrüc-
tion pratique, d’où j’ai tiré prefque tout cet article,
remarque qu’on ne voit aucune raifon de lui donner
de la quelle ; au lieu qu’en la fupprimant le gouvernail
en doit être plus folidement établi, 3c par
fa lituation perpendiculaire, réfifter mieux au fluide
que s’il étoit oblique : d’ailleurs la quelle de Vètambot
fait que tous les poids de la poupe tendent à délier
le vaiffeau en cette partie, ou à ouvrir l’angle
que Vétambot fait avec la quille. (Z )
ETAMBRAIES , ETAMBAIES , ET AMBRAIS,
ETAMBRES, SERRES D E M A TS, f. f. (Marine.)
ce font deux groffes pièces de bois qui accolent un
trou rond qui eft dans le tiilac, par où paffe le mât,
afin de renforcer le tiilac en cet endroit, 3c tenir le
mât plus ferme. Voyez Marine-, Pf^^cAe VI. fig. 2 1 ,
la forjns p^x-cictrUere'aê l'etambrai du grand mât.
Dans un vaiffeau de 60 canons & de 140 piés de
longueur, l’ètambrai du grand mât doit avoir 5 piés
de long fur 4 de large, 3c 6 pouces d’épais.
On met un ètambrai à tous les mâts fur chaque pont
du vaiffeau. Voye£ Marine, Planche IV. fig. /, Vétam-
braie du grand mât au premier pont, n°. 205 ; Vétam-
braie du grand mât au fécond pont, n°. 206 ; Vêtant-
braie du mât de mifaine au premier pont, n°. 207 ;
Vètambraie du mât de mifaine au fécond pont, n°.
208 ; Vètambraie du mât de mifaine au château d’avant,
n°. 209; Vètambraie du mât de beaupré, n°.
210; Vètambraie du mât d’artimon, n°. 211.
On appelle auffi étambraie, le lieu où porte le pié
du mât dans le fond du vaiffeau.
oùE ptaafmfebnratlieess dcua bceafbteafnlas.n , ce font les ouvertures par Voye^Cabestan.
On donne auffi le nom d’étambraie à une toile poif-
fée qui fe met autour des mâts fur le tiilac, de peur
que l’eau ne les pourriffe. Voye^ Braies. (Z )
ETAMER, v . (Chimie, Arts & Métiers.) Etamer
n’eft autre chofe qu’appliquer une lame legere d’étain
fur un autre métal ; ce qui eft la même chofe que
fouder. Voye^Varticle Soudure. Les Chauderonniers
fe fervent d’un alliage compofé de deux parties d’étain
& d’une partie ae plomb, pour étamerles uften-
files de cuifine qui font de cuivre. Pour cet effet, on
avive la piece qu’on veut étamer, c’eft-à-dire qu’on
la racle avec un racloir ou inftrument de fer tranchant
, arrondi par le bout 3c arrêté dans un manche
de bois affez long; on fait chauffer la piece après
qu’elle a été avivée; on y jette de la poix-réfine, 3ç