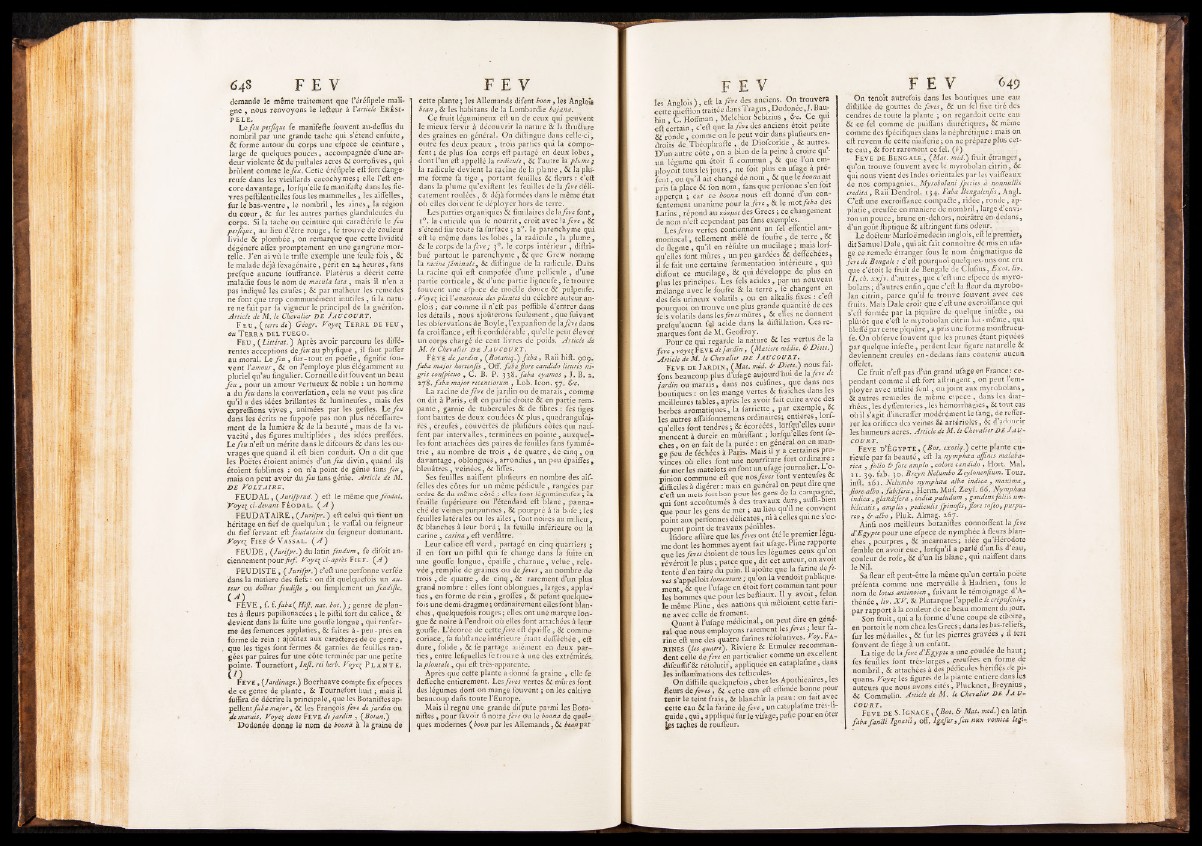
demande le même traitement que l ’éréfipele maligne
, nous ren vo yons le le&eur à Yarticle Er é s i -
p e l e .
Le fou ptrßquc fe manifefte fouvent au-deflus du
nombril par une grande tache qui s’étend enfuite,
& forme autour du corps une efpece de ceinture ,
large de quelques pouces, accompagnée d’une ardeur
violente 8c de pullules acres 6c corrofives, qui
brûlent comme le fou. Cette érélipele ell fort dange-
reufe dans les vieillards cacochymes ; elle l’eft encore
davantage, lorfqu’elle le manifefte dans les fièvres
peftilentielles fous les m ammellesles aiflelles,
iur.le bas-ventre, le nombril, les aines,, la région
du coeu r, & fur les autres parties glanduleufes du
corps. Si la tache ou ceinture qui caraéléril'e le fou
perflque, au lieu d’être rouge, fe trouve de couleur
livide & plombée, on remarque que cette lividité
dégénéré allez promptement en une gangrène mortelle.
J’en ai vû le trille exemple une feule fois , 8c
le malade déjà fexagénaire , périt en 24 heures, fans
prefque aucune louffrance. Platérus a décrit cette
maladie fous le nom de macula lata , mais il n’en a
pas indiqué les caufes ; 8c par malheur les remedeS
ne font que trop communément inutiles , fi la nature
ne fait par fa vigueur le principal de la guérifon.
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
F e u , ( terra de') Géogr. Foye{ TERRE DE FEU,
o u T err a del fue g o .
Feu , (Littéral. ) Après avoir parcouru les différentes
acceptions de fou au phylique , il faut palfer
au moral. Le f iu , fur-tout en poéfie, fignifie fou-
vent l’amour, & on l’employe plus élégamment au
pluriel qu’au fingulier. Corneille dit fouvent un beau
feu , pour un amour vertueux 6c noble : un homme a du f o u dans la converfation, cela ne veut pas dire
qu’il a des idées brillantes 8c lumineufes, mais des
expreflions vives , animées par les gelles. Le fou
dans les écrits ne fuppofe pas non plus neceffaire-
ment de la lumière 8c de la beauté , mais de la vivacité
, des figures multipliées , des idées preflees.
Le fou n’eft un mérite dans le difcours 5c dans lès ouvrages
que quand il ell bien conduit. On a dit que
les Poètes étoient animés d’un fiü divin, quand ils
étoient fublimes : on n’a point de génie lans fou,
mais on peut avoir du fou lans génie. Article de M.
d e Vol ta ir e .
FEU D A L, ( Jurifprud. ) ell le même que féodal.
Voye^ ci-devant FÉODAL. ( A )
FEUDATAIRE, ( Jurifpr. ) ell celui qui tient un
héritage en fief de quelqu’un ; le valfal ou feigneur
du fief fervant ell feudataire du feigneur dominant.
V o y e i Fief 6* V a s sa l . Ç A )
FEUDE, (Jurifpr.) du latin foudum, fe difoit anciennement
\>Ourfief. Foye^ ci-après Fief. (A )
FEUDISTE, ( Jurifpr.) c’elt uneperfonne verfée
dans la matière des fiefs : on dit quelquefois un auteur
ou docteur foudiße , ou limplement un foudifle.
( 4 )
FEVE , f. ï.faba ( Hiß. nat. bot. ) ; genre de plantes
à fleurs papilionacees ; le piftil fort du calice, &
devient dans la fuite une goufle longue, qui renferme
desfemences applaties, 8c faites à - peu-près en
forme de rein : ajoutez aux caraôeres de ce genre,
que les tiges font fermes 8c garnies de feuilles rangées
par paires fur une côte terminée par une petite
pointe. Tournefort, lnß. rei herb. Foye{ P l a n t e .
e n
Fev e , (Jardinage.) Boerhaave compte lix efpeces
de ce genre de plante, & Tournefort huit ; mais il
fuflira de décrire la principale, que les Botaniftes appellent
fabamajor ^ 6c les François feve de jardin ou
de. marais. Foye[ donc Feve de jardin , (Botanj)
Dodonée donne le nom de boonà à la graine de
cette plante ; les Allemands difent boon, les Anglo«
bean, & les habitans de la Lombardie bajaha.'
Ce fruit légumineux eft un de ceux qui , peuvent
le mieux fervir à découvrir la nature & la ftruélure
des graines en général. On diftingue dans celle-ci ^
outre fes deux peaux , trois parties qui la compo-
fent ; de plus fon corps eft partagé en deux lobes,
dont l’un eft appelle la radicule, 8c l’autre là" plume ;
la radicule devient la racine de la plante , 8c l&pliï-
me forme fa tige , portant feuilles 8c flèùrS : ç’eft
dans la plume qu’exiftent les feuilles de la feve délicatement
roulées, & déjà formées dans le même état
Oit elles doivent fe déployer hors de terre.
Les parties organiques 8c fimilaires 6e\zfeve font,
i° . la cuticule qui fe nourrit, croît avec la feve, &
s’étend fur toute fa fur face ; 20. le parenchyme qui
eft le même dans les lobes, la radicule , la plume,
& le corps de la feve ; 30. le corps intérieur , diftri-
bué partout le parenchyme ,8 c que Grew nômmç
la racine fèminale, & diftingue de la radicule. Dans
la racine qui eft compofée d’une pellicule , d’une
partie corticale, & d’une partie ligneufe, fe trouve
fouvent une efpece de moëlle douce 6c püîpeufe.
. Foye^ ici Y anatomie des plantes du célébré auteur an-
glois ; car comme il n’eft pas poflible d’entrer dans
les détails , nous ajouterons feulement, que fuivant
les obfervations de Boy le , l’expanfion de la fève dans
fa croiflance, eft fi confidérable , qu’elle peut élever
un corps chargé de cent livres de poids. Article de
M. le Chevalier D E J AU COURT.
F è v e de jardin , (Botaniq.) faba, Raii hift. 909.
faba major hortenfis , Off. faba fore candido Ijturis ni-
gris confpicuo , C. B. P. 338. faba cyamos y J. B. 2.
278. faba major recentiorum , Lob. Icon. 57. &c.
La racine de fève de jardin ou de marais, comme
on dit à Paris , eft én partie droite 8c en partie rem-
pante, garnie de tubercules & de fibres : fes tiges
ïont hautes de deux coudées 8c plus, quadrangulai-
res , creufes, couvertes de plufieurs côtes qui naif-
fent par intervalles, terminées en pointe, auxquelles
font attachées des paires de feuilles fans lÿmmé-
trie , au nombre de trois , de quatre, de cinq , ou
davantage, oblongues, arrondies, un peu épaifles ,
bleuâtres , veinées, 8c liftes ..
Ses feuilles naiflent plufieurs en nombre des aif*
felles des côtes fur un même pédicule , rangées par
ordre 8c du même c ô t é e lle s font légumineufes ; la
feuille fupérienre ou l’ étendard ell blanc ,. panna-
ché de veines purpurines, 8c pourpré à fa bafe ; les
feuilles latérales ou les allés, font noires au milieu ,
& blanches à leur bord ; la feuille inférieure ou la
carine , carina, eft verdâtre.
Leur calice eft v erd , partagé en cinq quartiers ;
il en fort un piftil qui fe change dans la fuite en
une goufle longue, epaifle , charnue, v elu e, relevée
, remplie de graines ou de feve*, au nombre de
trois , de quatre , de cinq , 8c rarement d’un plus
grand nombre : elles font oblongues, larges, applaties
, en forme de rein , grofles , & pefant quelquefois
une demi-dragme ; ordinairement elles font blanches
, quelquefois rouges ; elles ont une marque longue
8c noire à l’endroit où elles font attachées à leur
goufle. L’écorce de cette fove eft épaifle, & comme
coriace, fa fubftance intérieure étant defîeçhée , eft
dure, folide , 8c fe partage aifément en deux parties
, entre lefquelles fe trouve à une des extrémités.,
la plontale, qui eft très-apparente.
Après que cette plante a donné fa graine , elle fe
deffeche entièrement. Les foves vertes 6c mûres font
des légumes dont on mange fouvent ; on les cùltive
beaucoup dans toute l’Europe.
Mais il régné une grande difpute parmi les Botaniftes
, pour lavoir fi notre feve Ou le boona de quelques
modernes (boon par les Allemands, 5c bean par
les An»(ois1 , eft la févt des anciens. On trouvera
cette queftion traitée dans Tragus, D o d ^ é e , J. Bau-
hin C. Hoffman , Melçhior Sebizrus , è-c. Ce <jui
eft certain , c’eft que. ljljf?« des anciens, ëtojt petite
S i rànd ecomme on le WM voir dans plufieurs endroits
de.Théophrafte , ; de Diofeoridé , & autres.
D ’un: autre, dftté, on a ’fiién de la peiné à croire qu’un
dégiline qui étoit'fi commun , & que l’on em-
pi'oyoit: tous le? jours ., ne fort plus en ùfàge à pre-
ïenf , oû qu’il ait changé de nom, Sc que leboonja.il
pris la place & fon. nom, fans que perfonne^s’en fort ,
apperçu ; car ce boona nous eft donné, d un con-
fcntcmenl unanime pour la feve le moi faba des
Latins, répond au eoa/aeç des Grecs ; ce changement
de nom n’eft cependant ,pas fans exemple*.,, ;
Les fèves vertes contiennent un Ici éfiéntiel ammoniacal',
tellement mêlé de foufre, de tèrre , &
de flegme , qu’il en réfulte un mucilage ; mÿslorf-
qii’ellçs font mûres,,; un peu .gardées f e defféçhées,
il fe fait une certaine fermentation intérieure , qui
diffout ce mucilage, & qui développe de plus en
plus lès principes. Les fels acides, pa£ un nouveau
mélange avec le foufre & la terre , fe changent^en
des fels urineux volatils » ou en alkafis fixes : c eft
pourquoi on trouve une plus grande quantité de ces
fels volatils dans les foves mûres, & elles ne donnent
prefqu’aucun fql acide dans la diftillation.. Çes remarques
font de M. Geoffroy. , i
Pour ce qui regarde la nature & les vertus de la
feve yvoyei F e v e de jardin , (Matière medic. & Dicte.)
Article de M. le Chevalier DE J AU c o u r t .
F e v e d e Ja r d i n , (Mat. méd. & Diete.) nous fai-
fons beaucoup plus d’ufage aujourd’hui de la feve de
jardin ou marais, dans nos cuifines, que dans nos
boutiques : on les mange vertes & fraîches dans les
meilleures tables, après les avoir fait cunie avec des
herbes aromatiques, la farriette , par exemple, 5c
les autres aflaifonnemens ordinaires; entières, lori-
qu’elles font tendres ; 8c écorcées, lorfqu elles commencent
à durcir en mûriflant ; lorfqu elles lont léchés
, on en fait de la purée : en général on en mange
peu de féchées à Paris. Mais il y a certaines provinces
où elles font une nourriture fort ordinaire :
fur mer les matelots en font un ufage journalier. L o-
pinion commune eft que nos foves font yenteules 5c
difficiles à digérer : mais en général on peut dire que
c ’eft un mets fort bon pour les gens de la campagne,
qui font accoûtumés à des travaux durs-, aufli-bien
que pour les gens de mer ; au lieu qu il ne convient
point aux perfonnes délicates, ni à celles qui ne s occupent
point de travaux pénibles. . *,
Ifidore aflïire que les foves ont ete le premier légume
dont les hommes ayent fait ufage. Pline rapporte
que les foves étoient de tous les légumes ceux qu on
révéroit le plus ; parce que, dit cet auteur, on.avoit
tenté d’en faire du pain. Il ajoute que la farine de ƒ*-
res s’appelloit lomentum ; qu’on la vendoit publiquement
8c que l’ufage en étoit fort commun tant pour
les hommes que pour les beftiaux. Il y avoir, félon
le même Pline, dessalions qur melorent cette farr-
ne avec celle de froment. , ,
Quant à l’ufage médicinal, on peut dire en general
que nous employons rarement les fevts; leur ta-
rine eft une des quatre farines réfolutives. fo y . rA-
r i n e s (les quatre). Riviere 8c Etmuler recommandent
celle de fove en particulier comme un excellent
difeuffif 8c rélolutif, appliquée en cataplafme, dans
les inflammations des tefticules.
On diftille quelquefois, chez les Apothicaires, les
fleurs de foves, 6c cette eau eft eftimee bonne pour
tenir le teint frais, 8r blanchir la peau.: on fait avec
cette eau 8c la farine Aefoye , un catMplalme très-liquide
, qui, appliqué fur le vifage, pafie pour en oter
£ps taches de rouifeur.
On teiioit autrefois dans les boutiques une eau
diftillée de gouttes de foeves, 8c un fel fixe tiré des
cendres de toute la plante ; on regardoit cette eau
8c e.e fel comme de puiflans diurétiques, 8c même
comme des fpécifiques .dans la néphrétique : mais on
eft revenu de cette niaiferie ; on ne prépare plus cette
eàû, 8c fort rarement ce fel. (b)
F e v e d e B e n g a l e , (Mat. méd.) fruit étranger ,
qu’on trouve fouvent avec le myrobolah citrin, 8c
qui nous vient des Indes orientales par les yaiffeaux
de, tyos,com^z%mes.. Myrobolani fpecies à nonnûllis
crédita, Raii Dendro,!. 13 4. Faba Bengalenfis., Angl.
C ’ëft une excroiflance compaéle, ridée, ronde, ap-
platié , creufée en mariiere de nombril, large d’environ
un pouce, brune en-dehors, noirâtre en-dedans,
d’un goût ftiptique 8c aftringent fans odeur.^. '
Le doéleur Marloë médecin anglois, eft le premier^
dit Samuel D a le , qui ait fait connoître 5c mis en ufage
ce.remede étranger fous le nom énigmatique ae
fove de Bengale : c’eft pourquoi quelques-uns ont cru
que c’étoit le fruit de Bengale de Clulîus, Ëxot. liv.
I l . fh. xxjy. d’autres , que c ’eft une efpece de myro-
b.bjans ; d’autres enfin,,, que c’eft la fleur du myrobo-
lan citrin, parce qu’il fe trouve fouvent avec xes
fruits. Mais Dale croît qiie c’eil une excroiflance qui
s’eft formée par la piquûre de quelque infefre, ou
plûtôt que c’eft le myrobolan citrin lui - même 5 qui
blefle par cette piquûre.ya pris une forme monftrueu-
fe. On obferve fouvent que les prunes étant piquées
par quelque infefte, perdent leur figure naturelle 8c
deviennent creufes en-dedans fans contenir aucun
oflelet.
Ce fruit n’eft pas d?ùn grand ufage en France : cependant
comme il eft fort aftringent, on peut l employer
avec utilité fe u l, ou joint aux myrobolans,
St autres remedes de, même etpece , dans les diarrhées
, les dyflenteries, les hémorrhagies, 8c tout cas
où il s’agit d’incrafler modérément le fang, de refler-
rer les orifices des veines 8c artérioles, 6c d adoucir
les humeurs acres. Article de M. le Ckevaller d e Ja u -
c o u r t .
F e v e d ’ É g y p t e , (Bot. exotiq.) cette plante cu-
rieufe par fa beauté, eft la nympheea affinis malabar
rica , folio & fore amplo , colore candido > Hort. Mal.
1 1. 39. fab. 30. Breyn Nelumbo Zcylonenfîum. Tour,
inft. 261. Nelumbo nympheea alba indica f maximai9
flore,aibo , fabifora , ,Herm. Miif. Zeyl. 66. Nymphoea
indica , glandifora, indice paludum , gaudens foliis um-
bilicatis , amplis , pediculis fpinofls, flore rofoot purpu-
reo, & albo , Pluk. Almag- 267.
Ainfi nos meilleurs botaniftes connoiflent la fove
d'Egypte pour une efpece de nymphée à fleurs„blan-
ches , pourpres , 8c incarnates y idee qu Hérodote
femble en avoir eu e, lorfqu’il a parle d un Iis d eaü>
couleur de rofe, 8c d’un lis b lanc, qui naiftent dans
le Nil. . V
Sa fleur eft peut-être la même qu’un certain poëte
préfenta comme une merveille a Hadrien, fous le
nom de lotus antinoien, fuivant le témoignage d’A-
thénée, liv. X F . & Plutarque l’appelle le crépüfcule,
par rapport à la couleur de ce beau moment du jour.
Son fruit, qui a la forme d’une coupé de ciboire,
en portoit le nom chez les Grecs ; dans les bas-reliefs,
fur les médailles, 8c fur les pierres gravées y il-iert
fouvent de liège à un enfant.. , ■ \ ‘ ;
La tige de la fove d 'E g yp te a une coudee. de haut;
fes feuilles font très-larges, , creufees en forme de
nombril, & attachées à des pédicules heriffes de pi-
quàns. F o ye^ les figures de la plante entière dans» les
auteurs que nous avons cites, Plucknet, Breynjus,
8c Commelin. Article de M . le Chevalier d e J A V -
c o u r t . .
F e v e d e S . I g n a c e ,• (Bot. & Mat. med.) e n I a ù p
fabafancli Ignatu, off, lgafur\fou nux vomica legi