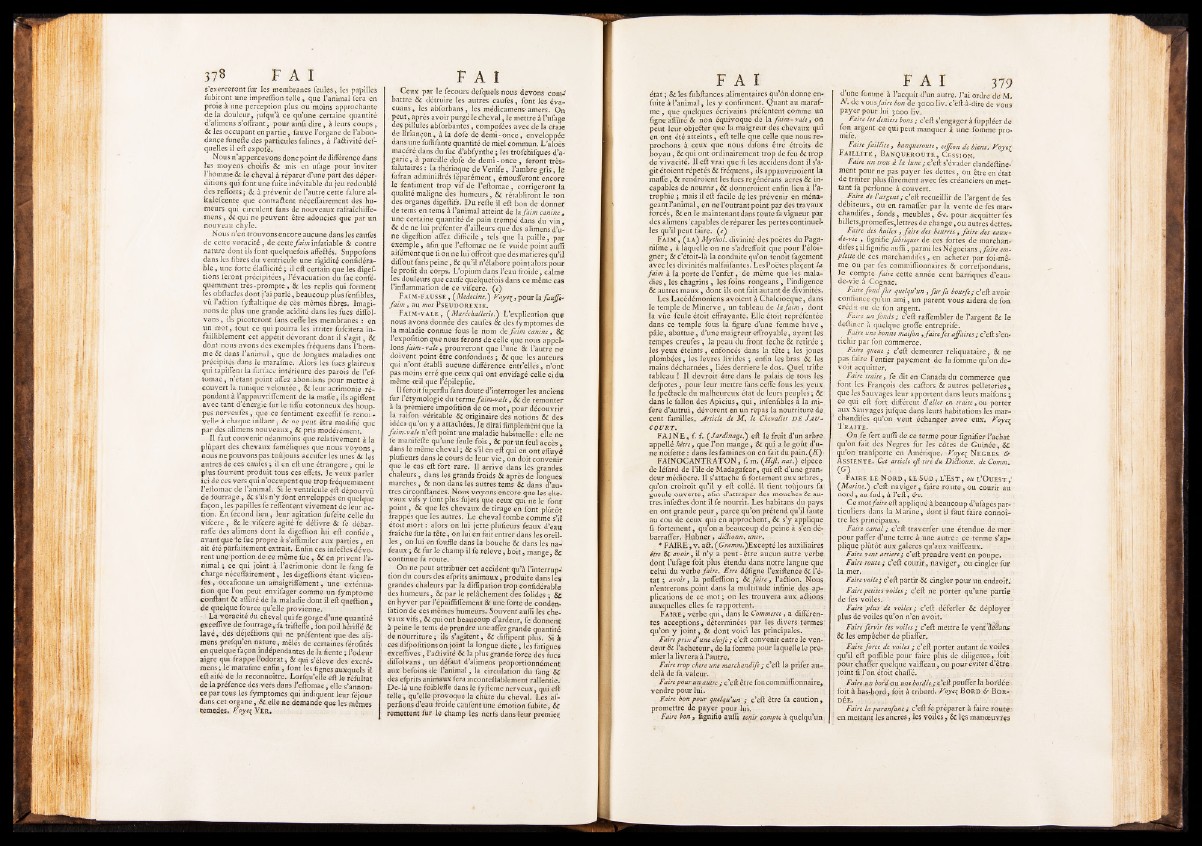
s’exerceront fur les membranes feules , les papilles
fubiront une impreffion telle, que l’animal fera en
proie à une perception plus ou moins approchante
d e là douleur, jufqu’à ce qu’une certaine quantité
d’alimens s’offrant, pour ainfi dire, à leurs coups,
& les occupant en partie, fauve l’organe de l’abondance
funefte des particules falines, à l’aâivité def-
quelles il eft expofé.
Nous n’appercevons donc point de différence dans
les moyens choifis 6c mis en ufage pour inviter
l’homme & le cheval à réparer d’une part des déperditions
qui font une fuite inévitable du jeu redoublé
des refforts ; & à prévenir de l’autre cette falure al-
kalefcente que contractent néceffairement des humeurs
qui circulent fans de nouveaux rafraîchiffe-
mens , 6c qui ne peuvent être adoucies que par un
nouveau chyle.
Nous n’en trouvons encore aucune dans les caufes
de cette voracité , de cette faim infatiable & contre
nature dont ils font quelquefois affe&és. Suppofons
dans les fibres du ventricule une rigidité confidéra-
b le , une forte élafticité ; il eft certain que les digef-
tions feront précipitées, l’évacuation du fac confé-
quemment très-prompte, & les replis qui forment
les obftacles dont j’ai parlé, beaucoup plus fenfibles,
vû l’àôion fyftaltique de cés mêmes fibres. Imaginons
de plus une grande acidité dans les fucs diffol-
vans, ils picoteront fans ceffe les membranes : en
un mot, tout ce qui pourra les irriter fufcitera infailliblement
cet appétit dévorant dont il s’agit, &
dont nous avons dés exemples fféquensdans l ’homme
& dans l’animal, que de longues maladies ont
précipités dans le marafme. Alors les fucs glaireux
qui. lapident la furface intérieure des parois de l’efi-
tomac, n’étant point affez abondans pour mettre à
couvert la tunique veloutée, & leur, acrimonie répondant
à l’appauvriffement de la maffe, ils agiffent
avec tant d’énergie fur le, tiffu cotonneux des houp-
■ pes nerveufes, que ce fentiment exceflif fe renouvelle
à chaque inflanr, & ne peut être modifié que
par des alimens nouveaux, 6c pris modérément.
Il faut convenir néanmoins que relativement à la
plupart des chevaux faméliques que nous voyons,
nous ne pouvons pas toujours accufer les unes & les
autres de ces caufes ; il en eft une étrangère, qui le
plus fou vent produit tous ces effets. Je veux parler
ici de ces vers qui n’occupent que trop fréquemment
l ’eftomac de l’animal. Si le ventricule eft dépourvu
de fourrage, 6c s’ils n’y font enveloppés en quelque
façon, les papilles fe reffentent vivement de leur action.
En fécond lieu, leur agitation fufcite celle du
vifcere , 6c le vifcere agité fe délivre & fe débar-
raffe des alimens dont la digeftion lui eft confiée
avant que te fuc propre à s’aflimiler aux parties en
ait été parfaitement extrait. Enfin ces infeéles dévorent
une portion de ce même fu c , & en privent l’animal
; ce qui joint , à l’acrimonie dont le fang fe
charge néceffairement, les digeftions étant vicieu-
fes , ôccafionne un amâigriffement, une exténuation
que l’on peut envifager comme un fymptome
confiant & affûré de la maladie dont il eft queftion,
de quelque four ce qu’elle provienne. fl
La voracité du cheval qui fe gorge d’une quantité
exceffive de fourrage Û fa trifteffe, fonpoil hériflé 6c
la v é , dés dé jetions qui ne préfentent que des alimens
prefqu’en nature, mêlés de certaines férofités
en quelque façon indépendantes de la fiente ; l’odeur
aigre qui frappe Fodorat, & qui s’élève des excré-
raens;; .lé marafme enfin, font les lignés auxquels il
eft aifé de la reconnoître. Lorfqu’elle eft le réfultat
de lapréfence desivefs dans l’eftomac, elle s’annonce
par tous les fymptomes qui indiquent leur féjour
dans cet organe, 6c elle ne demande que les mêmes
t-eme.de.s.1 floye^ Ver.
Ceux par le fecours defquels nous devons combattre
6 c détruire les autres caufes, font les éva-
cuans, les abforbans, les médicamens- amers. On
. peut, après avoir purgé le cheval, le mettre à l’ufage
des pilluies abforbantes, compofées avec de la cfaie
de Briançon, à la dofe de demi - once, enveloppée
dans une fuffifante quantité de miel commun. L ’aloès
macéré dans du fuc d’abfynthe ; les trOfchifques d’agaric,
a pareille dofe de demi-once , feront très-
falutaires : la thériaque de Venife, l’ambre gris, le
fafran adminiftrés féparément, émoufferont encore
le fentiment trop v if de l’eftomac, corrigeront la
qualité maligne des humeurs, 6 c rétabliront le ton
des organes digeftifs. Du refte il eft bon de donner
de tems en tems à 1 animal atteint de Y&faim canine ,
une certaine quantité de pain trempé dans du v in ,
& de ne lui préfenter d’ailleurs que des alimens d’une
digeftion affez difficile, tels que la paille, par
exemple, afin que l’eftomac ne fe vuide point auffi
aifément que fi on ne lui offroit que dés matières qu’il
diffout fans peine, 6 c qu’il n’élabore point alors pour
le profit du corps. L’opium dans l’eau froide, calme
les douleurs que caufe quelquefois dans ce même ca9
l’inflammation de ce vifcere. (e)
F a im -f a u s s e , (M e d e c in e .) V o y e ^ y 'ç to x x ld i f a u ffi*
f a im , au m o t Ps e u d o r e x ie .
F à IM-v à LE , (M a r é c h a l le r ie .') L ’explication que
nous avons donnée des caufes & des fymptomes de
la maladie connue fous le nom de f a im c a n in e , 8 c
l’expofition que nous ferons de celle que nous appelions
f a im ^ v a l e t prouveront que l’une & l’autre ne
doivent point être confondues ; 6 c que les auteurs
qui n’ont établi aucune différence entr’e lle s , n’ont
pas moins erré que ceux qui ont envifagé celle c i du
même oeil que l’épilepfie.
Il feroitfuperflu fans doute d’interroger les anciens
fur l’étymologie du terme faim-vale, 6c de remonter
à la première impofition de ce mot, pour découvrir
la raifon véritable 6c originaire des notions 6c des
idées qu’on y a attachées. Je dirai Amplement que la
faim-vale n’éft point une maladie habituelle : elle ne
fe manifefte qu’une feule fois, & par un feul accès >
dans le même cheval ; 6c s’il en eft qui en ont effuyé
plufieurs dans le cours de leur v ie , on doit convenir
que le cas eft fort- rare. Il arrive dans les grandes
chaleurs, dans les grands froids & après de longues
marches , & non dans les autres tems & dans d’autres
circortftances. Nous voyons encore que les chevaux
vifs y font plus fujets que ceux qui ne l.e font
point, & que les chevaux de tirage en font plutôt
frappés que les autres. Le cheval tombe comme s’il
étoit mort : alors on lui jette plufieurs féaux d’eau
fraîche fur la tête, on lui en fait entrer dans les oreilles
, on lui en fouffie dans la bouche & dans les na-
feaux ; & fur le champ il fe releve, boit, man<*e, &
continue fa route.
On ne peut attribuer cet accident qu’à l’interruption
du cours des efprits animaux, produite dans les
grandes chaleurs par la diffipation trop confidérable
des humeurs, & par le relâchement des folides ; &c
en hyver par l’épaiffiffement & une forte de conden-
fàtion de ces mêmes humeurs. Souvent auffi les chevaux
vifs, & qui ont beaucoup d’ardeur, fe donnent
à peine le tems de prendre une affez grande quantité
de nourriture ; ils s’agitent, 6 c diffipent plus. Si à
ces difpofitions on joint la longue diete, les fatigues
exceffives, l’a&ivité & la plus grande force des fucs
diffolvans , un défaut d’alimens proportionnément
aux befoins de l’animal, la circulation du fang 6 c
des efprits animaux fera inconteftablement rallentie.
De-là une foibleffe dans le fyftème nerveux, qui eft
telle, qu’elle provoque la chuté du cheval. Les af-
perfions d’eau froide caufent une émotion fubite, 6 c
remettent fur le champ les nerfs dans leur premier
état ; & les fubftances alimentaires qu’ôn donne en-
fuite à l’animal, les y confirment. Quant au marafme
, que quelques écrivains préfentent comme; Un
ligne allure & non équivoque dé la fa im -v a le on
peut leur objeéter que la maigreur des chevaux qui
en ont été atteints, eft telle que celle que nous reprochons
à ceux que nous difons être étroits de
boyau , 6c qui ont ordinairement trop de feu &c trop
de vivacité. Il eft vrai que fi les accidens dont il s’agit
étoient répétés 6c fréquens, ils appauvriroient lâ
maffe, & rendroient les lues regénérans acres 6c incapables
de nourrir, 6c donneroient enfin lieu à l’atrophie
; mais il eft facile de les prévenir en ménageant
l’animal, en ne l’outrant point par des trayaux
forcés, 8c en le maintenant dans toute fa vigueur par
des alimens'capables de réparer les pertes continuelles
qu’il peut faire, (e)
Fa im , ( l a ) Mythol. divinité des poètes du Paga-
nifme , à laquelle on ne s’adreffoit que pour l’éloigner;
& c’étoit-là la conduite qu’on tenoit fagement
avec les divinités malfaifantes. Les Poètes plaçent la
faim à la porte de l’enfer, de même que les mala-'
dies, les chagrins, les foins rongeans, l’indigence
8c autres maux, dont ils ont fait autant de divinités.
Les Lacédémoniens avoient à Chalcioëque, dans
le temple de Minerve, un tableau de la faim, dont
la vue feule étoit effrayante. Elle étoit repréfentée
dans ce temple fous la figure d’une femme h â v e ,
pâle, abattue, d’une maigreur effroyable, ayant les
tempes creufes, la peau du front feche 8c retirée ;
les yeux éteints , enfoncés dans lia, tête ; les joues
plombées, les levres livides ; enfin les bras 8c les
mains décharnées, liées derrière le dos. Quel trifte
tableau ! Il devroit être dans le palais de tous les
defpotes , pour leur mettre fans ceffe fous les, yeux
le fpe&acle du malheureux état de leurs peuples ; 8c
dans le fallon des Apicius, qui, infenfibles à la,mi-,
fere d’autrui, dévorent en un répas la nourriture de.
cent familles. Article de M. le Chevalier d e J a u -
C O U R T .
F A IN E , f. f. ( Jardinage.) eft le fruit d’un arbre
appellé hêtre , que l’on mange, 8c qui a le goût d’une
noifette : dans les famines on en fait du pain, (if)-
FAINOCANTRATON, f. m. (Hi/l. nat.) efpece
de léfard de Hle de Madagafcar, qui eft d’une grandeur
médiocre. Il s’attache fi fortement aux arbres,
qu’on croiroit qu’il y eft collé. 11 tient toujours fa
gueule ouverte, afin d’attraper des mouches 8c autres
infeôes dont il fe nourrit. Les habitans du pays
en ont grande peur, parce qu’on prétend qu’il faute
au cou de ceux qui en approchent, 8c s’y applique
fi fortement-, qu’on a beaucoup de peine à s’en dé-
barraffer. Hubner, diclionnv univ.
* FAIRE, v . aéh (Gramrn.)Exceptê les auxiliaires
être 8c avoir y il n’y a peut-être aucun autre verbe
dont l’ufage foit plus étendu dans notre langue que
celui du verbe faire. Etre défigne Fexiftence-8c l’é-:.
tat ; avoir y la pofïeffion; 6c faire y l’afrion. Nous
n’entrerons point dans la multitude infinie des applications
de ce mot; on les trouvera aux; a v ion s-
auxquelles elles fe rapportent.
Fa ir e , verbe qui, dans le Commerce, a différentes
acceptions., déterminées par les divers-termes'
qu’on y joint , & dont voici les principales.
Faire prix d'une chofe ; c’eft convenir entre le vendeur
8c l’acheteur, de la fomme pour laquelle le premier
la livrera à l’autre.
Faire trop chere une marchandife j c’eft la prifer au- ,
delà de fa, valeur.
Faire pour un autre j c’eft être fon commiflionnaire,
vendre pour lui.
Faire bon pour quelqu'un ; c’eft être fa caution,
promettre de payer pour lui.
Faire bon, lignifie auffi tenir compte à quelqu’un
d’une fomme à l’acquit d’un autre. J’ai ordre de M.
N. de vous/aire bon de 3000 liv. c’èft-à-dire de vous
payer pour lui 3600 liv.
Faire les deniers bons ; c’eft s’engager à fiippléer de
fon argent ce qui peut manquer à une fomme promue.
Faire faillite , banqueroute, cejjion de bierts. F~oye£
Fa i l l i t e > Ba n q u e r o u t e , C e s s io n .
Faire un trou a la lune j c ’eft s’évader clandeftine-
ment pour ne pas payer fes dettes, ou être en état
de traiter plus fûrement avec fes créanciers en mettant
fa perfonne à couvert.
Faire de Cargent; c’eft recueillir de l’argent de fes
débiteurs, ou en ramaffer par la vente de fes mar-
chandifes, fonds, meubles, &c. pour acquitter fes
billets,promeffes,lettres de change ,011 autres dettes.
Faire des huiles , faire des beurrés , faire des eaux-
de-vie y fignifie fabriquer de ces fortes de marchan-
difes ; il fignifie auffi, parmi les Négocians, faire emplette
de ces marchandifes, en acheter par foi-même
ou par fes commiffionnaires & correfpondans.
Je compte faire cette :année cent barriques d’eau-
de-vie à Cognac.
Faire fond fur quelqu'un , fur fa bourfe;Ce& avoir
confiance qu’un ami, un parent vous aidera de fon
crédit ou de fon argent.
Faire un fonds ; c’eft raffembler de l’argent 6c le
deftiner à.quelque groffe entreprife.
Faire une bonne maifon , faire fes affaires ; c’eft s’enrichir
par fon commerce.
Faire q u eu e ; c’eft demeurer reliquataire, S i ne
pas faire l’entier payement de la fomme qu’on de-
voit acquitter.
Faire traite y fe dit en Canada du commerce que
font les François des caftors & autres pelleteries,
que les Sauvages leur apportent dans leurs maifons ;
ce qui eft fort. différent.dW/er en traite ou porter
aux Sauvagçs jufque dans leurs habitations les marchandifes
qu’on veut -échanger .avec eux. Voye£
T r a i t e .
. On fe fert auffi de ce terme pour lignifier Fâchât
qu’on fait dès Negres fur les côtes de Guinée, 6c
qii’on tranfporte en Amérique. V.oye1 N e g r e s &
ASSIENTE. Cet article eft. tiré du Diclionn. de Comm.
c e ) - , v - , . , i ,
Fa ir e l e N o r d , LErSüiD, l ’Es t , ou l ’O u e s t ,1
(Marine.') c’eft naviger j faire route , ou courir au
nord, au fud, à l’eft, &c.
Ce mot faire eft appliquéeJ?eau coup d’ufagés particuliers
dans la Marine, dont il faut faire connoî-
tre les principaux.
Faire canal ; c’eft trayerfer une étendue^ de mer
pour palier d’une terre à une autre : ce terme s’applique
plutôt aux galeres qu’aux vaifleaux.
Faire vent arriéré; c’eft prendre vent.en poupe.
Faire route ; c’eft courir., naviger, ou cingler fur
la. mer.
Faire voile} c’eft partir 8f cingler pour un endroit.'
Faire petites-voiles ; c’eft ne pôrtèr qu’une partie
de fes voiles.
Faire plus 'de voiles ; c’eft déferler 6c déployer
plus de voiles qu’on n’en avoit.
Faire fervir les voiles ; c’eft mettre le vent âeaam»
6c les empêcher de pliaffer.
Faire force de voiles ; c’eft porter autant de. voiles
qu’il eft poffible pour faire plus de diligence, foit
pour chàlier quelque vaifleau , ou pour éviter d’être
joint fi Ton étoit chafle. : /
Faire.un bord..011 une bordée ; ç’efl pouffer la bordée.
foit à bas-bord, foit à tribord, foye^ B o r d # Bo r d
é e . . ;
Faire la paranfane; c’eft fe préparer à faire routes
en mettant lçs ancres, les voiles ? 8c lçs manoeuvres