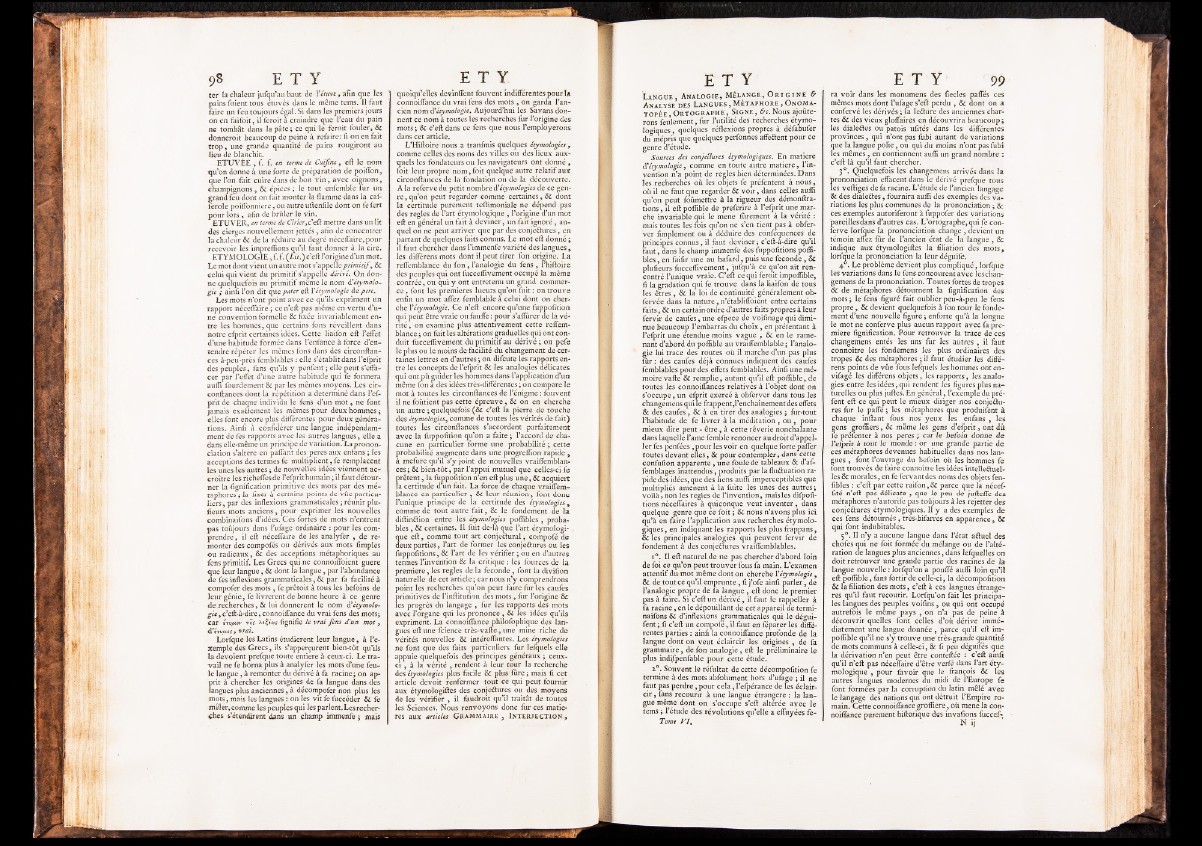
ter la chaleur jufqu’auhaut de Véiicvt, afin que les
pains foient tous etuvés dans le même tems. Il faut
faire un feu toujours égal. Si dans les premiers jours
on en faifoit, il feroit à craindre que l’eau du .pain
ne tombât dans la pâte ; ce qui le feroit fouler, 8c
donneroit beaucoup de peine à refaire: fi on en fait
trop , une grande quantité de pains rougiront au
lieu de blanchir..
ETUVÉE , f. f, en terme de Cuijîne, éft le nom
qu’on donne à une forte de préparation de poiflon,
que l’on fait cuire dans de bon v in , avec oignons,
champignons, 8c épices ; le tout enfemble Tùr un
grand feu dont on fait monter la flamme dans la caf-
lèrole poiffonniere, ou autre uftenfile dont on fe fert
pour lors , afin de brûler le vin.
ETUVER, en terme de Cirier,c’eft mettre dans un lit
des cierges nouvellement jettés, afin de concentrer
la chaleur 8c de la réduire au degré néceflaire, pour
recevoir les impreflions qu’il faut donner à la cire.
ETYMOLOGIE, f. f. (Lit.) c’efl: l’origine d’un mot.
Le mot dont vient un autre mot s’appelle primitifs Sc
celui qui vient du primitif s’appelle dérivé. On donne
quelquefois au primitif même le nom 8 étymologie
; ainfi l’on dit que pater eft l’étymologie de pere.
Les mots n’ont point avec ce qu’ils expriment un
rapport néceflaire ; ce n’eft pas même en vertu d’une
convention formelle 8c fixée invariablement entre
les hommes, que certains fons réveillent dans
notre efprit certaines idées. Cette liaifon eft l’effet
d’une habitude formée dans l’enfance à force d’entendre
répéter les mêmes fons dans des circonftan-
ces à-peu-près femblables : elle s’établit dans l’efprit
des peuples, fans qu’ils y penfent ; elle peut s’effacer
par l’effet d’une autre habitude qui fe formera
aufli fourdement 8c par les mêmes moyens. Les circonftances
dont la répétition a déterminé dans l’ef-
prit de chaque individu le fens d’un mot, ne font
jamais exactement les mêmes pour deux hommes ;
elles font encore plus différentes pour deux générations.
Ainfi à confidérer une langue indépendamment
de fes rapports avec les autres langues, elle a
dans elle-même un principe de variation. La prononciation
s’altere en paffant des peres aux enfàns ; les
acceptions des termes fe multiplient, fe remplacent
les unes les autres ; de nouvelles idées viennent accroître
les richeffes de l’efprit humain ; il faut détourner
la Signification primitive dès mots par des métaphores
; la fixer à certains points, de vue particuliers
, par des inflexions grammaticales ; réunir plusieurs
mots anciens, pour exprimer les nouvelles
combinaifons d’idées. Ces fortes de mots n’entrent
pas toujours dans l’ufage ordinaire : pour les comprendre
, il eft néceflaire de les analyfer , de remonter
des compofés ou dérivés aux mots Amples
ou radicaux, 8c des acceptions métaphoriques au
fens primitif. Les Grecs qui ne connoiffoient guere
que leur langue, & dont la langue, par l’abondance
de fes inflexions grammaticales, 8c par fa facilité à
compofer des mots, fe prêtoit à tous les befoins de
leur génie, fe livrèrent de bonne heure à ce genre
de recherches, & lui donnèrent le nom ïïétymologie
, c’eft-à-dire, connoiflance du v rai fens des mots;
car tTv/jtov tmc At|t'aç lignifie le vrai fens dé un mot,
âé’tTuuoç , vrai.
Lorfque les Latins étudièrent leur langue, à l’exemple
des Grecs, ils s’apperçurent bien-tôt qu’ils
la dévoient prefque toute entière à ceux-ci. Le trav
a il ne fe borna plus à analyfer les mots d’une feule
langue, à remonter du dérivé à fa racine; on apprit
à chercher les origines de fa langue dans des
langues plus anciennes, à decompofer non plus les
mots, mais les langues : on les vit fe luccéder 8c fe
mêler, comme les peuples qui les parlent. Les recherches
s’étendirent dans un champ immenfe ; mais
quoiqu’ elles devinflent fouvent indifférentes pour la
connoiflance du vrai fens des mots , on garda l’ancien
nom d'étymologie. Aujourd’hui les Savans donnent
ce nom à toutes les recherches fur l’origine des
mots ; 8c c’eft dans ce fens que nous l’employerons
dans cet article.
L ’Hiftoire nous a tranfmis quelques étymologies ,
comme celles des noms des villes ou des lieux auxquels
les fondateurs ou les navigateurs ont donné ,
foit leur propre nom, foit quelquè autre relatif aux
circonftances de la fondation ou de la découverte.
A la referve du petit nombre d'étymologies de ce genre
, qu’on peut regarder comme certaines, 8c dont
la certitude purement teftimoniale ne dépend pas
des réglés de l’art étymologique , l’origine d’un mot
eft en général un fait à deviner, un fait ignoré, auquel
on ne peut arriver que par des conjectures, en
partant de quelques faits connus. Le mot eft donné ;
il faut chercher dans l’immenfe variété des langues,
les différens mots dont il peut tirer fon origine. La
reflemblance du fo n , l’analogie du fens , l’hiftoire
des peuples qui ont fucceflivement occupé la même
contrée, ou qui y ont entretenu un grand commerce
, font les premières lueurs qu’on fuit : on trouve
enfin un mot afîez femblable à celui dont on cherche
l’étymologie. Ce n’eft encore qu’une fuppofition
qui peut être vraie ou faufle : pour s’aflïirer de la vérité
, on examine plus attentivement cette reflemblance
; on fuit les altérations graduelles qui ont conduit
fucceflivement du primitif au dérivé ; on pefe
le plus ou le moins de facilité du changement de certaines
lettres en d’autres ; on difcute les rapports entre
les concepts de l’efprit 8c les analogies délicates
qui ont pu guider les hommes dans l’application d’un
même fon à des idées très-différentes ; on compare le
mot à toutes les circonftances de l’énigme : fouvent
il ne foûtient pas cette épreuve, & on en cherche
un autre ; quelquefois (8c c’eft la pierre de touche
des étymologies, comme de toutes les vérités de fait)
toutes les circonftances s’accordent parfaitement
avec la fuppofition qu’on a faite ; l’accord de chacune
en particulier forme une probabilité ; cette
probabilité augmente dans une progreflion rapide ,
à mefure qu’il s’y joint de nouvelles vraiflemblan-
ces ; 8c bien-tôt, par l’appui mutuel que celles-ci fe
prêtent, la fuppofition n’en eft plus une, 8c acquiert
la certitude d’un fait. La force de chaque vraiflem-
blance en particulier , 8c leur réunion, font donc
l’unique principe de la certitude des étymologies,
comme de tout autre fait, 8c le fondement de la
diftin&ion entre les étymologies poflibles , probables
, 8c certaines. Il fuit de-là que l’art étymologi- .
ue eft, comme tout art conje&ural, compofé de
eux parties, l’art de former les conje&ures ou les
fuppofitions, 8c l’art de les vérifier ; ou en d’autres
termes l’invention 8c la critique : les fources de la
première, les réglés de la fécondé, font la divifion
naturelle de cet article ; car noüs n’y comprendrons
point les recherches qu’on peut faire fur les caufes
primitives de l’inftitution des m ots, fur l’origine 8c
les progrès du langage , fur les rapports des mots
avec l’organe qui les prononce , 8c les idées qu’ils
expriment. La connoiflance philofophique des langues
eft une fcience très-vafte, une mine riche de
vérités nouvelles 8c intéreflantes. Les étymologies
ne font que des faits particuliers fur lefquels elle
appuie quelquefois des principes généraux ; ceux-
ci , à la vérité , rendent à leur tour la recherche
des étymologies plus facile 8c plus fïire ; mais fi cet
article devoit renfermer tout ce qui peut fournir
aux étymologiftes des conje&ures ou des moyens
de les vérifier , il faudroit qu’il traitât de toutes
les Sciences. Nous renvoyons donc fur ces matières
aux articles Grammaire , Interjection ,
Langue, Analogie, Mélange, Or ig in e & Analyse des Langues , Métaphore , Onomatopée,
Ortographe, Signe, &c.Nous ajoûte-
rons feulement, fur Futilité des recherches étymologiques
, quelques réflexions propres à défabufer
du mépris que quelques perfonnes affe&ent pour ce
genre d’étude.
Sources des conjectures étymologiques. En matière
d’étymologie, comme en toute autre matière, l’invention
n’a point de regies bien déterminées. Dans
les recherches oit les objets fe préfentent à nous,
oii il ne faut que regarder 8c vo ir , dans celles aufli
qu’on peut foûmettre à la rigueur des démonftra-
tions, il eft poflible de prefcrirè à l’efprit une marche
invariable qui le mene lïirement à la vérité :
mais toutes les fois qu’ on ne s’en tient pas à obfer-
ver Amplement ou à déduire des conféquences de
principes connus, il faut deviner ; c’eft-a-dire qu’il
faut, dans le champ immenfe des fuppofitions poflibles
, en faifir une au hafard, puis une fécondé , 8c
plufieurs fucceflivement, jufqu’à ce qu’on ait rencontré
l’unique vraie. C’eft ce qui feroit impoflible,
fi la gradation qui fe trouve dans la liaifon de tous
les êtres , 8c la loi de continuité généralement ob-
fervée dans la nature, n’établifloient entre certains
faits, 8c un certain ordre d’autres faits propres à leur
fervir de caufes, une efpece de voifinage qui diminue
beaucoup l’embarras du choix, en préf entant à
l’efprit une étendue moins vague , 8c en le ramenant
d’abord du poflible au vraiflemblable ; l’analogie
lui trace des routes où il marche d’un pas plus
iûr : des caufes déjà connues indiquent des caufes
femblables pour des effets femblables. Ainfi une mémoire
vafte 8c remplie, autant qu’il eft poflible, de
toutes les connoiflances relatives à l’objet dont on
s’occupe, un efprit exercé à obferver dans tous les
changemens qui le frappent,l’enchaînement des effets
8c des caufes, 8c à en tirer des analogies ; fur-tout
l’habitude de fe livrer à la méditation , ou , pour
mieux dire peut - être, à cette rêverie nonchalante
dans laquelle l’ame femble renoncer au droit d’appel-
ler fes penfées ,pour les voir en quelque forte pafler
toutes devant elles, 8c pour contempler, dans cette
confufion apparente , une foule de tableaux 8c d’af-
femblages inattendus, produits par la flu&uation rapide
des idées, que des liens aufli imperceptibles que
multipliés amènent à la fuite les unes des autres ;
voilà, non les regies de l’invention, mais les difpofi-
tions néceflaires à quiconque veut inventer, dans
quelque genre que ce foit ; 8c nous n’avons plus ici
qu’à en faire l’application aux recherches étymologiques
, en indiquant les rapports les plus frappans,
8c les principales analogies qui peuvent fervir de
fondement à des conje&ures vraiffemblables.
i° . Il eft naturel de ne pas chercher d’abord loin
de foi ce qu’on peut trouver fous fa main. L’examen
attentif du mot même dont on cherche l’étymologie,
8c de tout ce qu’il emprunte, fi j’ofe ainfi parler, de
l’analogie propre de là langue , eft donc le premier
pas à faire. Si c’eft un dérivé, il faut le rappeller à
fa racine, en le dépouillant de cet appareil de termi-
naifons 8c d’inflexions grammaticales qui le dégui-
fent ; fi c’eft un compofe, il faut en féparer les différentes
parties : ainfi la connoiflance profonde de la
langue dont on veut éclaircir les origines , de fa
grammaire, de fon analogie, eft le préliminaire le
plus indifpenfable pour cette étude.
2°. Souvent le réfultat de cette décompofition fe
termine à des mots abfolument hors d’ufage ; il ne
faut pas perdre, pour cela, l’efpérance de les éclaircir
, fans recourir à une langue étrangère : la langue
même dont on s’occupe s’eft altérée avec le
tems ; l’étude des révolutions qu’elle a efluyées fe-
Tome VI.
ra voir dans les monumens des fiecles pafles ces
mêmes mots dont l’ufage s’eft perdu , 8c dont on a
confervé les dérivés ; la le&ure des anciennes chartes
8c des vieux gloflaires en découvrira beaucoup ;
les diale&es ou patois ufités dans les différentes
provinces, qui n’ont pas fubi autant de variations
que la langue p olie, ou qui du moins n’ont pas fubi
les mêmes, en contiennent aufli un grand nombre :
c’eft là qu’il faut chercher.
3°. Quelquefois les changemens arrivés dans la
prononciation effacent dans le dérivé prefque tous
les veftiges de fa racine. L ’étude de l’ancien langage
8c des diale&es, fournira aufli des exemples des variations
les plus communes de la prononciation ; 8c
ces exemples autoriferont à fuppofer des variations
pareillesdans d’autres cas. L’ortographe, qui fe con-
lerve lorlque la prononciation change, devient un
témoin allez fur de l’ancien état de la langue , 8c
indique aux étymologiftes la filiation des mots,
lorfque la prononciation la leur déguife.
4°. Le problème devient plus compliqué, lorfque
les variations dans le fens concourent avec les changemens
de la prononciation. Toutes fortes de tropes
8c de métaphores détournent la lignification des
mots ; le fens figuré fait oublier peu-à-peu le fens
propre, 8c devient quelquefois à fon tour le fondement
d’une nouvelle figure ; enforte qu’à la longue
le mot ne conferve plus aucun rapport avec fa première
lignification. Pour retrouver la trace de ces
changemens entés les uns fur les autres , il faut
connoître les fondemens les plus ordinaires des
tropes 8c des métaphores ; il faut étudier les différens
points de vûe fous lefquels les hommes ont en-
vifagé les différens objets, les rapports, les analogies
entre les idées, qui rendent les figures plus naturelles
ou plus juftes. En général, l’exemple du pré-
fent eft ce qui peut le mieux diriger nos conje&ures
fur le pafle ; les métaphores que produisent à
chaque inftant fous nos yeux les enfans , les
gens grofliers, 8c même les gens d’efprit, ont dû
fe préfenter à nos peres ; car le befoin donne de
Velprit à tout le monde : or une grande partie de
ces métaphores devenues habituelles dans nos langues
, font l’ouvrage du befoin où les hommes fe
font trouvés de faire connoître les idées intelle&uel-
les 8c morales, en fe fervant des noms des objets fen-
fibles : c’eft par cette raifon,8c parce que la nécef-
fité n’eft pas délicate , que le peu de juftefle des
métaphores n’autorife pas toujours à les rejetter des
conje&ures étymologiques. Il y a des exemples de
ces fens détournés , très-bifarres en apparence, ôc
qui font indubitables,
5°. Il n’y a aucune langue dans l’état a&ucl des
chofes qui ne foit formée du mélange ou de l’altération
de langues plus anciennes, dans lefquelles on
doit retrouver une grande partie des racines de la
langue nouvelle : lorfqu’on a poulfé aufli loin qu’il
eft poflible, fans fortir de celle-ci, la décompofition
8c la filiation des mots, c’eft à ces langues étrangères
qu’il faut recourir. Lorfqu’on fait les principales
langues des peuples voifins, ou qui ont occupé
autrefois le meme pays , on n’a pas de peine à
découvrir quelles font celles d’où dérive immédiatement
une langue donnée , parce qu’il eft impoflible
qu’il ne s’y trouve une très-grande quantité
de mots communs à celle-ci, 8c fi peu déguifés que
la dérivation n’en peut être conteftée : c’eft ainfi
qu’il n’eft pas néceflaire d’être verfé dans l’art é tymologique
, pour favoir que le françois 8c les
autres langues modernes du midi de l’Europe fe
font formées par la corruption du latin mêlé avec
le langage des nations qui ont détruit l’Empire romain.
Cette connoiflance grofliere, où mene la con-
noiflance purement hiftorique des invafions fuccef