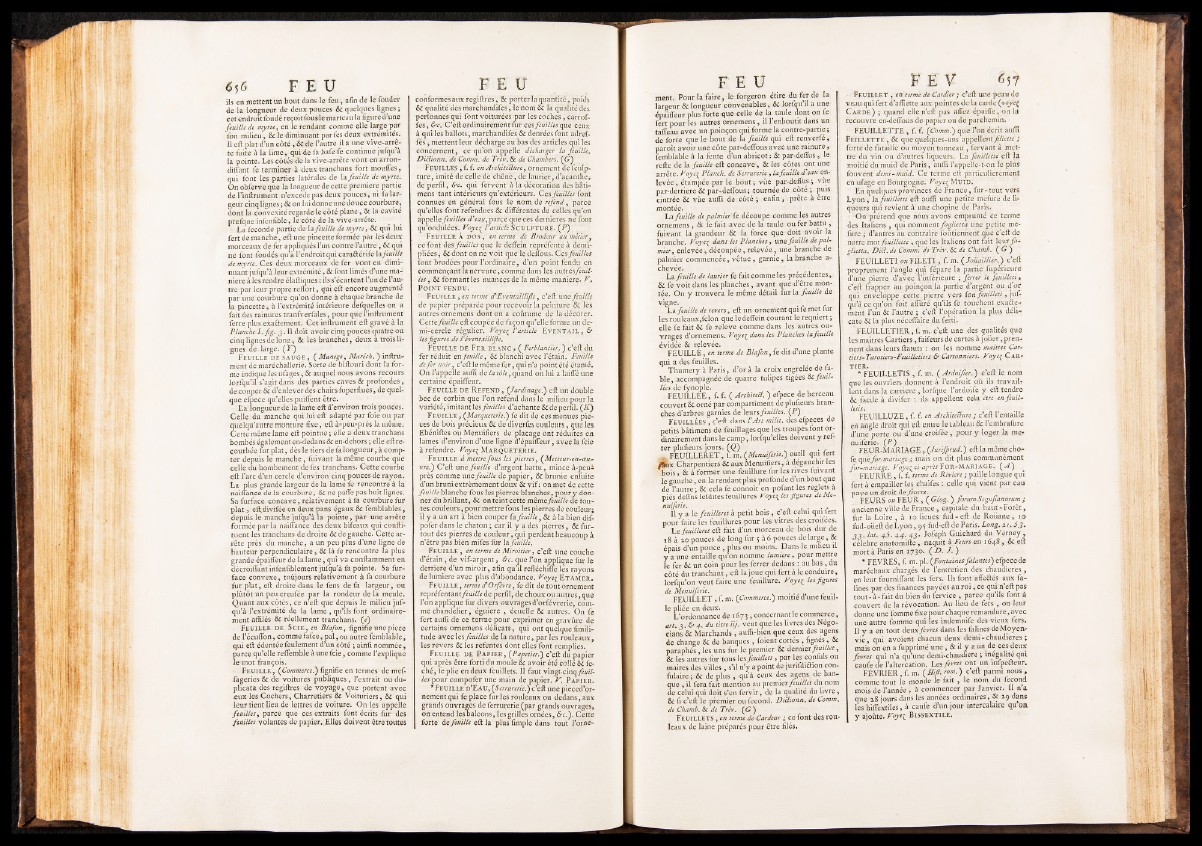
S P F E U
ils en mettent un bout dans le feu , afin de le îbùder
de la longueur de deux pouces & quelques lignes ;
cet endroit foudé reçoitfousle marteau la figure d’une
feuille de myrte, en le rendant comme elle large par
fon milieu, & l e diminuant parfes deux extrémités.
Il eft plat d’un côté , & de l’autre il a une vive-arrê-
te faite à la lime, qui de fa bafe fe continue jufqu à
la pointe. Les côtés delà vive-arrête vont en arron-
diflant fe terminer à deux tranchans fort moufles,
qui font les parties latérales de la feuille de myrte.
On obierve que la longueur de cette première partie
de rinftrument n’excede pas deux pouces , ni fa largeur
cinq lignes ; & on lui donne une douce courbure,
dont la convexité regarde le côté plane-, & la cavité
prefque infenfible, le côté de la vive-arrête.
; La fécondé partie de la feuille de myrte, & qui lui
fert de manche, efl: une pincette formée par les deux
morceaux de fer appliqués l’un contre l’autre, & qui
né font fondés qu’à l ’endroit qui caraôérife la feuille
de myrte. Ces deux morceaux de fer vont en diminuant
jufqu’à leur extrémité, & font limés d’une maniéré
à les rendre élafliques : ils s’écartent l’un de l’autre
par leur propre reffort, qui efl encore augmenté
par une courbure qu’on donne à chaque branche de
la pincette , à l’extrémité intérieure defquelles on a
fait des rainures tranfverfales, pour que l’inftrument
ferre plus exa&ement. C e t infiniment efl gravé à la
Planche I . fig. 3. Il doit avoir cinq pouces quatre ou
cinq lignes de long, & les branches, deux à trois lignes
dé. large. ( Y ) '
Feuille de sauge . ( Manege, Maréch. ) infiniment
dé niaréchallerie. Sorte de biftouri dont la formé
indique les ufages, & auquel nous avons recours
lorfqu’il s’agit dans des parties caves & profondes,
de couper 6c d’enlever des chairs fuperflues, de quelque
efpece qu’elles puiffent être.
La longueur de la lame efl d’environ trois pouces.
Celle du manche qui lui efl adapté par foie ou par
quelqu’autre monture fixe, efl à-peu-près la même.
Cette même lame efl pointue ; elle a deux tranchans
bombés également en-dedans 6c en-dehors ; elle eft recourbée
fur plat, dès le tiers de fa longueur, à compter
depuis le manche, fuivant la même courbe que
celle du bombement defes tranchans. Cette courbe
efl l’arc d’un cercle d’environ cinq pouces de rayon.
La plus grande largeur de la lame fe rencontre à ia
naiffance de la courbure, & ne paffepas huit lignes.
Sa furface concave, relativement à fa courbure fur
p la t , effdivifée en deux pans égaux & femblables,
depuis le manche jufqu’à la pointe, par une arrête
formée par la naiffance des deux bifeaux qui confti-
tuent les tranchans de droite 6c de gauche. Cette arrête
près du manche, a un peu plus d’une ligne de
hauteur perpendiculaire, & là fe rencontre la plus
grande épaiffeur de la lame , qui va conflamment en
décroiffant infenfiblement jufqu’à fa pointe. Sa fur-
face convexe, toujours relativement à fa courbure
fur plat, efl droite dans le fens de fa largeur, ou
plutôt un peu creufée par la rondeur de la meule.
Quant aux côtés, ce n’eft que depuis le milieu jufqu’à
l’extrémité de la lame , qu’ils font ordinairement
affilés 6c réellement tranchans. (e)
Feuille de Sc ie , en Blafon, fignifie une piece
de l’écuffon, comme fafee, pal, ou autre femblable,
qui efl édentée feulement d’un côté ; ainfi nommée,
parce qu’elle reffemble à une feie, comme l’explique
le mot françois.
Feuille , ( Commerce.) fignifie en termes de mef-
fageries & de voitures publiques, l’extrait ou duplicata
des regiftres de voyage, que portent avec
.eux les Cochers, Charretiers & Voituriers, 6c qui
leur tient lieu de lettres de voiture. On les: appéllé
feuilles, parce que ces extraits font écrits fur des
feuilles volantes de p.apier. Elles doivent être toutes
F E U
conformés aux regiftres, & porter la quantité, poids
6c qualité dés marchandifes, le nom 6c là qualité des
personnes qui font voiturées par les coches, carrof-
fes, &c. C ’eft ordinairement fur ces feuilles que ceux
à qui les ballots, marchandifes 6c denrées font adref-
fé s , mettent leur décharge au bas des articles qui les
concernent, ce qu’on appelle décharger la feuille.
Dictionn. de Comm. de Trév. & de Chambers. (GY
Feuilles , f. f. en Architecture, ornement defçulp-
ture, imité de celle dé chêne, de laurier, d’acanthe *
de perfil, &c. qui fervent à la décoration des bati-
mens tant intérieurs qu’extérieurs. Ces feuilles font
connues en général fous le nom de refend, parce
qu’elles font refendues 6c différentes de celles qu’on
appelle feuilles d'eau, parce que ces dernieres ne font
qu’ondulées. Foyt^ l ’article'Scu l p tu r e . (P)
Feuille À DOS, en terme de Brodeur au métier -
ce font des feuilles que le deffein repréfente à denii-
pliées, & dont on ne voit que ledeffous. Ces feuilles
font brodées pour l’ordinaire, d’un point fendu en
commençant la nervure, comme dans les autresfeuil-
lés , 6c formant fes nuaneçs de la même manière, V.
Point fendu-
Feu ill e, en terme dEvent'aillijle, c’éft une feuille
de papier préparée pour recevoir la peinture 6c les
autres ornémens dont on a cofttume de la décorer.
Cette feuille efl coupée de façon qu’elle forme un demi
cercle régulier. Foye$ l ’article Ev e n t a il , 6*
les figures de l ’èventaillifte.
Feuille de Fer blan c , ( Ferblantier. ) c’eft du
fer réduit en feuille, & blanchi avec l’étâih. Feuille
de fernoir, c’eft le même fer, qui n’a point été étamé.
On l’appelle aufli de la tôle, quand on lui a laiffé une
certaine épaiffeur.
Feuille de Refend , (Jardinage.) efl un double
bec de corbin que l’oii refend dans le milieu pour la
variété, imitant les feuilles d*achante& de perfil, (/f)
Feuille , (Marqueterie.) fe dit de ces menues pièces
de bois précieux 6c de diverfes couleurs, que les
Ebéniftes ou Menuifiers de placage ont réduites en
lames d’environ d’une ligné d’épaiffeur, avec la feie
à refendre. Foye^ Marqu eterie,
FEUILLE à mettre fous les pierres, (Metteur-en-oeu-
vrè.) C ’eft une feuille d’argent battu, mince à-peui
près comme une feuille, de papier, 6c brunie enfuite
d’un bruni extrêmement doux & v if: on met de cette
feuille blanche fous les pierres blanches, pour y donner
du brillant, & on teint cette même feuille de tou-
I tes couleurs, pour mettre fous les pierres de couleur;
il y a un art à bien couper fa feuille, & à la bien dif-
pofer dans le chaton ; car il y a des pierres, & fur-
tout des pierres de couleur, qui perdent beaucoup à
n’être pas bien mifes fur la feuille.
Feu il l e , en terme de Miroitier, c’eft une couche
d’étain , de vif-argent, &c. que l’on applique fur le
derrière d’un miroir, afin qu’il refléçhiffe les rayons
de lumière avec plus d’abondance. Foyej^ Et am e r .
Feuille , terme d Orfèvre, fe dit de tout ornement
repréfentant feuille de perfil, de choux ou autres, que
l’on applique fur divers ouvrages d’orfèvrerie, comme
chandelier, éguiere , écuelle 6c autres. On fe
fert aulïï de ce terme pour exprimer en gravure de
certains ornemens délicats, qui ont quelque fimili-
tude avec les feuilles de la nature, par les rouleaux,
les revers 6c les refentes dont elles font remplies.
Feuille de Papier , (Papetier.} c’eft du papier
qui après être forti du moule 6c avoir été colle 6c fe-
ché, fe plie en deux feuillets. Il faut vingt-cinq feuiU
les pour compofer une main de papier. F. Papier.
* Feuille d’Eau, (Serrurerie,) c’eft une pieced’or-
nement qui fe place fur les rouleaux ou dedans, aux
grands ouvrages de ferrurerie (par grands ouvrages,
on entend les balcons, les grilles ornées, &c.). Cette
forte de feuille eft la plus fimple dans tout l’orne-
F E U
ment. Pour la faire, le .forgeron étire du fer de la. ;
largeur 6c longueur convenables, 6c lorfqu il a une-
épaiffeur plus forte que celle de la taule dont on fe
fert pour les autres ornemens, il l’enboutit dans un
taffeau avec un poinçon qui forme la contre-partie;
de forte que le bout de la feuille qui eft renyerfé,
p.aroît avoir une côte par-deffous avec une rainure,
femblable à la fente d’un abricot : & par-deffusle.
relie de la feuille eft concave', & les côtes ont une
arrête. Voyeç Planch. de Serrurerie , la feuille d’eau enlev
ée, étampée par lé bout ; vue par-deffus ; vue
par-derriere & par-deffous ; tournée de côté ; puis
cintrée 6c vue aufli dé côté ; enfin, .prête..à etre
montée.
La feuille de palmier fe découpe comme, lés autres ,
ornemens, & fe fait avec de la taule ou fer battu ,
fuivant la grandeur 6c la force que doit avoir la
branche. Foye^ dans les flanches, une feuille de palmier,
enlevée-, découpée ^relevée, une branche de
palmier commencée, vê tu e , garnie, la branche a-
chevée, '
La feuille de laurier fe fait comme les précédentes,
6c fe voit dans les planches, avant que.d’être montée.
On y trouvera le même détail fur la feuille de
vigne, "
. La feuille de revers, eft un ornement qui fe met fur
les rouleaux,félon que le deffein courant le requiert ;
elle fe fait 6c fe releve comme dans .les autres ouvrages
d’ornemens. Foye{ dans les Planches la feuille
évicjée & relevée.
FEUILLÉ, en terme de Blafon, fe dit d’une plante
qui a des feuilles. . , . c
Thumery à Paris, d’or à la croix engrelee de fable,
accompagnée de quatre tulipes tigées 6cfeuil-
lées de fynople. j
FEUILLÉE, f. f. ( Architecl. ) efpece de berceau
couvert 6c orné par compartiment de plufieurs branches
d’arbres garnies de leurs feuilles. (P)
Feuillees , c’eft dans VArt milit. des efpeces de
petits bâtimens de feuillages que les troupes font ordinairement
dans le camp, lorfqu’elles doivent y ref-
ter plufieurs jours. ( Q ) ' .. • r
^ F E U IL L E R E T , 1. m. {Menuiferie.) outil qui fert
/5ux Charpentiers 6c aux Menuifiers , à dégauchir les
bois, & à former une feuillure fur les rives fuivant
le gauche, en la rendant plus profonde d’un bout que
de l’autre ; 6c cela fe connoît en pofant les reglets à
piés deffus lefdites feuillures Voye{ les figures de Menuiferie.
- .
11 y a le feuilleret à petit bois , c’ eft celui qui fert
pour faire les feuillures pour les vitres des croifées.
Le feuilleret eft fait d’un morceau de bois dur de
18 à 2.0 pouces de long fur 5 à 6 pouces de large, &
épais d’un pouce, plus ou moins. Dans le milieu il
y a une entaille qu’on nomme lumière, pour mettre
le fer 6c un coin pour les ferrer dedans : au bas , du
côté du tranchant, eft la joue qui fert à le conduire,
lorfqu’on veut faire une feuillure. Foye^ les figures
de Menuiferie. . .,
FEUILLET , f. m. {Commerce.) moitié d une feuille
pliée en deux.
L’ordonnance de 1673 > concernante commerce,
art. 3 .& 4 .d u titre iij. veut que les livres des Négoc
i a i & Marchands , aufli-bien que ceux des âge ns
de change 6c de banques , foient cottés , lignes, &
paraphés, les uns fur le premier 6c dernier feuillet,
6c les autres fur tous \es feuillets, par les confuls ou
maires des villes , s’il n’y a point de jurifdiaion con-
fulaire ; 6c de plus , qu’à ceux des agens. de banque
, il fera fait mention au premier feuillet du nom
de celui qui doit s’en fervir, de la qualité du livre,
& fi c’eft le premier ou fécond. Diaionn. de Comm.
de Chamb. & de Trév. (<r)
Feuillets , en terme de Cardeur ; ce font des rouleaux
de laine préparés pour être filés.
F E V 65?
Feu illet , m terme de Carder ; c’eft uilé peau de
veau qui fert d’afliette aux pointes d elà cardçfvoyeÇ
C ard e) ; quand elle n’eft pas affez épaiffe, on la
recouvre en-deffaus de papier ou de parchemim
FEUILLETTE , f. f. (Comm.) que l ’on écrit àufll
Fe il l e t t e , & que quelqués-uns appellent fillette}
fortè de futaille ou moyen tonneau , fervant à mettre
du vin ou d’autres liqueurs. La feuillette éft la
moitié du muid de P a r isau fli l’appelle-t-on' lé plus
fouvent demi-muid. Ce terme eft particulièrement
en ufage en Bourgogne. Foye%_ Mü id .
En quelques provinces de France, fur-to’ut'vers
Lyon -, la feuillette eft aufli une petite mefure de liqueurs
qui revient’ à'une chopine dé Paris*
■ On-prétend que noüs' avons emprunté ce terme
des Italiens , q\ii nomment foglietta une petite mefure
d’autres au contraire foiitiennent qüé c ’eft de
notre mot feuillette', que les Italiens ont mit leur /o-*
gliettà. Dicl.de Comm. de Trév. 6c de ChdmÈ. f G )
FEUILLETI.ç«FiLETI, f. m. (Joüaillier.'^ c’eft
proprement l’angle .qui fépare la partie fupérieure
d’une pierre d’avec l’inférieure ; ferrer le fu ille t i,
ç’eft' frapper au poinçon la partie .d’argent ou cj’or
qui enveloppe'cette, pierre vers fqn feuilleti , jufqu’à
ce qu’on foit affiué qu’ils fe touchent, e^afte-«
; ment l’un & l’autre ; .c’eft’ l’opération la plus déli-
i cate 6c la plus néçeffàire du ferti.
. FEUILLETIER, f. ni., ç’eft une des qualités quô
les maîtres Cartiers, faifeurs de cartes à jpiier, prennent
dans leurs ftatuts : on les nomme maîtres Çar-
ùers-rTarotiers-Feuilletiers. & Canonniers. Foyeç. CARTIER.
* FEUILLETIS , f. m. (Ardoifier.) : ç’eft le nom
que.les ouvriers donnent à l’endroit pii ils tra-vaiL
lent dans la carrière * lorfque l’ ardoife y eft .tendre
6c facile à divifer : ffs. appellent cela être -en feuil-
■ ktisi . H H H H H H H 1 1 FEUILLUZE, f. f. en Architecture ; c eft l’entaille
i en angle droit qui eft entre le tableau 6c l’embrafure
d’une porte ou d’une ç-roifée, pour y loger la me-
: nuilefie. (P ) . . 2 •; - i- C:
FEURtM ARIA G E , (Jurifprud. ) eft la même choie
qneJpf-mariage-^ mais on dit plus communément
. for-mariage, Foyes^ ci-après FOR-MARIAGE. ( A )
■ FEURRE, f . f. terme de Riviere ; paille longue qui
fert à’empailler les çhaifes ; celle qui vient par eau
paye un droit de. feurre.
FEURS ou FEUR, ( Gèog. ) forupi Segufianontm ;
ancienne ville de France , capitale du h.au.t-Forêt,
fur la Loire , à 10 lieues fud - eft de Roiiane , iç>
' fud-oiieft de L yon, 9 5 fiid-eft de Paris. Long, z /., $3.
33 . lat. 43. 44. 43. Jofeph Guichard du Verney,
célébré anatomifte, naquit k Feurs. en 1648, eft
mort à Paris en 1730. ( D . J . )
* FEVRES, f. m. pl. (Fontaines filantes) efpece de
maréchaux chargés de l’entretien des chaudières ,
en leur fourniffant les fers. Ils font affe&és aux fa-
lines par des finances payées au r o i , ce qui n’eft pas
tout-à-fait du bien du fervice , parce qu’ils font à
couvert de la révocation. Au lieu de fers , on leur
donne une fomme fixe pour chaque remandure, avec
. une autre fomme qui- les indemnife des vieux; fers.
Il y a en tout deux fevres dans les falines de Moyen-
v ie , qui avoieiit chacun deux demi - chaudières ;
mais on en a fupprimé une , & il y a un de césdeux
fevres qui n’a qu’une demi-chaudiere ; inégalité qui
çaufè de l’altercation. Les fevres ont un infpefleür,
FÉVRIER, f . m. ( Hift. rom. ) c ’ e f t p a rm i n o u s ,
c o m m e t o u t l e m o n d e l e f a i t , l e n o m d u f é c o n d ,
m o i s d e l ’ a n n é e , à c o m m e n c e r p a r J a n v i e r . Il n ’ a
q u e z8 j o u r s d a n s l e s a n n é e s o r d i n a i r e s , & 29 d a n s
l è s h i f f e x t i l e s , à c a u f é d ’u n j o u r i n t e r c a l a i r e q u ’ o n
y a j o u t e . Foye^ B i s s e x t i l e ,