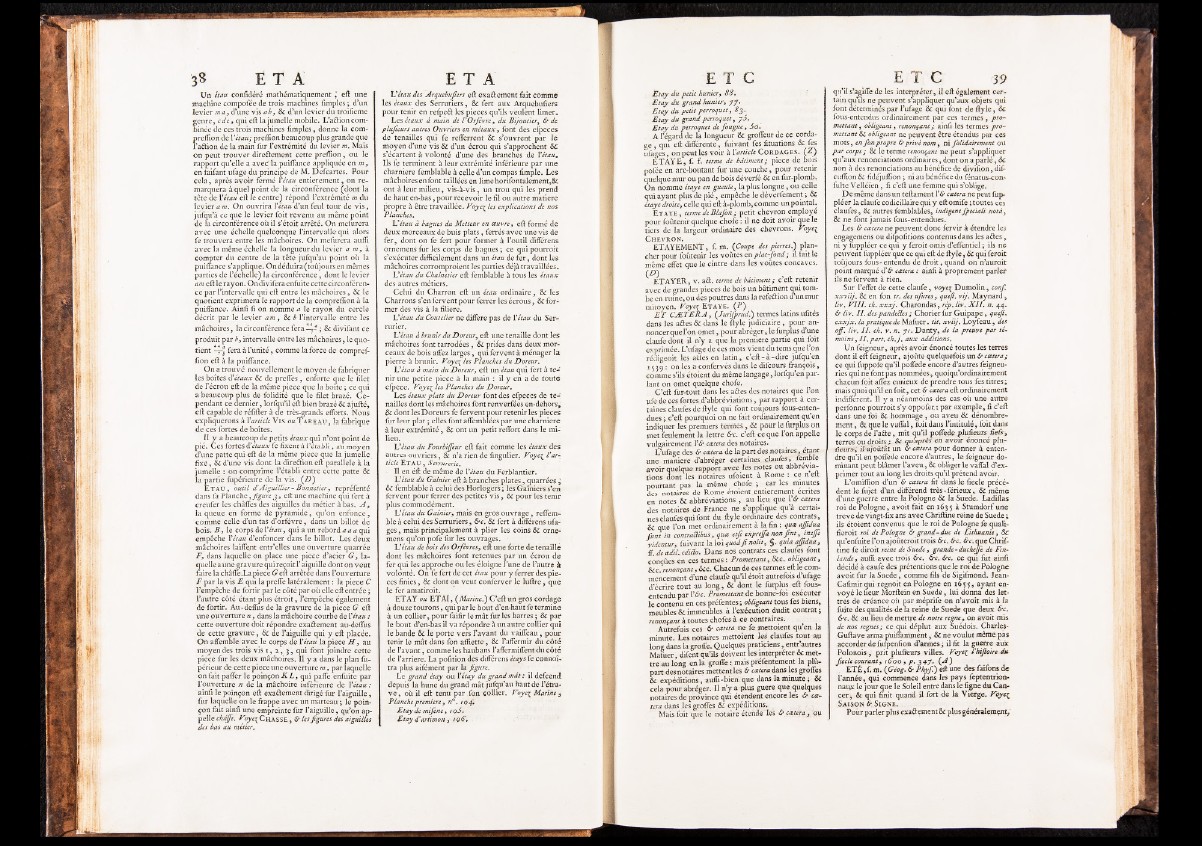
Un étau confidéré mathématiquement ', eft une ;
machine compofée de trois machines fimples ; d’un
levier ma, d’une vis ab, & d’un levier du troifieme
genre, cd e, qui eft la jumelle mobile. L’aûion combinée
de ces trois machines fimples, donne la com-
preflion de l 'étau; preflion beaucoup plus grande que
l’aftion de la main fur l’extrémité du levier m. Mais
on peut trouver directement cette preflion, ou le
rapport qu’elle a avec'la puiflance appliquée enm ,
en faifant ufage du principe de M. Defcartes. Pour
cela, après avoir fermé Y étau entièrement, on remarquera
à quel point de la circonférence (dont la
tête de Y étau eft le centre) répond l’extrémité m du
levier a m. On ouvrira Y étau d’un feul tour de v is ,
jufqu’à ce que le levier foit revenu au même point
de la circonférence oii il s’étoit arrêté. On mefurera
avec une échelle quelconque l’intervalle qui alors
fe trouvera entre les mâchoires. On mefurera aufli
avec la même échelle la longueur du levier a m, &
compter du centre de la tête jufqu’au point oh la
puiflance s’applique. On déduira (toujours en mêmes
parties de l’echelle) la circonférence, dont le levier
atn eft le rayon. On divifera enfuite cette circonférence
par l’intervalle qui eft entre les mâchoires, 8c le
quotient exprimera le rapport de la compreflion à la
puiflance. Ainfi fi on nomme a le rayon du cercle
décrit par le levier am, 8c b l’intervalle entre les
mâchoires, la circonférence fera — ; 8c divifant ce
produit par b, intervalle entre les mâchoires, le quotient
fera à l’unité, comme la force de compreffion
eft à la puiflance.
On a trouvé nouvellement le moyen de fabriquer
les boîtes d'étaux 8c de preffes , enlorte que le filet
de l’écrou eft de la même piece que la boîte ; ce qui
a beaucoup plus de folidité que le filet brazé. Cependant
ce dernier, lorfqu’il eft bien brazé & ajufté,
eft capable de réfifter à de très-grands efforts. Nous
expliquerons à YarticU Vis ou Tare AU, la fabrique
de ces fortes de boîtes.
Il y a beaucoup de petits étaux qui n’Ônt point de
pié. Ces fortes $ étaux fe fixent à l’établi, ali moyen
d’une patte qui eft de la même piece que la jumelle
fixe, 8c d’une vis dont la direftion eft parallèle à la
jumelle : on comprime l’établi entre cette patte 8c
la partie fupérieure de la vis. ÇD) Etau, outil d’Aiguillier-Bonnetier, repréfenté
dans fa Planche, figure j , eft une machine qui fert à
creufer les châffes des aiguilles du métier à bas. A ,
la queue en forme de pyramide, qu’on enfonce,
comme celle d’un tas d’orfévre, dans un billot de
bois. B , le corps de Y étau , qui a un rebord aaa qui
empêche Y étau d’enfoncer dans le billot. Les deux
mâchoires laiflejnt entr’elles une ouverture quarrée
F , dans laquelle on place une piece d’acier G , laquelle
a une gravure qui reçoit l’ aiguille dont on veut
faire la châffe.Lapiece G eft arrêtée dans l’ouverture
F par la vis E qui la prefle latéralement : la piece C
l ’empêche de fortir par le côté par où elle eft entrée ;
l’autre côté étant plus étroit, l’empêche également
de fortir. Au-deffus de la gravure de la piece G eft
une ouverture n , dans la mâchoire courbe de Y étau :
cette ouverture doit répondre exactement au-defliis
de cette gravure, 8c de l’aiguille qui y eft placée.
On aflembleavec le corps de Y étau la piece H , au
moyen des trois vis i , z , 3, qui font joindre cette
piece fur les deux mâchoires. Il y a dans le plan fu-
périeur de cette piece une ouverture m, par laquelle
on fait pafler le poinçon K L , qui paffe enfuite par
l ’ouverture n de la mâchoire inférieure de Yétau :
ainfi le poinçon eft exactement dirigé fur l’aiguille,
fur laquelle on le frappe avec un marteau ; le poinçon
fait ainfi une empreinte fur l’aiguille, qu’on appelle
châjfe. Foyci Chasse , & les figures des aiguilles
des bas au métier,
Vétau des Arquebufiers eft exactement fait comme
les étaux des Serruriers, 8c fert aux Arquebufiers
pour tenir en refpeCt les pièces qu’ils veulent limer.
Les etaux a main de V Orfèvre, dit Bijoutier, & de
plufieurs autres Ouvriers en métaux, font des efpeces
de tenailles qui fe reflerrent 8c s’ouvrent par le
moyen d’une vis 8c d’un écrou qui s’approchent &
s’écartent à volonté d’une des branches de Y étau.
Ils fe terminent à leur extrémité inférieure par une
charnière femblable à celle d’un compas fimple. Les
mâchoires en font taillées en lime horifontalement,8c
ont à leur milieu, vis-à-vis, un trou qui les prend
de haut en-bas, pour recevoir le fil ou autre matière
propre à être travaillée. Voye£ les explications de nos
Planches.
L'étau à bagues du Metteur en oeuvre, eft formé de
deux morceaux de buis plats, ferrés avec une vis de
fer, dont on fe fert pour former à l’outil différens
ornemens fur les corps de bagues ; ce qui pourroit
s’exécuter difficilement dans un étau de fe r , dont les
mâchoires corromproient les parties déjà travaillées.
Uétau du Chaînetier eft femblable à tous les étaux
des autres métiers.
Celui du Charron eft un étau ordinaire, 8c les
Charrons s’en fervent pour ferrer les écrous, 8c former
des vis à la filiere.
L’étau du Coutelier ne différé pas de Y étau du Serrurier.
L’étau à brunir du Doreur, eft une tenaille dont les
mâchoires font tarrodées, & prifes dans deux morceaux
de bois affez larges, qui fervent à ménager la
pierre à brunir. Voye£ les Planches du Doreur.
L ’étau à main du Doreur, eft un étau qui fert à tenir
une petite piece à la main : il y en a de toute
efjpece. Voye%_ les Planches du Doreur.
Les étaux plats du Doreur font des efpeces de te-’
nailles dont les mâchoires font renverfées en-dehors,
8c dont les Doreurs fe fervent pour retenir les pièces
fur leur plat ; elles font affembîées par une charnière
à leur extrémité, êc ont un petit reflort dans le milieu.
L’étau du FourbiJJeur eft fait comme les étaux des
autres ouvriers, & n’a rien de fingulier. Voye£ l ’article
Etau , Serrurerie.
- Il en éft de même de Y étau du Ferblantier.
U étau du Gaînier eft à branches plates, quarrées ^
8c femblable à celui des Horloger^ ; les Gaîniers s’en
fervent pour ferrer des petites vis , 8c pour les tenir
plus commodément.
L’étau du Gaînier, mais en gros ouvrage, reffem-
ble à celui des Serruriers, &c. 8c fert à différens ufa-
ges, mais principalement à plier les coins 8c ornemens
qu’on pofe fur les ouvrages. -
L’étau de bois des Orfèvres, eft une forte de tenaille
dont les mâchoires font retenues par un écrou de
fer qui les approche ou les éloigne l ’une de l’autre à
volonté. On fe fert de cet étau pour y ferrer des pièces
finies, 8c dont on veut conferver le luftre, que
le fer amatiroit.
ETAY ou ET AI, {^Marine.) C ’eft un gros cordage
à douze tourons, qui par le bout d’en-haut fe termine
à un collier, pour faifir le mât fur les barres ; 8c par
le bout d’en-bas il va répondre à un autre collier qui
le bande 8c le porte vers l’avant du vaifleau, pour
tenir le mât dans fon afliette, 8c l’affermir du côté
; de l’avant, comme les haubans l’affermiffent du côté
j de l’arriere. La pofition des différens étays fe connoî-
tra plus aifément par la figure.
Le grand ètay ou Yètay du grand mât : il defeend
depuis la hune du grand mât jufqu’au haut dé l’étrav
e , où il eft tenu par .fon collier. Voye{ Marine,
Planche première , n°. 104.
Etay de mifene , 1 o5.
Etay d’artimon , 1 ç C,
Èîày du petit hunier, 88.
Etay du grand hunier, y j .
Etay du petit perroquet, 8y3.
Etay du grand, perroquet, y S.
Etay du perroquet de fougue, Sô.
A l’égard de la longueur & groffeur de ce cordage
, qui eft différente, fuivant fes fituations 8c fes
ufages, on peut les voir à Y article Cordages. (Z )
E T A Y E , f. fi terme de bâtiment ; piece de bois
pofée en arc-boutant fur une couche, pour retenir
quelque mur ou pan de bois déverfé 8c en fur-plomb.
On nomme étaye en gueule, la plus longue, ou celle
qui ayant plus de pié , empêche le déverfement ; 8c
etaye droite, celle qui eft à-plomb, comme un pointai. Etaye , terme de Blafon ; petit chevron employé
pour foûtenir quelque choie : il ne doit avoir que le
tiers de la largeur ordinaire des chevrons. Voye^ Chevron. ETAYEMENT, f. m. ( Coupe des pierres j) plancher
pour foûtenir les voûtes en plat-fond ; il fait le
même effet que le cintre dans les voûtes concaves.
(D)
ETA YER, v . a£L terme de bâtiment; c’eft retenir
avec de grandes pièces de bois un bâtiment qui tombe
en ruine, ou des poutres dans la refeûion d’un mur
mitoyen. Voyei Etaye. (T). /
E T CÆ T E R A , (Jurifprud.) termes latins ufites
dans les aftes Sc dans le ftyle judiciaire, pour annoncer
que l’on omet, pour abréger, le furplus d’une
claufe dont il n’y a que la première partie qui foit
exprimée. L’ufage de ces mots vient du tems que l’on
rédigeoit les a&es en latin, c’eft-à -dire jufqu’en
1539 : on les a confervés dans le difeours françois,
comme s’ils étoient du même langage, lorfqu’en parlant
on omet quelque chofe.
C’eft fur-tout dans les attes des notaires que l’on
tife de ces fortes d’abbréviations, par rapport à certaines
daufes de ftyle qui font toujours fbus-enten-
dues ; c’eft pourquoi on ne fait ordinairement qu’en
indiquer les premiers ternies, 8c pour le furplus on
met feulement la lettre &c. c’eft ce que l’on appelle
vulgairement Y & cetera des notaires.
L’ufage des & ccetera de la part des notaires.» étant
une maniéré d’abréger certaines claufes, femblè
avoir quelque rapport avec les notes ou abbrevia-
tions dont les notaires ufoient à Rome : ce neit
pourtant pas la même chofe ; car les minutes
des notaires de Rome étoient entièrement écrites
en notes 6c abbréviations , au liçu que l à* ccetera
des notaires de France ne s’applique qu’à certaines
claufes qui font du ftyle ordinaire des contrats,
& que l’on met ordinairement à la fin : quee affidua
funt in contraclibus, quee etji expreffanonfint, inejfe
videntur, fuivant la loi quodfi nolit, § . quia affidua,
ff. de edil. edicto. Dans nos contrats ces claufes font
cônçûes en ces termes : Promettant, 8cc. obligeant,
t ic . renonçant, 8cc. Chacun de ces termes eft le commencement
d’une claufe qu’il étoit autrefois d’ufage
d’écrire tout au long, 8c dont le furplus eft fous-
entendu par Y&c. Promettant de bonne-foi exécuter
le contenu en ces préfentes ; obligeant tous fes biens,
meubles6cimmeubles à l’exécution dudit contrat;
renonçant à toutes chofes à ce contraires.
Autrefois ces & cetera ne fe mettoient qu’en la
minute. Les notaires mettoient les claufes tout au
long dans la groffe. Quelques praticiens, entr’autres
Mafuer, difent qu’ils doivent les interpréter 6c mettre
au long en la groffe : mais prélèvement la plû-
part des notaires mettent les & cetera dans les groffes
6c expéditions, aufli-bien que dans la minute ; 8c
cela pour abréger. Il n’y a plus guere que quelques
notaires de province qui étendent encore les <5* cetera
dans .les groffes 6c expédition?*'
Mais foit que le notaire é tende les & cetera * .'ou
qu’il s’âgiffe de les interpréter, il eft également certain
qu’ils ne peuvent s’appliquer qu’aux objets qui
font déterminés par l’ufage 6c qui font de f ty le , 8c
fous-entendus ordinairement par ces termes, promettant,
obligeant, renonçant ; ainfi les termes promettant
8c obligeant ne peuvent être étendus par ces
mots, en fon propre & privé nom, ni folidairement ou
par corps ; 6c le terme renonçant ne peut s’appliquer
qu’aux renonciations ordinaires, dont on a parlé, 6c
non à des renonciations au bénéfice de divifion, dif-
cuflîon 6c fidéjuflion ; ni au bénéfice du fénatus-con-
fulte V elléïen, fi c’eft une femme qui s’oblige.
De même dans un teftament Y & cetera ne peut fup-
pléer laclaufecodicillairequiy eftomife ; toutes ces
claufes, 6c autres femblables, indigentfpeciali nota,
6c ne font jamais fous-entendues.
Les & cetera ne peuvent donc fervir à étendre les
engagemens ou difpofitions contenus dans les a êtes,
ni y fuppléer ce qui y feroit omis d’effentiel ; iis ne
peuvent fuppléer que ce qui eft de ftyle, 6c qui feroit
toûjours fous-entendu de droit, quand on n’auroit
point marqué d’& cetera ■: ainfi à proprement parler
ils ne fervent à rien.
Sur l’effet de cette claufe, voye^ Dumolin, conf.
xxviij. 6c en fon tr. des ufures, quefi. vij. Maynard,
liv. VIII. ch. x x x j. Charondas, rép.liv. X I I . n. 44.
& liv. II. des pandectes; Chorierfur Guipape, queJL
cxxjx. la pratique de Mafuer. tit. xviij. Loyfeau, des
ojf. liv. II. ch. v. n. y i. Danty, de la preuve par témoins,
II. part. ch.j. aux additions.
Un feigneur, après avoir énoncé toutes les terres
dont il eft feigneur, ajoûte quelquefois un & cetera;
ce qui fuppolè qu’il poffede encore d’autres feigneu-
ries qui ne font pas nommées, quoiqu’ordinairement
chacun foit affez curieux de prendre tous fes titres ;
mais quoi qu’il en foit, cet & cetera eft ordinairement
indifferent. Il y a néanmoins des cas où une autre
perfonne pourroit s’y oppofer. : par exemple, fi c’eft
dans une foi 8c hommage , ou aveu 6c dénombrement
, 6c que le vaffal, loit dans l’intitulé, foit dans
le corps de l’aéle, mît qu’il poffede plufieurs £efs,
terres ou droits ; & qu après en avoir énoncé plu-
/îeursr, iPajoûtât un G* cetera pour donner à entendre
qu’il en poffede encore d’autres, le feigneur dominant
peut blâmer l’aveu, 6c obliger le vaffal d’exprimer
tout au long les droits qu’il prétend avoir.
L’omiflion d’un & cetera fit dans le fiecle précédent
le fujet d’un différend très-férieux, 6c même
d’une guerre entre la Pologne 6c la Suede. Ladiflas
roi de Pologne, avoit fait en 1635 à Stumdorf une
treve de vingt-fix ans avec Chriftine reine de Suede ;
ils étoient convenus que le roi de Pologne fe quali-
fieroit roi de Pologne & grand-duc de Lithuanie, 8c
qu’enfuite l’on ajouterait trois &c. &c. &c. que Chriftine
fe dirait reine de Suede , grande - duchejfe de Finlande,
aufli avec trois &c. &c. &c. ce qui fut ainfi
décidé à caufe des prétentions que le roi de Pologne
avoit fur la Suede, comme fils de Sigifmond. Jean-
Cafimirqui regnoit en Pologne en 1655, ayant envoyé
le fieur Morftein en Suede, lui donna des lettres
de créance où par méprife on n’avoit mis à la
fuite des qualités de la reine de Suede que deux &c.
&c. 6c au lieu de mettre de notre régné, on avoit mis
de nos régnés; ce qui déplut aux Suédois. Charles-
Guftave arma puiffamment, 6c ne voulut même pas
accorder de fufpenfion d’armes ; il fit la guerre aux
Polonois , prit plufieurs villes. Voyti l ’hifioire dtt
fiecle courant, 1C00, p. $4y- ÇA')
ÉTÉ ,f . m. ÇGcog. & Phyf.) eft une des faifons de
l’année, qui commence dans les pays feptentrion-
naipc le jour que le Soleil entre dans le ligne du Cancer,
& qui finit quand il fort de la Vierge. Voyeç Saison ^..Signe,
Pour parler plus exa&emcnt 6c plus généralement,