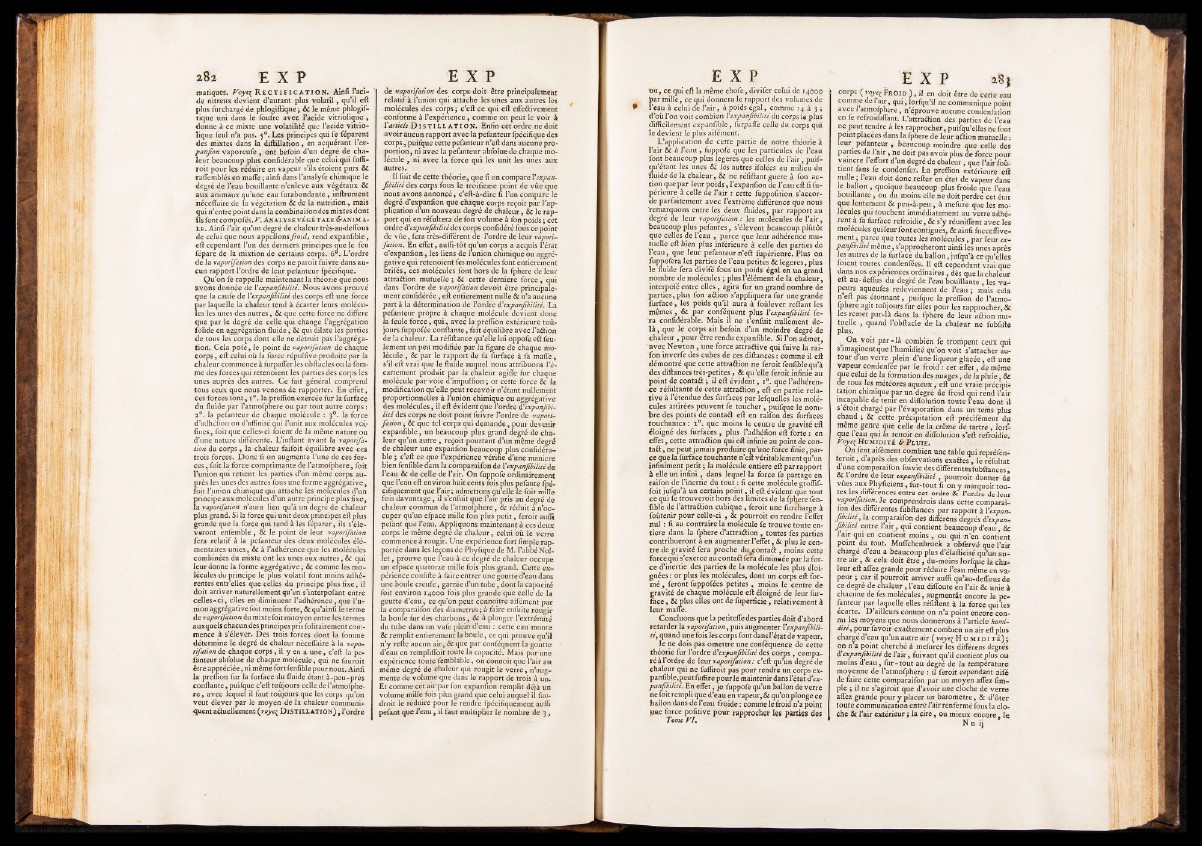
matiqués. Voyt%_ R e c t i f i c a t i o n . Ainfi l’acide
nitreux devient d’autant plus vo la til, qu’il eft
plus furchargé de phlogiftique ; & le même phlogil-
tique uni dans le foufre avec l’acide vitriolique ,
donne à ce mixte une volatilité que l’acide vitriolique
feul n’a pas. ç°. Les principes qui fe réparent
des mixtes dans la diflillation, en acquérant Yex-
panjion vaporeufe , ont befoin d’un degré de chaleur
beaucoup plus confidérable que celui qui fuffi-
roit pour les réduire en vapeur s’ils étoient purs &
raffemblés en malle ; ainli dans l’analyfe chimique le
degré de l’eau bouillante n’enleve aux végétaux &
aux animaux qu’une eau furabondante, infiniment
nécefTaire de la végétation & de la nutrition, mais
qui n’entre point dans la combinaifondes mixtes dont
ils font compofés. V. A n a l y s e v é g é t a l e & a n im a l
e . Ainfi l’air qu’un degré dechaleur très-au-deffous
de celui que nous appelions froid, rend expanfible,
eft cependant l’un des derniers, principes que le feu
fépare de la mixtion de certains corps. 6®. L ’ordre
de la vaporifation des corps ne par oit fuivre dans aucun
rapport l’ordre de leur peianteur fpécifique.
Qu’on fe rappelle maintenant la théorie que nous
avons donnée de Ÿexpanjibilitc. Nous avons prouvé
que la caufe de Y expanjibilitè des corps eft une force
par laquelle la chaleur tend à écarter leurs molécules
les unes des autres, & que cette force ne différé
que par le degré de celle qui change l’aggrégation
folide en aggrégation fluide j & qui dilate les parties
de tous les corps dont elle ne détruit pas l’aggréga-
tion. Cela pofé, le point de vaporifation de chaque
corps, eft celui où la force répulfive produite par la
chaleur commence à furpaffer les obftacles ou la fom-
me des forces qui retenoient les parties des corps les
unes auprès des autres. Ce fait général comprend
tous ceux que nous venons de rapporter. En effet,
ces forces font, i° . la preftion exercée fur la furface
du fluide par l’atmofphere ou par tout autre corps :
2°. la pefanteur de chaque molécule : 30. la force
d’adhéfion ou d’affinité qui l’unit aux molécules voi-
fines, foit que celles-ci foient de la même nature ou
d’une nature différente. L’inftant avant la vaporifation
du corps , la chaleur faifoit équilibre avec ces
trois forces. Donc fi on augmente l’une de ces force
s, foit la force comprimante de l’atmofphere, foit
l ’union qui retient les parties d’un même corps auprès
les unes des autres fous une forme aggrégative,
foit l’union chimique qui attache les molécules d’un
principe aux molécules d’un autre principe plus fixe,
la vaporifation n’aura lieu qu’à un degré de chaleur
plus grand. Si la force qui unit deux principes eft plus
grande que la force qui tend à les féparer, ils s’élèveront
enfemble , & le point de leur vaporifation
fera relatif à la pefanteur des deux molécules élémentaires
unies, & à l’adhérence que les molécules
combinées du mixte ont les unes aux autres, & qui
leur donne la forme aggrégative ; & comme les molécules
du principe le plus volatil font moins adhérentes
entr’elles que celles du principe plus fixe, il
doit arriver naturellement qu’en s’interpofant entre
ce lles -ci, elles en diminuent l’adhérence, que l’union
aggrégative foit moins forte, & qu’ainfi le terme
de vaporifation du mixte foit mitoyen entre les termes
auxquels chacun des principes pris folitairement commence
à s’élever. Des trois forces dont la fomme
détermine le degré de chaleur nécefTaire à la vaporifation
de chaque corps, il y en a une, c’eft la pefanteur
abfolue de chaque molécule, qui ne fauroit
être appréciée, ni même fort fenfible pour nous. Ainfi
la preftion fur la furface du fluide étant à-peu-près
confiante, puifque c’eft toûjours celle de l’atmofphe-
r e , avec lequel il faut toûjours que les corps qu’on
veut élever par le moyen de la chaleur communiquent
actuellement (voye[ D ist il l ation) , l’ordre
de vaporifation des corps doit être principalement
relatif à l’union qui attache les unes aux autres les
molécules des corps ; c’eft ce qui eft effectivement
conforme à l’expérience, comme on peut le voir à
l’article D i s t i l l a t i o n . Enfin cet ordre ne doit
avoir aucun rapport avec la pefanteur fpécifique des
corps, puifque cette pefanteur n’eft dans aucune prof
>ortion, ni avec la pefanteur abfolue de chaque mo-
écule , ni avec la force qui les unit les unes aux
autres.
Il fuit de cette théorie, que fi on compare Yexpan-
Jîbilitè des corps fous le troifieme point de vue que
nous avons annoncé, c*eft-à-dire fi l’on compare le
degré d’expanfion que chaque corps reçoit par l ’application
d’un nouveau degré de chaleur, & le rapport
qui en réfultera de fon volume à l'on poids ; cet
ordre d’expanjibilitè des corps confidéré fous ce point
de vu e, fera très-différent de l’ordre de leur vaporifation.
En effet, aufli-tôt qu’un corps a acquis l’état
d’expanfion, les liens de l’union chimique ou aggrégative
qui retenoient fes molécules font entièrement
brifés, ces molécules font hors de la fphere de leur
attraction mutuelle ; & cette derniere force, qui
dans l’ordre de vaporifation devoit être principalement
confidérée, eft entièrement nulle & n’a aucune
part à la détermination de l’ordre d’expanjibilité. La
pefanteur propre à chaque molécule devient donc
la feule force, qui, avec la preftion extérieure toujours
fuppofée confiante, fait équilibre avec l’aCtion
de la chaleur. La réfiftance qu’elle lui oppofe eft feulement
un peu modifiée par la figure de chaque molécule
, & par le rapport de là furface à fa maffe ,
s’il eft vrai que le fluide auquel nous attribuons l’écartement
produit par la chaleur agiffe fur chaque
molécule par voie d’impulfion; or cette force & la
modification qu’elle peut recevoir n’étant nullement
proportionnelles à l’union chimique ou aggrégative
des molécules, il eft évident que l ’ordre a 'expanjibilitè
des corps ne doit point fuivre l’ordre de vaporifation
, & que tel corps qui demande, pour devenir
expanfible, un beaucoup plus grand degré de chaleur
qu’un autre , reçoit pourtant d’un même degré
de chaleur une expanfion beaucoup plus confidérable
; c’eft ce que l’expérience vérifie d’une manière
bien fenfible dans la comparaifon de Y expanjibilitè de.
l’eau & de celle de l’air. On fuppofe ordinairement
que l’eau eft environ huit cents fois plus pefante fpé-
cifiquement que l’air; admettons qu’elle le foit mille
fois davantage, il s’enfuit que l’air pris au degré de
chaleur commun de l’atmofphere, & réduit à n’occuper
qu’un efpace mille fois plus petit, feroit aufli
pelant que l’eau. Appliquons maintenant à ces deux
corps le même degré de chaleur, celui où le verre
commence à rougir. Une expérience fort fimple rapportée
dans les leçons de Phyfique de M. l’abbé NoL
îe t , prouve que l’eau à ce degré de chaleur occupe
un efpace quatorze mille fois plus grand. Cette expérience
confifte à faire entrer une goutte d’eau dans
une boule creufe, garnie d’un tube, dont la capacité
foit environ 14000 fois plus grande que celle de la
goutte d’eau, ce qu’on peut connoître aifément par
la comparaifon des diamètres ; à faire enfuite rougir
la boule fur des charbons, & à plonger l’extrémité
du tube dans un vafe plein d’eau : cette eau monte
& remplit entièrement la boule, ce qui prouve qu’il
n’y relie aucun air, & que par conféquent la goutte
d’eau en rempliffoit toute la capacité. Mais par une
expérience toute femblable, on connoît que l’air au
même degré de chaleur qui rougit le verre, n’augmente
de volume que dans le rapport de trois à un.
Et comme cet air par fon expanfion remplit déjà un
volume mille fois plus grand que celui auquel il fau-
droit le réduire pour le rendre fpécifiquement aufli
pefant que l’eau, il faut multiplier le nombre de 3 ,
*>û, ce qui eft la même chofe , divifer celui de 14000
par mille, ce qui donnera le rapport des volumes de
• l ’eau à celui dé l’a ir , à poids égal, comme 14 à 3 ;
d ’où l’on voit combien 1 ’expanjibilitè du corps le plus
difficilement expanfible, furpaffe celle du corps qui
le dévient le plus aifément.
L’application de cette partie de notre théorie à
ï ’air & à l’eau , fuppofe que les particules de l’eau
font beaucoup plus légères que celles de l’a ir , puif-
qu’étant lés Unes &C les autres ifolées au milieu du
fluide de là chaleur, & ne réfiftantguere à fon action
que par leur poids, l’expanfion de l’eau eft fi fu-
périeure à celle de l’air : cette fuppofition s’accorde
parfaitement avec l’extrême différence que nous
remarquons entre les deux fluides, par rapport au
degré de leur vaporifation ; les molécules de l’air ,
beaucoup plus pefantes, s’élèvent beaucoup plûtôt
que celles de l’eau , parce que leur adhérence mutuelle
eft bien plus inférieure à celle des parties de
l ’eau, que leur pefanteur n’eft fupéfieure. Plus on
fuppofera les parties de l’eau petites & legeres, plus
le fluide fera divifé fous un poids égal en un grand
nombre de molécules ; plus l ’élément de la chaleur,
interpofé entre elles, agira fur un grand nombre de
parties, plus fon aCtion s’appliquera fur une grande
furface, les poids qu’il aura à foûlever reliant les
mêmes, & par conféquent plus Y expanjibilitè fera
confidérable. Mais il ne s’enfuit nullement delà
, que le corps ait befoin d’un moindre degré de
chaleur , pour être rendu expanfible. Si l’on admet,
avec Newton, une force attraCtive qui fuive la raifort
inverfe des cubes de ces diftances : comme il eft
démontré que cette attraction ne feroit fenfible qu’à
des diftances très-petites, & qu’elle feroit infinie au
point de contaCt ; il eft évident, i° . que l’adhérenc
e réfultante de cette attraélion, eft en partie relative
à l’étendue des furfaces par lefquelles les molécules
attirées peuvent fe toucher, puifque le norii-
bre des points de contaCt eft en raifon des furfaces
touchantes : 1° . que moins le centre de gravité eft
éloigné des furfaces , plus l’adhéfion eft forte : en
effet, cette attraélion qui èft infinie au point de con-
taél, ne peut jamais produire qu’une force finie, parce
que la furface touchante n’eft véritablement qu’un
infiniment petit ; la molécule entière eft par rapport
à elle un infini, dans lequel la force fe partage en
raifon dé l’inertie du tout : fi cette molécule groflif-
foit jufqu’à un certain point, il eft évident que tout
ce qui le trouveroit hors des limites de la fphere fen-
fible de l’attraélion cubique , feroit une furcüarge à
foùtenir pour celle-ci , & pourroit en rendre l’effet
nul : fi au contraire la molécule fe trouve toute entière
dans la fphere d’attraûion , toutes fes parties
contribueront à eft augmenter l ’effet, & plus le centre
de gravité fera proche du contaft, moins cette
force qui s’exerce au contaél fera diminuée par la force
d’inertie des parties de la molécule les plus éloignées
: or plus les molécules, dont un corps eft formé
, feront fuppofées petites , moins le centre de
gravité de chaque molécule ell éloigné de leur fur-
face , & plus elles ont de fuperficie, relativement à
leur maue.
Concluons que la petiteffedes parties doit d’abord
retarder la vaporifation, puis augmenter Ypxpanfibili-
eé, quand une fois les corps font dans l’état de vapeur.
Je ne dois pas omettre une conféquence de cette
théorie fur l’ordre d’expanjibilitè des corps , comparé
à l’ordre de leur vaporifation : c’eft qu’un degré de
chaleur qui ne fuffiroit pas pour rendre un corps expanfible,
peut fuffire pour le maintenir dans l’état d’ex-
panjibilité. En effet, je fuppofe qu’un ballon de verre
ne foit rempli que d’eau en vapeur, & qu’on plonge ce
ballon dans de l’eau froide : comme le froid n’a point
lias force pofitiye pour rapprocher les parties des
Tome VI,
corps ( voj^ Fr o id ) , il en doit être de céfte eau
Comme de l’air , qui, lorfqu’il ne communique point
avec 1 atmofphere, ft’éprouve aucune condenfatiotl
en fe refroidiffant. L’attraéliori des parties de l’eaù
ne peut tendre à les rapprocher, puifqu’ellèsne font
point placées dans la fphere dé leur aCtion mutuelle :
leur pefanteur ^ beaucoup moindre que celle des
parties de 1 air ; ne doit pas avoir plus de force pouf
vaincre l’effort d’un degré de chaleur, que l ’air foû-
tient fans fe condenfer. La preftion extérieure eft:
nulle ; l’eau doit donc relier en état de vapeur dans
le ballon , quoique beaucoup plus froide que l’eaü
bouillante, ou au moins elle ne doit perdre cet état
que lentement & peu-à-peu, à mefure que les molécules
qui touchent immédiatement au verre adhérent
à fa furface refroidie, & s’y réunifient avec lés
molécules qui leur font contiguës -, & ainfi fucceflive-
ment I Parce que toutes les m olécules, par leur expanjibilitè
même, s’approcheront ainfi les unes après
les autres de la furface du ballon, jufqu’à ce qu’elles
foient toutes condenféesi II eft cependant vrai que
dans nos expériences ordihaifés , dès que la chaleur
eft au-deffus du degré de l’eaü bouillante , les vapeurs
aqueufes redeviennent de l’eau ; mais cela
n’eft pas étonnant, puifque la preftion de l ’atmo^
fphere agit toûjo.urs fur elles pour les rapprocher, &
les remet par-là dans la fphere de leur aCtion mutuelle
, quand l’obftacle de la chaleur ne fubfifté
plus.
j. O*1 .voit p â r- là combien fe trompent ceux qui
s imaginent que l’humidité qu’on voit s’attacher autour
d’un verre plein d’une liqueur glacée, eft une
vapeur condénfee par le froid : cet effet ; de même
que celui de la formation des nuages ; dé la pluie, &
de tous les météores aq u e u x e ft une vraie pfécipi-
tation chimique par un degré de froid qui rend l’air
incapable de tenir en diffolution toute l’eau dont il
s etoit chargé par l’évaporation dans un 'tetris plus
chaud ; & cette précipitation eft précifément du
même genre que celle de la crème dç tartre , lorsque
l’eau qui la tenoit en diffolution s’eft refroidie»
F o y e^ H u m id it é & P l u i e .
On fent aifément combien une table qui repréfeii-
teroit, d’après des obfervations exactes, lé réfultat
d’une comparaifon fuivie des différentesfubftances ,
& l’ordre de leur expanfibilitè , pourroit1 donner de
vues aux Phyficiens, fur-tout fi on y marquoit toutes
les différences entre cet ordre & l’ofdre de leur
i vaporifation. Je comprendrois dans cette comparaifon
des différentes fubftances par rapport à Yexpaw.
Jibilite, la comparaifon des différens degrés diexpan-
Jibilitè entre l’air, qui contient beaucoup d’ea u , &
1 air qui en contient moins , ou qui n’en contient
point du^ tout. Muffchenbroek a obfèrvé que l’air
chargé d’eau a beaucoup plus d’élafticité qu’un autre
air , & cela doit ê tre, du-moins lorfque la chaleur
eft affez grande pour réduire l’eau même en vapeur
; car il pourroit arriver aufli qu’au-deffous de
ce degré de chaleur, l’eau diffoute en l’air & unie à
chacune de fes molécules, augmentât encore la pe*
fanteur par laquelle elles réfiftent à la force qui les
écarte. D ’ailleurs comme on n’a point encore connu
les moyens que nous donnerons à l’article humidité,
pour favoir exactement combien un air eft plus
chargé d’eau qu’un autre air ( voyeç J3u m id î t é ) 2
on n a point cherché à mefurer les différens degrés
dHexpanjibilitè de l’air, fui'vant qu’il contient plus ou
moins a’eau, fur-tout au degré de la température
moyenne de l’atmofphere : il feroit cependant aifé
de faire cette comparaifon par un moyen affez fim-
■ pie ; il ne s’agiroit que d’avoir une cloche de verre
affez grande pour y placer un baromètre, & d’ôter
toute communication entre l’air renfermé fous la cloche
& l’air extérieur ; la c ire, ou mieux encore. le
N n ij