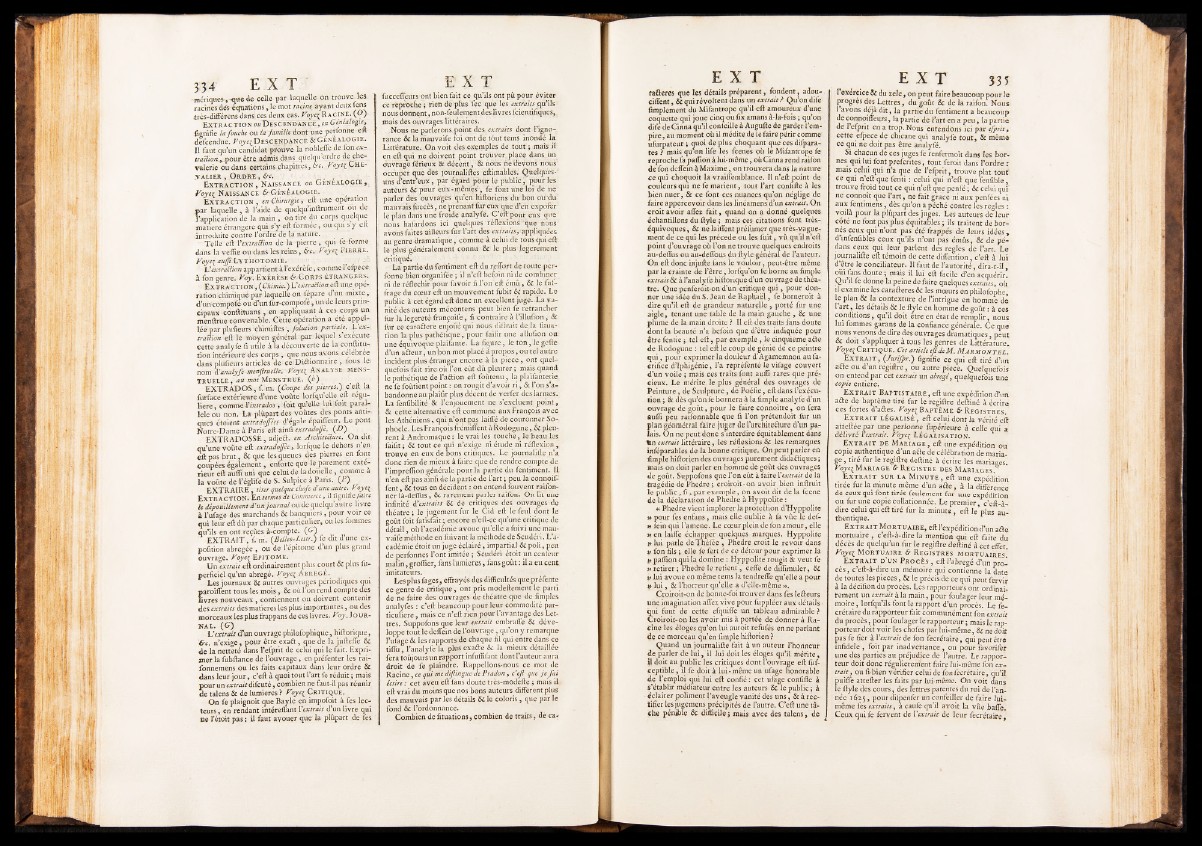
334 E X T tnériques,-racines dés-que équatiocnesl,<fe l ele p maro tl aquelle racine ayant on trouve deux fens
les., trèsE-xtraction différens dans! ces Descend deux cas.an Voye[ Ra cine. (O) dfiegfnciefined uche ou ou famille front-ç une z ,e n peribnne Genealogte,eft luae f.o Des.la cçndANcE &'Genéalogie.
Il faut qu’un Voye{candidat ptoiive la nobleffe de ion ex.n
vtraalceliroien ^ojpuo dwaxn ês tcreer atadimnsis ç dhaàpqxutreesl ,q u ’ordre de che&
c. Voye^ Che-
,vaElxietrr ,a Octridorne, , N&a<.i s,s /a n;c e ■ * fc ou Genealo.gïe,
Voyez Naissance- 6* Généalogie. Ex t r a c t io n , en Chirurgie y eft une operation
par laquelle, à l’aide de quelqu’inftrument ou de
l ’application de la main , on tire du corps quelque
matière étrangère qui s’y eft formée, ou qui s y eft
introduite contre l’ordre de la nature.
danTse llàle v eeAflieY e oxutr daactniso nle ds ere-lian-sp, ierre-, qui fe-forme &c. ,V>ye{ PibrHe.
Voye^ auffi Lythotomie. # -
\Jextraction appartient à lfexérèfe, comme l’efpece
à fon genre. Vay. Exérèse ^ C orps étrangers.
E X TRA G TIO N, {Chimie.') L’extraction eftuneppe-;
ration .chhhiqué par laquelle on fépare d’un mixte,
d’un compofe ou d’un fur-compofé -, un de leurs principaux
conftituans , en appliquant à ces .corps un
menftrue convenable. Cette opération, a ete appel-
lëè par plusieurs chimiftes\.falution partiale. L ex-,
traction eft le 'moyen général par lequel sexecute
cette analyfe li utile à la découverte de la conftitu-r
tion intérieure'des corps , que nous avons.célebree
dans pliïfiéurs articles deceiDiûionnaire , fous le1»
nom à 'analyfe menftrue lie: Voye^ A nalyse MENSTRUELLE,
aü mot "MENSTRUE. (£)■ ‘ , }
EXTRADOS-, f.-m. (Coupe des pierres. ).c.e{t. la
furface extérieure d’une voûte lorfqu’elle eft régulière,
comme Vintrados, foit qu’elfe lui foit parallèle
ou non. La plupart des voûtes des ponts antiques
étoient extradoffées d’égale épaiffeur. Le pont
Notre-Dame à Paris eft ainfi extradojfé. (D )
EXTRADOSSÉ, adjefr. en Architecture. .On dit
qu’une voûte eft extradoffée , lorfque le dehors n en
eft pas brut, & que les queues des pierres en font
coupées également, enforte que lë parement extérieur
eft aufli uni que celui de la doiielle, comme a
la voûte de l’églife de S. Sulpice à Paris. (P)
EXTRAIRE, tirer quelque chofe d'une autre. Vlye^ Extraction. En termes de Commerce, il lignifie faire
le dépouillement d'un journal ou de quelqu’autre livre
à l’ufage des marchands & banquiers, pour voir ce
qui leur eft dû par chaque particulier, ou les fommes
qu’ils en ont reçûes à-compte. (G)
EX TR A IT , f. m. (Belles-Leur.) fe dit d une ex-
pofition abrégée , ou de l’epitome d un plus grand
ouvUrna geex.t rVaioty eef{t EorpdiiTnOaiMreEm.ent plus court & plus fu-
perficiel qu’un abrégé. Voye[ Abrégé.
Les journaux & autres ouvrages périodiques qui
paroilfent tous les m ois, & où l’on rend compte des
livres nouveaux, contiennent ou doivent contenir
des extraits des matières les plus importantes, ou des
morceaux les plus frappans de ces livres. V?y. Journal.
(G)
L’extrait d’un ouvrage philofophique, hiftorique,
'dOec .l an n’eexttiegteé, dpaonusr l ’êetfrper iet xdaeû c,e qluuie q duei llea f ajuitf.t eEffxep r&i
fmoenrn leam feunbsf taonuc lee sd ef ali’otsu cvarpagiteau, xe nd apnrés fleenutre ro lredsr er a&i-
pdaonusr luenu r jour, c’eft à quoi tout l’art fe réduit ; mais extrait difcuté, combien ne faut-il pas reunir
de talens & de lumières ? V Critique.
On fe plaignoit que Bayle en impofoit à fes lecteurs
, en rendant intéreflant Vextrait d’un livre qui
ne l’étoit pas : il faut avouer que la plupart de les
fuccéfleiirs ont bien fait ce qu’ils ont pu pour éviter
ce reproche ; tieïi dé plus fec que les extraits qu’ils
nous donnent, non-feulement des livres fcientifiques,
mais des ouvrages littéraires.
Nous ne parlerons, point des extraits dont l’ignorance
& la mauvaife foi ont de tôut tems inondé la
Littérature. On voit des exemples de tout ; maïs il
en eft qui ne doivent point trouver, place dans, un
ouvrage férieux & décent, & nous ne devons nous
occuper que des journaliftes éftimables.' Quelques-'
uns d’éntr’eu x, par égardpoùrle publie ^ pour les
auteurs 6c pour eux-mêmes-, fe' font imé loi de ne
parler des ouvrages qu’en hiftoriens du bon ou du
mauvais fuccèS, ne prenant fur eiix que d’en expofer
le plan danèùne froide analyfe. C ’éft pour eux que
nous hafardons ici quelques réflexion^0que nous
avons faites ailleurs fur l’art des extraits, 'appliquées
au genre dramatique, comme à celui de tous qui eft
lë plus généralement connu & le plus legerement
Critiqué. '' :
La partie du fentiment èft du reffort: de toute -.per-
fonne bien organifée ; il n’eft befoin ni de combiner-
ni de réfléchir pour favoir fi l’on'eft ému, & le fuf-
frage du coeur eft un mouvement fubit Ôf rapide. Le
public à cet égard eft donc un excellent juge.-La vanité
des auteurs mécontens peut biéri fe retrancher
fur la legereté françoife, fi contraire à Tillufion, &
fur ce ca rafler e enjoué qui nous diftrait de la fitua-
tion là plus pathétique, pour faifir une allufion ou
une équivoque plailante. La figure, le ton, le gefte
d’un afleur, un bon mot placé à propos, ou tel autre
incident plus étranger encore à la piece, ont quelquefois
fait rire où l’on eût dû pleurer ; mais quand
le pathétique de l’aftion eft foûtenu , la plailanterie
ne fe foutient point : on rougit d’avoir r i , & l’on s’abandonne
au plaifir plus décent de verfer des larmes.
La fenfibilité & l’enjouement ne s’excluent point,
& cette alternative eft commune aux François avec
l.es Athéniens, qui n’ont pas laiffé de couronner Sophocle.
Les François frémiffent à Rodogune, & pleurent
à Andromaque : le vrai les touche, le beau les.
faifit ; & tout ce qui n’exige ni étude ni réflexion ,
trouve en eux de bons critiques. Le journalifte n’a
donc rien de mieux à faire que de rendre compte de.
l’impreflion générale pour la partie du fentiment. Il
n’en eft pas airifi de la partie de l’art ; peu la connoiJP
fent, & tous en décident : on entend fouvent raifon-
ner là-deflïis, & rarement parler ràifon. On lit une
infinité dfextraits & de critiques des ouvrages de
théâtre ; le jugement fur le Cid eft le feul dont le
goût foit fatisfait ; encore n’eft-ce qu’une critique.de
détail, où l’académie avoue qu’elle a fuivi une mauvaife
méthode en fuivant la méthode de Scudéri. L’académie
étoit un juge éclairé, impartial & poli, peu
de perfonnes l’ont imitée ; Scudéri étoit un cenfeur
malin, groflier, fans lumières, fans goût : il a eu cent
imitateurs.
Lesplusfages, effrayés des difficultés que préfente
ce genre de critique, ont pris modeftement le parti
de ne faire des ouvrages de théâtre que de fimples
analyfes : c’eft beaucoup pour leur commodiré particulière
, mais ce n’eft rien pour l’avantage des Lettres.
Suppofons que leur extrait embraffe & développe
tout le deffein de l’ouvrage, qu’on y remarque
l’ufage & les rapports de chaque fil qui entre dans ce
tiffu, l’analyfe la plus exafte & la mieux détaillée
fera toujours un rapport infuffifant dont l’auteur aura
droit de fe plaindre. Rappelions-nous ce mot de
Racine ce qui me diftingue de Pradon, c'efi que j e fai
écrire : cet aveu eft fans doute très-modefte ; mais il
eft vrai du moins que nos bons auteurs different plus
des mauvais par les détails & le coloris, que par le
fond & l’ordonnance.
Combien de fituations, combien de traits, dè caraûeres
que les détails préparent, fondent, adou-
çiffent, & qui révoltent dans un extrait? Qu’on dife
Amplement du Mifantrope qu’il eft amoureux d’une
coquette qui joue cinq ou fix amans à-la-fois ; qu’on
dife de Cinna qu’il conlëille à Augufte de garder l’empire
, au moment où il médite de le faire périr comme
ufurpateur ; quoi de plus choquant que ces difpara-
tes ? mais qu’on life les feenes où le Mifantrope fe
reproche fà paffion à lui-même, où Cinna rend raifon
de fon deffein à Maxime, ©n trouvera dans la nature
ce qui choquoit la vraisemblance. Il n’eft point de
couleurs qui ne fe marient, tout l’art confifte à les
bien nuer, & ce fopt ces nuances qu’on néglige de
faire appercevoir dans les linéamens d’un extrait. On
croit avoir affez fa it, quand on a donné quelques
échantillons du ftyle ; mais ces citations font très-
équivoques , & ne laiffent préfumer que très-vaguement
de ce qui les précédé ou les fuit, vu qu’il n’eft
point d’ouvrage où l’on ne trouve quelques endroits
au-deffus ou aurdeffous du ftyie général de l’auteur.
On eft donc injufte fans le vouloir, peut-être même
par la crainte de l’être, lorfqu’on fe borne avi fimple
extrait & à l’analyfe hiftorique d’un ouvrage de théâtre.
Que penferoit-Dn d’un critique q u i, pour donr
ner une idée du S. Jean de Raphaël, fe borneroit à
dire qu’il eft de grandeur naturelle , porté fur une
aigle, tenant une tahle de la main gauche > & une
plume de la main droite ? Il eft des traits fans doiite
dont la beauté n’a befoin que d’être indiquée pour
être fentie ; tel e ft , par exemple , le cinquième a&e
de Rodogune : tel eft le coup de génie de ce peintre
q u i, pour exprimer la douleur d’Agamemnon au fa-
crifice d’Iphigénie, l’a repréfenté le vifage couvert
d’un voile ; mais ces traits font auffi rares que précieux.
Le mérite le plus général des ouvrages de
Peinture, de Sculpture, de Poéfie, eft dans l’exécution
; & dès qu’onfe bornera à la fimple analyfe d’un
ouvrage de goût, pour le faire connoître, pn fera
auffi peu raifonnable que fi l’on prétendent fur un
plan géométral faire juger de. l’archite&ure d’un par
lais. On ne peut donc s interdire équitablement dans
tin extrait littéraire., les réflexions & les remarques
inféparables de la bonne critique. On peut parler en
fimple hiftoriendes ouvrages purement didactiques;
mais on doit parler en homme de goût des ouvrages
de goût. Suppofons que l’on eût à faire Y extrait de la
tragédie de Phedre; croiroit-on avoir bien inftruit
le public, fi , par exemple, on avoit dit de la feene
de la déclaration de Phedre à Hyppolite :
« Phedre vient implorer la protection d’Hyppolite
» pour fes enfans, mais elle oublie à fa vue le def-
n fein qui l ’amen^* Le coeur plein de fon amour, elle
». en laide échapper quelques marques. Hyppolite
lui parle de Théfée , Phedre croit le revoir dans
» fon fils ; elle fe fert çfece détour pour exprimer la
it paffion qui la domine : Hyppolite rougit & veut fe
» retirer ; Phedre le retient, cefle de diflimuier, &
» lui avoue en même tems la tendreffe qu’elle a pour
p lu i, & l’horreur qu’elle a d’elle-même ».
Croiroit-on de bonne-foi trouver dans fes lecteurs
line imagination affez vive pour fuppléer aux détails ■
qui font de cette efquiffe un tableau admirable ?
Croiroit-on les avoir mis à portée, de donner à Racine
les éloges qu’on lui aurqit refufés en ne parlant
de ce morceau qu’en fimple hiftorien ?
Quand un journalifte fait à un auteur l’honneur
de parler de lu i, il lui doit les éloges qu’il mérite,
fi doit au public les critiques dont l’ouvrage eft fuf-
ceptiblc, fi fe doit à lui-même un ufage honorable
de l’emploi qui lui eft confié : cet ufage confifte à
s’établir médiateur entre les auteurs & le public ; à
• éclairer poliment l ’aveugle vanité des uns, & à rectifier
les jugemens précipités de l’autre. C ’eft une tâche
pénible & difficile ; mais avec des talens, de
1 exercice & du zele, on peut faire beaucoup pour le
progrès des Lettres, du goût & de la raifon. Nous
1 avons déjà dit, la partie du fentiment a beaucoup
de copnoiffeiirs, la partie de l’art en a peu, la partie
de l’efprit en a trop. Nous entendons ici par efprit,
cette efpece de chicane qui analyfe tout, & même
ce qui ne doit pas être analyfé.
Si chacun dé ces juges fe renfermoit dans les bornes
qui lui font preferites, tout ferait dans l’ordre :
mais celui qui h*a que de l’efprit, trouve plat tout
ce qui n’eft que fenti : celui qui n’eft que fenfible,
trouve froid tout ce qui q’eft que penfé ; & celui qui
ne connoît que l’art, ne fait grâce ni aux penfées ni
aux feptimens, dès qu’on a péché contre les réglés :
voilà pour la plupart des juges. Les auteurs de leur
côté ne font pas plus équitables ; ils traitent de bornés
ceux qui n’ont pas été frappés de leurs idées ,
d’infenfibles ceux qu’ils n’opt pas émus, &c de pé-
dans ceux qui leur parlent des réglés de l’art. Le
journalifte eft témoin de cette diffention, c’eft à lui
d’être le conciliateur. Il faut de l’autorité, dira-t-il,
oui fans doute ; mais il lui eft facile d’en acquérir.
Qu’il fe donne la peine de faire quelques extraits, où
il examine les carafreres & les moeurs en philofophe,
fe plan & la contexture de l’intrigue en homme de
1 a rt, les details & 1e ftyle en homme de goût : à ces
conditions, qu’il doit être en état de remplir, nous
lui fommes garans de la confiance générale. Ce que
nous venons de dire des ouvrages dramatiques, peut
& doit s’appliquer à tous fes genres de Littérature.
Voyei Critique. Cet article tjt de M. Ma rm o n t e l . Extrait , (Jurifpr.) fignifie ce qui eft tiré d’un
aéle ou d un regiftre, ou autre piece. Quelquefois
on entend par cet extrait un abrégé, quelquefois une
copie entière.
Extrait Baptistaire , eft une expédition d’un
a&e de haptême tiré fur 1e regiftre deftiné à écrire
ces fortes d’a&es. Voyei Baptême & Registres.
Extrait légalise , eft celui dont la vérité eft
atteftée par une perfonne fupérieure à celle qui a
délivré r extrait. Voyei Légalisation.
Extrait de Mariage , eft une expédition ou
copie authentique d ’un a&e de célébration de mariage
, tiré fur 1e regiftre deftiné à écrire fes mariages.
Voyeç Mariage & Registre des Mariages.
Extrait sur la^Minute , eft une expédition
tirée fur la minute même d’un afre, à la différence
de ceux qui font tirés feulement fur une expédition
ou fur une copie collationnée. Le premier c’eft-à-
dire celui qui eft tiré fur la minute, eft le*plus authentique.
moErtxutairrae i,t c M’efot-ràt-duiarei rlae ,m eeftn lt’ieoxnp éqduiit ieofnt df’auinte a fdrue décès de quelqu’un fur 1e regiftre deftiné à cet effet.
VoEyei Mortuaire & Registres mortuaires* xtrait d’un Procès , eft l’abrégé d’un procès
, c’eft-à-dire un mémoire qui contienne la date
de toutes fes pièces, & 1e précis de ce qui peut fervir
à la décifiondu procès. Les rapporteurs ont ordinaU
fement un extrait à la main, pour foulager leur mémoire
, lorfqu’ils font 1e rapport d’un procès. Le fe-
crétaire du rapporteur fait communément fon extrait
du procès, pour foulager 1e rapporteur ; mais le rapporteur
doit voir fes chofes par lui-même, & ne doit
pas fe fier à Vextrait de fon fecrétaire, qui peut être
infidèle , foit par inadvertance , ou pour fàvorifer
une des parties au préjudice de l’autre. Le rapporteur
doit donc régulièrement faire lui-même fon extrait
, qu fi-bien vérifier celui de fon fecrétaire, qu’il
puiffe attefter les faits par lui-même. On voit dans
le ftyle des cours, des lettres patentes du roi de l’année
i f iz ç , pour difpenfer un confeilfer de faire lui-
même fes extraits, à caufe qu’il avoit la vûe baffe.
Ceux qui fe fervent de l'extrait de leur fecrétaire ,