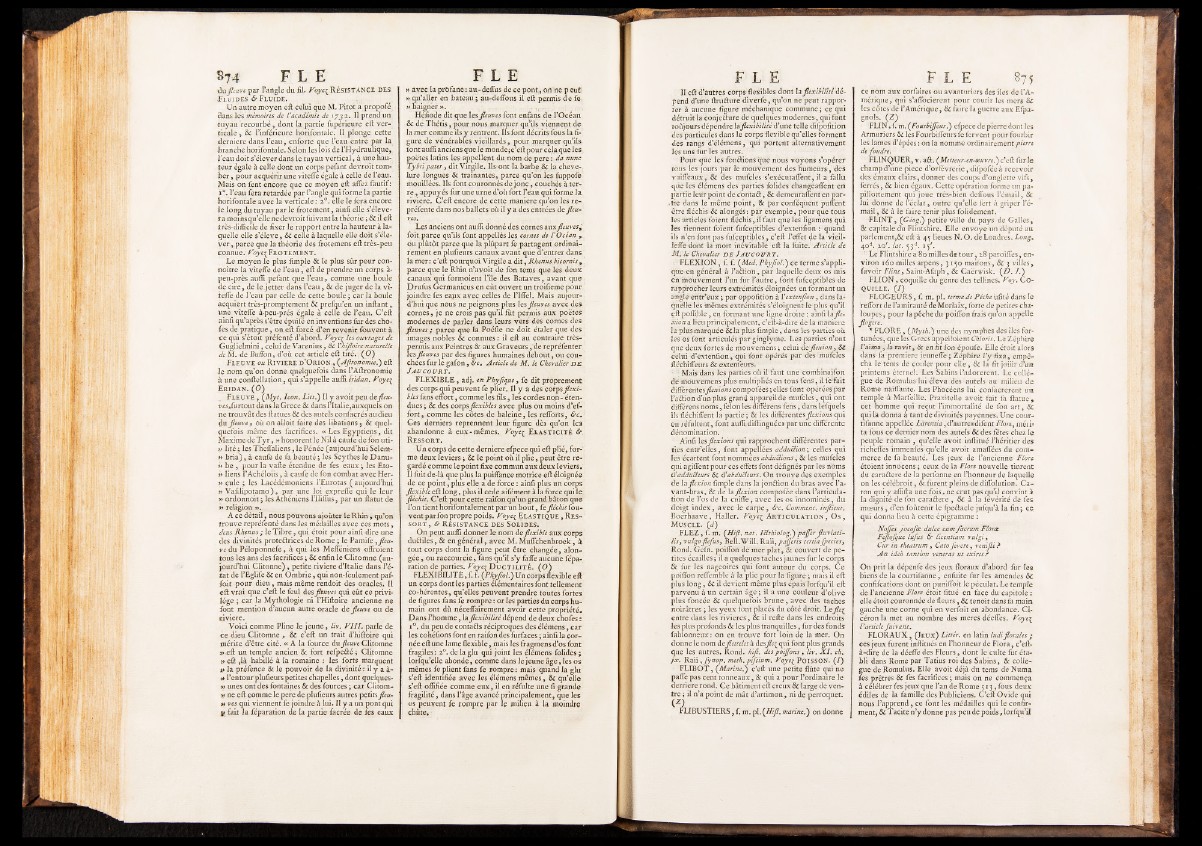
du fleuve par Pangle du £1. Voye^ Résistance des
Fluides & Fluide.
Un àutre moyen eft celui que M. Pitot a propofé
flans les mémoires de l ’académie de 1732.. Il prend un
tuyau recourbé, dont la partie fupérieure eft verticale
, & l’inferieure horifontale. Il plonge cette
derniere dans l’eau, enforte que l’eau entre par la
tranche horifontale. Selon les lois de l’Hydraulique,
l ’eau doit s’élever dans le tuyau vertical , à une hauteur
égale à celle dont un corps pelant devroit tomber
, pour acquérir une vîteffe égale à celle de l’eau.
Mais on font encore que ce moyen eft affez fautif:
i°. l’eau fera retardée par l’angle qui forme la partie
horifontale avec la verticale : z°. elle le fera encore
le long du tuyau par le frotement,. ainfi elle s’éleve-
ira moins qu’elle ne devroit fuivant la théorie ; & il eft
très-difficile de fixer le rapport entre la hauteur à laquelle
elle s’élève, & celle à laquelle elle doit s’élever,
parce que la théorie des frotemens eft très-peu
connue.' V jyeç Frotem ent.
Le moyen le plus fimple & le plus sûr pour con-
noître la vîteffe de l’eau, eft de prendre un corps à-
peu-près auflï pefant que l’eau, comme une boule
de cire, de le.jetter dans l’eau, & de juger de la vî-
ieffe de Teau par celle de cette boule ; car la boule
acquiert très-promptement & prefqu’en un inftant,
une vîteffe à-peu-prés égale à celle de l’eau. C’eft
ainfi qu’après s’être épuifé en inventions fur des cho-
fes de pratique, on eft forcé d’en revenir fouvent à
ce qui s’ëtoit préfenté d’abord. Voye£ les ouvrages de
Guglielmini, celai de Varenius, 8c Vkîjloire naturelle
de M. de Buffon, d’où cet article eft tiré., (O ) Fleuve ou Riviere d’Orion , (Aflronomie.) eft
le nom qu’on donne quelquefois dans l’Aftronomie
a une conftellation, qui s’appelle auffi éridan, Voye^ Eridan. (O) Fleuve , (My t. Icon. Lin.') Il y avoit peu defleuves
Surtout dans laGrece & dans l’Italie,auxquels on
ne trouvât des ftatues & des autels confacrés au dieu
du fleuve , où on alloit faire des libations, & quelquefois
même des facrifices. « Les Egyptiens, dit
Maxime de T y r , » honorent le Nil à caufe de fon uti-
» lité ; les Theffaliens, le Pénée (aujourd’hui Selem-
» bria), à caufe de fa beauté ; les Scythes le Danu-
» be , pour la vafte étendue de fes eaux ; les Eto-
» liens l’Achéloüs, à caufe de fon combat avec Her-
» cule ; les Lacédémoniens l’Eurotas ( aujourd’hui
»> Vafilipotamo), par une loi expreffe qui le leur
» ordonnoit ; les Athéniens l’Iliffus, par un ftatut de.
» religion ».
A ce détail, nous pouvons ajoûter le Rhin, qu’on
trouve repréfenté dans les médailles avec ces mots,
deus Rhenus ; le Tibre, qui étoit pour ainfi dire une
des divinités prote&rices de Rome ; le Pamife y fleuve
du Péloponnefe, à qui les Mefféniens offroient
tous les ans des facrifices ; & enfin le Clitomne (aujourd’hui
Clitonne), petite riviere d’Italie dans l’état
de l’Eglife & en Ombrie, qui non-feulement paf-
foit pour dieu, mais même rendoit des oracles. Il
eft vrai que c’eft le feul des fltuves qui eût ce privilège
; car la Mythologie ni l’Hiftoire ancienne ne
font mention d’aucun autre oracle de fleuve ou de
riviere.
Voici comme Pline le jeune, lîv. V I I I . parle de
ce dieu Clitomne , & c’eft un trait d’hiftoire qui
mérite d’être cité. « A la fource du fleuve Clitomne
»» -eft un temple ancien & fort refpeâé ; Clitomne
»> eft tlà habillé à la romaine : les forts marquent
»» la préfence & le pouvoir de la divinité: il y a à-
* l’entour plufieurs petites chapelles, dont quelques-
*> unes ont des fontaines & des fources ; car Clitom-
» ne eft comme le pere de plufieurs autres petits fleu-
>» ves qui viennent fe joindre à lui. Il y a un pont qui
!» fait la féparation de la partie facrée de fes eaux
» avec la profane : au- deffus de ce pont, ofï ne p eut
» qu’aller en bateau ; au-deffous il eft permis d e fe
» baigner ».
Héfiode dit que les fleuves font enfans de. l’Océan
& de Thétis, pour nous.marquer qu’ils viennent de
la mer comme ils y rentrent. Ils font décrits fous la figure
de vénérables vieillards, pour marquer qu’ils,
font auffi anciens que le nionde;c’éft pour cela que les
poètes latins les: appellent du nom de pere : da nunc
Tybripater , dit Virgile. Ils ont la barbe la cheve-;
lure longues & tramantes, parce qu’on les fuppofe
mouillées. Ils font couronnés de jonc, couchés à terre
, appuyés fur une. urne d’où fort l’eau qui forme la
riviere. C’eft encore de cette maniéré qu’on les re-
préfentè dans nos ballets où il y a des entrées de fieu-
ves.
Le s anciens ont auffi donné des cornes auxfleuves
foit. parce qu’ils font appelles les cornes de L'Océan ,
ou plûtôt parce que la plûpart fe partagent ordinairement
en plufieurs canaux avant que d’entrer dans
la mer : c’eft pourquoi Virgile a dit, Rhenus biçornisr .
parce que le Rhin n’avoit de fon tenjs que lés deux
canaux qui formoient l’île des Bataves, avant que
Drufus.Germanicus en eût ouvert un troifieme pour
joindre fes eapx avec celles de l’IfTel. Mais aujourd’hui
que nous ne peignons plus les fleuves avec des
cornes, je ne crois pas qu’il fût permis aux poètes
modernes de parler dans leurs vers des cornes des
fleuves ; parce que la Poéfie ne doit étaler que des
images nobles & connues : il eft au contraire très-
permis aux Peintres & aux Graveurs ,‘de repréfenter
les fleuves par des figures humaines debout, ou couchées
fur le gafon , &c. Article de M . le Chevalier D E
J AU COURT.
FLEXIBLE, adj. en Phyflque , fe dit proprement
des corps qui peuvent fe plier. Il y a des'corps f le x ibles
fans effort, comme les fils, les cordes non- étendues
; & des corps flexibles.a v e c plus ou moins d’effort
, comme les côtes de baleine, les refforts, & c.
Ces derniers reprennent leur figure dès qu’on les
abandonne à eux-mêmes. Voye^ E l a s t i c i t é &.
R e s s o r t .
. Un corps de cette derniere efpece qui eft plié, forme
deux leviers ; & le point où il plie, peut être regardé
comme le point fixe commun aiix deux leviers.'
Il fuit de-là que plus la puiftance motrice eft éloignée
de ce point, plus elle a de force : ainfi plus un corps
flexible eft long, plus il cede aifément à la force qui le
fléchit. C’eft pour cette raifon qu’un grand bâton que
l’on tient horifontalement par un bout, fe fléchit fou-
vent par fon propre poids. Voye^ Elastique , Resso
rt, & RESISTANCE DES SOLIDES.
On peut auffi donner le nom de flexible aux corps
duttiles, & en général, avec M. Muflchenbroek, à
tout corps dont la figure peut être changée , alon-
gée, ou raccourcie, fans qu’il s’y fafle aucune fépa-,
ration de parties. Voye^ D u c t i l i t é . ( O )
FLEXIBILITÉ, f. f. (Phyflol.) Un corps flexible eft:
un corps dont les parties élémentaires font tellement
Co-hérentes, qu’elles peuvent prendre toutes fortes
de figures fans fe rompre : or les parties du corps humain
ont dû néceffairement avoir cette propriété.
Dans l’homme, la flexibilité dépend de deux chofes :
i° t du peu de contaâs réciproques des élémens, car
les cohéfions font en raifon des furfaces ; ainfi la cornée
eft une lame flexible, mais les fragmens d’os font
fragiles : 20. de la glu qui joint les élémens folides ;
lorfqu’elle abonde, comme dans le jeune âge, les os
mêmes fe plient fans fe rompre : mais quand la glu
s’eft identifiée avec les élémens mêmes, & qu’elle
s’eft offifiée comme eux, il en réfulte une fi grande
fragilité, dans l’âge avancé principalement, que les
os peuvent fe rompre par le milieu à la moindre chute»
Il eft d’autres corps flexibles dont 1% flexibilité dz-
pend d’une ftruélure diverfe, qu’on ne peut rapporter
à aucune figure méçhartique commune ; ce qui
détruit la conjecture de quelques modernes , qui font
toûjours dépendre la flexibilité d’une telle difpofition
des particules dans le corps flëxible qu’elles forment
des rangs d’élémens, qui portent alternativement
lesTins fur les autres.
' 1 Pour que les fondions tjüé nous voyons s’opérer
tous les jours par le mouvement des humeurs, des
vaiffeaux, & des mufcles -s’exécutaffent, il a fallu
qiie les élémens des parties folides ehangèaffent en
partie leur point de contaét, & demeuràffent en par-
.tie dans le même point, & par conféqüent punënt
être fléchis & alongés: par exemple, pour qiië tçus
les articles foient fléchis,.il'faut que les ligamens qui
lés tiennent foient fufceptibles d’extenlion : quand
ils n’en font pas fufceptibles, c’eft l’éffet de la vîeil-
JëfFèdoht la mort inévitable eft la fuite. Article de
M l le Chevalier DE Ja u c&URT.
- FLEXION, f. f. (Med. Phyflol.) ce terme s’applique'en
général à l’aêtion, par laquelle deux oS mis
ch ftio'uvement l’un fur l ’autre, font fufceptibles de
rapprocher leurs extrémités éloignées en formant un
angle entr’eux ; par oppofition à Vextenfion, dans laquelle^
lés mêmes extrémités s’éloignent le plus qu’il
eft poffible, en formant une ligne droite : ainfi la'fle?
xion a lieu principalement, c’eft-à-dire de la maniéré
la plus marquée & la plus fimple, dans les parties où
les os font articulés par ginglyme. Les parties; n’ont
que deux fortes de mouvemens ;.celui àeflexion3 8t
cèlùi-d’extenfion , qui font opérés par dès mufcles
fléçhifTeitrs ôc extenl’eurs.
\ Mais dans les parties où il-faut une combinàifon
de môuvemens plus multipliés en tous fens, il fe1feit
différentes flexions composées ;• elles font opérées par
l’aftion d’un plus grand appareil de mufcles, qui ont
différens noms, félon les différens fens, dans lefquels
ils fléchiffent la partie ; & les différente s flexions qui
èn réfultent, font auffi diftinguées par une différente
dénomination.
Ainfi les flexions qui rapprochent différentes parties,
entr’elles, font appellées adduction ; celles qui
lès écartent font nommées abductions, & les mufcles
qui agiffent pour ces effets font défigriés par les n'oms
à 'adducteurs & d’abducteurs. On trouve des exemples
de la flexion fimple dans la jonftion du bras avec l’avant
bras, & de la flexion compofée dans l’articulation
de l’os de la cuiffe, avec les-os innominés, du
doigt index, avec -le carpe, &c. Comment, inflitut.
Boerhaave, Haller. V o ye^ A r t i c u l a t i o n , Os ,
M u s c l e , (fl)
FLEZ, f. m. (Hifl. nat. Ictthiolog.) pafler fluviati-
lisy vulgoflefus, Bell.Will. Raii, pafleris tertiafpecies3
Rond. Gefn. poiffon de mer plat, & couvert de petites
écailles ; il a quelques taches jaunes fur le corps
& fur les nageoires qui font autour du corps. Ce
poiffon reffemble à la plie pour la figure ; mais il eft
plus long, & il devient même plus épais lorfqu’il eft
parvenu à un certain âge ; il a une couleur d’olive
plus foncée & quelquefois brune, avec des taches
noirâtres ; les yeux font placés du côté droit. Lefle^
entre dans les rivières, & il refte dans les endroits
les plus profonds & les plus tranquilles, fur des fonds
fablonneux : on en trouve fort loin de la mer. On
donne le nom de flettelet à desfle^ qui font plus grands
que les autres. Rond. hifl. des poiflons , liv. X I . ch.
j x . Raii yjynop. meth. pifeium. Voye^ POISSON. (/)
FLIBOT, (Marine.) c’eft une petite flûte qui ne
paffe pas cent tonneaux, & qui a pour l’ordinaire le
derrière rond. Ce bâtiment eft creux & large de ventre
; il n’a point de mât d’artimon, ni de perroquet.
(^)
FLIBUSTIERS, f. m. pl. (Hifl, marine.) on donne
ce nom aux corfaires ou avanturiers des îles de l’Amérique,
qui s’affocierent pour courir les mers &
les côtes1 de l’Amérique, & faire la guerre aux Efpa-
gno'.s. (Z)
FLIN, f. m. (Fourbifleuri) efpece de pierre dont les
Armuriers & les Fourbiffeurs fe fervent pour fourbir
les lames d’épées : on la nomme ordinairement pierre
de foudre:
FLINQUER, v. a6t. (Metteur-en-otuvre.) c’eft furie
champ d’une piece d’orfèvrerie, difpofée à recevoir
des émaux clairs, donner des coups d’onglette vifs,
ferrés, & bien égaux. Cette opération forme un pa-
pillottement qui joue très-bien deffous l’émail, &
lui donne de l’éclat, outre qu’elle fort à griper l’émail
, & à le faire tenir plus folidement.
FLINT, (Géog.) petite ville du pays de Galles,
& capitale du Flintshire. Elle envoyé un député au
parlement,& eft à 45 lieues N. O. de Londres. Long.
40d. x o '.la t . *3?. i5/,
" Le Flintshire a 80 milles de tour, 28 paroiffes, environ
160 milles arpens, 3150 maifons, & 3 villes,
favoir F lin t , Saint-Afaph, & Caërvisk. (D . J .)
FLION, coquille du genre des tellines. Voy. Coq
u i l l e . ( / )
FLOGEURS, f. m. pl. terme de Pêche iifité dans le
l'effort de l’amirauté de Morlaix, forte de petites chaloupes
, pour la pêche du poiffon frais qu’on appelle
fiogere.
* FLORE, (Myth.) une des nymphes des îles fortunées,
que les Grées appelloient Ckloris. Le Zéphire
l'aima, la ra v it , & en fit fon époufe. Elle étoit alors
dans fa première jeuneffe ; Zéphire l’y fixa, empêcha
le tems de couler pour elle, & la fit jouir d'un
printems éternel; Les Sabins l’adorerent. Le collègue
de Romulus lui éleva dés autels au milieu de
Rome naiffante. Les Phocéens lui confacrerent un
temple à Marfeille; Praxitelle avoit fait fa ftatue,
cet homme qui reçut l’immortalité de fon art &
qui la donna à tant de divinités payennés. Une cour-
tifanne appéllée Ldrentia, d’autres difent Flore, mérita
fous ce dernier nom des autels & des fêtes chez le
peuplé romain , qu’elle avoit inftitué l’héritier des
richeffes immènfes- qu’elle avoit amaffées du commerce
de fà beauté. Les jeux de l’ancienne Flore
étoient innocens ; ceux de la Flore nouvelle tinrent
du caraftere de la perfonne en l’honneur de laquelle
on les célébroit, &.furent pleins de diffolution. Caton
qui y affifta une fois, ne crut pas qu’il convînt à
la dignité de fon cara&ere , & à la févérité de fes
moeurs, d’en foûtenir le fpeétacle jufqu’à la fin ; ce.
qui donna lieu à cette épigramme :
Nofles jocofoe dulce cum facrum Flora
Feflofque lufus & licentiam vulgi,
Cur in theatruiri , Cato feyere, venifli ?
A n ideo tantum vénéras ut exires ?
On prit la dépenfe des jeux floraux d’abord fur les
biens de la courtifanne, enfuite fur les amendes &
confifcations dont on puniffoit le pécùlat. Le temple
de l’ancienne Flore étoit fitué en face du capitole :
elle étoit couronnée dé fleurs, Sc tenoit dans fa main
gauche une corne qui en verfoit en abondance. Cicéron
la met au nombre des meres déeffes. Voye£
l'article fuivant.
FLORAUX, (J e u x ) Littèr. en latin ludiflorales ;
ces jeux furent inftitués en l’honneur de Flora, c’eft-
à-dire de la déeffe des Fleurs, dont le culte fut établi
dans Rome par Tatius roi des Sabins, & collègue
de Romulus. Elle avoit déjà du tems de Numa
fes prêtres & fes facrifices ; mais on ne commença
à célébrer fes jeux que l’an de Rome 513, fous deux
édiles de la famille des Publiciens. C’eft Ovide qui
nous l’apprend, ce font les médailles qui le confirment,
& Tacite n’y donne pas peu de poids , lorfqu’il