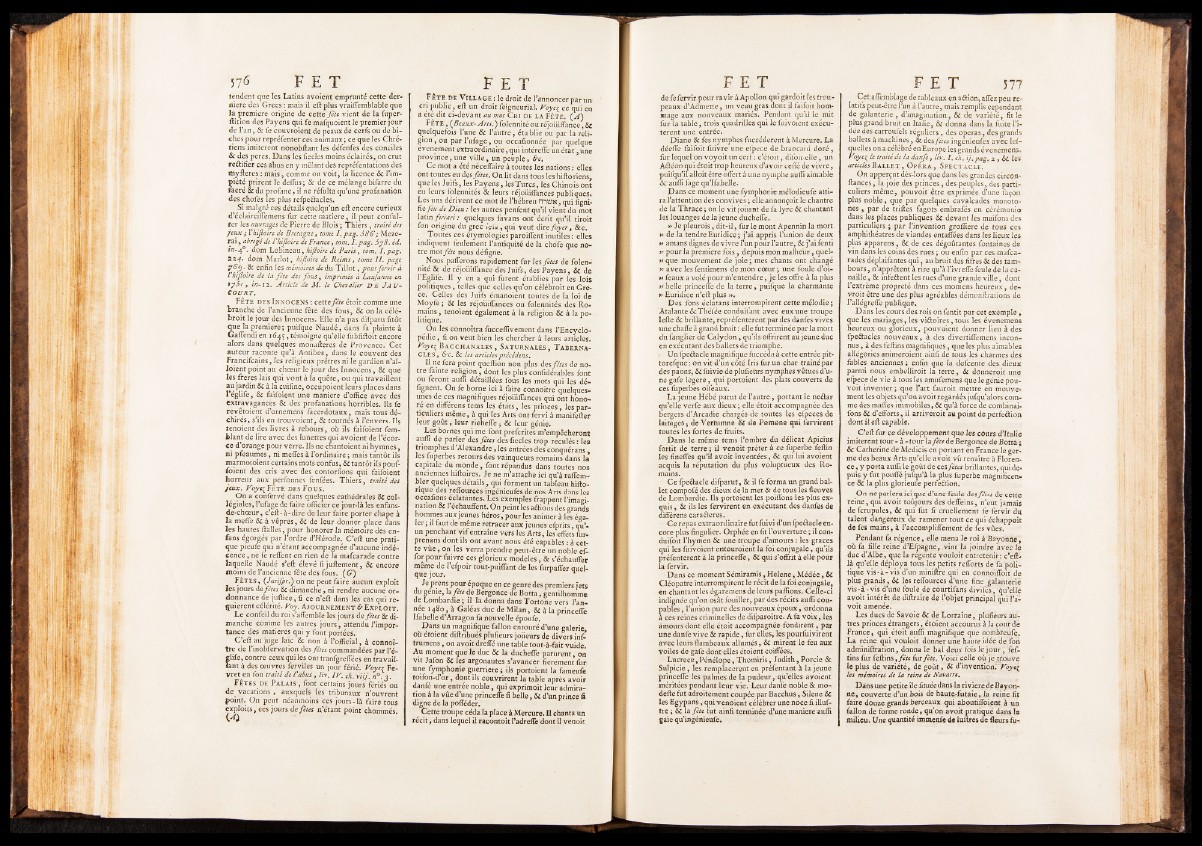
tendent que les Latins avoient emprunté cette dernière
des Grecs : mais il eft plus vraisemblable que
la première origine de cette fête vient de la fuper-
ftition des Payens qui fe mafquoient le premier jour
de l’an, & fe couvroient de peaux de cerfs ou de biches
pour repréfenter ces animaux; ce que les Chrétiens
imitèrent nonobftant les défenfes des conciles
& des peres. Dans les fiecles moins éclairés, on crut
re&ifier ces abus en y mêlant des repréfentations des
myfteres : m ais, comme on v o it, la licence & l’impiété
prirent le deffus; & de ce mélange bifarre du
facré & du profane, il ne réfulta qu’une profanation
des chofes les plus refpeôacles.
Si malgré ces détails quelqu’un eft encore curieux
d’éclairciffemens fur cette matière, il peut conful-
ter les ouvrages de Pierre de Blois ; Thiers, traite des
jeux ; Yhijloire de Bretagne, tome I. pag. 686 ; Meze-
r a i, abrégé de l'hijloire de France, tom, I , pag. 6y8. èd.
tn-40. dom Lobineau, kijloire de Paris, tom. I . pag.
2.24. dom Marlot, hijloire de Reims, tome II. page
76 3 • & enfin les mémoires de du T illo t , pourfervir à
l'hijloire de la fête des fous, imprimés à Laujanne en
tySt y in - i l. Article de M. le Chevalier DE J A U -
C O U R T .
F ê t e d e s In n o c e n s : cette fête étoit comme une
tranche de l’ancienne fête des fous, & on la celé—
broit le jour des Innocens. Elle n’a pas difparu fitôt
que la première; puifque Naudé, dans fa plainte à
Gaffendi en 1645, témoigne qu’elle fubfiftoit encore
alors dans quelques monafteres de Provence. Cet
auteur raconte qu’à Antibes, dans le couvent des
Francifcains, les religieux prêtres ni le gardien n’al-
loient point au choeur le jour des Innocens, & que
les freres lais qui vont à la quête, ou qui travaillent
au jardin & à la cuiiine, occupoient leurs places dans
l’églife, & faifoient une maniéré d’office avec des
extravagances & des profanations horribles. Ils fe
revêtoient d’ornemens fàcerdotaux, mais tous déchirés,
s’ils en trouvoient, & tournés à l’envers. Ils
tenoient des livres à rebouçs, oit ils faifoient fem-
blant de lire avec des lunettes qui avoient de l’écorce
d’orange pour verre. Ils ne enantoient ni hymnes,
ni pfeaumes, ni meffes à l’ordinaire ; mais tantôt ils
marmotoient certains mots confus, & tantôt ils pouf-
foient des cris avec des contorfions qui faifoient
horreur aux perfonnes fenfées. Thiers, traité des
jeux. Voyt{ FÊTE DES FOUS.
On a confervé dans quelques cathédrales & collégiales,
l’ufage de faire officier ce jour-là les enfans-
de-choeur, c’eft- à-dire de leur faire porter chape à i
la meffe & à vêpres, & de leur donner place dans
les hautes ftalles, pour honorer la mémoire des en-
fans égorgés par l’ordre d’Hérode. C ’eft une pratique
pieufe qui n’étant accompagnée d’aucune indécence
, ne fe relient en rien de la mafearade contre
laquelle Naudé s’eft élevé li juftement, & encore
moins de l’ancienne fête des fous. (G )
F ê t e s , ( Jurifpr.) on ne peut faire aucun exploit
les jours de fêtes & dimanche, ni rendre aucune ordonnance
de juftice, fi ce n’eft dans les cas qui requièrent
célérité. V oy. A jo u r n em e n t & E x p l o i t .
Le confeil du roi s’affemble les jours de fêtes & dimanche
comme les autres jours, attendu l’importance
des matières qui y font portées.
C ’eft au juge laïc & non à l’official, à connoî-
tre de l’inobfervation des fêtes commandées par l’é-
clife, contre ceux qui les ont tranfgreffées en travaillant
à des oeuvres ferviles un jour férié. Voye^ Fe-
Vret en fon traité de l'abus, liv. IP. ch.viij. n . g .
F ê t e s d e Pa l a i s , font certains jours fériés ou
de vacations , auxquels les tribunaux n’ouvrent
point. On peut néanmoins ces jours-là faire tous
exploits, ces jours de fêtes n’étant point chommés.
F ê t ë d e V i l l a g e : le droit de l’annoncer par un
erj public, eft un droit feigneurial. Voyeç ce qui en
a été dit ci-devant au mot C r i d e l a F ê t e . (A }
F ê t e , {Beaux- Arts.) folennité ou réjoiiiffance, &
quelquefois l’une & l’autre, établie ou par la religion
, ou par l’ufage, ou occafionnée par quelque
événement extraordinaire, qui intéreffe un é ta t , une
province, une v ille , un peuple, &ct
Ce mot a été néceffaire à toutes les nations : elles
ont toutes eu d es fêtes. On lit dans tous les hifto riens,
que les Juifs, les P ayens, les Turcs, les Chinois ont
eu leurs folennités & leurs réjoiiiffances publiques.
Les uns dérivent ce mot de l’hébreu ITIWN, qui figni-
f e f i i i de Dieu : les autres penfent qu’il vient du mot
latin feriari : quelques favans ont écrit qu’il tiroit
fon origine du grec tç-la, qui veut dire foyer, &c.
Toutes ces étymologies paroiffent inutiles : elles
! indiquent feulement l ’antiquité de la chofe que notre
mot fête nous défigne.
Nous pafferons rapidement fur les fêtes de folen-
nité & de réjoiiiffance des Juifs, des Payens, & de
l’Eglife. Il y en a qui furent établies par les lois
politiques, telles que celles qu’on célébroit en G rèce.
Celles des Juifs émanoient toutes de la loi de
Moyfe ; & les réjoiiiffances ou folennités des Romains
, tenoient également à la religion & à la p o - .
litique.
On les connoîtra fucceffivement dans l’Encyclopédie
, fi on veut bien les chercher à leurs articles.
Voyé[ B a c c h a n a l e s , S a t u r n a l e s , T a b e r n a c
l e s , &c. & les articles précêdens.
Il ne fera point queftion non plus des fêtes de notre
fainte religion, dont les plus confidérables font
ou feront auffi détaillées fous les mots qui les dé-
fignent. On 1e borne ici à faire connoître quelques-
unes de ces magnifiques réjoiiiffances qui ont honoré
en différens tems les états, les princes, les particuliers
même, à qui les Arts ont fervi à manifeftef
leur goût, leur richeffe, & leur génie.
Les bornes qui me font preferites m’empêcheront
auffi de parler des fêtes des fiecles trop reculés: les
triomphes d’Alexandre , les entrées des conquérans ,
les fuperbes retours des vainqueurs romains dans la
capitale du monde, font répandus dans toutes nos
anciennes hiftofres. Je ne m’attache ici qu’à raffem-
bler quelques détails, qui forment un tableau hifto-
rique des reflources ingénieufès de nos Arts dans les
occafions éclatantes. Les exemples frappent l’imagination
& l’échauffent. On peint les aftions des grands
hommes aux jeunes héros, pour les animer à les égaler
; il faut de même retracer aux jeunes efprits, qu’un
penchant v if entraîne vers les Arts, les effets fur-
prenans dont ils ont avant nous été capables : à cette
vue , on les verra prendre peut-être un noble ef-
for pour fuivre ces glorieux modèles, & s’échauffer
même de l’efpoir tout-puiffant de les furpaffer quelque
jour. ^
Je,prens pour époque en ce genre des premiers jets
du genie, la fête de Bergonce de Botta, gentilhomme
de Lombardie ; il la donna dans Tortône vers l’année
1480, à Galéas duc de Milan, & à la princeffe
Ifabelle d’Arragon fa nouvelle époufe.
^ Dans un magnifique fallon entouré d’urte galerie,
oit étoient diftribués plufieurs joüeurs de divers inf-
trumens, on avoit dreffé une table tout-à-fait vuide.
Au moment que le duc & la ducheffe parurent, oii
vit Jafon & les argonautes s’avancer fierement fur
une fymphonie guerriere ; ils portaient la fameufe
toifon-d’o r , dont ils couvrirent la table après avoir
danfé une entrée noble, qui exprimoit leur admiration
à la vûe d’une princeffe fi belle, & d’un prince fi
digne de la pofféder.
■ Çette troupe céda la place à Mercure. II chanta un
récit, dans lequel il racontait l'adreffe dont il venoit
de fe fervir pour ravir à Apollon qui gardoit lès troupeaux
d’Admette, un veau gras dont il faifoit hommage
aux nouveaux mariés. Pendant qu’il le mit
fur la table, trois quadrilles qui le fuivoient exécutèrent
une entrée.
Diane & fes nymphes fuccéderent à Mercure. La
déeffe faifoit fuivre une efpece de brancard doré,
fur lequel on voyoit un cerf : c’étoit, difoit-elle, un
Aéléon qui étoit trop heureux d’avoir ceffé de v iv re ,
puifqu’il alloit être offert à une nymphe auffi aimable
&' auffi fage qu’Ifabelle.
Dans ce moment une fymphor.ie mélodieufe attira
l’attention des convives ; elleannonçoit le chantre
de la Thrace ; on le v it joiiant de fa lyre & chantant
les louanges de la jeune ducheffe.
» Je pleurois, d it-il, fur le mont Apennin la mort
» de la tendre Euridice ; j’ai appris l’union de deux
» amans dignes de vivre l’un pour l’autre, & j’ai fenti
>t pour la première fois, depuis mon malheur, quel-
» que mouvement de joie ; mes chants ont changé
>f avec les fentimens de mon coeur ; une foule d’oi-
»> féaux a volé pour m’entendre, je les offre à la plus
»■ belle princeffe de la terre, puifque la charmante
*> Euridice n’eft plus ».
Des fons éclatans interrompirent cette mélodie ;
Atalante & Théfée conduifant avec eux une troupe
lefte & brillante, repréfenterent par des danfes vives
une chaffe à grand bruit : elle futterminée par la mort
du fanglier de Calydon, qu’ils offrirent au jeune duc
en exécutant des ballets de triomphe,
i Un fpeûacle magnifique fuccéda à cette entrée pit-
torefque : on v it d’un côté Iris fur un char traîné par
des paons, & fuivie de plufieîirs nymphes vêtues d’une
gafe legere, qui portoient des plats couverts de
ces fuperbes oifeaux.
La jeune Hébé parut de l’autre, portant le neftar
qu’elle verfe aux dieux ; elle étoit accompagnée des
bergers d’Arcadie chargés de toutes les efpeces de
laitages, de Vertumne & de Pomone qui fervirent
toutes les fortes de fruits.
Dans le même tems l’ombre du délicat Apicius
fortit de terre ; il venoit prêter à ce fuperbe feftin
les fineffes qu’il avoit inventées, & qui lui avoient
acquis la réputation du plus voluptueux des Romains.
Ce fpe&acle difparut, & il fe forma un grand ballet
compofé des dieux de la mer & de tous les fleuves
de Lombardie. Ils portoient les poiffons les plus exquis
, & ils les fervirent en exécutant des danfes de
différens caraCteres.
C e repas extraordinaire fut fuivi d’un fpedacle encore
plus fingulier. Orphée en fit l’ouverture ; il con-
duifoit l’hymen & une troupe d’amours : les grâces
qui les fuivoient entouroient la foi conjugale, qu’ils
préfenterent à la princeffe, & qui s’offrit à elle pour
la fervir.
Dans ce moment Sémiramis, Helene, Médée, &
Cléopâtre interrompirent le récit de la foi conjugale,
en chantant les égaremens de leurs pallions. Celle-ci
indignée qu’on osât fouiller, par des récits auffi coupables
, l’union pure des nouveaux époux, ordonna
à ces reines criminelles de difparoître. A fa vo ix, les
amours dont elle étoit accompagnée fondirent, par
une danfe vive & rapide, fur elles, les pourfuivirent
avec leurs flambeaux allumés, & mirent le feu aux
voiles de gafe dont elles étoient coiffées.
Lucrèce, Pénélope, Thomiris, Judith, Porcie &
Sulpicie, les remplacèrent en préfentant à la. jeune
princeffe les palmes de la pudeur, qu’elles avoient
méritées pendant leur vie. Leur danfe noble & mo-
defte fut adroitement coupée par Bacchus, Silene &
les Egypans, qui venoient célébrer une noce fi illustre
; & la fête fut ainfi terminée d’une maniéré auffi
gaie qu’ingénieufe.
Cet affemblage de tableaux en a£Hon, affez peu relatifs
peut-être l’un à l’autre, mais remplis cependant
de galanterie , d’imagination, & de variété, fit le
plus grand bruit en Italie, & donna dans la fuite l’idée
des carroufels réguliers, des opéras j des grands
ballets à machines, & des fêtes ingénieufes avec lesquelles
on a célébré en Europe les grands é venemens.
V?yei le traité de la danfe , liv. I. ch. ij. pag. 2 , & les
articles B a l l e t , O p é r a , S p e c t a c l e .
On apperçut dès-lors que dans les grandes circon-
ftances, la joie des princes, des peuples, des particuliers
même, pou voit être exprimée d’une façon
plus noble, que par quelques cavalcades monotones
, par de triftes fagots embrafés en cérémonie
dans les places publiques ôc devant les maifons des
particuliers ; par l’invention groffiere de tous ces
amphithéâtres de viandes entaffées dans les lieux les
plus apparens, & de ces dégoûtantes fontaines de
vin dans les coins des rues ; ou enfin par ces màfca-
rades déplaifantes qui, au bruit des fifres & des tambours
, n’apprêtent à rire qu’à l’ivreffe feule de la canaille
, & infeâent les rues d’une grande ville, dont
l’extrême propreté dans ces momens heureux, de-
vroit être une des plus agréables démonftrations de
l’allégreffe publique.
Dans les cours des rois on fentit par cet exemple
que les mariages, les viftoires, tous les évenemens
heureux ou glorieux, pouvoient donner lieu à dey
fpeûacles nouveaux, à des divertiffemens inconnus
, à des feftins magnifiques, que les plus aimables
allégories animeroient ainfi de tous les charmes des
fables anciennes ; enfin que la defeente des dieux
parmi nous embelliroit la terre, & donneroit une
efpece de vie à tous les amufemens que le génie pou-
voit inventer ; que l’art fauroit mettre en mouvement
les objets qu’on avoit regardés jufqu’alors comme
des maffes immobiles, &c qu’à force de combinai-
fons & d’efforts, il arriveroit au point de perfe&ion
dont il eft capable.
C’eft fur ce développement que les cours d’Italie
imitèrent tour - à - tour la fête de Bergonce de Bottà ;
& Catherine de Medicis en portant en France le germe
des beaux Arts qu’elle avoit vû renaître à Florence
, y porta auffi le goût de ces fêtes brillantes, qui de*
puis y fiit pouffé jufqu’à la plus fuperbe magnificence
& la plus glorieufe perfection.
On ne parlera ici que d’une feule des fêtes de cette
reine, qui avoit toûjours des deffeins, n’eut jamais
de fcrupules, & qui fut fi cruellement fe fervir du
talent dangereux de ramener tout ce qui échappoit
de fes mains, à l’accompliffement de les vûes.
Pendant fa régence, elle mena le roi à Bayonne,
où fa fille reine d’Eljpagne, vint la joindre avec le
duc d’Albe, que la regente vouloit entretenir: c’eft-
là qu’elle déploya tous les petits refforts de fa politique
v is -à -v is d’un miniltre qui en connôiffoit de
plus grands, & les reffources d’une fine galanterie
vis-à -v is d’une foule de courtifans divifés, 'qu’elle
avoit intérêt de diftraire de l’objet principal qui l’a-
voit amenée.
Les ducs de Savoie & de Lorraine, plufieurs autres
princes étrangers, étoient accourus à la cour dé
France, qui était auffi magnifique que nombreüfe.
La reine qui vouloit donner une haute idée de fon
adminiftration, donna le bal deux fois le jo u r , feftins
fur feftins yfête fur fête. Voici celle où je trouve
le plus de variété, de goût, & d’inventiom'Koytj
les mémoires de la reine de Navarre.
Dans une petite île fituée dans la riviere de Bayonne,
couverte d’un bois de hauterfutaie, la reine fit
faire douze grands berceaux qui aboutiffoient à un
fallon de forme ronde, qu’on avoit pratiqué dans ls
milieu. Une quantité immenfc de iuftres de fleurs fri