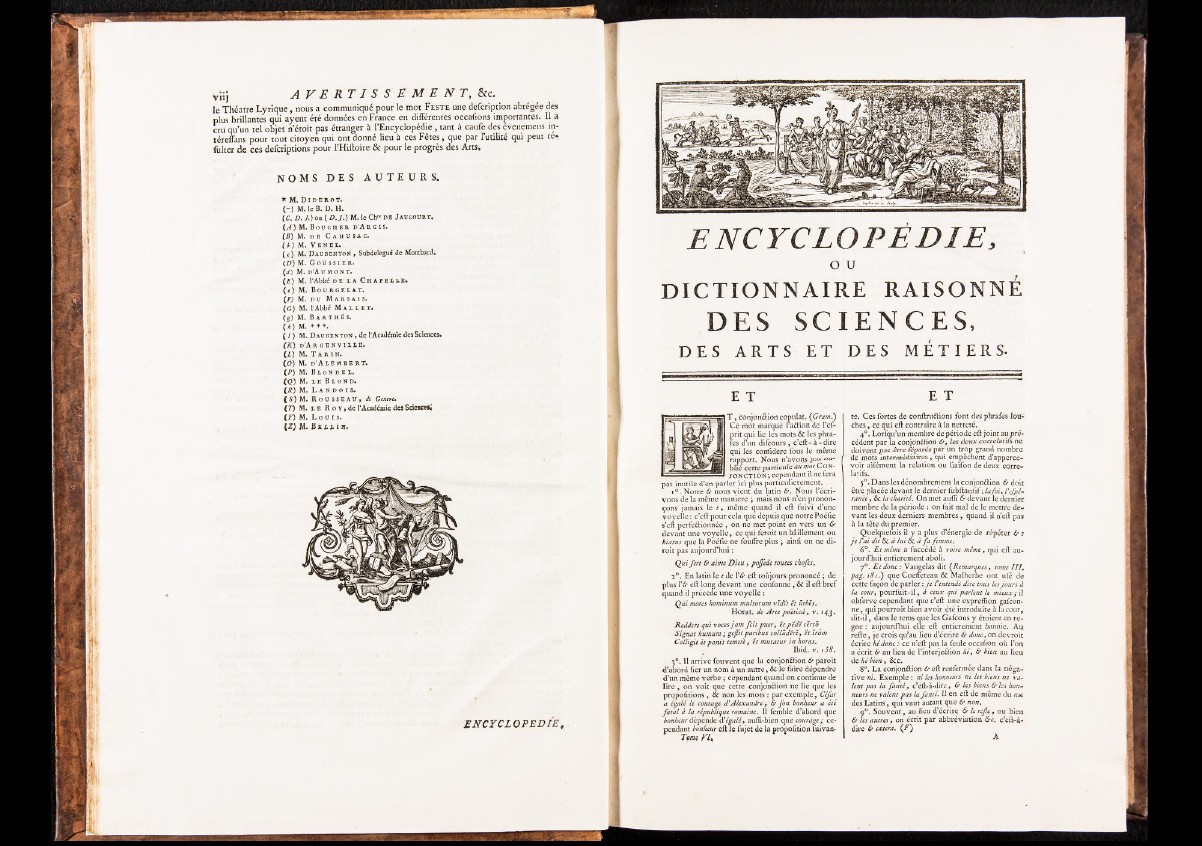
v î i j A V E R T I S S E M E N T , & c .
le Théâtre L y r iq u e , nous a communiqué pour le mot F e s t e une description abrégée des
plus brillantes qui ayent été données en France en différentes occafions importantes. 11 a
cru qu’un tel objet n’étoit pas étranger à l’Encyclopédie, tant à caufe des évenemens in-
téreffans pour tout citoyen qui ont donné lieu à ces Fêtes, que par l’utilité qui peut té*
fulter de ces defcriptions pour l’Hiftoire & pour le progrès des Arts,
n o m s d e s a u t e u r s ,
* M. D i d e r o t *
M. le B. D. H.
(C. D. A ) ou ( D.J.) M. le Ch» DE JaucoURT.
(A ) M. B o u c h e r d’A r g i s .
(5) M. d b C a h u s a c .
( b ) M. V e N e i .
( c) M. Daubenton , Subdelegué de Montbard»
(D) M. G oti ss ie r.
(id) M. d’A u m o n î .
(E) M. l’Abbé d e l a C h a p e l l e *
(«) M. Bo u r g e l a t .
(FJ M. du M a r s a i s.
(G) M. l’Abbé Ma l l e t .
(g) M. B A R T H É S.
(À) M. * * * .
( / ) M. Daube N ton , de l’Académie des Sciences»
(K) d’A r g e n VILLE.
( i ) M. T a r i n .
(O) M. d’A l e m b e r t .
(P) M. B l o n d e l .
(Q) M. l e B l o n d .
(R) M. L A N d o i s.
( 5 ) M. R o u s s e a u , de Geneve.
( r ) M. l e R o y , de l’Académie des Science#^
( Y) M. L o u i s .
(Z) M. B s L i i sr.
E N C Y C L O P E D I E
ENCYCLOPÉDIE,
O U
DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES S C IENC E S ,
DES A R T S ET DES MÉTIERS -
E T E T
T , COhjon&ion copitlat. (Gram!)
Ce mot marque i’a&ion de l’ef-
prit qui lie les mots & les phra-
les d’un difcours , c’eft-à -d ire
qui les corrfidere fous le même
rapport. Nous n’avons pas oublie
cette particule aù mot C onjo
n c t io n ; cependant il ne fera
pas inutile d’en parler ici plus particulièrement.
i ° . Notre & nous vient du latin &. Nous l’écrivons
de la même maniéré ; mais nous n’en prononçons
jamais le t , même quand il eft fuivi d’une
voyelle : c’eft pour cela que depuis que notre Poéfie
s’en perfectionnée , on ne met point en vers un 6*
devant une v o y elle, ce qui feroit un bâillement ou
hiatus que la Poélie ne foudre plus ; ainfi on ne di-
roit pas aujourd’hui :
Qui fert & aime Dieu , pojfede toutes chofes.
2°. En latin le t de ¥& eft toujours prononcé ; de
plus F# eft long devant une conforme, & il eft bref
quand il précédé une voyelle :
Qui mores hominum multorum vïdXt et ürhes.
Horat. de Arte poètied, v. 143.
Reddere qui voces jam feit puer, itpêdé certd
Signât humum; gtjlit paribus collûdêrë, et ïràm
Colligit et ponit temerï , et mutatur in horas.
Ibid. v. i58.
30. Il arrive fouvent que la conjonction & paroît
d’abord lier un nom à un autre, & le faire dépendre
d’un même verbe ; cependant quand on continue de
lire , on voit que cette conjonction ne lie que les
prqpofitions , & non les mots : par exemple, Céfar
a égalé le courage d'Alexandre , & fort bonheur a été
fatal à la république romaine. Il femble d’abord que
bonheur dépende à!égalé, aufli-bien que courage; cependant
bonheur eft le fujet de la propoûtion fuivan-
Tome y i\
te. Ces fortes de conftruCtions font des phrafes louches
, ce qui eft contraire à la netteté.
40. Lorfqu’un membre de période eft joint au précédent
par la conjonction &, les deux corrélatifs ne
doivent pas être réparés par un trop grand nombre
de mots intermediaires, qui empêchent d’apperce-
voir aifément la relation ou liaifon de deux corrélatifs.
5°.Danslesdénombremens la conjonction & doit
être placée devant le dernier fubftantif ; la foi, l'efpé-
rance, &cla charité. On met aufli &. devant le dernier
membre de la période : on fait mal de le mettre devant
les deux derniers membres, quand il n’eft pas
à la tête du premier.
Quelquefois il y a plus d’énergie de répéter & ;
je l'ai dit & à lui & à fa femme.
6°. Et même a fuccédé à voire même, qui eft aujourd’hui
entièrement aboli.
70. E t donc: Vaugelas dit (Remarques, tome I I I ,
pag. 181.) que Coeffeteau & Malherbe ont ufé de
cette façon de parler : je P entends dire tous les jours à
la cour, pourfuit-il, à ceux qui parlent le mieux; il
obferve cependant que c’eft une expreflion gafeon-
ne, qui pourrait bien avoir été introduite à la cour,
dit-il, dans le tems que les Gafcons y étoient en régné
: aujourd’hui elle eft entièrement bannie. Au
refte, je crois qu’au lieu d’écrire & donc, on devrait
écrire hé donc : ce n’eft pas la feule occafion oii l’on
a écrit & au lieu de l’interjeftion hé, & bien au lieu
de hé bien, &c.
8°. La conjondion & eft renfermée dans la négative
ni. Exemple : ni les honneurs ni les biens ne valent
pas la fanté, c’eft-à-dire, & les biens & les honneurs
ne valent pas la fanté. Il en eft de même du nec
des Latins, qui vaut autant que & non.
o°. Souvent, au lieu d’écrire & le refie, ou bien
& les autres , on écrit par abbréviation &c. c’eft-à-
dire & ceetera. (F )
A