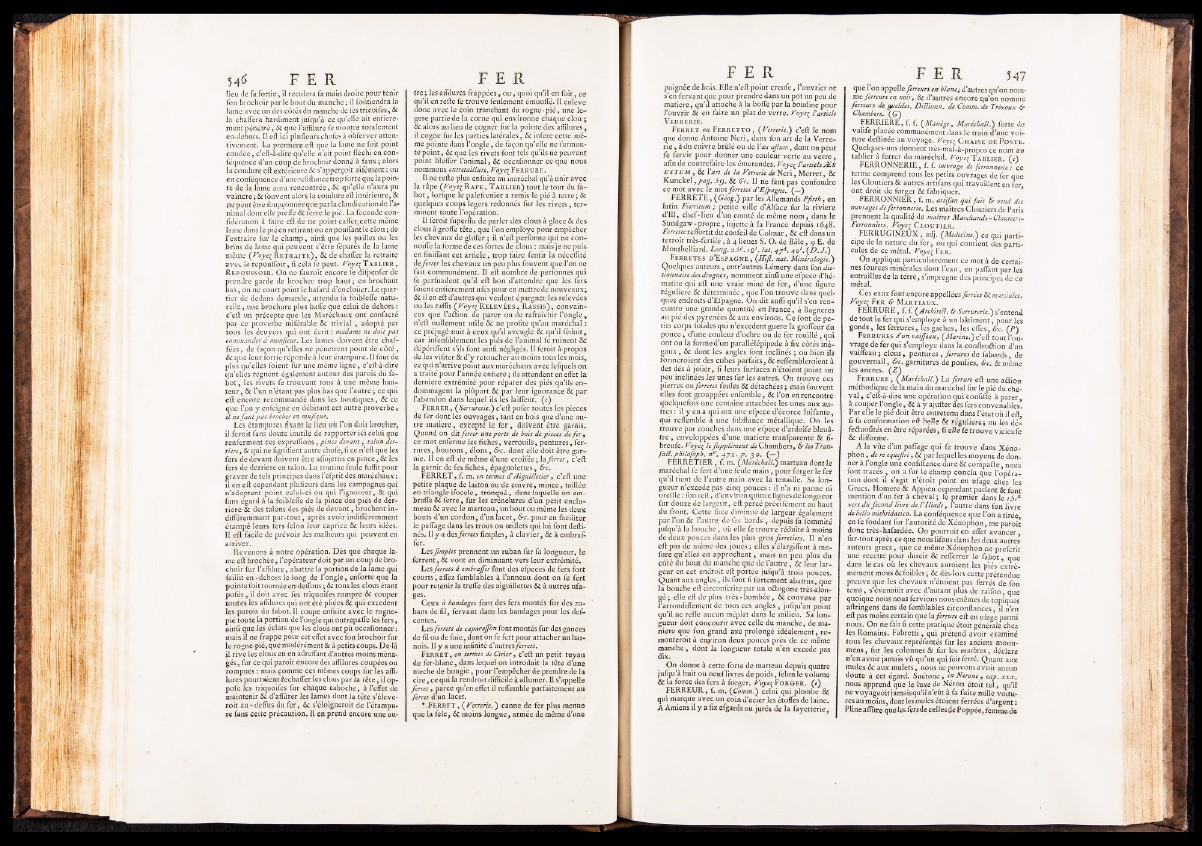
lieu de fa fôrtie, il reculera fa main droite pour tenir
fon brochoir par le bout du manche ; il l'oûtiendra la
lame avec un des côtés du manche de fes tricoifes, &
la chaflera hardiment jufqu’à ce qu’elle ait entièrement
pénétré, 6c que l’affilure fe montre totalement
en-dehors» Il efl ici plufieurs chofes à obferver-attentivement.
La première eft que la lame ne foit point
coudée, c’eft-à-dire qu’elle n’ait point fléchi en con-
féquence d’un coup debrochoir donné à faux; alors
la coudure eft extérieure 6c s’apperçoit aifémentc ou
en conféquence d’une reliftance trop forte que la pointe
de la lame aura rencontrée, 6c qu’elle n’aura pu
vaincre ; & fou vent alors la coudure eft intérieure, &
ne peut être foupçonnéeque parla claudication de l’animal
dont elle preffe -6c ferre le pié. La fécondé confédération
à faire eft de ne point caffer^cette même
lame dans lepiéen retirant ou en pouffant le clou ; de
l’extraire fur le champ, ainfi que les pailles ou les
brins de lame qui peuvent s’être féparés de la lame
même (Voye{ Retra ite) , 6c de chaffer la retraite
avec le repouffoir, fi cela fe peut, Voye^ T ablier ,
R epoussoir. On ne fauroit encore fe difpenferde
prendre garde de brocher trop haut ; en brochant
bas, on ne court point le hafard d’encloiier. Le quartier
de dedans demande, attendu fa foibleffe naturelle
, une brochure plus baffe que celui de dehors :
c’eft un précepte que les Maréchaux ont confacré
par ce proverbe miférable & trivial , adopté par
tous les écuyers qui ont écrit : madame ne doit pas
commander à monfîeur. Les lames doivent être chaf-
fées, de façon qu’elles ne pénètrent point de cô té ,
& que leur l'ortie réponde à leur étampure. Il faut de
plus qu’elles foient fur une même ligne, c’eft-à-dire
qu’elles régnent également autour des parois du fa-
bot , les rivets fe trouvant tous à une même hauteur,
& l’un n’étant pas plus bas que l’autre ; ce qui
eft encore recommandé dans les boutiques, 6c ce
que l’pn y enfeigne en débitant cet autre proverbe ,
U ne faut pas brocher en mufique.
Les étampures fixant le lieu oh l’on doit brocher,
il feroit fans doute inutile de rapporter ici celui que
renferment ces exprefîions, pince devant, talon derrière,
& qui ne fignifient autre chofe, fi ce n’eft que les
fers de devant doivent être affujettis en pince, 6c les
fers de derrière en talon. La routine feule fuflit pour
graver de tels principes dans l’efprit des maréchaux :
il en eft cependant plufieurs dans les campagnes qui
n’adoptent point celui-ci ou qui l’ignorent, & qui
fans égard à la foibleffe de la pince des piés de derrière
& des talons des piés de devant, brochent indifféremment
par-tout, après avoir indifféremment
étampé leurs fers félon leur caprice 6c leurs idées.
Il eft facile de prévoir les malheurs qui peuvent en
arriver.
Revenons à notre opération. Dès que chaque lame
eft brochée, l’opérateur doit par un coup de brochoir
fur l’affilure, abattre la portion de la lame qui
faillit en - dehors le long de l’ongle, enforte que la
pointefoit tournée en-deffous ; 6c tous les clous étant
pqfés, il doit avec fes triquoifes rompre 6c couper
toutes les affilures qui ont été. pliées 6c qui excédent
les parois du fabot. Il coupe enfuite avec le rogne-
pié toute la portion de l’ongle qui outrepaffe les fers,
ainfi que: les éclats que les clous ont pu occafionner :
mais.il ne frappe pour cet effet avec fon brochoir fur
ie rogne-pié, que modérément & à petits coups. De-là
il rive les clous en en adreffant d’autres moins ménagés
, fur ce qui paroît encore des affilures coupées ou
rompues : mais .çomme cçs mêmes coups fur les affilures
pourraient îechaffer les clous par la tête, il op-
pofe les triquoifes fur chaque caboche, à l’effet de
maintenir 6c d’aflûrer les lames dont la tête s’éleve-
roit au-deffus du fer, 6c s’éloigneroit de l’étampu-
re fans cette précaution. Il en prend encore une autre
; les affilures frap pé es , o u , quoi qu’il en fo it , ce
qu’il en refte fe trou v e feulement émouffé. Il enleve
donc a v e c le coin tranchant du ro gn e -p ié , une légère
partie de la corne qui environne chaque clou ;
6 c alors au lieu de cogner fur la pointe des affilures,
il cogne fur les parties laté rales , 6 c infère cette même
pointe dans l’o n g le , de façon qu’elle ne furmon-
te p o in t, 6 c que les rivets font tels qu’ils ne peuvent
point bleffer l’an ima l, & occafionner ce que nous
nommons e n t r e ta illu r e . V o y e £ F e r r u r e .
Il ne refte plus enfuite au maréchal qu’à uftir avec
la râpe (V o y e ^ R â p e , T a b l ie r ) tout le tour du fabot
, lorfque le palefrenier a remis le pié à terre ; &
quelques coups levers redonnés fur les rivets, terminent
toute l’operation.
Il feroit fupernu de parler des clous à glace & des
clous à greffe tête, que l’on employé pour empêcher
les chevaux de gliffer ; il n’eft perfonne qui ne con*-
noiffe la forme de ces fortes de clous : mais je ne puis
en finiffant cet article, trop faire fentir la néceffité
de fe r r e r les chevaux un peu plus fouvent que l’on ne
fait communément. Il eft nombre de perlonnes qui
fe perfuadent qu’il eft bon d’attendre que les fers
foient entièrement ufés pour en mettre de nouveaux;
6c il en eft d’autres qui veulent épargner les relevées
ou les raffis ( V o y e { R e l e v é e s , R a s s is ) , convaincus
que l’aftion de parer ou de rafraîchir l’ongle ,
n’eft nullement utile 6c ne profite qu’au maréchal :
ce préjugé nuit à ceux qu’il aveugle 6c qu’il féduit,
car infenfiblement les piés de l’animal fe ruinent 6 c
dépériffent s’ils font ainfi négligés. Il feroit à-propos
de les vifiter & d’y retoucher au moins tous les mois,
ce qui n’arrive point aux maréchaux avec lefquels on
a traité pour l’année entière ; ils attendent en effet la
derniere extrémité pour réparer des piés qu’ils endommagent
la plûpart 6c par leur ignorance 6c par
l’abandon dans lequel ils les laiffent. («)
F e r r e r , ( S e r ru r e r ie .) c’eft pofer toutes les pièces
de fer dont les ouvrages, tant en bois que d’une autre
matière, excepté le f e r , doivent être garnis*
Quand on dit f e r r e r u n e p o r t e d e b o is d e p iè c e s d e f e r ,
ce mot enferme les fiches, verrouils, pentures, ferrures
, boutons, élons, & c . dont elle doit être garnie.
Il en eft de même d’une croifée ; la f e r r e r , c ’eft
la garnir de fes fiches, épagnolettes, & c .
FERRET, f. m. e n te rm e s d 'A i g u i l l e t i e r , c’eft une
petite plaque de laiton ou de cuivre, mince, taillée
en triangle ifocele, tronqué, dans laquelle on em-
braffe 6 c ferre, fur les crénelures d’un petit enclu-
meau 6 c avec le marteau, un bout ou même les deux
bouts d’un cordon, d’un lacet, & c . pour en faciliter
le paffage dans les trous ou oeillets qui lui font defti-
nés. Il y a des fe r r e t s fimples, à clavier, 6 c à embraf-
fer.
Les f im p le s prennent un ruban fur fa longueur, le
ferrent, 6 c vont en diminuant vers leur extrémité.
Les f e r r e t s à em b ra ffer font des efpeces de fers fort
courts, affez femblables à l’anneau dont on fe fert
pour retenir la treffe des aiguillettes 6 c à autres ufa-
ges.C
eux à b a n d a g e s font des fers montés fur des rubans
de fil, fervant dans les bandages pour les défi*
centes.
Les f e r r e t s d e ca p a ra ffo n font montés fur des gances
de fil ou de foie, dont on fe fert pour attacher un har-
nois. Il y a une infinité à* n u i t e s f e r r e t s .
Fe r r e t , e n te rm e s d e C i r i e r , c’eft un petit tuyau
de fer-blanc, dans lequel on introduit la tête d’une
meche de bougie, pour l’empêcher de prendre de la
cire, ce qui la rendroit difficile à allumer. Il s’appelle
f e r r e t , parce qu’en effet il reffemble parfaitement au
f e r r e t d’un lacet.
* JFe r r e t , ( V e r r e r ie . ) canne de fer plus menue
que la fele, 6 c moins longue, armée de même d’une
poignée dè bois. Elle n’eft point creufe, l’ouvrier nê
s’en fervant que pour prendre dans un pot un peu de
matière, qu’il attache à la boffe par la boudiné pour
l’ouvrir & en faire un plat de verre. Voye^ l'article
V errerie.
Ferret ou Fe r r e t t o , ( Verrerie,) c’eft le nom
que donne Antoine Neri, dans fon art de la Verrerie
, à du cuivre brûlé ou de Vas ujlum, dont on peut
fe fervir pour donner une couleur verte au verre,
afin de contrefaire les émeraudes. Voye{ F article Æ s
VSTUM, 6c Vart de la Verrerie de Neri, Merret, 6c
Kunckel, pag. 5 g . 6c (T/. Il ne faut pas confondre
ce mot avec le mot ferretes d'Efpagne. (—)
FERRETE, ( Gèog.) par les Allemands Pfirth, en
latin Fierritum ; petite ville d’AIface fur la riviere
d’Ill, chef- lieu d’un comté de même nom, dans le
Sundgaw-propre, fujette à la France depuis 1648.
Ferrettereffortitdu confeil de Colmar, 6c eft dans un
terroir très-fertile, à 4 lieues S. O. de Bâle, 9 E. de
Montbelliard. Long. z 5d. 10'. lat. 47*. 40'. (' D .J .)
Ferretes d’Espagne , (Hifl. nat. Minéralogie.)
Quelques auteurs, entr’autres Lémery dans fon dictionnaire
des drogues, nomment ainfi une efpece d’hématite
qui eft une vraie mine de fer, d’une figure
régulière 6c déterminée, que l’on trouve dans quelques
endroits d’Efpagne. On dit auffi qu’il s’en rencontre
une grande quantité en France, à Bagneres
au pié des pyrenées 6c aux environs. Ce font de petits
corps folides qui n’excedent guere la groffeur du
pouce, d’une couleur d’ochre ou de fer rouillé, qui
ont ou la forme d’un parallélépipède à fix côtés inégaux
, 6c dont les angles font inclinés ; ou bien ils
formeroient des cubes parfaits, 6c reffembleroient à
des dés à joiier, fi leurs furfaces n’étoient point un
peu inclinées les unes fur les autres. On trouve ces
pierres ou ferretes feules 6c détachées ; mais fouvent
elles font grouppées enfemble, 6c l’on en rencontre
quelquefois une centaine attachées les unes aux autres
: il y en a qui ont une efpece d’écorce luifante,
qui reffemble a une fubftance métallique. On les
trouve par couches dans une efpece d’ardoife bleuâtre
, enveloppées d’une matière tranlparente & fi-
breufe. Vyye^ le fupplément de Chambers, & les Tran-
Jacl. philofoph. n°. 472. p. J o. (—)
FERRET1ER , f. m. (Maréchall.) marteau dont le
maréchal fe fert d’une feule main, pour forger le fer
qu’il tient de l’autre main avec la tenaille. Sa longueur
n’excede pas cinq pouces : il n’a ni panne ni
oreille : fon oe il, d’environ quinze lignes de longueur
fur douze de largeur, eft percé précifément au haut
du front. Cette face diminue de largeur également
par l’un & l’autre de fes bords , depuis fa fommité
jufqu’à la bouche, où elle fe trouve réduite à moins
de deux pouces dans les plus gros ferretiers. Il n’en
eft pas de même des joues ; elles s’élargiffent à me-
fure qu’elles en approchent, mais un peu plus du
côté du bout du manche que de l’autre, 6c leur largeur
en cet endroit eft portée jufqu’à trois pouces.
Quant aux angles, ils font fi fortement abattus, que
la bouche eft circonfcrite par un oâogone très-alon-
gé ; elle eft de plus très - bombée, 6c convexe par
l’arrondiffement de tous ces angles , jufqu’au point
qu’il ne refte aucun méplat dans le milieu. Sa longueur
doit concourir avec celle du manche, de manière
que fon grand axe prolongé idéalement, re-
monteroit à environ deux pouces près de ce même
manche, dont la longueur totale n’en excede pas
dix.
On donne à cette forte de marteau depuis quatre
jufqu’à huit ou neuf livres de poids, félon le volume
6c la force des fers à forger. Voye[ Fo rg er. (e)
FERREUR, f. m. (Comm.) celui qui plombe 6c
qui marque avec un coin d’acier les étoffes de laine.
A Amiens il y a fix efgards ou jurés de la fayetterie,
que 1 on appelle/erreurs en blanc; d’autres qu’on nomme
f erreurs en noir, 6c d’autres encore qu’on nomme
ferreurs de gueldes. Diclionn. de Comm. de Trévoux &
Chambers. (G)
FERRIERE, f. f. ( Manège , Maréchall.) forte de
valife placée communément dans le train d’une v o iture
deftinée au voyage. Voye^ C haise de Po st e.
Quelques-uns donnent très-mal-à-propos ce nom au
tablier à ferrer du maréchal. Voye7 T a blier, (e)
FERRONNERIE, f. f. ouvrage de ferronnerie : ce
terme comprend tous les petits ouvrages de fer que
les Cloütiérs & autres artifans qui travaillent en fer
ont droit de forger 6c fabriquer.
FERRONNIER, f. m. artifan qui fait & vend des
ouvrages de ferronnerie. Les maîtres Cloutiers de Paris
prennent la qualité de maîtres Marchands -Cloutiers-
Ferronniers. Voye{ CLOUTIER.
FERRUGINEUX, adj. (Medecine.) ce qui participe
de la nature du fe r , ou qui contient des particules
de ce métal. Voye{ Fe r .
O n applique particulièrement Ce mot à de Certaines
fources minérales dont l’e a u , en paffant par les
entrailles de la te rre , s’imprégne des principes de ce
métal.
Ces eaux font encore appeliées ferrées 6c martiales*
Voye[ Fer & M a r t ia u x .
FERRURE, f. f. ( Architecl. & Serrurerie.) s’entend
de tout le fer qui s’employe à un bâtiment, pour les
gonds, les ferrures, les gâches, les effes, &c. (P)
FERRURES d'un vaijfeau, (Marine.) c’eft tout l'ouvrage
de fer qui s’employe dans la conftruétion d’un
vaiffeau ; clous, pentures , ferrures de fabords de
gouvernail, &c. garnitures de poulies, &c. &même
les ancres. (Z )
Fe r r u r e , ( Maréchall.) La ferrure eft une a&ion
méthodique de la main du maréchal fur le pié du chev
al , c’eft-à-dire une opération qui "confifte à parer ,
à couper l’ongle, & à y ajufter des fers convenables.
Par elle le pié doit être entretenu dans l’état où il eft,
fi fa conformation eft belle & régulière; ou les dé-
fe&uofités en être réparées, fi elle fe‘trouve vicieufe
6c difforme.
A la vue d’un paffage qui fe trouve dans Xéno-
phon, de re equejlri, 6c par lequel les moyens de donner
à l’ongle une confiftence dure & compa&e, nous
font tracés , on a fur le champ conclu que l’opération
dont il s’agit n’étoit point en ufage chez les
Grecs. Homere & Appien cependant parlent & font
mention d’un fer à cheval ; le premier dans le /5/e
vers du fécond livre de l'Iliade, l’autre dans fon livre
de bello mithridatico. La conféquence que l ’on a tirée
en fe fondant fur l’autorité de Xénophon, me paroît
donc très-hafardée. On pourroit en effet avancer
fur-tout après ce que nous lifons dans les deux autres
auteurs grecs, que ce même Xénophon ne preferit
une recette pour durcir 6c refferrer le fabot, que
dans le cas où les chevaux auroient les piés extrêmement
mous &foibles ; 6c dès-lors cette prétendue
preuve que les chevaux n’étoient pas ferrés de fon
tems, s’évanoiiit avec d’autant plus de raifon, que
quoique nous nous fervions nous-mêmes de topiques
aftringens dans de femblables circonftances il n’en
eft pas moins certain que la ferrure eft en ufage parmi
nous. On ne fait fi cette pratique étoit générale chez
les Romains. Fabretti, qui prétend avoir examiné
tous les chevaux repréfentés fur les anciens monu-
mens, fur les colonnes & fur les marbres, déclare
n’en avoir jamais vu qu’un qui foit ferré. Quant aux
mules 6c aux mulets, nous ne pouvons avoir aucun
doute à cet égard. Suétone, in Nerone , cap. xxx.
nous apprend que le luxe de Néron étoit t e l, qu’il
ne voyageoit jamais qu’il n’eût à fa fuite mille voitures
aü moins, dont les mules étoient ferrées d’argent :
Pline affûre que les fersde celles de Poppée, femme de