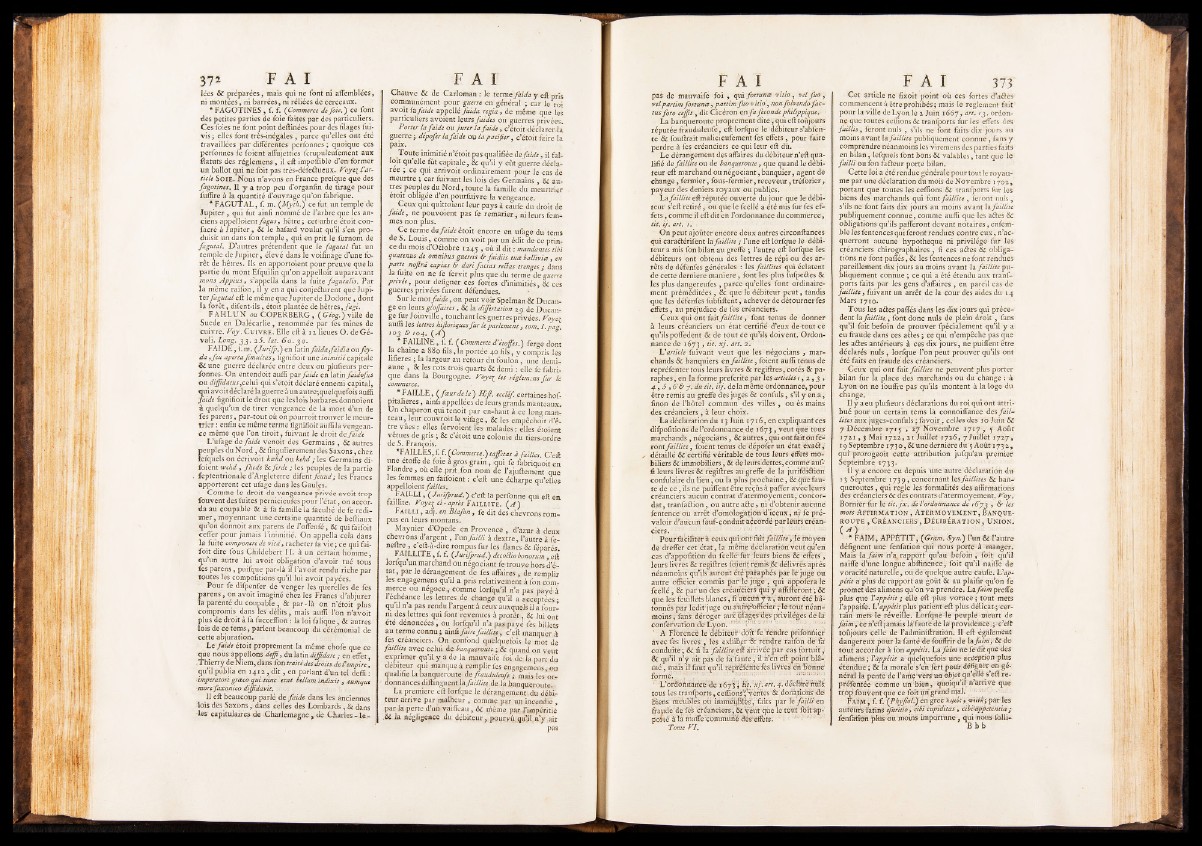
3 7* F A I
lées & préparées, mais qui ne font ni aflemblées,
ni montées, ni barrées, ni réliées de cerceaux.
* FAGOTINES , f. f. ( C om m e r c e d e f o i e . ' ) ce font
des petites parties de foie faites par des particuliers.
Ces foies ne font point deftinées pour des filages fui-
vis ; elles font très-inégales , parce qu’elles ont été
travaillées par différentes perfonnes ; quoique ces
perfonnes fe foient affujetties fcrupuleufement aux
ftatuts des réglemens , il eft impoffible d’en former
un ballot qui ne foit pas très-défeflueux. V o y e ^ l 'a r t
i c l e So i e . Nous n’avons en France prefque que des
f a g o t in e s . Il y a trop peu d’organfin de tirage pour
fuffire à la quantité d’ouvrage qu’on fabrique.
* FAGUTAL, f. m. (Myth.) ce fut un temple de
Jupiter , qui fut ainfi nommé de l’arbre que les anciens
appelaientfagus, hêtre; cet*arbre étoit con-
facré à Jupiter, & le hafard voulut qu’il s’en produisît
un dans fon temple, qui en prit le furnom de
fagutal. D’autres prétendent que le fagutal fut un
temple de Jupiter, élevé dans le voifinage d’une forêt
de hêtres. Ils en apportoient pour preuve que la
partie du mont Efquilin qu’on appelloit auparavant
pions Appius, s’appella dans la fuite fagutalis. Par
la même raifon, il y en a qui conjeflurent que Jupiter
fagutal eft le même que Jupiter de Dodone, dont
la forêt, difent-ils, étoit plantée de hêtres,^^'.
FAHLUN ou COPERBERG, ( Géog.) ville de
Suede en Dalécarlie, renommée par fes mines de
cuivre. Voy. C u iv r e . Elle eft à 12 lieues O. de Gé-
vali. Long. 3 3 . x5. lat. 6 0 .30 .
FAIDE, f. m. (Jurifp.) en latin faida yfaidia ou fey-
da , feu aperta Jimultas, fignifioit une inimitié capitale
& une guerre déclarée entre deux ou plufieurs perfonnes.
On entendoit aufli par faide en latin faidofus
ou dijfidatus,celui qui s’étoit déclaré ennemi capital,
qui avoit déclaré la guerre à un autre quelquefois aufli
faide fignifîoit le droit que les lois barbares donnoient
à quelqu’un de tirer vengeance de la mort d’un de
fes parens, par-tout où on pourrait trouver le meurtrier
: enfin ce même terme fignifioit aufli la vengeance
même que l’on tirait, fuivant le droit de faide
L ’ufage de faide venoit des Germains , & autres
peuples du Nord, & fingulieremertt des Saxons, chez
îefquels on écrivoit kcehd ou kehd ; les Germains di-
foient wehd, fhede & ferde ; les peuples de la partie
feptentrionale d’Angleterre difent feuud; les Francs
apportèrent cet ufage dans les Gaules.
Comme le droit de vengeance privée avoit trop
fouvent des fuites pernicieufes pour l’état, on accor-
da au coupable & à fa famille la faculté de fe redi-
mer, moyennant une certaine quantité de beftiaux
qu’on donnoit aux parens de l’offenfé, & qui faifoit
cefler pour jamais l’inimitié. On appella cela dans
la fuite compontre de vitâ, racheter la vie ; ce qui faifoit
dire fous Childebert II. à un certain homme,
qu’un autre lui avoit obligation d’avoir tué tous
fes parens, puifque par-là il l’avoit rendu riche par
toutes lès compofitions qu’il lui avoit payées.
- Pour fe difpenfer de venger les querelles de fes
parens, on avoit imaginé chez les Francs d’abjurer
la parente du coupable , & par-là- on n’étoit plus
compromis dans les délits, mais aufli l’on n’avoit
plus de droit à fa fucceffiori : la loi falique, & autres
lois de ce tems, parlent beaucoup du cérémonial de
-cette abjuration.
Le faide étoit proprement la même chofe que ce
que nous appelions deff, du latin dijfidare ; en effet
.Thierry de Niem, dans fon traité des droits, de P empire,
qu’il publia en 14 12 , d i t , en parlant d’un tel deffi : ;
imperatori greeco quitùnc erat bellum indixit, .eumque !
■ morefaxonico diffidavit.
Il eft beaucoup parlé de faide dans les anciennes :
lois des Saxons ; dans .celles des Lombards, & dans :
les capitulaires de Charlemagne , de Charles - le.-
F A I Chauve & de Garloman : le terme faida y eft pris
communément pour guerre en général ; car le roi
avoit (a faide appellé faida regia , de même que les
particuliers avoient leurs faides ou guerres privées;
P or ter la faide ou jurer la faide, c’étoit déclarer, la
guerre ; dépofer la faide ou la pacifier , c’étoit faire la
paix.
Toute inimitié n’étoit pas qualifiée de faide, il fat-
loir qu elle fut capitale, & qu’il y eût guerre déclarée
; ce qui arrivoit ordinairement pour le cas de
meurtre ; car fuivant les lois des Germains , & aiu-
très peuples du Nord, toute la famille du meurtrier
etoit obligée d’en pourfuivre la vengeance.
Ceux qui quittaient leur pays à caufe du droit de
faide, ne pouvoient pas fe remarier, ni leurs femmes
non plus.
Ce terme de faide étoit encore en ufage du tems
de S. Louis, comme on voit par un édit de ce prince
du mois d Octobre 1 14 5 , ü dit : mandantes tibi
quatenus de omnibus guerris & faidiis tuce ballivioe , ex
parte nofira copias & dari fadas reclas trenges ; dans
la fuite on ne fe fervit plus que du terme de guerre
privée, pour defigner ces fortes d’inimitiés, & ces
guerres privées furent défendues.
Sur le mot faide, on peut voir Spelman & Ducan-
ge en leurs gloffaires, & la dijfertation 2 ^ de Ducan-
ge fur Joinville, touchant les guerres privées. Voyez
aufli les lettres hifioriquesfur le parlement, tom. I.pa*.
10 3 & 10 4 . ( A j
* FAILINE, f. f. ( Commerce d'étoffes.) ferge dont
la chaîne a 880 fils ,1a portée 40 fils, v compris les
lifieres ; la largeur au retour du foulon, une demi-
aune , & les rots trois quarts & demi : elle fe fabrique
dans la Bourgogne. Voye^ les réglemens fur le
commerce.
‘ FAILLE, ( fou r de le ) Hj.fi. eêc&/..certaineshof,
pitalieres, ainfi app.elle.es de leurs grands manteaux.
Un chaperon qui tenoit par en-haut-à.eei long manteau,
lexircbiivroit le. yifage, & les.empêchoit d’être
Viles : elles fervoient les malades : elles étoient
vêtues de gris ; & c’étoit une doiônte du tiers-ordre
de S. François.
‘ FAILLES, f. f. (Commerce.) taffetas i failles. C ’eft
une étoffe de foie à gros grain, qui fe fabriquoit en
Flandre, oiielle.prit.fon nom de l’ajuflement que.
les femmes en faifoient : c’eft une écharpe qu’elles
appelloient failles.
FAILLI, ( Jurffprud. ) c’eft la perfonne qui eft en
faillite. Voye^ ci-apres F a i l l i t e . (A )
F a i l l i , a d j . en Blafin, f e d i t d e s c h e v r o n s r o m .
p u s e n l e u r s m o n t a n s .
Maynier d’Opede en Provence , d’azur à deux
chevrons d’argent, l’un failli à dextre, l’autre à fe-
neftre , c’eft-à-dire rompus fur les flancs & féparés.
FAILLITE, f. f. ( ƒ urifprud. ) decoclio bonorum, eft
lorfqu un marchand ou négociant fe trouve hors d’état,
par le dérangement de fes affaires , de remplir
les engagemens qu’il a pris relativement à fon commerce
ou négoce, comme lorfqu’il n’a pas payé à
l’échéance les lettres de change qu’il a acceptées.;
qu’il n’a pas rendu l’argent à ceux auxquels il a fourni
des lettres qui font revenues à protêt, & lui ont
été dénoncées ou lorfqu’il n’a pas;,payé fes billets
au terme connu ; ainfi faire faillite, c’eft manquer à
fes créanciers. On confond quelquefois le mot de
faillite avec celui de banqueroute ; & quand on veut
exprimer qu’il y a de la mauvaife foi de? la part du
débiteur qui manque à remplir fes engagemens on
qualifie la banqueroute de frauduleufi mais.lestar-r
donnances diftinguent la faillite,.de la banqueroute.
La première eft lorfque le dérangement’, du débiteur
arrive par.malheur , comme,par unincendie,
par la perte d’un vaiffeau, & même, par-i’impéritiê
.& la négligence du débiteur ,.p9uryûlqu’jl. n’y taif
pas
F A I pas de mauvaife foi , qui fortunée vitio, vél fu ô ,
velpartim fortunæ , partim fuo vitio', non folvendofa'o-
tus foro ceffit, dit Cicéron en fa fécondé philippique.
La banqueroute proprement dite/qui eft toujours
réputée frauduleufe, eft lorfque le débiteur s’abfen-
te & fouftrait malicieufement fes effets, pour faire
perdre à fes créanciers ce qui leur eft du.
Le dérangement des affaires du débiteur n’eft-qua-
lifié de faillite ou de banqueroute, que quand le débiteur
eft marchand ou négociant, banquier, agent de
change, fermier, fous-fermier, receveur, tréforier ,
payeur des deniers royaux ou publics.
La faillite eft réputée ouverte du jour que le débiteur
s’eft retiré, ou que le fcéllé a été mis fur fes effets
, comme il eft dit en l’ordonnance du commerce,
tit. ij. art. i . .
On peut ajouter encore deux autres circonftances
qui cara&érifent \afaillite ; l’une eft lorfque le débiteur
a mis fon bilan au greffe ; l’autre eft lorfque les
débiteurs ont obtenu des lettres de répi ou des arrêts
de défenfes générales : lés faillites qui éclatent
de cette derniere maniéré, font lés plus fufpeôes &
les plus dangereufes , parce qu’elles font ordinairement
préméditées , & que le débiteur peut, tandis
que les défenfes fübfiftent, achever de détourner fes
effets, au préjudice de fes: créanciers.
Ceux qui ont fait faillite, font tenus de donner
à leurs créanciers un état certifié d’eux de-tout ce
qu’ils pofledent & de tout ce qu’ils doivent. Ordonnance
de 1673 ; tit. x j. art. iV l;!
L ’article fuivant veut que les négocians , marchands
& banquiers en faillite, foient aufli tenus de
repréfenter tous leurs livres & régiftres, Cotés & paraphes
, en la forme preferite par les articles 1 , 2 , 3 ,
4 , 5 ,6 '& y. du tit. iij. de la meme ordonnance, pouf
être remis au greffe des jugeis & confuls, s’il y en a ;
finon de l’hôtel commun des villes , ou ès mains
des créanciers, à leur choix.
La déclaration du 13 Juin 17 16 , en expliquant ces
difpofitiohS de l’ordonnance de 1673 , veut que toüs’
marchands , négocians, & autres, qui ont fàit oii fé-
vontfaillite, foient tenus de dépofer un état exaft;
détaillé & certifié véritable, de tous leurs effets mobiliers
& immobiliers, & de leiirs.dettes, comme auf-'
fi leurs livres & rëgiftrès au greffe de la jurifdiâîbn
confulaire du lieu , ou la plus prochaine, & qû'é faute
de c e , ils rie puiffent être.reçûs à paffer avecleufs’
créanciers aucun contrat d’atermoyement, concordât,
tranfa&ion, ou autre afte, ni d’obtenir aucune
fentence ou arrêt d’omologation ti’iceux , ni fe prévaloir
d’aucun fàuf-conduit a^ebrdé par leurs créanciers.
’ •
' Poür'fëcrlit'ér à ceux qUi.dht fMt faillite , ié ifiôyen
de drefîer cet état, la même déclàration véüt qu’en
cas d’appofitiôn du fcelle^ftir'foüfs hïens 8c:effets',
leurs litres & regiftres fd.ièrit fçmis.& délivrës àprës
néanmoins qu’ils auront été paj-aphés pa rléjugé ou
autre officier commis par lé pige , qui appofera le
fcellé, & .par uii des créàhéï'èr? ^ui y âflîït’efont ; &
que les fcuilléts blancs, fi :attcUA fy i f adronf été’ bâ-
tonnés par lédif juge ou-trafir^bfficie.f, létfoifit'fiéatt-
moins ; fans déroger aux^wéqsrd^ privilèges de Ia;
confervation de1 Lyon. ''-' F 11 -
A Fforencê lé débifçûV1dç^f'Fe.'fendre pfifôhftidf
avec les livrés , îès fexfiiBfrxfe'' feh^re r'aifôn déia?
conduite; & fi la faillitrttt. ànitée.'par cas fortuit,
& qu’il n’y ait pas de ia faute, il n’en eft point, blâmé
, mais il faût qu’il réjft’éféfité fos, livres' ëh bonne
forme. ! , ' r r
• L’oi'àbfinancé^de 167^ J ïitficfiart. 4.'dScfêrrê
tous les tranfports, ceffions, Ÿèiiïes '& doriktidiià dë
biens' 'ffïéiibîèà pti imméiiBlesy faits par \e fa illi en
fraude'de'fè^ 'cféanciers-, & Veut ^ùe lé tottf :foltùp-
pofté à lâ mafle'commiiA'é des'èfibts. i
Tome VI,
F A I 373 Cet article ne fixoit point oit ces fortes d’aéles
commencent à être prohibés ; mais le reglement fait'
pdur la ville de Lyon le 2 Juin 1667* art- 13. ordonne
que toutes ceflions & tranfports fur les effets des
faillis, feront nuis , s’ils ne’ font faits dix jours au
moins avant \a faillite publiquement connue, fans y
comprendre néanmoins les viremens des parties faits
en bilan, Iefquels font bons & valables, tant que le
failli ou fort fafteur porte bilan.
Cette loi a été rendue générale pour tout le royaume
par une déclaration du mois dé Novembre 1702,
portant que toutes les ceflions & tranfports for les
biens des marchands qui font faillite , feront nuis ,
s’ils ne font faits dix jours au moins avant la faillite
publiquement connue, comme aufli que les a fies &
obligations qu’ils pafleront devant notaires, enfem-
ble les fentences qui feront rendues contre eux, n’acquerront
aucune hypotheque ni privilège-fur les
créanciers chirographaires , fi ces a fies & obligations
ne font pafîes, & lès fentences ne font rendues
pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement
connue ; ce qui a été étendu aux tranfports
faits par les gens d’affaires , en pareil cas de
faillite, fuivant un arrêt de la cour des aides du 14
Mars 1710.
Tous les afles paftes dans les dix jours qui précèdent
la faillite., font donc nuis de plein d ro it, fans
qu’il foit befoin de prouver fpécialement qu’il y a
eu fraude dans ces afles ; ce qui n’empêche pas que
les afles antérieurs à ces dix jours, ne puiffent être
déclarés nuis , lorfque l’on peut prouver qu’ils ont
été faits en fraude des créanciers.
Ceux qui ont fait faillite né peuvent plus porter
bilan fur la place des marchands ou du change : à
Lyon on ne fouffre pas qu’ils montent à la loge du
changé.
Il y a eu plufieurs déclarations du roi qui ont attribué
pour un certain tems là connoiffance dés faillites
aux jüges-confuls ; favoir, celles des 10 Juin &
7 D écembre'1715 , 27 Novembre 17 17 , 5 Août
1 7 2 1 ,3 Mai 1722, 21 Juillet 1726, 7 Juillet 172 7 ,
19 Septémbre 1730, & une derniere du'5 Août 173-2,
quf prarogedit cette attribution jufqu’au premier
Septembre 1733.
Il y à encore eu depuis Une autre déclaration dû
13 Septembre 1739, concernant les faillites & banqueroutes
, qui réglé les formalités des affirmations
dès créanciers & dés contrats d’atermoyement. Voy.
Bornièf fur le tit. j x . de Üotdonnante de iSy '3 , & les
mots A f f ir m a t io n , A t e r m o y e m e n t , Ba n q u e r
o u t e , C r é a n c ieMs :, D é l i b é r a t io n , U k io n .
( A j > :
* FAIM , APPÉTIT, (Grâm. d^y/z.) l’un & l’autre
défignènt une fenfation qiü nous porté à manger.
Mais la faim r? a rapport qu’au befoin, foit qu’il
naiffe d’une longue abftinéncè',; foit qu’il naiffe de
voracité naturelle, oit dë quelque autre éàüfè. h 7appétit
à pliiS de rapport au-goût & au plaifir qu’on fe
prohièt-des alimens qu’on v a prendre. La faim preffe
plus que Yappédt ; elle eft plus vorace ; tdut mets
î’appaife. L’appétit plus patiëht eft plus délicât'^cer-
tain mets-le réveille. Lorfque'lë pèuplé- meurt de
fuimjce h’eft jamais là'füutèdè îa! providèncêi^c’eft
tdûjôurs celle de l’adminiftrëtrôn. Il eft également
dangerçux pdur là fanté de foifffrir dé là jàittiy St de
tout accorder à fort appétit. La jaim néfédJi que des
alimens ; Y appétit a quelquefois une aedéption plus
étendue ; & la morale s’éh fèrt poUr défigAèr en gé-
liéràl la pentë de l’artVe 'vefs imobjét qu’èllê s’èft ré-
préfentée comme un'bien; quoiqu’il n’àrfivè que
frô{ifouyentque ce foit iin grand mal. ! -!;
| f . f. (PAyfidlifefi^èô ^/jUUffiVtifypar lës
aittèurs latins efuritio fdbï- éupïditas , dVddpJetentia ;
fenfotibh phis ou moins importune, qui mous folli-
B b b