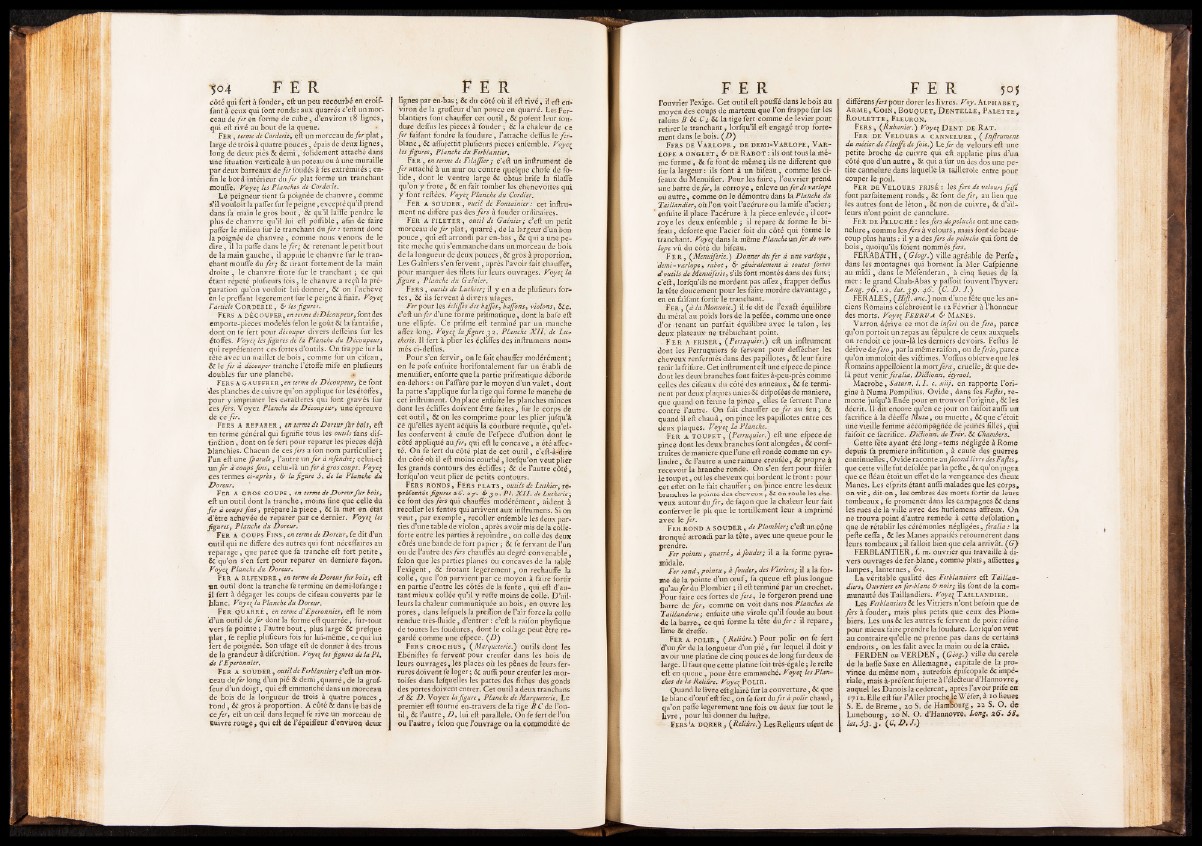
côté qui fert à fouder, eft un peu recourbé en croif-
fant ceauà d cee ux en qui forme font ronds de ciibe,: aux d’environ quarrés c’eft 18 un lignes,morfer
quFi eerft ,r ivé au bout Cordent,de la terme de eft queue. un morceau de plat,
llaorngge ddeé dtreouixs àp iqéus a&tr ed epmouic,efso,l iédpeamise dnet adtetuacxh fer léig dnaenss, punare dfeituuxa tbioarrir evaeurtxic daele à lin foudés poteau à fes ou extrémités à une muraille fer ; enfmino
ulef. lbeo. rd; intérieur du fer plat forme un tranchant Le peigneur Voye^ les tient Planches fa poignée de Corderie. dé chanvre, comme
sd’ailn vs ofua loirifta lîna plea fgferor sfu br oleu pte, ig&n eq,u e’ixlc leapiftfée q pue’inl dprree nlde pplauflse dr ele c mhailniveure f uqru l’èil tlruain cehfta npto dflui ble, afin de faire ldai rpeoignée de chanvre , comme nous fer : tenant donc
il la paffe dans le & retenant venons le petit de bout
le cdhea lnat , m maoinu fglea udcuh e, il fer; &appuie tirant le fortement chanvre fur de la le tranfer;
main
édtraonitte r é, pléet éc hpalunfviereu rsfr footies ,f uler cleh atnravnrceh aa rnetç ;u clae pqruéi
penar laet iporne flqaun’to nle gveoruelmoiet nltu fiu dr olen pneeirg, n&e à ofinn iTr.a cheve Voye{
Varticle CORDERIE , & Us figures. Fers a DÉCOUPER, en terme deDécoupcur, font des
dComnpt oornte l-ep ifeecret sp mouord elés lélon le goût & la fantaifie, étoffes. découper divers deffeins fur les Voyé[ Us figures de la Planche du Découpeur, tqêutie raevperécf uenn tmenati lcleets dfoer bteosi sd,’ ocuotmilsm. eO fnu rf ruapnp cei ffeuar ula, & le fer à découper tranche l’étoffe mife en plufieurs
douFbles fur une planche. <p ers A GAUFFRER ,en terme de Découpeur; Ce font
dpéosu pr lyan icmhpesri dmee cru lievsr ec qarua’oûne raepsp qliuqiu efo fnutr lgersa évtéosf ffeusr, ces fers. Voyez Planche du Découpeur, une épreuve
de ce fer. tinF teerrms ea g érnéépraalr qeuri ,l iegnn itfeirem teo dues Dleosr eur fur bois, eft outils fans dif-
btilnaéntcihoines, .d Conhta counn l ed fee crt pour reparer les pièces déjà l’un eft une es fers a Ion nom particulier; un fpatule, l’autre un fer à refendre; celui-ci fer a coups fins, celui-là un fer à gros coups. Voye£ ces termes ci-après, & la figure 5. de la Planche du
Doreur. Fer A GROS COUPS , en terme de Doreur fur bois, eft un outil dont la tranche, moins fine que celle du
fde’rê tàr ec oaucphse fvinése ,d pe rréeppaarree lra ppaier ccee ,d &er nliae mr. et en état Voye^ les
figures, Planche du Doreur. Fer A COUPS Fins , en terme de Doreur, fe dit d’un
roeuptailr qaugie n, eq udeif fpéarréc dee qs uaeu tfrâe str qaunic fhoen et fnt éfcoerftf apireetsi taeu,
& qu’on s’en fert pour reparer en derniere façon.
.Voyez Planche du Doreur. Fer a refendre , en terme de Doreur fur bois, eft
i«ln f eorut tàil ddéognatg lear tlreasn ccohuep fse tdeer mciifneea ue nc oduemveir-ltos fpanagr el e: blanc. Voye[ la Planche du Doreur. Fer QUARRÉ, en terme d.'Eperonnier, èft le nom
d’un outil de fer dont la forme eft quarrée, fur-tout
pvelarst ,f fae p roeipnltiee ;p llu’afiueturers b fooius tf,u pr lluusi -lmarêgme e&, c ep qreufiq luuei fdeer tl ad eg rpaonidgenuére .à Sdiofnc ruéftaiogne. eft de donner à des trous Voye{ les figures delà PI,
de P Eperonnier. ceaFue rd eA SOUDER, outil de Ferblantier; c’eft un morfeur
d’ufne dr oloinggt, dq’uuni epfité e &m mdeamncih, qe udaanrrsé u, nd em loar cgeroafu-
tdoen bdo,i s& d ger olas àlo pnrgoupeourrt iodne. trois à quatre pouces, A côté & dans le bas dé
ce fer, eft un oeil dans lequel fe rive un morceau de
çuivre rouge, qui eft de l’épaiffeur d’environ deux
lignes par èn-bas ; & du côté oîi il eft r iv é , il eft erf-
viron de là groffeur d ’un pouce en quarré. Les Ferblantiers
font chauffer cet outil, & polénf leur fou-
du*e deffus les pièces à fouder ; & la chaleur de ce
fer faifant fondre la foudure, l’attache deffus le fer-
blanc, & affujettit plufieurs pièces enfemble. Voyé^
les figures, Planche du Ferblantier. Fer , tntermcdeFilaJp.tr; c’eft un infiniment de
fer attaché à un mur ou contre quelque chofe de fo-
lide, dont le ventre large & obtus brife la filafle qu’on y frote, & en fait tomber les ebenevottes qui
y font reftées. Voyeç Planche du Cordier. Fer a SOUDER, outil de Fontainier: cet infinimeFnt
ne différé pas des fers à fouder ordinaires. er a fileter, outil de Gainier; c’eft un petit
morceau de fer plat, quarré, de là largeur d’un bon
pouce, qui eft arrondi par en-bas , & qui a une petite
meche qui s’emmanche'dans un morceau de bois
de la longueur de deux pouces, & gros à proportion.
LesGaînîers s’en fervent, après l’avoir fait chauffer,
pour marquer des filets fur leurs ouvrages. Voye{ lu
figure , Planche du Gainier. tesF ,e &rs i,l so fuetrilvse dnet Làu dthivieerr;s ilu lya geens .a de plufieurs forFer
pour les éclijfes des baßes, baßons, violons, & c .
c’eft un fer d’une forme prifmatique, dont la bafe eft
une ellipfe. Ce prifnie eft terminé par un manche
affez long. Voyeç la figure 3 2. Planche X I I . de Lutherie.
11 fert à plier les édifies des inftrumens nommés
ci-deffus.
Pour s’en fervir, on le fait chauffer modérément ;
on le pofe enfui te horifontalement fur un établi de
menuifier, enforte que la partie prifmatique déborde
èn-dehors : on l’affûre par le moyen d’un v a let, dont
la patte s’applique fur la tige qui forme le manche de
cet infiniment. On place enfuiteles planches minces
dont les édifies doivent être faites, fur le corps de
cet outil, & on les comprime pour les plier jufqu’à
ce qu’elles ayent acquis la courbure requife, qu’elles
confervent à caufe de l’efpece d’uûion dont le
côté appliqué au fer, qui eft le concave, a été affecté.
On fe fert du côté plat de cet outil, c’eft-àrMirë
du côté où il eft möins courbé, lorfqu’on veut plier
les grands contours des édifies; & de l’autre cô té,
lorfqu’on veut plier de petits contours. Fers ronds , Fers plats , outils de Luthier, re-
préfentés figures 26. 2y. & 30. PI. X I I . de Lutherie;
ce fönt des fers qui chauffés modérément, aident à
recoller les fentes qui arrivent aux inftrumens. Si on
v eu t, par exemple, recoller enfemble les deux parties
d’une table de violon, après avoir mis de la colle-
forte entre les parties à rejoindre, on colle des deux
côtés Une bande de fort papier ; & fe fervant de l’un
ou de l’autre des fers chauffés au degré convenable ,
félon que les parties planes ou concaves de la table
l’exigent, & frotant legerement, on rechauffe la
colle, que l’on parvient par ce moyen à faire fortir
en partie d’entre les côtés de la fente , qui eft d’autant
mieux collée qu’il y refte moins de colle. D ’ailleurs
la chaleur communiquée au bois, en ouvre les
pores, dans lefquels la preflion de l’air force la colle
rendue très-fluide, d’entrer : c’eft la raifon phyfique
de toutes les foudures, dont le collage peut être regardé
comme une efpece. {D') FERS crochus, ( Marqueterie.) outils dont les
Ebéniftes fe fervent pour creufer dans les bois de
leurs ouvrages, les placés où les pênes de leurs ferrures
doivent fe loger ; & aufli pour creufer les mor-
toifes dans lefquelles les pattes des fiches des gonds
des portes doivent entrer. Cet outil a deux trancharis
A & D . Voyez la figure, Planche de Marqueterie. Le
premier eft tourné en-travers de la tige B C de l’outil
, & l’autre, D , lui eft parallele. On fe fert de l’un
ou l’autre, félon que l’ouvrage ou la commodité de
l ’ouvrier l’exige. Cet outil eft pouffé dans le bois au
moyen des coups de marteau que l’on frappe fur les
talons B & C; &c la tige fert comme de levier pour
retirer le tranchant, lorfqu’il eft engagé trop forte--
ment dans le bois. (D )
F f r s d e V a r l o p e , d e d e m i - V a r l o p e , V a r l
o p e a O n g l é e ; 6* d e R a b o t : ils ont tous la même
forme, & fe font de même; ils ne different que
fur la largeur : ils font à un bifeau, comme les ci-
feaux du Menuifier. Pour les faire, l’ouvrier prend
une barre de fer, la corroyé, enleve un fer de varlope où autre, comme on le démontre dans la Planche du
Taillandier, oh. l’on voit l’acérure ou la mife d’acier ;•
enfuite il place l’acérure à la piece enlevée, il corroyé
les deux enfemble ; il repare & forme le bifeau
, deforte que l’acier foit du côté qui forme le
tranchant. Voye[ dans la même Planche un fer de varlope
vu du côté du bifeau.
F e r , (Menuiferie.) Donner du fer à une varlope,
'demi-varlope, rabot, & généralement à toutes fortes
d?outils de Ménuiferie, s’ils font montés dans des fûts ;
c’eft, lorfqu’ils ne mordent pas affez, frapper deffus
la tête doucement pour les faire mordre davantage,
en en faifant fortir le tranchant.
F e r , (à la Monnaie.) il fe dit de l'exaft équilibre
du métal au poids lors de la pefée, comme une once
d’or 1 tenant un parfait équilibre avec le talon, les
deux plateaux ne trébuchant point.
F e r A FRISER, ( Perruquier.) eft un infiniment
dont les Perruquiers fe fervent pouf deffécher les
cheveux renfermés dans des papillotes, & leur faire
tenir la frifure. Cet infiniment eft Une efpéce de pince
dont les deux branches font faites à-peu-près comme
celles des cifèaiix du côté des anneaux, & fe terminent
par deux plaques uniesôç difpofées de maniéré,
què quand on ferme la pince , elles fe ferrent l’une
contre l’autre. On fait chauffer ce fer au feu ; &
quand il eft chaud, on pince les papillotes entre ces
deux plaques. Voye^ la Planche.
F er a t o u p e t , (Perruquier.) eft une elpece.de
pince dont les deux branches font alongées, & conf-
truites de maniéré que l’une eft ronde comme un cy lindre,
& l’autre a une rainure creufée, & propre à
recevoir la branche ronde. On s’en fert pour frifer
le toupet, oit les cheveux qui bordent le front : pour
cet effet on le fait chauffer ; on pince entre les deux
branches la pointe des cheveux, & on roule les cheveux
autour du fer, de façon que la chaleur leur fait
conferver le pli que le tortillement leur a imprimé
avec le fer.
F e r r o n d A s o u d e r , de Plombier; c’eft un.cône
tronqué arrondi par la tête, avec une queue pour le
prendre.
Fer pointu , quarré, à fouder; il a la forme pyramidale.
Fer rond, pointu, à fouder, des Vitriers; il a la forme
de la pointe d’un oeuf, fa queue eft plus longue
qu’au fer du Plombier ; il eft terminé par un crochet.
Pour faire ces fortes de fers, le forgeron prend une
barre de fer, comme on voit dans nos Planches de
Taillanderie; enfuite une virole qu’il fonde au bout
de la barre-, ce qui forme la tête du fer ; il repare ,
lime & drefle.
F er a p o l i r , (Reliure.) Pour po lir on fe fert
d’un fer de la. longueur d’un p ié , fur lequel il doit y
avo ir une platine de cinq pouces de long fur deux de
large. Il faut que Gette platine foit très-égale ; le refte
eft en queue , pour être emmanché. Vtye^ les P louches
de la Reliûre. Voye{ POLIR.
Quand le livre eft glaire fur la couverture, & que
le blanc-d’oe uf eft fe c , on fe lert du fer à polir chaud,
qu’on paffe legerement une fois ou deux fur tout le
livre, pour lui donner du luftre.
F e r s 1 a d o r e r , (Reliure.) LesRelieurs u f e n t d e
différens fers pour dorer les livres. Voy. A l p h a b e t ,
A r m e , C o i t î , Bo u q u e t , D e n t e l l e , Pa l e t t e *
R o u l e t t e , Fl e u r o n .
F e r s , (Rubanier.) Voye[ D E N T D E R A T .
Fer d e V e lo u r s a c a n n e lu r e , ( lnfirument
, du métier de l'étoffe de foie.) Le fer de velours eft une
i petite broche de cuivre qui eft applatie plus d’un
côté que d’un autre, & qui a fur un des dos une petite
cannelure dans laquelle la tajllerole entre pour
couper le poil.
F er d e V e l o u r s FRISÉ : les fers de velours fripé
j font parfaitement ronds, & font de fer, au lieu que
; les autres font de léton, &£ non de cuivre, & d’ail-
’ leurs n’ont point de cannelure.
Fe r d e Pe l u c h e : les fers depeluche ont une cannelure
, comme les fers à velours, mais font de beaucoup
plus hauts : il y a des fers de peluche qui font de
b ois, quoiqu’ils foient nommés_ƒ£«.
FERABATH, (Gèogr.) ville agréable dë Perfe,-
dans les montagnes qui bornent la Mer Cafpienne
■ au midi, dans le Méfenderan, à cinq lieues de la
mer : le grand Chah-Abas y paffoit fouvent l’hyver;
• Long. j 6 . 12. lat.^Q. JS. (C. D . J.)
FERALES, (Hifl. anc.) nom d’une fête que les anciens
Romains célébroient le i z Février à l’honneur
des morts. Voye^ F e b r u a & Mânes.
Varron dérive ce mot dë inferi ou de fero, parce
qu’on portoit un repas au fépulcre de ceux auxquels
on rendoit cë jôur-là les derniers devoirs. Feftus le
dérive de fero , par la même raifon, ou àeferio, parce
qu’on immoloit des victimes. Voflius obferve que les
Romains appelloient la mort fera, cruelle, & que delà
peut venir firalia. Diîlionn. étymol.
Macrobe, Saturn. 1. 1. c. xiij. en rapporte l’origine
à Numa Pompilius. Ovid e, dans fes Fafies, remonte
jufqu’à Enée pour en trouver l’origine, & les
décrit. Il dit encore qu’en ce jour on faifoit aufli un:
facrifice à la déeffe Muta, ou muette, & que c’étoit
une vieille femme accompagnée de jeunes filles, qui
faifoit ce facrifice. Diclionn. de-Trév. & Ckambers.
Cette fête ayant été long-tems négligée à Rome
depuis fa première inftitution, à caufe des guerres
continuelles, Ovide raconte au fécond livre des Fafies,
que cette ville fut defolée par la pefte, & qu’on jugea
que ce fléau étoitun effet de la vengeance des dieux
Mânes. Les efprits étant aufli malades que les corps,
on v i t , dit-on, les ombres des morts fortir de leurs
tombeaux, fe promener dans les campagnes & dans
les rues de la ville avec des hurlemens affreux. On
ne trouva point d’autre remede à cette defolation ,
que de rétablir les cérémonies négligées, feralia : la
pefte eeffa, & les Mânes appaifés retournèrent dans
leurs tombeaux ; il falloit bien que cela arrivât. (G)
FERBLANTIER, f. m. ouvrier qui travaille à divers
ouvrages de fer-blanc, comme plats, afliettes ,
lampes, lanternes, &c.
La véritable qualité des Ferblantiers eft Taillandiers,
Ouvriers enfer-blanc & noir; ils font de la communauté
des Taillandiers. Voye^ T a il l a n d ie r .
Les Ferblantiers & les Vitriers n’ont befoin que de
fers à fouder, mais plus petits que ceux des Plombiers.
Les uns & les autres fe fervent de poix réfine
pour mieux faire prendre la foudure. Lorfqu’on veut
au contraire qu’elle ne prenne pas dans de certains
endroits, on les falit avec la main ou de la craie.
FERDEN ou VERDEN, (Géog.) ville du cercle
de la baffe Saxe en Allemagne, capitale de la province
du même nom, autrefois épifcopale & impériale
, mais à-préfent fujetre à l’élefreur d’Hannovre ,
auquel les Danois la cederent, après l’avoir prife en
171 z. Elle eft fur l’Aller prochele \Véfer, à 1 o lieues 1S. E. de Breme, 20 S. de Hambourg, 12 S. O . de
Lunebourg, 20 N. O. d’Hannovre. Long, 2 6 . SS.
lut, S3 .3 . (C, D . J,)