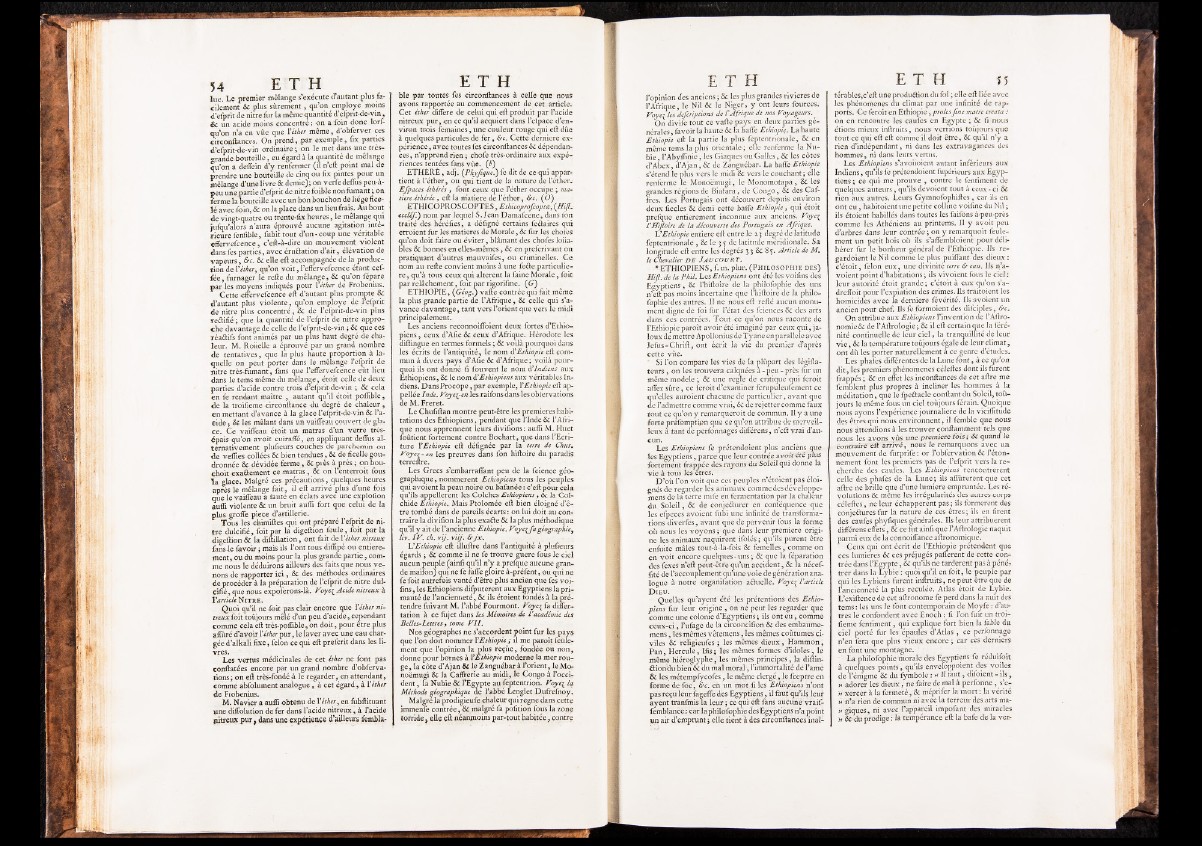
lue. Le premier mélange s’exécute d’autant plus facilement
& plus sûrement, qu’on employé moins
d’efprit de nitre fur la meme quantité d efprit-de-vin,
& un acide moins concentre : on a foin donc lorf-
qu’on n’a en vue que l'éther même, d’obferver ces
circonftances. On prend, par exemple, fix parties
d’efprit-de-vin ordinaire ; on le met dans une très-
grande.bouteille , eu égard à la quantité de mélange
qu’on a deffein d’y renfermer (il n’eft point mal de
prendre une bouteille de cinq ou fix pintes pour un
mélange d’une livre & demie); on verfe deffus peu-à-
peu une partie d’efprit de nitre foible non fumant ; on
terme la bouteille avec un bon bouchon de liège ficelé
avec foin, & on la place dans un lieu frais. Au bout
de vingt-quatre ou trente-fix heures, le mélange qui
jufqu’alors n’aura éprouvé aucune agitation intérieure
fenfible, fubit tout d’un-coup une véritable
effervefcence, c’eft-à-dire un mouvement violent
dans fes parties, avec éruftation d’air, élévation de
vapeurs, &c. & elle eft accompagnée de la production
de Véther, qu’on v o it , l’effervefcence étant cef-
fe e , furnager le relie du mélange, & qu’on fépare
par les moyens indiqués pour l’éther de Frobenius.
Cette effervefcence eft d’autant plus prompte &
d’autant plus violente , qu’on employé de l ’efprit
de nitre plus concentré, &c de l’ efprit-de-vin plus
reftifié ; que la quantité de l’efprit de nitre approche
davantage de celle de l’efprit-de-vin ; & que ces
réaüifs font animés par un plus haut degré de chaleur.
M. Rouelle a éprouvé par un grand nombre
de tentatives, que la plus haute proportion à laquelle
on peut porter dans le mélange l’efprit de
nitre très-fumant, fans que l’effervefcence eût lieu
dans le tems même du mélange, étok celle de deux
parties d’acide contre trois d’efprit-de-vin ; & cela
en fe rendant maître , autant qu’il étoit poflible,
de la troifieme circonftanee du degré de chaleur,
en mettant d’avance à la glace l ’efprit-de-vin & l’acide
, & les mêlant dans un vaifTeau couvert de glace.
Ce vaifTeau étoit un matras d’un verre très-
épais qu’on avoit cuirafle, en appliquant deffus alternativement
plufieurs couches de parchemin ou
de veffies collées & bien tendues, & de ficelle goudronnée
& dévidée ferme, & près à près ; on bou-
choit exaâement ce matras, & on l’enterroit fous
l a glace. Malgré ces précautions, quelques heures
apres le mélange fait, il eft arrivé plus d’une fois
que le vaifTeau a fauté en éclats avec une explofion
auffi violente & un bruit auffi fort que celui de la
plus greffe piece d’artillerie.
Tous les chimiftes qui ont préparé l’efprit de nitre
dulcifié, foit par la digeftion feule, foit par la
digeftion & la diftillation, ont fait de l ’éther nitreux
fans le favoir ; mais ils l’ont tous diflipé ou entièrement,
ou du moins pour la plus grande partie, comme
nous le déduirons ailleurs des faits que nous v enons
de rapporter i c i , & des méthodes ordinaires
de procéder à la préparation de l’efprit de nitre dulcifié,
que nous expoferons-là. Voye{ Acide nitreux A î’article Nitre.
Quoi qu’il ne -foit pas clair encore que l’éther nitreux,
foit toujours mêlé d’un peu d’acide, cependant
comme cela eft très-poflible, on doit, pour être plus
affûré d’avoir Y éther pur, le laver avec une eau chargée
d’alkali fixe, félon ce qui eft prefcrit dans les livres.
Les vertus médicinales de cet étker ne font pas
conftatées encore par un grand nombre d’obferva-
tions; on eft très-fondé 4 le regarder, en attendant,
comme abfolument analogue, à cet égard, à l’éther
de Frobenius.
M. Navier a auffi obtenu de Y éther, en fubftituant
une difTolution de fer dans l’acide nitreux, à l’acide
pitreux p u r , dans une expérience d’ailleurs femblable
par toutes fes circonftances à celle que nous
avons rapportée au commencemènt de cet article.
Cet éther différé de celui qui eft produit par l’acide
nitreux pur, .en ce qu’il acquiert dans l’efpace d’environ
trois femaines, une couleur rouge qui eft dûe
à quelques particules de fer, &c. Cette derniere expérience
, avec toutes fes circonftances & dépendances,
n’apprend rien ; chofe très-ordinaire aux expériences
tentées fans vûe. (h)
ETHÉRÉ, adj. (Phyjîque.') fe dit de ce qui appartient
à l ’éther, ou qui tient de la nature de Fethér.
Efpaces éthèrés , font ceux que l’éther occupe ; matière
éthérée, eft la matière de l’éther, &c. (O)
ETHICOPROSCOPTES, Etlûcoprofcopta, Hifi.
tccléj,!) nom par lequel S. Jean Damafcene, dans Ion
traité des heréfies, a défigné certains feûaires qui
erroient fur les matières de Morale, & fur les choies
qu’on doit faire ou év ite r , blâmant des chofes louables
&c bonnes en elles-mêmes., ■ & en prefcrivant ou
pratiquant d’autres mauvaifes, ou criminelles. Ce
nom au refte convient moins à une feôe particulière
, qu’à tous ceux qui altèrent la faine Morale, foit
par relâchement, foit par rigorifme. (6 )
ETHIOPIE, (Géogé) vafte contrée qui fait même
la plus grande partie de l’Afrique, & celle qui s’avance
davantage, tant vers l’orient que vers le midi
principalement.
Les anciens reconnoiffoient deux fortes d’Ethio-
piens, ceux d’Afie & ceux d’Afrique. Hérodote les
diftingue en termes formels ; & voilà pourquoi dans
les écrits de l’antiquité, le nom d’Ethiopie eft commun
à divers pays d’Afie & d’Afrique ; voilà pourquoi
ils ont donné fi fouvent le nom d’Indiens aux
Ethiopiens, & le nom d’Ethiopiens aux véritables Indiens.
Dans Procope, par exemple, l’Ethiopie eff appelée
Inde. Voye^en les raifons dans les obfer varions
de M. Freret.
Le Chufiftan montre peut-être les premières habitations
des Éthiopiens, pendant que l’Inde & l’Afrique
nous apprennent leurs divifions: auffi M. Huet
foûtient fortement contre Bochart, que dans l’Ecriture
Y Ethiopie eft dëfignée par la terre de Chus.
Voyez-en les preuves dans fon hiftoire du paradis
terreftre.
Les Grecs s’embarraffant peu de la fcience géographique
, nommèrent Ethiopiens tous les peuples
qui avoient la peau noire ou bafanée : c’eft pour cela
qu’ils appelèrent les Colches Ethiopiens, &c la Col-
chide Ethiopie. Mais Ptolomée eft bien éloigné d’être
tombé dans de pareils écarts : on lui doit au contraire
la divifion la plus exaûe & la plus méthodique
qu’il y ait de l’ancienne Ethiopie. Voye^fa géographie,
liv. IV . ch. vij. viij. & jx-,
U Ethiopie eft illuftre dans l’antiquité à plufieurs
égards ; & comme il ne fe trouve guère fous le ciel
aucun peuple (ainfi qu’il n’y a .prefque aucune grande
maif'on) qui ne fe îaffe gloire à-.préfent, ou qui ne
fe foit autrefois vanté d’être plus ancien que fes voi-
fins, les Ethiopiens difputérent aux Egyptiens la primauté
de l’ancienneté, & ils étoient fondés à la prétendre
fuivant M. l’abbé Fourmont. Voye^ fa difler-
tation à ce fùjet dans les Mémoires de L'académie des
Belles-Lettres, tome VII.
Nos géographes ne s’accordent point fur les pays
que l’on doit nommer l’Ethiopie ; il me paroît feùle-
ment que l’opinion la plus rèçûe, fondée ou non,
donne pour bornes à YÈthiopie moderne la mer roug
e, la côte d’Àjan le Zanguébar à l’orient, le Mo-
noëmugi &: la Caffrerie au midi, le Congo à l’occident
, la Nubie & l’Egypte au feptentrion. V?yé^ la
Méthode géographique de l’abbé Lenglet Dufrefnoy.
Malgré la prodigieufe chaleur qui régné dans cette
immenfe contrée, ôç malgré fa pofition fous la zone
torride > elle eft néanmoins par-tout habitée, contre
l’opinion des anciens ; & les plus grandes rivières de
l’Afrique, le Nil & le Niger, y ont leurs fources.
Voyelles defcriptions de l ’Afrique de nos Voyageurs.
On divife tout ce vafte pays en deux parties générales
, favoir la haute & la baffe Ethiopie. La haute
Ethiopie eft la partie la plus feptentrionale, & en
même tems la plus orientale ; elle renferme la Nubie
, l’Abyftinie, les Giaques ou Galles, & les côtes
d’Abex, d’Ajan, & de Zanguébar. La baffe Ethiopie
s’étend le plus vers le midi & vers le couchant ; elle
renferme le Monoëmugi, le Monomotapa, & les
grandes régions de Biafara, de Congo, & des Caf-
fres. Lès Portugais ont découvert depuis environ
deux fiecles & demi cette baffe Ethiopie, qui étoit
prefque entièrement inconnue aux anciens. Voye^
l ’Hifioire de la découverte des Portugais en Afrique.
L’Ethiopie entière eft entre le 23 degré de latitude
feptentrionale , & le 3 5 de latitude méridionale. Sa
longitude eft entre les degrés 3 3 & 85. Article de M.
le Chevalier DE J A U COU RT.
* ETHIOPIENS, f. m. plur. (Philosophie des)
Hifi. de la Phil. Les Ethiopiens ont été les voifins des
Egyptiens, & l’hiftoire de la philofophie des uns
n’eft pas moins incertaine que l’hiftoire de la philofophie
des autres. Il ne nous eft refté aucun monument
digne de foi fur l’état de,s fciences &: des arts
dans ces contrées. Tout ce qu’on nous raconte de
l’Ethiopie paroît avoir été imaginé par ceux qui, jaloux
de mettre Apollonius de Tyane en parallèle avec
Jefus-Chrift, ont écrit la vie du premier d’après
cette vûe.
' Si l’on compare les vies de la plûpart des légifla-
feurs , on les trouvera calquées à - peu - près fur un
même modèle ; & une réglé de critique qui ferait
affez sûre, ce feroit d’examiner fcrupuleufement ce
qu’elles auraient chacune de particulier, avant que
de l’admettre comme vrai, & de rejetter comme faux
tout ce qu’on y remarquerait de commun. Il y a une
forte préfomptipn que ce qu’on attribue de merveilleux
à tant de perfonnages différens, n’eft vrai d’aucun.
Les Ethiopiens fe prétendoient plus anciens que
les Egyptiens, parce que leur contrée avoir été plus
fortement frappée des raycins du Soleil qui donne la
vie à tous lès etres. ; '
D ’où l’on voit que ces peuples n’étoient pas éloignés
de regarder les animaux comme des développe-
mens de la terre mife en fermentation par la chaleur
d u .So leil, & de eonje&urer en conféquence que
les efpëces avoient fubi une infinité de transformations
diverfes, avant que de parvenir fous la forme
où nous les voyons ; que dans leur première origine
les animaux naquirent ifolés ; qu’ils purent être
enfuite mâles tout-à-la-fois & femelles, comme on
en voit encore quelques-uns; & que la féparation
des fexes n’eft peut-être qu’un accident, & la nécef-
lité de l’accouplement qu’une voie de génération ana.-
logue à notre organifation afruqlle. Voye^ l'article
Dïeü. • i , Quelles qu’ayent été les prétentions des Ethiopiens
fur leur origine, on ne peut les regarder que
comme une colonie d’Egyptiens ; ils ont e u , comme
ceux-c i, l’ufage de la circoncifion & des embaume-
mens, les mêmes vêtemens, les mêmes coûtumes civiles
& religieufes ; les mêmes dieux, Hammon,
Pan, Hercule, Ifis; les mêmes formes d’idoles, le
même hiéroglyphe, les mêmes principes, la diftin-
ôiondu bien & du mal moral, l’immortalité de l’ame
& les métempfycofes, le même clergé., le fceptre en
forme de foc, &c. en un mot fi les Ethiopiens n’ont
pas reçu lëur fageffe des Egyptiens, il faut qu’ils leur
ayent tranfmis la leur ; ce qui eft fans aucuné vraif-
femblanêe- car la philofophie des Egyptiens n’a point
Un air d’emprunt ; elle tient à dès circonftances Inaltérables,
c’eft une production du fol ; elle eft liée avec
les phénomènes du climat par une infinité de rapports.
Ce feroit en Ethiopie, proies fine matre creata :
on en rencontre les caufes en Egypte ; & fi nous
étions mieux inftruits, nous verrions toûjqurs que
tout ce qui eft eft comme il doit être, &ç qu’il n’y a
rien d’indépendant, ni dans les extravagances des
hommes, ni dans leurs vertus.
Les Ethiopiens s’avoiioient autant inférieurs aux
Indiens, qu’ils fe prétendoient fupérieurs aux Egyptiens
; ce qui me prouve , contre le fentiment de
quelques auteurs, qu’ils dévoient tout à ceux - ci &
rien aux autres. Leurs Gymnofophiftes , car ils en
ont e u , habitoient une petite colline voifine du Nil ;
ils étoient habillés dans toutes les faifons à-peu-près
comme les Athéniens au printems. Il y avoit peu
d’arbres dans leur contrée ; on y remarquoit feulement
un petit bois où ils s’aflembloient pour délibérer
fur le bonheur général de l’Ethiopie. Ils re-
gardoient le Nil comme le plus puiflant des dieux :
c’étoit, félon eux, une divinité terre & eau. Ils n’a-
voient point d’habitations ; ils vivoient fous le ciel :
leur autorité étoit grande ; c’étoit à eux qu’on s’a-
dreffoit pour l’expiation des crimes. Ils trairaient les
homicides avec la derniere févérité. Ils avoient un
ancien pour chef. Ils fe formoient des difciples, &c.
On attribue aux Ethiopiens l’invention de l’Aftro-
nomieôc de l’Aftrologie ; & il eft certain que la féré-
nité continuelle de leur c iel, la tranquillité de leur
v ie , & la température toûjours égale de leur climat,
ont dû les porter naturellement à ce genre d’études.
Les phafes différentes de la Lune font, à ce qu’on
dit, les premiers phénomènes céleftes dont ils furent
frappés ; & en effet les inconftances de cet aftre me
femblent plus propres à incliner les hommes à la
méditation, que le fpeftacle confiant du Soleil, toûjours
le même fous un ciel toûjours férain. Quoique
nous ayons l’expérience journalière de la viciffitude
des êtres qui nous environnent, il femble que nous
nous attendions à les trouver confiamment tels, que
nous les avons vus une première fois; 8c quand le
contraire eft arrivé, nous le remarquons avec un
mouvement de furprife : or l’obfervation & l’étonnement
font les premiers pas de l’efprit vers la recherche
des caufes. Les Ethiopiens rencontrèrent
celle des phafes de la Lune; ils affûrerent que cet
aftre ne brille que d’une lumière empruntée. Les révolutions
& meme les irrégularités des autres corps
céleftes, ne leur échappèrent pas ; ils formèrent des
conjectures fin la nature de ces êtres ; ils en firent
des caufes phyfiques générales. Ils leur attribuèrent
différens effets, & ce fut ainfi que l’Aftrologie naquit
parmi eux de la connoiffance aftronomique.
' Ceux qui ont écrit de l’Ethiopie prétendent que
ces lumières & ces préjugés pafferent de cette contrée
dans l’Egypte, & qu’ils ne tardèrent pas à pénétrer
dans la Lybie : quoi qu’il en foit, le peuple par
qui les Lybiens furent inftruits, ne peut être que de
l’ancienneté la plus reculée. Atlas étoit de Lybie.
L’exiftence de cet aftronome fe perd dans la nuit des
tems : les uns le font contemporain de Moyfe : d’autres
le confondent avec Enoch : fi l’on fuit un troifieme
fentiment, qui explique fort bien la fable du
ciel porté fur les épaules d’Atlas , ce perfonnage
n’en fera que plus vieux encore ; car ces derniers
en font une montagne. ■' - • . '
La philofophie'morale des Egyptiens fe reduifoit
à quelques points, qu’ils enveloppoient des voiles
de l’énigme & du fymbole : « II faut, difoient - ils ,
» adorer les dieux, ne faire de mal à perfonne , s’e-
>> xerçer à la fermeté, & méprifer la mort : la vérité
'» n’a rien de commun ni avec la terreur'des arts ma-
» giques, ni avec l’appareil impofant des miracles
'» & du prodige : la tempérance eft la bafe de la ver*-