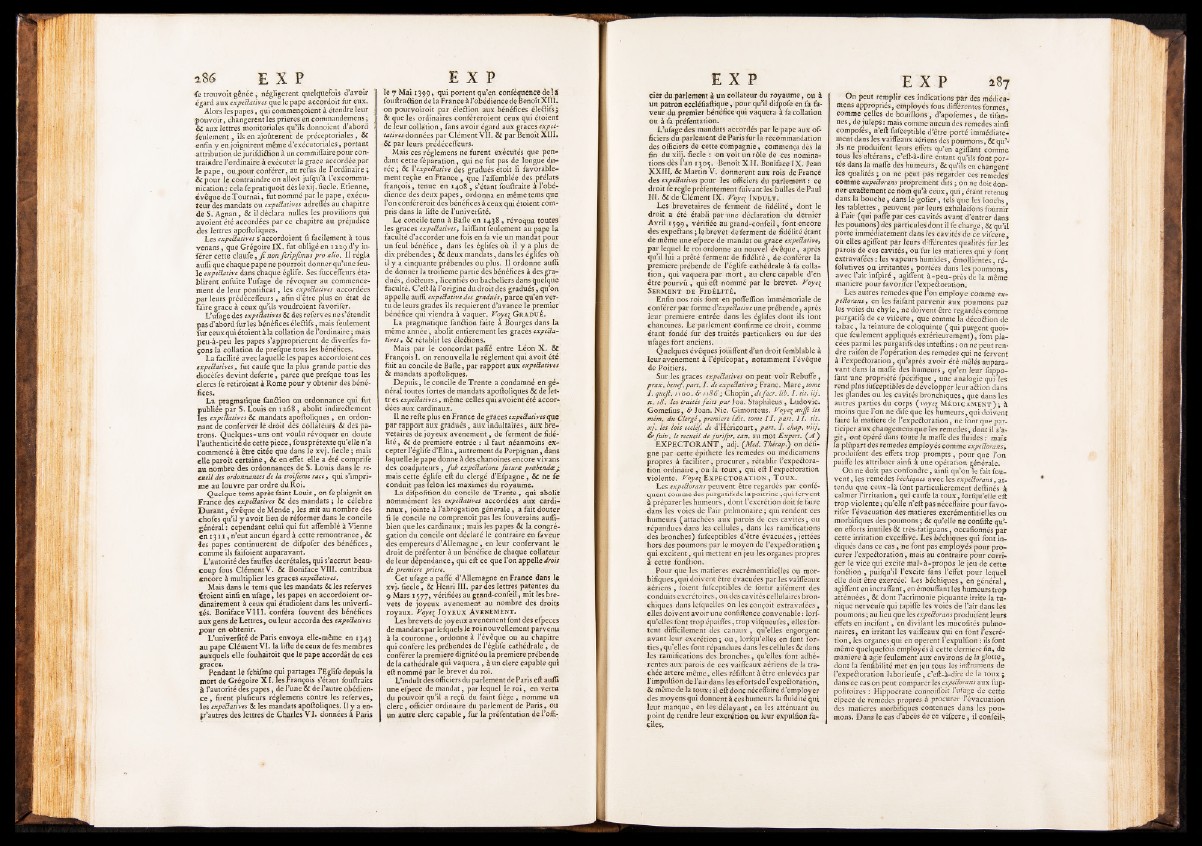
•=fe trou voit gênée, négligèrent quelquefois d’avoir
égard aux expectatives que le pape accordoit fur eux.
Alors les papes, qui commençoient à-étendre leur \
•pouvoir, changèrent les prières en commandemens ; ■
& aux lettres monitoriales qu’ils donnoient d’abord .
feulement, ils en ajoûterent de préceptoriales, &
•enfin .y en .joignirent même d’exécutoriales, portant
•attribution de. jurifdiâion à un commiffairepour contraindre
l’ordinaire à exécuter la grâce accordée par
le pape, ou.pour conférer., au refus de l’ordinaire ;
& pour le contraindre on alloit jufqu’à l’excommunication:
celafepratiquoit dès le xij. fiecle. Etienne,
évêque ■ de Tournai, fut nommé par le pape, exécuteur
des mandats ou expectatives adreffés au chapitre
de S. Agnan, St il déclara milles les provifions qui
avoient été accordées par ce chapitre au préjudice
des lettres apoftoliques.
Les expectatives s’accordoient fi facilement à tous
venans, que Grégoire IX. fut obligé en 1229 d’y inférer
cette claufe, J i nonfcnpf.mus.pro alio. Il régla
aulîi que chaque pape ne pourroit donner qu’une feule
expectative dans chaque églife. Ses fucceffeurs établirent
enfuite l’ufage de révoquer au commencement
de leur pontificat, les expectatives accordées
par leurs prédéceffeurs , afin d’être plus en état de
faire grâce à ceux qu’ils voudroient favorifer.
L’ufage des expeaatives St des referves ne s’étendit
pas d’abord furies bénéfices éleftifs, mais feulement
fur ceux qui étoient à la collation de l’ordinaire ; mais
peu-à-peu les papes s’approprièrent de diverfes façons
la collation de prefque tous les bénéfices.
La facilité avec laquelle les papes accordoient ces
expectatives9 fut caufe que la plus grande partie des
diocèfes devint deferte, parce que prefque tous les
clercs fe retiroient à Rome pour y obtenir des bénéfices.
La pragmatique fan&ion ou ordonnance qui fut
publiée par S. Louis en 1268, abolit indirectement
les expeaatives St mandats apoftoliques , en ordonnant
de conferver le droit des collateurs & des patrons.
Quelques-uns ont voulu révoquer en doute
l ’authenticite de cette piece, fous prétexte qu’elle n’a
commencé à être citée que dans le xv j. fiecle ; mais
elle paroît certaine, St en effet elle a été comprife
au nombre des ordonnances de S. Louis dans le recueil
des ordonnances de la troijîeme race , qui s’imprime
au louvre par ordre du Roi. _
Quelque tems après faint L ouis, on fe plaignit en
France des expectatives St des mandats ; le célébré
Durant, évêque de Mende, les mit au nombre des
chofes qu’il y avoit lieu de réformer dans le concile
général : cependant celui qui fut affemblé à Vienne
en 1 3 1 1 , n’eut aucun égard à cette remontrance, St
les papes continuèrent de difpofer des bénéfices,
comme ils faifoient auparavant.
L’autorité des fauffes décrétales, qui s’accrut beaucoup
fous Clément V . & Boniface VIII. contribua
encore à multiplier les grâces expectatives.
Mais dans le tems que les mandats St les referves
étoient ainfi en ufage, les papes en accordoient ordinairement
à ceux qui étudioient dans les univerfi-
tés. Boniface V I I I . conféra fouvent des bénéfices
aux gens de Lettres, ou leur accorda des expectatives
pour en obtenir.
L’univerfité de Paris envoya elle-même en 1343
au pape Clément VI. la lifte de ceux de fes membres
auxquels elle fouhaitoit que le pape accordât de ces
grâces.
Pendant le fchifme qui partagea l’Eglife depuis la
mort de Grégoire X I . les François s’étant fouftraits
à l’autorité des papes, de l’une & de l’autre obédienc
e , firent plufieurs réglemens contre les referves,
les expectatives & les mandats apoftoliques. Il y a en-
jr ’autre s des lettres de Charles V I . données à Paris
le 7 Mai 1399, qui portent qu’en conféquence de là
fouftraûion de la France à l’obédience de Benoît XIIL
on pourvoiroit par éleâion aux bénéfices éleûifs»
& que les ordinaires confëreroîent ceux q\ii étoient
de leur collation, fans avoir égard aux grâces expet*
tatives données par Clément VII. St par Benoît XIII.
St par leurs prédéceffeurs.
Mais ces réglemens ne furent exécutés que pendant
cette féparatiôn, qui ne fut pas de longue durée
; & 1 ''expectative des gradués étoit ïï favorablement
reçue en France , que l’affemblée des prélats
françois, tenue en 1408 , s’ étant fouftraite à l’obédience
des deux papes, ordonna en même tems que
P on conféreroit des bénéfices à ceux qui étoient compris
dans la lifte de l’univerfité.
Le concile tenu à Bafle en 1438 , révoqua toutes
les grâces expectatives, laiffant feulement aù pape la
faculté d’accorder une fois en fa v ie un mandat pour
un feul bénéfice, dans les églifes oh il y à plus de
dix prébendes ; St deux mandats, dans les églifes où
il y a cinquante prébendes Ou plus. Il ordonne auffi
de donner la troifieme partie des bénéfices à des gradués,
.doéteurs, licentiés Ou bacheliers dans quelque
faculté. C’eft-là l’origine du droit des gradués, qu’on
appelle aufli expectative des gradués, parce qu’en vertu
de leurs grades ils requièrent d’avance le premier
bénéfice qui viendra à vaquer. V o y e { G r a d u é .
La pragmatique fanftion faite à Bourges dans la
même année, abolit entièrement les grâces expectatives
, St rétablit les élections.
Mais par le concordat paffé entre Léon X . &
François I. on renouvella le réglement qui âvoit été
fait au concile de Bafle, par rapport aux expectatives
& mandats apoftoliques.
Depuis, le concile de Trente a condamné en général
toutes fortes de mandats apoftoliques & de let-
tr es expectatives, même celles qui aVoient été accordées
aux cardinaux.
Il ne refte plus en France de gfâces expectatives que
par rapport aux gradués, aux indultaires, aux bre-
vetaires de joyeux avenement, de ferment de fidélité
, & de première entrée : il faut néanmoins excepter
l’églife d’Elna, autrement de Perpignan, dans
laquelle le pape donne à des chanoines encore vivans
des coadjuteurs , fub expectatione futurce pmbtndce
mais cette églife eft du clergé d’Efpagne, & ne fe
conduit pas félon les maximes du royaume.
La difpofition du concile de Trente, qui abolit
nommément les expectatives accordées aux cardinaux
, jointe à l’abrogation générale, a fait douter
fi le concile ne comprenoit pas les foüverains auffi-
bien que les cardinaux ; mais les papes & la congrégation
du concile ont déclaré le contraire en faveur
des empereurs d’Allemagne, en leur confervant le
droit de préfenter à un bénéfice de chaque collateur
de leur dépendance, qui eft ce que l’on appelle droit
de première prière.
Cet ufage a paffé d’Allemagne en France dans le
xvj. fiecle, & Henri III. parues lettres patentes du
9 Mars 1 <77, vérifiées au grand-confeil, mit les brevets
de joyeux avenement au nombre des droits
royaux, f^ o y e i Jo y e u x A v e n em e n t .
Les brevets de joyeux avenement font des efpeces
de mandats par lefquels le roi nouvellement parvenu
à la couronne, ordonne à l’évêque ou au chapitre
qui conféré les prébendes de l’églife cathédrale, de
conférer la première dignité ou la première prébende
de la cathédrale qui vaquera, à un clerc capable qui
eft nommé par le brevet du roi.
L’induit des officiers du parlement de Paris eft aufîî
une efpece de mandat, par lequel le ro i, en vertu
du pouvoir qu’il a reçû du faint fiége , nomme un
clerc , officier ordinaire du parlement de Paris , ou I un autre clerc capable, fur la préfentation de l’offi-
EXP cier du.parlement à un collateur du royaume, ou à
un patron eccléfiaftique, pour qu’il dilpofe en fa faveur
du premier bénéfice qui vaquera a fa collation
ou à fa préfentation.
L’ufàge des mandats accordés par le pape aux officiers
du parlement de Paris fur la recommandation
des officiers de cette compagnie, commença dès la
fin du xiij. fiecle : on voit un rôle de ces nominations
dès l’an 1305. Benoît X I I . Boniface IX . Jean
XXIII. St Martin V . donnèrent aux rois de France
des expectatives pour les officiers du parlement: ce
droit fe réglé préfentement fuivant les bulles de Paul
III. & de Clément IX; Voye^ In d u l t .
Les brevetaires de ferment de fidélité -, dont le
droit a été établi par une déclaration du dernier
Avril 1599 , vérifiée au grand-confeil , font encore
des expeâans ; le brevet de ferment dé fidélité étant
de même une efpece de mandat ou grâce expectative,
par lequel le roi ordonne au nouvel évêque, après
qu’il lui a prêté ferment de fidélité , de conférer la
première prébende de l’églife cathédrale à fa collation
, qui vaquera par mort, au clerc capable d’en
être pourvû , qui eft nommé par le brevet. Voye^
S e r m e n t d e F id é l i t é .
Enfin nos rois font en poffeffion immémoriale de
conférer par forme d’expectative une prébende, après
leur première entrée dans les églifes dont ils font
chanoines. Le parlement confirme ce droit, comme
étant' fondé fur des traités particuliers ou fur des
ufages fort anciens.
Quelques évêques joiiiffent d’un droit femblable à
leur avenement à l’épifcopat, notamment l’évêque
de Poitiers.
Sur les grâces expectatives on peut voir RebufFe,
prax. benef.part. I. de expéclativo ; Franc. Marc, tome
ƒ. quejl. 1100. & ri8S-; Chopin,defacr. lib, I. tit. iij.
n. 18. les traités faits pat Joa. Staphileus , Ludovic.
Gomefius, & Joan. Nie. Gimonteus. Voye£ aujji les
mém. du Clergé, première édit, tome I I . part. IL. tit.
x j. les lois eccléf. de d’Héricourt, part. I . chap, viij.
& fuiv. le recueil de jurifpr. can. au mot Expert. (A )
EXPE CTORANT, adj. (Med. Thérapï) on défi-
gne par cette épithete les remedes ou medicamens
propres à faciliter, procurer, rétablir l’expe&ora-
tion ordinaire , ou la toux , qui eft l’expe&oration
violente. Voyt{ E x p e c t o r a t io n , T o u x .
Les expectorans peuvent être regardés par confé-
quent comme des purgatifs de la poitrine ,qui fervent
à préparer les humeurs, dont l’excrétion doit fe faire
dans les voies de l’air pulmonaire ; qui rendent ces
humeurs (attachées aux parois de ces cavités, ou
répandues dans les cellules, dans les ramifications
des bronches) fufceptibles d’être évacuées, jettées
hors des poumons par le moyen de l’expeûoration ;
qui excitent, qui mettent en jeu les organes propres
à cette fon&ion.
Pour que les matières excrémentitielles ou morbifiques
, qui doivent être évacuées par les vaiffeaux
aériens , l'oient fufceptibles de fortir aifément des
conduits excrétoires, ou des cavités Cellulaires bronchiques
dans lefquelles on les conçoit extravafées,
elles doivent avoir une confidence convenable : lorf-
qu’elles font trop épaiffes, trop vifqueufes, elles for-
tent difficilement des canaux , qu’elles engorgent
avant leur excrétion ; o u , lorfqu’elles en font for-
ties, qu’elles font répandues dans les cellules & dans
les ramifications des bronches, qu’elles font adhérentes
aux parois de ces vaiffeaux aériens de la trachée
artere même, elles réfiftent à être enlevées par
l’impulfion de l’air dans les efforts de l’expeéloration,
& même de la toux : il eft donc néceffaire d’employer
des moyens qui donnent à ces humeurs la fluidité qui
leur manque, en les délayant, en les atténuant au
point de rendre leur excrétion ou leur expulfion faciles.
E X P 287
On peut remplir ces indications par des médica-
mens appropriés, employés fous différentes formes,
comme celles de bouillons, d’apofemes, de tifan-
nes, de juleps: mais comme aucun des remedes ainfi
compofes, n’eft fufceptible d’être porté immédiatement
dans les vaiffeaux aériens des poumons, & qu’ils
ne pïoduifertt leurs effets qu’en agiffant comme
tous les àltérans, c’eft-à-diré entant qu’ils font portés
dans là maffe des humeurs, & qu’ils en changent
les qualités ; on nè peut pâs.''regarder ces remedes*
comm e expectorans proprement dits ; on ne doit donner
exactement ce nom qu’à ceux, qui, étant retenus
dans là bouche, dans lé gofier, tels que les looc'hs
les tablettes, peuvent par leurs exhalaifons fournir
à l’air (qui paffe par ces cavités avant d’éntrer dans
tes poumons) des particules dont il fe charge, St qu’il
porte immédiatement dans les cavités de ce v ifeere,
où elles âgiffent par leurs différentes qualités fur les
parois de ces cavités, ou fur les matières qui y font
extravafées : les vapeurs humides, émollientes, ré-
folutives ou irritantes, portées dans les poumons,
avec l’air infpiré, âgiffent à-peu-près de la même
maniéré pour favorifer Féfcpe&oration.
Les autres remedes que l’on employé comme expectorans,
en les fâifaiit parvenir aux poumons par
les voies du chyle, ne doivent être regardés comme
purgatifs de ce vifeere, que comme ladécoâion de
tabac, la teinture de coloquinte (qui purgent quoique
feulement appliqués extérieurement), font placées
parmi les purgatifs des inteftins : on ne peut rendre
raifort de l’opération des remedes qui ne fervent
à l’expeâoration, qu’après avoir été mêlés auparavant
dans la maffe des humeurs, qu’en leur fiippo-
fant une propriété fpécifique , une analogie qui les
rend plus fufceptibles de développer leur a&ion dans
les glandes ou les cavités bronchiques, que dans les
autres parties du corps (voye^ M é d i c a m e n t ) ; à
moins que l’on ne dife que les humeurs, qui doivent
faire la matière de l’expe&oration, ne font que participer
aux changemens que les remedes, dont il s’agit,
ont opéré dans toute la maffe des fluides : mais
la plupart des remedes employés comme expectorans,
produifent des effets trop prompts , pour que l’on
puiffe les attribuer ainfi à une opération générale.
On ne doit pas confondre, ainfi qu’on le fait fou-
vent, les remedes béchiques avec les expectorans, attendu
que ceux-là font particulièrement deftinés à
calmer l ’irritation, qui caufe la toux, lorfqu’elle eft
trop violente ; qu’elle n’eft pas néceffaire pour favorifer
l’évacuation des matières excrémentitielles ou
morbifiques des poumons ; & qu’elle ne confifte qu’en
efforts inutiles St très-fatiguans, occafionnés par
cette irritation exceffivé. Les béchiques qui font indiqués
dans ce cas, ne font pas employés pour procurer
l’expeôoration, mais au contraire pour corriger
le vice qui excite m al-à-propos le jeu de cette
fonction , puifqu’il l’excite fans l’effet pour lequel
elle doit être exercée! Les béchiques, en général,
âgiffent en incraffant, en émouffant les humeurs trop
atténuées, St dont l’acrimonie piquante irrite la tunique
nerveufe qui tapiffe les voies de l’air dans les
poumons ; au lieu que les expectorans produifent leurs
effets en incifant, en divifant les mucofités pulmonaires
, en irritant les vaiffeaux qui en font l’excrétion
, les organes qui en opèrent Fexpulfion : ils font
même quelquefois employés à cette derniere fin, de
maniéré à agir feulement aux environs de la glotte,
dont la fenfibilité met en jeu tous les inftrumens de
l’expeôoration laborieufe, c’eft-à-dire de la toux ;
dans ce cas on peut comparer les expectorans aux fup-
pofitoires : Hippocrate connoiffoit I’ufage de cette
efpece de remedes propres à procurer l’évacuation
des matières morbifiques contenues dans les poumons.
Dans le cas d’abcès de cc vifeere , il eonfeil-.