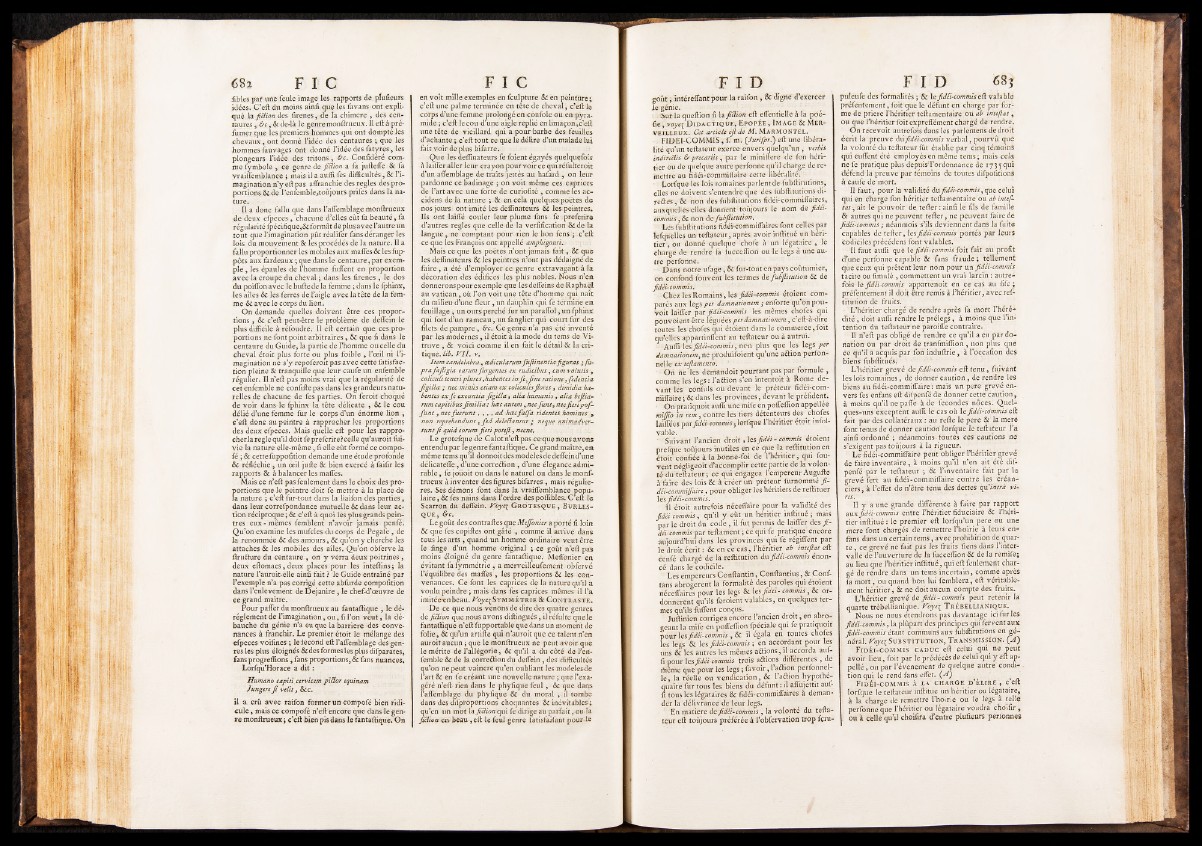
'6 8a F I C
fibles par une feule image les rapports de plufieurs
idées. C’eft du moins ainfi que les favans/ont expliqué,
la fiction des firen e sd e la chimere , des centaures
'$mÆ & de-là le genre monftrueux. Il eft à préfumer
que les premiers hommes qui ont dompté les
chevaux j ont donné l’idée des centaures ; que les
hommes fauvages ont donné l’idée des fatyres, les
plongeurs l’idee des tritons, &c. Confidéré comme
fymbole , ce genre de fiîlion a fa jufteffe & fa
vraisemblance ; mais il a auffi fies difficultés , 8c l’imagination
n’y eft pas affranchie des réglés des proportions
& de l ’enfemble,toujours prifes dans la nature.
Il a donc fallu que dans l’affemblage monftrueux
de deux efpeees, chacune d’elles eût fa beauté, fa
régularité fpécifique,8c formât de plus,avec l’autre un
tout que l’imagination pût réalifer fans déranger les
lois du mouvement & les procédés de la nature; Il a
fallu proportionner les mobiles aux maffes 8c les fup-
pôts aux fardeaux ; que dans le centaure, par exemple
, les épaules de l’homme fuffent en proportion
avec la croupe du cheval ; dans les firenes , le dos
du poiffon avec le bufté de la femme ; dans le fphinx,
les ailes 8c les ferres de l’aigle avec la tête de la femme
& avec le corps du lion.
On demande quelles doivent être ces proportions
, 8c c’eft peut-être le problème de deffein le
plus difficile à réfoudre. Il eft certain que ces proportions
ne font point arbitraires , 8c que fi dans le
centaure du Guide, la partie de l’homme ou celle du
cheval étoit plus forte ou plus foible , l’oeil ni l’imagination
ne s’y repoferoit pas avec cettè fatisfac-
tion pleine & tranquille que leur caufe un enfemble
régulier. Il n’eft pas moins vrai que la régularité de
cet enfemble ne confiftepas dans les grandeurs naturelles
de chacune de fes parties. On feroit choqué
de voir dans le fphinx la tête délicate , & le cou
délié d’une femme fur le corps d’un énorme lion ,
c’eft donc au peintre à rapprocher les proportions
des deux efpeees. Mais quelle eft pour les rapprocher
la réglé qu’il doit fe preferire? celle qu’auroit fui-
vie la nature elle-même, fi elle eût formé ce compo-
fé ; & cette fuppofition demande une étude profonde
8c réfléchie, un oeil jufte & bien exercé à faifir les
rapports & à balancer les maffes.
Mais ce n’eft pas feulement dans le choix des proportions
que le peintre doit fe mettre à la place de
la nature ; c’eft fur-tout dans la liaifon des parties,
dans leur correfpondance mutuelle 8c dans leur action
réciproque ; 8c c’eft à quoi les plus grands peintres
eux - mêmes femblent n’avoir jamais penfé.
Qu’on examine les mufcles du corps de Pegafe, de
la renommée 8c des amours, 8>c qu’on y cherche les
attaches & les mobiles des ailes. Qu’on obferve la
ftruâure du centaure., on y verra deux poitrines,
deux eftomacs, deux places pour. l'es inteftins ; la
nature l’aiiroit-elle ainfi fait ? le Guide entraîné par
l’exemple n’a pas corrigé cette abfurde composition
dans l’enlevement de Dejanire, le chef-d’oeuvre de
ce grand maître.
Pour paffer du monftrueux au fantaftique , le déréglement
de l’imagination, ou, fi l’on v eu t, la débauche
du génie n’a eu que la barrière des convenances
à franchir. Le premier étoit le mélange des
efpeees voifines ; le fécond eft l’affemblage des genres
lés plus éloignés 8cdes formes les plus difpârates,
fans progreffions, fans proportions, & fans nuances.
Lorfqu’Horace a dit :
Humano capiti cervicem pictor equinam
Jungere f i relie, 8cc.
il a crû avec raifon former un compofé bien ridicule
, mais ce compofé n’éft encore que dans le genre
monftrueux ; c’eft bien pis dans le fantaftique. On
F I C
e n v o i t m i l l e e x e m p l e s e n f c u l p t u r e 8 c e n p e i n t u r e ;
c ’ e f t u n e p a lm e t e rm in é e e n t ê t e d e c h e v a l , c ’ e f t l e
c o r p s d ’ u n e f e m m e p r o l o n g é e n c ô n f o l e o u en- p y r a m
i d e ; c ’ e f t l e c o u d ’u n e a i g l e r e p l i é e n l im a ç o n - , c ’ e f t
u n e t ê t e d e v i e i l l a r d q u i a p o u r b a r b e d e s f e u i l l e s
d ’ a c h â n t e ; c ’ e f t t o u t c e q u e l e d é l i r e d ’u n m a l a d e lu i
f a i t v o i r d e p lu s b i f a r r e ^ . .
Q u e l e s d e f f in a t e u r s f e f o i e n t é g a y é s q u e l q u e f o i s
à l a i f f e r a l l e r l e u r c r a y o n p o u r v o i r c e q u l r é f u l t e r o i t
d ’u n a f f e m b l a g e d e t r a i t s j e t t é s a u h a f a r d , o n l e u r
p a r d o n n e c e b a d in a g e ; o n v o i t m ê m e c e s c a p r i c e s
d e P a r t a v e c u n e f o r t e - d e c u r i o f i t é , c o m m e l e s a c -
c i d e n s d e l a n a t u r e ; & e n c e l a q u e l q u e s p o è t e s d e
n o s jo u r s - o n t im i t é l e s d e f f in a t e u r s 8 c l e s p e i n t r e s .
I l s o n t l a i f f é c o u l e r l e u r p lu m e f a n s . f e - .p r e f e r i r e
d ’ a u t r e s r é g l é s q u e c e l l e d e l a v e r f i f i c a t i o n 6 c d e l a
l a n g u e , n e . c o m p t a n t p o u r r i e n l e b o n f e n s j . c ’ e f t
c e q u e l e s F r a n ç o i s o n t - a p p e l l é amphigouri1..
M a i s c e q u e l e s p o è t e s ; n ’ o n t j a m a i s f a i t , & q u e
l e s d e f f in a t e u r s 6 c l e s p e i n t r e s n ’ o n t p a s d é d a i g n é d e
f a i r e , a é t é d ’ e m p l o y e r c e g e n r e e x t r a v a g a n t à l a
d é c o r a t i o n d e s é d i f i c e s l e s p l r i s : n o b l e s . N o u s n ’ e n
d o n n e r o n s p o u r e x e m p l e q u e l e s d e f f e i n s d e R a p h a ë l
a u V a t i c a n , o i t l ’ o n v o i t l i n e t ê t e d ’h o m m e , q u i n a î t
d u m i l i e u d ’ u n e f l e u r , u n d a u p h in q u i f e t e rm in e e n
f e u i l l a g e , u n o u r s p e r c h é f u r u n p a r a f f o l , u n f p h i n x
q u i f o r t d ’u n r a m e a u , u n f a n g l i e r q u i c o u r t f u r d e s
f i l e t s d e p a m p r e , &c. Ce g e n r e n ’ a p a s é t é i n v e n t é
p a r l e s m o d e r n e s , i l é t o i t à l a m o d e d u t em s d e V i -
t r u v e j 8c v o i c i c o m m e i l e n f a i t l e d é t a i l 6c l a c r i t
i q u e . / # . VII. v.
Item candelabra., oedicularum fufiinentia figuras ; fu-
pra fafiigia earum furgentes ex rudicibus, cum volutis ,
co lie u li teneri plures ,habentes in fie, f i ne ratio ne ,fedentia
figUU i nec minùs etiamex coliculisflores , dimidia lui-
bentes ex fe exeuntia figilla , alia humanis , alia befiia-
rum capitibusfi mi lia : hxc autem, neefuntÿ nec.fieri poj-
funt, nec fuerunt. . . . ad .heeefalfa ridentes ho mines »
non reprehendunt, fed deleclantur ; neque animadver-
tunt f i quid eorum fieri potefi , neene.
L e g r o t e f q u e d e C a l o t n ’ e f t p a s c e -q u e n o u s a v o n s
e n t e n d u p a r l e g e n r e f a n t a f t i q u e . C e g r a n d m a î t r e , e n
m ê m e t em s q u ’ i l d o n n o i t d e s m o d è l e s d e d e f f e i n d ’u n e
d é l i c a t e f f e -, d ’ u n e c o r r e & i o n , d ’ u n e é l é g a n c e a d m i r
a b l e , f e j o ü o i t o u d a n s l e n a t u r e l o u d a n s l e m o n t
t r u e u x à in v e n t e r d e s f i g u r e s b i f a r r e s , m a i s r é g u l i è r
e s . S e s d é m o n s f o n t d a n s l a v r a i f f e m b l a n c e p o p u l
a i r e , 6 c f e s n a in s d a n s l ’ o r d r e d e s p o f f ib l e s . C ’ e f t l e
S c a r r o n d u d e f f e i n . Voye^ G r o t e s q u e / B u r l e s q
u e , &c.
L e g o û t d e s c o n t r a i r e s q u e Mejfonier a p o r t é f i l o i n
6c q u e f e s ç o p i f t e s o n t g â t é , c o m m e i l a r r i v e d a n s
t o u s l e s a r t s , q u a n d u n h o m m e o r d i n a i r e v e u t ê t r e
l e l in g e d ’u n h o m m e o r i g i n a l ; c e g o û t n ’ e f t p a s
m o in s é l o i g n é d u g e n r e f a n t a f t i q u e . M e f f o n i e r e n
é v i t a n t f a f y m m é t r i e j a m e r v e i l l e u f e m e n t o b f e r v é
l ’ é q u i l i b r e d e s m a f f e s , l e s p r o p o r t i o n s 6 c l e s c o n v
e n a n c e s . C e f o n t l e s c a p r i c e s d e l a n a t u r e q u ’ i l a
v o u l u p e i n d r e ; m a i s d a n s f e s c a p r i c e s m ê m e s i l l ’ a
im i t é e * e n b e a u . / ' 'ô y ^ S Y M M É T R i E 8c C o n t r a s t e .
D e c e q u e n o u s v e n o n s d e d i r e d e s q u a t r e g e n r e s
d e fiction q u e n o u s a v o n s d i f t i n g u é s , i l r é f u l t e q u e l e
f a n t a f t i q u e n ’ e f t f u p p o r t a b l e q u e d a n s u n m o m e n t d e
f o l i e , 6 c q u ’ u n a r t i f t e q u i n ’ a u r o i t q u e c e t a l e n t n ’ e n
a u r o i t a u c u n ; q u e l e m o n f t r u e u x n e p e u t a v o i r q u e
l e m é r i t e d e l ’ a l l é g o r i e , 6 c q u ’i l a d u c ô t é d e l ’ e n -
f e m b l e 6 c d e l a c o r r e é l i o n d u d e f f e i n , d e s d i f f i c u l t é s
q u ’o r i n é p e u t v a i n c r e q u ’ e n o u b l i a n t l e s m o d è l e s d e
l ’ a r t 6 c e n f e c r é a n t u n e n o u v e l l e n a t u r e ; q u e l ’ e x a g
é r é n ’ e ft- r i e n d a n s l e p h y f i q u e f e u l , 6 c q u e d a n s
l ’ a f f e m b l a g e d u p h y f i q u e 6 c d u m o r a l , i l t o m b e
d a n s d e s d i f p t o p o r t i o n s c h o q u a n t e s 8 c in é v i t a b l e s - ;
q u ’ e n u n m o t l a fictionofii f e d i r i g e a l i p a r f a i t , -o u - la
fiction e n b e a u , e f t l e - f e u l g e n r e f a t i s f a i f a n t p o u r le
F I D goût ; intéreffant pour la raifon, 8c digne d’exercer
Je.génie. ’• • . '
Sur la queftion fi la fiction eft effentielle à la poe-
f iW ï ïS M D i d a c t i q u e , E p o p é e , I m a g e 8c M e r v
e i l l e u x . Cet article èfi de AL M a r m o n t e l .
FIDÉI-COMMIS , f . mV (Jurifpr.) eft une libéralité
qu’un teftateur exerce envers quelqu’un , ver bis
indircelis & precariis, par le miniftere de foh héritier
ou de quelque autre perfonne qü’il charge de remettre
au fidéUêOmmiflaire cette libéralités -
• Lorfque les lois romaines parlent de fubftitutions,
elles ne doivent s’entendre que des fubftitutions di-
re&ésy 8c non des fubftitutions fidéi-conimiffaires,
auxquelles !eiles donnent:toûjours le nom de fidei-
tômmiû, 6c non de fubfiitiitiàn.
Lés fubftitutions fidéi-c'ommiffaires font celles par
îefqdèlles ün teftàteür ; après, avoir inftitué un héritier,.
ou donné quelque chofe à un légataire , le
charge de rendre fa luceeffiori ou lë legs à une autre
perfbhne. ^ ; y
Dans notre ufage, 8c für-toüt en pays coûtumier,
on confond fouvent les termes de fubfiitution 8c de
fidêi-ùommis.
Chez les Romains , les fidéi-commis étoiënt comparés
aux legs pèr damnationem ; enforte qü’ôn pou-
Voit laiffer par fidéi-commis les mêmes chofes qui
jpouvôient être léguées per damnationem, c’eft-à-dire
toutes les chofes qui étoient dans le commerce, foit
qu-’ellés âppartinffent au teftateur ou à autrui.
Au Ailes fidéi-commis, non plus que les legs per
damnationem, ne produifoient qu’une aftion perfori-
nelle e!x:teftàmento'. ■ '
Ori ne'lès deniandoit pourtant pas par formule ,
comme les legs : l’a&ion s’en intentoit à Rome devant
les conluls ou devant le préteur fidéi-com-
miffàire ; 6c dans les provinces, devant le préfident.
Ori pr atiquoit auffi une mife en poffeflîon appellée
miffio in rem , contre les tiers détenteurs des chofes
laiffées ipzxfidèi- commis, lorfque l’héritier étoit infol-
vable.
- Suivant l’ancien droit, lés fidéi-commis etoient
prefque toûjours inutiles en ce que la reftitutionen
étoit confiée à la bonne-foi de l’héritier ; qui fou-
vent négligeoit d’accomplir cette partie de la volonté
du teftateur; ce qui engagea l’empereur Augufte
à faire des lois 8c à créer im préteur furnommé fi~
déi-commijfaire, pour Obliger les héritiers de reftituer
lèsfidéi^cOrnmis. '[ ’
11 étoit autrefois néceffaire pour la validité des
fidéi commis, qu’il y eût un héritier inftitué ; mais
par le droit du code , il fut, permis de laiffer des fi-
déi-commis ^ r teftament ; ce qui fe pratique encore
aujourd’hui dans les provinces qui fe régifféht par
le droit écrit : 6c en ce cas, l’héritier ab inteftat eft
cenfé chargé de la reftitution d\\ fidéi-commis énoncé
dans le codicile. ^ ^
Les empereurs Conftantin, Conftantius, 8t Conf-
tans abrogèrent la formalité des paroles qui étoient
néceffaires pour les legs 6c les fidei- commis, 6c ordonnèrent
qu’ils feroient valables, en quelques termes
qu’ils fuffent conçus. .
Juftinien corrigea encore l’ancien droit, en abrogeant
la mife en poffeffion fpéciale qui fe pratiquoit
pour les fidéi-commis , 8c il égala en toutes chofes
les legs 8c les fidéi-commis ; en accordant pour les
uns 8c les autres les mêmes aftionS, il adeorda auffi
pour 1 es fidéi-commis trois aétions différentes , de
thème que pour les legs ; favoir, l’aâion perfonnel-
le , la réelle ou vendication, 8c l’aftion hypothe-
quaire fur tous les biens du défunt : il aflujettit auf-
u tous les légataires 8c fidéi-commiffaires à demander
la délivrance dé leur legs.
En matière de fidéi-commis , la volonté du teftateur
élit toûjours préférée à l’obfervation trop feru-
F I D JPf
p u l e u f e d e s f o rm a l i t é s ; 8 c \e fidéi-commis e f t v a l a b l e
p r é f ë n t e m e n t , f o i t q u e l e d é f u n t e n c h a r g e p a r f o r m
e de p r i e r e l ’h é r i t i e r t e f t a m e n t a i r e o u ab ititeflat,
o u q u e l ’h é r i t i e r f o i t e x p r e f f é m e n t c h a r g é d e T e n d r e .
On recevoit autrefois dans les paflemens dë droit
écrit la preuve ànfidéï-cdmmis v erbal, pourvû que
la volonté du teftateur fût établie par cinq témoins
qui euffent été employés en même tems; mais cela
ne fe pratique plus depuisTordonnance de 173 s qui
défend la preuve par témoins de toutes difpofitionà
Û caufe de mort.
Il faut, pour la validité dufidéi-càmm'ts, que celui
qui en charge fon héritier teftamentaire ou ab intcf*
far-, ait lé pouvoir de tefter: ainfi le fils de famille
& autres qui ne peuvent tefter, ne peuvent faire dé
fidéicùmmis ; néanmois s’ils deviennent dans la fuite
capables de tefter, les fidéi-commis portés par leurs
Codiciles précédens font valables. '
Il faut auffi què le fidéi- commis foit fait ail profit
d’une perfonne capable 8c fans fraude ; tèllement
qué ceux'qui prêtent leur nom pour un fidéi-commis
tacite ou fimulé , commettent un vrai larcin : autrefois
le fidéi-commis appartenoit én ce cas au fife ;
préfentement il doit être remis à l’héritier, avec refc
titution de fruits.
L’héritier chargé de rendre après fa iriôrt l’hérédité
, doit auffi rendre le prélegs , à moins que l’intention
du teftateur ne paroiffe contraire.
Il n’eft pas Obligé de rendre ce qu’il a eu par donation
ou par droit de tranfmiffion , non plus que
ce qu’il â acquis p>ar foh iriduftrie, à l’occafion des
biens fubftïtués:
L’héritier grevé.defidéi-commis eft tenu, fuivant
lès lois romaines, de donner caution , de rendre les
biens au fidéi-commiffaire : mais un pere grevé envers
fes enfans eft difpenfé de donner cettè' caution,
à moins qu’il ne paffe à de fécondés nôcë's. Quelques
uns exceptent auffi le cas oîi le fidii-càmfniseft.
fait par des collatéraux : au refte le pere 8c la mere
font tenus de donner caution lorfque le teftateur l’a
ainfi ordonné ; néanmoins - toutes ces cautions né
s’exigent pas toûjours à la rigueur.
Le fidéi-commiffaire peut obliger l’héritier grevé
de faire inventaire,: à moins qu’il n’en ait été difpenfé
par le teftateur ; 8c l’inventaire fait par le
grevé fert au fidéi-commiffaire contre les créanciers,
à l’effet de n’être tenu des dettes qü'intrà virés.
Il y â une grande différence à faire par rapport
aux fidéi-commis entre l’héritier fiduciaire & l’héritier
inftitué : le premier eft lorfqu’un pere ou une
mere font chargés de remettre l’hoirie à leurs en-
fans dans un certain tems, avec prohibition de quarte
, ce grevé ne fait pas les fruits fiens dans l’intervalle
de l’ouverture de la fucceffion 8c de la remife;
au lieu que l’héritier inftitué , qui eft feulement chargé
de rendre dans un tems incertain, comme après
fa mort, ou quand bon lui femblera , eft véritablement
héritier, 8c ne doit aucun compte dés fruits.
L’héritier grevé de fidéi - commis peut retenir la
quarte trébellianique. Voyt£ T r Éb é l l i a ^ i q u è .
Nous ne nous étendrons pas davantage ici fur lès
fidéi-commis, la.plûpart de$ principes qui fervent aux
fidéi-commis étant communs aux fubftitutions en général.
Vaye{ S u b s t i t u t i o n , T r a n s m i s s i o n . (A )
F i d é i - c o m m i s c a d u c eft celui qui ne peut
avoir lieu, foit par le prédécès de celui qui y eft appellé
, ou par l’évenement' de quelque autre concfi- .
tion qui le rend fans effet. (A)
F iD É I - c O M M i è À l a c h a r g e d ’ é l i r e , c ’ e l t
• l o r f q u e l e t e f t a t e u r in f t i t u é u n h é r i t i e r o u l é g a t a i r e ,
à l a c h a r g e d e r em e t t r e l ’ h o i r i e o u l e l e g s à t e l l e
p e r f o n n e q u e l ’h é r i t i e r o u l é g a t a i r e v o u d r a c h o i f i r ,
o u à c e l l e q u ’i l c h o i f i r a d ’ e n t r e p lu f i e u r s p e r f o n n e s