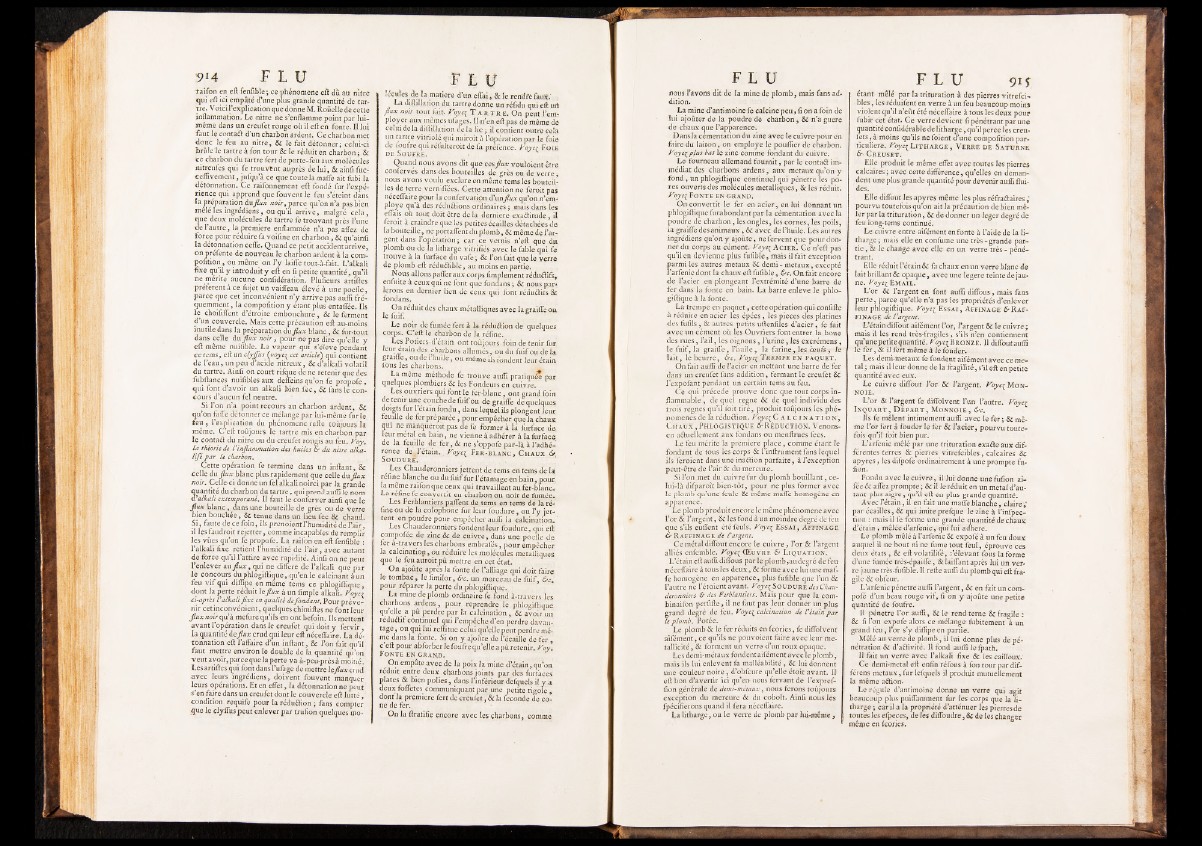
-taifon en eft fenfible ; ce phénomène eft du au nître
qui eft ici empâté d’une plus grande quantité de tartre.
Voici l’explication que donne M.Uoiielle de cette
inflammation. Le nitre ne s’enflamme point .par lui-
même dans un creufet rouge où il eft en fonte. Il lui
faut le contaft d’un charbon ardent. Ce charbon met
"donc le feu au nitre, & le fait détonner; celui-ci
brûle le tartre à fon tour & le réduit en charbon; &
ce charbon du tartre fert de porte-feu aux molécules
nitreufes qui fe trouvent auprès de lui, & ainfi fuc-
ceffivement, jufqu’à ce que toute la mafle ait fubi la
détonnation. Ce raifonnement eft fondé fur l’expérience
qui apprend que fouvent le feu s’éteint dans
la préparation duflu x noir, parce qu’on n’a pas bien
mêlé les ingrédiens, ou qu’il arrive, malgré ce la,
que deux molécules de tartre fe trouvant près l’une
•de l’autre, la première enflammée n’a pas allez de
force pour réduire fa voifine en charbon, & qu’ainfi
la détonnation celle. Quand ce petit accident arrive,
On préfente de nouveau le charbon ardent à la compofition,
ou même on l’y laiffe tout-à-fait. L’alkali
fixe qu’il y introduit y eft en fi petite quantité, qu’il
lie mérité aucune conlidération. Plulieurs artiftes
préfèrent à ce fujet un vailfeau élevé à une poelle,
parce que cet inconvénient n’y arrive pas auffi fréquemment
, la compofition y étant plus entaffée. Ils
le choififfent d’étroite embouchure, & le ferment
d’un couvercle. Mais cette précaution eft au-moins
inutile dans la préparation du flux b lanc, & fur-tout
dans celle du flu x noir , pour ne pas dire qu’elle y
eft même nuilible. La vapeur qui s’élève pendant
ce tems, eft un clyjfus (voye^ cet article) qui contient
de l’eau, un peu d’acide nitreux, & d’alkali volatil
du tartre. Ainfi on court rifque de ne retenir que des
fubftances nuifibles aux deffeins qu’on fe propofe,
qui font d’avoir un alkali bien fe c , & fans le concours
d’aucun fel neutre.
Si l’on n’a point recours au charbon ardent, &
qu’on faffe détonner ce mélange par lui-même fur le
feu , l’explication du phénomène refte toujours ia
même. C ’eft toujours le tartre mis en charbon.par
le contaél du nitre ou du creufet rougis au feu. Voy.
la théorie de l'inflammation des huiles & du nitre atka-
lifé par le charbon.
Cette opération fe termine dans un inftant, &
celle du flux_ blanc plus rapidement que celle du flux
noir. Celle-ci donne un fel alkali noirci par la grande
quantité du charbon du tartre, qui prend auffi le nom j
Cl alkali extemporané. Il faut le conlerver ainfi que le
flux blanc,. dans une bouteille de grès ou de. verre
bien bouchée, ôç tenue dans un lieu fec & chaud.
S i, faute de ce foin, ils prenoientl’humidité de l’air
il les faudroit rejetter, comme incapables de remplir
les vues qu’on fe propofe. La raifon en eft fenfible :
l’alkali fixe retient l’humidité de l’air , avec autant
de force qu’il l’attire avec rapidité. Ainfi on ne peut
l’enlever au flu x , qui ne différé de l’alkali que par
le concours du phlogiftique, qu’en le calcinant à un
feu v i f qui diffipe en même tems ce phlogiftique,
•dont la perte réduit le flux à un fimple alkali. Voyc^
xi-aprés V alkali fixe en qualité de fondant. Pour prévenir
cetinconvénient, quelques chimiftes ne font leur
flu x noir qu’à mefure qu’ils en ontbefoin. Ils mettent
avant l’opération dans le creufet qui doit y fervir,
la quantité deflux crud qui leur eft néceffaire. La détonnation
eft l’affaire d’un inftant, & l’on fait qu’il
faut mettre environ le double de la quantité qu’on
veut avoir, parce que la perte va à-peu-près à moitié.
Les artiftes qui font dans l’ufage de mettre leflux crud
avec leurs ingrédiens, doivent fouvent manquer
leurs opérations. Et en effet, la détonnation ne peut'
s’en faire dans un creufet dont le couvercle eft lutté ,'
condition requife pour la reduélion ; fans compter
que le clylfus peut enlever par trufion quelques molécules
de îa matière d’un effai, & le rendfè faux; .
La diftillation du tartre donne un réfidu qui eft urt
flux noir tout fa it Vyye{ T a r t r e . On peut l’eim
ployer aux mêmes ufages. Il n’en.eft pas de même de
celui de la diftillation d elà lie ; il contient outre cela
un tartre vitriolé qui nuiroit à l’opération par le foie
de foufre qui réfolteroit de fa préfence. Foyer F g i e
d e S o u f r e . •
Quand nous avons dit que cesflu x voüïôiènt être
confervés dans des bouteilles de grès ou de verre,
nous avons voulu exclure en même tems les bouteib
les de terre verniffees. Cette attentionné feroit pas
neceffaire pour la confervatipn d*ünflux qu’on n’em-
ploye qu’à des reduâions ordinaires ; mais dans les
effais où tout doit être de la derniere exactitude , il
feroit à craindre que les petites écailles détachées de
la bouteille, ne portaffent du plomb, & même de l’argent
dans l’operation ; car ce vernis n’eft que du
plomb ou de la litharge vitrifiés avec le fable qui fe
trouve à la furface du vafe ; & l’on fait que le verre
de plomb eft réductible, au moins en partie*
Nous allons paffer aux corps fimplement rédudifs,
ènfuite à ceux qui ne font que fondans ; 6c nous par-*
lerons en dernier lieu de ceux qui font réduCtits &
fondans.
On réduit des chaux métalliques avec la graiffè ou
le fuif.
Le noir dé fumée fert à la réduction de quelques
corps. C ’eft le charbon de la réfinèi
Les Potiers-d’etain ont toujours foin de tenir fur
euF^tain charbons allumés, ou du fuif ou de la
graille, ou de 1 huile, ou même ils fondent leur étain
tous les charbons^
La même méthode fe trouvé auffi pratiquée par
quelques plombiers & les Fondeurs én cuivre.
Les ouvriers qui font le fer-blanc, ont grand foin
de tenir une couche de fuif ou de graifle de quelques
doigts fur 1 etain fondu, dans lequel ils plongent leur,
feuille de fer préparée, pour empêcher que la chaux
qui ne manqueroit pas de fe former à la furface de,
leur métal en bain, ne vienne à adhérer à la furface^
de la feuille de fer ,& ne s’oppofe par-là à l ’adhérence
de^l’étain. Vjye^ Fer -b l a n c , C haux 6*
Soudure.
Les Chauderpnniers jettent de tems en tems de là
refine blanche ou du fuif fur l’étamage en bain, pour
la meme raifon que ceux qui travaillent au fer-blanc*
La refine fe convertit en charbon ou noir de fumée*.
Les Ferblantiers paffent de tems en tems de laré-*
fine ou de la colôphone fur leur foudure, oit ljy jettent
en poudre pour empêcher auffi, la calcination*
Les Chauderonniers fondent leur foudure, qui eft
compofep de zinc & de cuivre, dans une poelle de
fer à-travers les charbons embrafés, pour empêcher
la calcination, ou réduire les molécules métalliques
que le feuauroitpû mettre en cet état.
On ajoute apres la fonte de l’àlliage qui doit faire
le tombac, le fimilor, &c. un morceau de fuif, &c4
pour réparer la perte du phlogiftique.
La mine de plomb ordinaire fe fond à-travers les
charbons ardens, pour reprendre le phlogiftique
qu’elle a pu perdre par la calcination, & avoir un
rédu&if continuel qui l’empêche d’en perdre davantage,
ou qui lui reftitue celui qu’elle peut perdre même
dans la fonte. Si on y ajoute de l’écaille de fe r ,
c’eft pour abforber le foufre qu’elle a pu retenir. Voy.
Fonte en gran.d.
t On empâte avec de la poix la mine d’étain, qu’on
réduit entre deux charbons joints par des furfaces
plates & bien polies, dans l’inférieur defquels il y a
deux folfetes communiquant par une petite rigole ,
dont la première fert de creufet, & la fécondé de cône
de fer.
On la ftratifie encore avec les charbons, comme
nous l’avons dit de la mine de plomb, mais fans addition.
La mine d’antimoine fe- calcine peu, fi on a foin de
lui ajouter de la poudre de charbon, & n’a guere
de chaux que l’apparence.
Dansla cementation du zinc avec le cuivre pour en
faire du laiton, on employé le pouffier de charbon.
Voye^plus bas le zinc comme fondant du cuivre.
Le fourneau allemand fournit, par le contaû immédiat
des charbons ardens, atix métaux qu’on y
fond, un phlogiftique continuel qui pénétré les pores
ouverts des molécules métalliques, & les réduit.
Voyt^ F o n t e e n g r a n d .
On convertit le fer en acier, en lui donnant un
phlogiftique furabondant par k cémentation avec la
poudre de charbon, les ongles, les cornes, les poils,
la graifle des animaux, & avec de l’huile. Les autres
ingrédiens qu’on y ajoûfe, ne fervent que pour don-
net du corps au cément. Voye[ A c i e r . Ce n’eft pas
qu’il en devienne plus fufible, mais il fait exception
parmi les autres métaux & demi - métaux, excepté
l ’arfenic dont la chaux eft fufible, &c. On fait encore
de l’acier en plongeant l’extrémité d’une barre de
fer dans' la fonte en bain. La barre enleve le phlogiftique
à la fonte.
La trempe en paquet, cette opération qui confifte
à réduire en acier les épées, les pièces des platines
des fufils, & autres petits uftenfiles d’acier, fe fait
avec un cément où les Ouvriers font entrer la boue
des rues, l’a il, les oignons, l ’urine, les excrémens,
le fuif, la graifle, l’huile, la farine ,de,s oeufs, le
la it, le beurre, &c. Voye^ T r e m p e e n p a q u e t .
On fait auffi de l’acier en mettant une barre de fer
dans un creufet fans addition, fermant le creufet &
l ’expofant péndant un certain tems au feu.
Ce qui précédé prouve donc que tout corps inflammable
, de quel régné & de quel individu des
trois régnés qu’il foit tiré, produit toujours les phénomènes
de 1aréduâion. Voyeç C a l c i n a t i o n ,
C h a u x , P h l o g i s t i q u e & R é d u c t i o n . Venons-
en aftuellement aux fondans ou menftrues fecs.
Le feu mérite la première place, comme étant le
fondant de tous les corps & l’inftrument fans lequel
ils feroient dans une inaftion parfaite, à l’exception
peut-être de l’air & du mercure.
Si l’on met du cuivre fur du plomb bouillant, celui
là difparoît bien-tôt, pour ne plus former avec
le plomb qu’une feule & même mafle homogène en
apparence.
Le plomb produit encore le même phénomène avec
l’or & l’argent, & les foïid-à un moindre degré de feu
que s’ils euffent étéfeuls. Voye£ E s s a i , A f f i n a g e
6* R a f f i n a g e de l'argent.
Ce métal diffout encore le cuivre, l’or & l’argent
alliés enfembte. Voyeç OE u v r e & L i q u a t i o n .
L’étain eft auffi diflous par le plomb,au degré de feu
néceffaire à tous les deux, & forme avec lui une maf-
fe homogène en apparence, plus fufible que l’un &
l’autre ne Pétoient avant. Voye^ S o u d u r e des Chauderonniers
& des Ferblantiers. Mais pour que la com-
binaifon perfifte, il ne faut pas leur donner un plus
grand degré de feu. Voye£ calcination de l'étain par
le plomb. Potée.
Le plomb & le fer réduits en feories, fe diflolvent
aifémertt, ce qu’ils ne potivoient faire avec leur rtie-
tallicité, & forment un verre d’un roux opaque.
Les demi-métaux fondent aifément avec le plomb,
mais ils lui enlevent fa malléabilité , & lui donnent
une couleur noire, d’oblcure qu’elle étoit avant. Il
eft bon d’avertir ici qu’en* nous fervant de l’expref-
fion générale de demi-métaux, nous ferons toujours
exception du mercure & du cobolt. Ainfi nous les
fpécifierons quand il fera néceffaire.
La litharge, ou le verre de plomb par lui-même > ;
étant mêlé par la trituration à des pierres vitrefei-
blés, les réduifent en verre à un feu beaucoup moins
violent qu’il n’eut été néceffaire à tous les deux pour
fubir cet état. Ce verre devient fi pénétrant par une
quantité confidérable de litharge, qu’il perce les creu-
fets, a moins qu’ils nefoient d’une compofition particulière.
Voyei L i t h a r g e , V e r r e d e S a t u r n e
&■ C r e u s e t .
Elle produit le même effet avec toutes les pierres
calcaires; avec cette différence, qu’elles en demandent
une plus grande quantité pour devenir auffi fluides.
Elle diflbut les apyres même les plus réfra&aires ;
pourvu toutefois qu’on ait la précaution de bien mêler
par la trituration, & de donner un leger degré de
feulohg-tems continué.
Le cuivre entre aifément en fonte à l’aide de la litharge
; mais elle en confume une très - grande part
ie , & le change avec elle en un verre très - pénétrant.
Elle réduit l’étain & fa chaux en un verre blanc de
lait brillant & opaque, avec une legere teinte de jau*
ne. Voye[ Ém a il .
L’or & l’argent en font auffi diffous, mais fans
perte, parce qu’elle n’a pas les propriétés d’enlever
leur phlogiftique. Voye^ E s s a i , A f f i n a g e 6* R a f f
i n a g e de l'argent.
L’étain diffout aifément l’or, l’argent & le cuivre ;
mais il les rend très-fragiles, s’ils n’en contiennent
qu’une petite quantité. Voye^ B r o n z e . Il dliffoutauffi
le fer, & il fert même à le fonder.
Les demi-metaux fe fondent aifément avec ce métal
; mais il leur donne de la fragilité, s’il eft en petite
quantité a vec eux.
Le cuivre diffout l’or & l ’argent. Voyeç Mon-
NOiE.
L’or & l’argent fe diflolvent l’un l’autre. Voyeç
I n q u a r t , D é p a r t , M o n n o i e , &c.
Ils fe mêlent intimement auffi avec le fer ; & même
l’or fert à fouder le fer & l’acier, pourvu toutefois
qu’il foit bien pur.
L ’arfenic mêlé par une trituration exaéle aux d ifférentes
terres & pierres vitrefcibles, calcaires &c
apyres , les difpofe ordinairement à une prompte fu-
fîon.
Fondu avec le cuivre, il lui donne unefiifion ai-
fée & affez prompte ; & il le réduit en un métal d’autant
plus aigre, qu’il eft en plus grande quantité.
Avec l’étain, il en fait une mafle blanche, claire,"
par écailles, &: qui imite prefque le zinc à l’infpec-
tion : mais il fe forme une grande quantité de chaux
d’étain, mêlée d’arfenic,- qui lui adhéré.
Le plomb mêlé à l’arfenic & expofé à un feu doux
auquel il ne bout ni ne fume tout feul, éprouve ces
deux états, & eft volatilifé, s’élevant fous la forme
d’une fumée très-épaiffe, &Iaiffant après lui un verre
jaune très-fufible. Il refte auffi du plomb qui eft fragile
& obfcur.
L’arfenic pénétré auffi l’argent, & en fait un com-
pofé d’un beau rouge v if, fi on y ajoûte une petite
quantité de foufre.
Il pénétré l’or auffi, & le rend-terne & fragile :
& fi l’on expofe alors ce mélange fubitement à un
grand feu, l’Or s’y diffipe en partie.
Mêlé au verre de plomb, il lui donne plus de pénétration
& d’aélivité. Il fond auffi le fpath.
Il fait un verre avec l’alkali fixe & les cailloux.'
Ce demi-metal eft enfin réfous à fon tour par dif-
férens métaux, fur lefquels il produit mutuellement
la même aô'iôn.
Le régule d’antimoine donne un verre qui agit
beaucoup plus puiflamment fur les corps que la litharge
; car il a la propriété d’atténuer les pierres de
toutes les efpeces, de les diffoudre, & de les changer
même en feories.