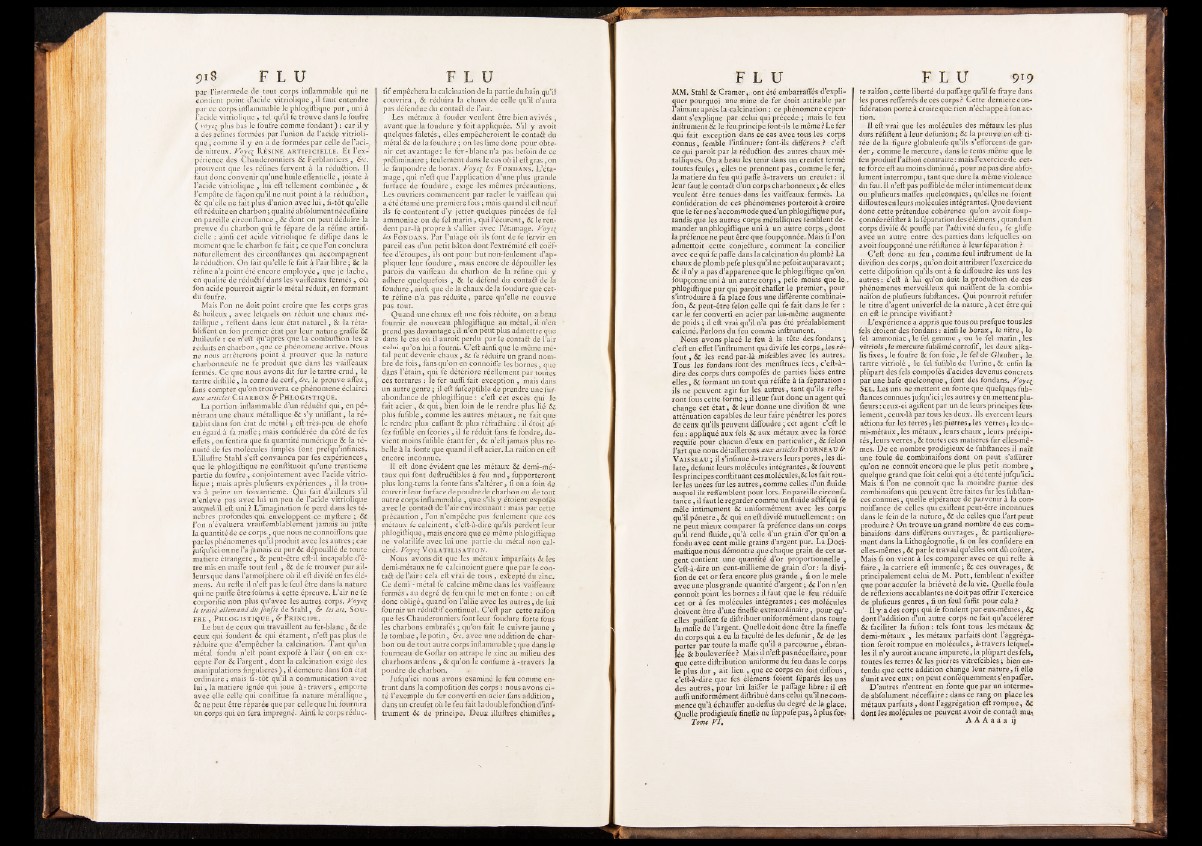
par l’intermede de tout corps inflammable qui ne
contient point d’acide vitriolique , il faut entendre
par ce corps inflammable le phlogiflique pur , uni à
l ’acide vitriolique, tel qu’il fe trouve dans le foufre
( voye^ plus bas le foufre comme fondant ) : car il y
a des réfines formées par l’union de l’acide vitriolique,
comme il y en a de formées par celle de Façade
nitreux. Voyc^ R ésine a r t if ic ie l le . Et l’expérience
des Chauderonniers & Ferblantiers , &c.
prouvent que les réfines fervent à la réduction. Il
faut donc convenir qu’une huile effentielle, jointe à
l’acide vitriolique , lui efl tellement combinée , &
l’empâte de façon qu’il ne nuit point à la rédu&ion,
& qu’elle ne fait plus d’union avec lu i, fi-tôt qu’elle
eft réduite en charbon ; qualité abfolument néceflaire
en pareille circonfiance , & dont on peut déduire la
preuve du charbon qui fe fépare de la réfine artificielle
: ainfi cet acide vitriolique fe diflipe dans le
moment que le charbon fe fait ; ce que l’on conclura
naturellement des circonftances qui accompagnent
la réduction. On fait qu’elle fe fait à l’air libre ; & la
réfine n’a point été encore employée, que je fâche,
en qualité de réduftif dans les vaiffeaux fermés , où
fon acide pourroit aigrir le métal réduit, en formant
du foufre.
Mais l’on ne doit point croire que les corps gras
& huileux, avec lefquels on réduit une chaux métallique
, relient dans leur état naturel, & la réta-
bliffent en fon premier état par leur nature grade &
huileufe : ce n’èft qu’après que la combuftion les a
réduits en charbon, que ce phénomène arrive. Nous
ne nous arrêterons point à prouver que la nature
charbonneufe ne fe produit que dans les vaiffeaux
fermés. Ce que nous avons dit fur le tartre crud, le
tartre diflillé, la corne de cerf, &c. le prouve affez,
fans compter qu’on trouvera ce phénomène éclairci
aux articles CHARBON 6*PHLOGISTIQUE.
La portion inflammable d’un réduélif qui, en pénétrant
une chaux métallique & s’y unifiant, la rétablit
dans fon état de métal, efl très-peu de chofe
eu égard à fa maflfe ; mais confidérée du côté de fes
effets, on fentira que fa quantité numérique & la ténuité
de fes molécules Amples font prefqu’infinies.
L ’illuflre Stahl s’efl convaincu par fes expériences,
que le phlogiflique ne conflituoit qu’une trentième
partie du foufre, conjointement avec l’acide vitriolique
; mais après plufieurs expériences , il la trouva
à peine un foixantieme. Qui fait d’ailleurs s’il
n’enleve pas avec lui un peu de l’acide vitriolique
auquel il efl uni ? L’imagination fe perd dans les ténèbres
profondes qui enveloppent ce myflere ; &
l ’on n’évaluera vraiffemblablement jamais au nulle
la quantité de ce corps, que nous ne connoiffons que
par les phénomènes qu’il produit avec les autres ; car
jufqu’ici on ne l’a jàmais eu pur & dépouillé de toute
matière étrangère, & peut-être eft-U. incapable d’être
mis en maffe tout feul , & de fe trouver pur ailleurs
que dans l’atmofphere où il efl divifé en fes élé-
mens. Au refie il n’efl pas le feul être dans la nature
qui ne puiffe être foûmis à cette épreuve. L ’air ne fe
corporifie non plus qu’avec les autres corps. Voye^
le traite allemand, du foufre de Stahl, & les art. SOUFRE
, Ph lo g is t iq u e , & Prin cipe.
Le but de ceux qui travaillent au fer-blanc, & de
ceux qui foudent & qui étament, n’efl pas plus de
réduire que d’empêcher la calcination. Tant qu’un
métal fondu n’eft point expofé à l’air ( on en excepte
l’or & l’argent, dont la calcination exige des
manipulations fingulieres), il demeure dans fon état
ordinaire ; mais fi-tôt qu’il a communication avec
lu i , la matière ignée qui joue à-travers , emporte
avec elle celle qui conflitue fa nature métallique,
& ne peut être reparée que par celle que lui fournira
un corps qui en fera imprégné. Ainfi le corps réductif
empêchera la calcination de la partie du bain qu’ il
couvrira , & réduira la chaux de celle qu’il n’aura
pas défendue du contaél de l’air.
Les métaux à fouder veulent être bien avivés ,
avant que la foudure y foit appliquée. S’il y avoit
quelques faletés, elles empêcheroient le contaél du
métal & de la foudure ; on les lime donc pour obtenir
cet avantage : le fer - blanc n’a pas befoin de ce
préliminaire ; feulement dans le cas où il efl gras ,on
le faupoudre de borax. Voye%_ les Fond ans. L’étamage
, qui n’efl que l’application d’une plus grande
furface de fôudiire, exige les mêmes précautions.
Les ouvriers commencent par racler le vaifTeau qui
a été étamé une première fois ; mais quand il efl neuf
ils fe contentent d’y jetter quelques pincées de fel
ammoniac ou de fel marin, qui récurent, & le rendent
par-là propre à s’allier avec l’étamage. Foye^
les Fondans. Par l’ufage où ils font de fe fervir en
pareil cas d’un petit bâton dont l’extrémité efl coëf-
fée d’étoupes, ils ont pour but non-feulement d’appliquer
leur foudure, mais encore de dépouiller les
parois du vaifTeau du charbon de la refine qui y
adhéré quelquefois , & le défend du contaft de la
foudure, ainfi que de la chaux de la foudure que cette
féline n’a pas réduite, parce qu’elle ne couvre
pas tout.
Quand une chaux efl une fois réduite, on a beau
fournir de nouveau phlogiflique au métal, il n’en
prend pas davantage ; il n’en peut plus admettre que
dans le cas où il auroit perdu par le contaél de l’air
celui qu’on lui a fourni. C ’efl ainfi que le même métal
peut devenir chaux, & fe réduire un grand nombre
de fois, fans qu’on en connoiffe les bornes, que
çfans l’étain, qui fe détériore réellement par toutes
ces tortures : le fer aufli fait exception, mais dans
un autre genre ; il efl fufceptible de prendre une fur-
abondance de phlogiflique : c’efl cet excès qui le
fait acier, & qui, bien loin de le rendre plus lié &
plus fufible, comme les autres métaux, ne fait que
le rendre plus caflant & plus réfraélaire : il étoit affez
fufible en fcories, il fe réduit fans fe fondre, devient
moins fufible étant fe r , & n’efl jamais plus rebelle
à la fonte que quand il efl acier. La raifon en efl
encore inconnue.
I I e f l d o n c é v i d e n t q u e l e s m é t a u x & d e m i -m é t
a u x q u i f o n t d e f l r u é l i b l e s à f e u n u d , f u p p o r t e r o n t
p lu s l o n g - t em s l a f o n t e f a n s s ’ a l t é r e r , f i o n a f o i n d e
c o u v r i r l e u r f u r f a c e d e p o u d r e d e c h a r b o n o u d e t o u t
a u t r e c o r p s in f l a m m a b l e , q u e s ’ i l s y é t o i e n t e x p o f é s
a v e c l e c o n t a f t d e l ’ a i r e n v i r o n n a n t : m a i s p a r c e t t e
p r é c a u t i o n , l ’o n n ’ e m p ê c h e p a s f e u l e m e n t q u e c e s
m é t a u x f e c a l c i n e n t , c ’ e f l - à - d i r e q u ’ i l s p e r d e n t l e u r
p h l o g i f l i q u e , m a i s e n c o r e q u e c e m ê m e p h l o g i f l i q u e
n e v o l a t i l i f e a v e c l u i u n e p a r t i e d u m é t a l n o n c a l c
i n é . Voye^ V o l a t i l i s a t i o n .
Nous avons dit que les métaux imparfaits & les
demi-métaux ne fe calcinoient guere que par le con-
ta â de l’air : cela efl vrai de tous, ex'cepté du zinc.
Ce demi - métal fe calcine même dans les vaiffeaux
fermés, au degré de feu qui le met en fonte : on efl
donc obligé, quand on l’allie avec les autres, de lui
fournir un réduétif continuel. C ’efl par cette raifon
que les Chauderonniers font leur foudure forte fous
les charbons embrafés ; qu’on fait le cuivre jaune ;
le tombac, le potin, & c . avec une addition de charbon
ou de tout autre corps inflammable ; que dans le
fourneau de Goflar on attrape le zinc au milieu des
charbons ardens , & qu’on le confume à - travers la
poudre de charbon. *
Jufqu’ici nous avons examiné le feu comme entrant
dans la compofition des corps : nous avons cité
l’exemple du fer converti en acier fans addition,
dans un creufet où le feu fait la double fonction d’inf-
trument & de principe. Deux illuflres chimifles.
•MM. Stahl & Cramer,; ont été embarrâffés d’expliquer
pourquoi une mine de fer étoit attirable par
l’aimant après la calcination ; ce phénomène cepen-
.dant s’explique par celui qui précédé:; mais Je. feu
inflrument ôc le feu principe font-ils le même ? Le fer
.qui fait exception dans ce cas avec tous les corps
connus, femble rinfinuer: font-ils différens ? c’efl
ce qui paroît par la réduction des autres chaux métalliques.
On a beau les'tenir dans un creufet fermé
toutes feules, elles ne prennent pas, comme le fer,
la matière du feu qui paffe à-travers un creufet : il
leur faut fe contaél d’un corps charbonneux ; & elles
veulent être tenues dans les vaiffeaux fermés. La
confidération de ces phénomènes porteroit à croire
que le fer ne s’accommode que d’un phlogiflique pur,
tandis que les autres corps métalliques fèmblent demander
un phlogiflique uni à un autre cûrps., dont
la préfence ne peut être que foupçonnée. Mais fi l’on
admettait cette conjecture, comment la concilier
avec ce qui fe paffe dans la calcination du plomb? La
chaux de plomb pefe plus qu’il ne pefoit auparavant ;
& il n’y a pas d’apparence que le phlogiflique qu’on
foupçonne uni à un autre corps, pefe moins que l e .
phlogiflique pur qui paroît chaffer le premier, pour
s’introduire a fa place fous une différente combinai-
fon, & peut-être félon celle qui fe fait dans.le fer :
car le fer converti en acier par lui-même augmente
de poids ; il efl vrai qu’il n’a pas été préalablement
calciné. Parlons du feu comme infiniment.
Nous avons placé le feu à la tête des fondans;
c’efl en effet l’inflrument qui divifé les corps.» les réfout
, & les rend par-là mifcibles avec les autres.'
Tous les fondans font des menflrues fecs, c’efl-à-
dire des corps durs compofés de parties liées entre
elles, & formant un tout qui réfifle à fa feparation :
ils ne peuvent agir fur les autres, tant qu’ils relieront
fous cette forme ; il leur faut donc un agent qui
change cet état, & leur donne une divifion & une
atténuation capables de leur faire pénétrer les pores
de ceux qu’ils peuvent diffoudre ; cet agent c’efl le
feu : appliqué aux fels & aux métaux avec la force
requife pour chacun d’eux en particulier, & félon
l’art que nous détaillerons aux articles F ourneau &
V aisseau ; il s’infinue à-travers leurs pores, les dilate,
defunit leurs molécules intégrantes, & fouvent
les principes conflituant ces molécules,&c les fait rouler
les unces fur les autres, comme celles d’un fluide
auquel ils reffemblent pour lors. En pareille circonf-
tance, il faut le regarder comme un fluide aâifqui fe
mêle intimement & uniformément avec les corps
qu’il pénétré, & qui en efl divifé mutuellement : on
ne peut mieux comparer fa préfence dans un corps
qu’il rend fluide, qu’à celle d’un grain d’or qu’on a
fondu avec cent mille grains d’argent pur. La Doci-
mafiique nous démontre que chaque grain de cet argent
contient une quantité d’or proportionnelle ,
c’efl-à-dire un cent-millieme de grain d’or : la divifion
de cet or fera encore plus grande , fi on le mele
avec une plus grande quantité d’argent ; & l’on n’en
connoît point les bornes : il faut que le feu réduife
cet or à fes molécules intégrantes ; ces molécules
doivent être d’une fineffe extraordinaire., pour qu’elles
puiffent fe diflribuer uniformément dans toute
la maffe de l’argent. Quelle doit donc être la fineffe
du corps qui a eu la faculté de les defunir, & de les
porter par toute la maffe qu’il a parcourue, ébranlée
& bouleverfée ? Mais il n’efl pas néceflaire, pour
que cette diflribution uniforme du feu dans le corps
le plus dur , ait lieu , que ce corps en foit diffous,
c’efl-à-dire que fes élémens foient féparés les uns
des autres, pour lui laiffer le paffage libre : il efl
aufli uniformément diflribué dans celui qu’il ne commence
qu’à échauffer au-deffus du degré de la glace.
Quelle prodigieufe fineffe ne fuppofepas, àplusfor-
Tomc F I *
te raifon, cette liberté du paffage qu’il fe fraye dans
les pores reflerrés de ces corps ? Cette derniere confidération
porte à croire que rien n’échappe à fon action.:
1
Il efl vrai que les molécules des métaux les plus
durs réfiflent à leur defunion:; & la preuve: en eft: tirée
de la figure globuleufe qu’ils s’efforcent ide garder,
comme le mercure, dans le tems même que le
feu produit l’a&ioh contraire: mais l’exercice de cette.
force efl au moins diminué,.polir ne pas dire abfo-
lument interrompu, tant que dure la même violence
du feu. Il n’efl pas poflîblé de mêler intimement deux
ou: plufieurs maffes quelconques, qu’elles ne foient
diffoutes en; leurs molécules intégrante^.' Que devient
donc cette prétendue cohérence qu’on avoit foup-
çonnéeréfifler à la féparationdes élémens, quand un
corps divifé & pouffé par l’aélivité du feu , fe gliffe
avec un autre entre des parties dans lefquelles on
avoit foupçonné une réfiftance à leur féparation ?
C ’efl donc au feu , comme feul inflrument de la
divifion des corps, qu’on doit attribuer l’exercice de
cette difpofition qu’ils ont à fe diffoudre les uns les
autres: c’efl à lui qu’on doit la produ&ion de ces
phénomènes merveilleux qui naiffent de la eombi-
naifon de plufieurs fubflances. Qui pourroit refufer
le titre d’agent univerfel de la nature,à cet être qui
en efl le principe vivifiant ?
L ’expérience a appris que tous ou prefque tous les
fels étoient des fondans : ainfi le borax, le nitre, le
fel ammoniac , le fel gemme , ou le fel marin, les
vitriols, le mercure fublimé corrofif, les deux alka-
lis fixes, le foufre & fon foie, le fel de Glauber, le
tartre vitriolé , le fel fufible de l’u rine,& enfin la
plupart des fels compofés d’acides devenus concrets
par une bafe quelconque, font des fondans. Foyeç
Sel. Les uns ne mettent en fonte que quelques fubflances
connues jufqu’ici ; les autres y en mettent plufieurs
: ceux-ci agiffent par un de leurs principes feulement
, ceux-là par tous les deux. Ils exercent leurs
aérions fur,les terres, les pierres, les verres, les demi
métaux , les métaux, leurs chaux, leurs précipités,
leurs verres, & toutes ces matières fur elles-mêmes.
De ce nombre prodigieux de fubflances il naît
une foule de combinaifons dont on peut s’aflurer
qu’on ne connoît encore que le plus petit nombre ,
quelque grand que foit celui qui a été tenté jufqu’ici.'
Mais fi l’on ne connoît que la moindre partie des
combinaifons qui peuvent être faites fur les fiibflan-
ces connues, quelle efpérance de parvenir à la con-
noiffance de celles qui exiflent peut-être inconnues
dans le fein de la nature, & de celles que l’art peut
produire ? On trouve un grand nombre de ces combinaifons
dans différens ouvrages, & particulièrement
dans la Lithogéognofie, fi on les confidere en
elles-mêmes, & par le travail qu’elles ont dû coûter.
Mais fi on vient à les comparer avec ce qui refie à
faire, la carrière efl immenfe ; & ces ouvrages, 8c
principalement celui de M. Pott, femblent n’exifler
que pour accufer la brièveté de la vie. Quelle foule
de réflexions accablantes ne doit pas offrir l’exercice
de plufieurs genres, fi un feul fuffit pour cela ?
Il y a des corps qui fe fondent par eux-mêmes, &
dont l’addition d’un autre corps ne fait qu’accélérer
& faciliter la fufion : tels font tous les métaux &
demi-métaux , les métaux parfaits dont l’aggréga-
tion feroit rompue en molécules, à-travers lefquelles
il n’y auroit aucune impureté, la plûpart des fels,
toutes les terres & les pierres vitrefcibles ; bien entendu
que cette addition change leur nature, fi elle
s’unit avec eux ; on peut conféquemments’enpaffer.
D ’autres n’entrent en fonte que par un intermède
abfolument néceflaire : dans ce rang on place les
métaux parfaits, dont l’aggrégation eft rompue, &ç
dont les molécules ne peuvent avoir de çpntaél mu*
* A A A a à a ij