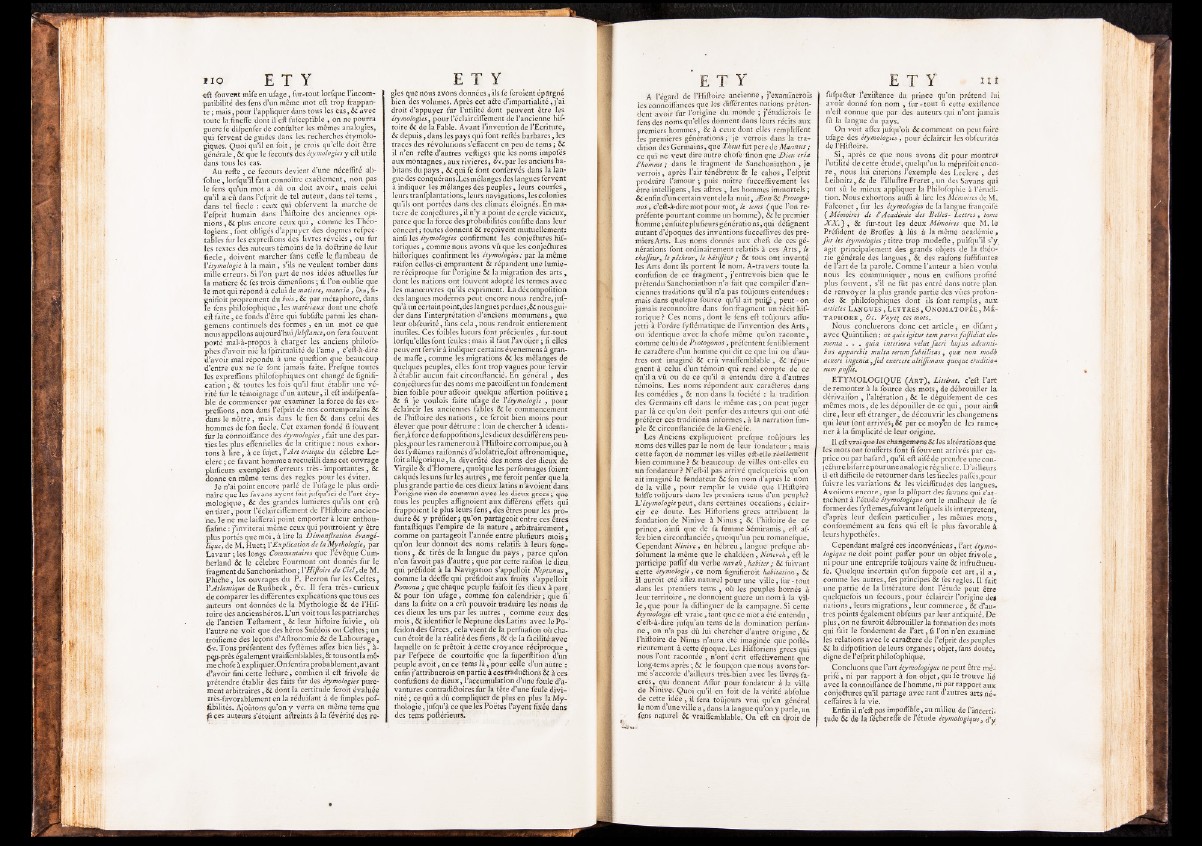
•eft fouvent mife en ufage, fur-tout lorfque l’incompatibilité
des fens d’un même mot eft trop frappante
; mais, pour l’appliquer dans tous les Cas, & avec
loute la fineffe dont il eft fufceptible , on ne pourra
guere fe difpenfer de confulter les mêmes analogies,
■ qui fervent de guides dans les recherches étymologiques.
Quoi qu’il en foit, je crois qu’elle doit etre
générale, & que le fecours des étymologies y eft utile
dans tous les cas. •
Au refte, ce fecours devient d’une néceffité âb-
folue, lorfqu’il faut connoître exactement, non pas
le fens qu’un mot a dû ou doit avoir, mais celui
qu’il a eu dans l’efprit de tel auteur, dans tel tems ,
dans tel fiecle : ceux qui obfervent la marche de
l ’efprit humain dans l'hiftoire des anciennes opinions
, & plus encore ceux q u i, comme les Théologiens
, font obligés d’appuyer des dogmes refpec-
tables fur les expreffions des livres révélés, ou Ailles
textes dès auteurs témoins de la doCtrine de leur
fiecle, doivent marcher fans ceffe feflambeau de
Vétymologie à la main, s’ils ne veulent tomber dans
mille erreurs. Si l’on part de nos idées actuelles fur
la matière &c fes trois dimenfions ; fi l’on oublie que
le mot qui répond à celui de matière, materia, Sx», fi-
gnifioit proprement du bois, & par métaphore, dans
le fens phiiofophique, les matériaux dont une chofe
eft faite, ce fonds d’être qui fubfifte parmi les chan-
gemens continuels des formes , en un mot ce que
nous appelions aujourd’hui fubjiance, on fera fouvent
porté mal-à-propos à charger les anciens philofo-
phes d’avoir nié la fpiritualité de l’ame , c’eft-à-dire
d’avoir mal répondu à une queftion que beaucoup
d’entre eux ne fe font jamais faite. Prefque toutes
les expreffions philofophiques ont changé de lignification
; & toutes les fois qu’il faut établir une vérité
fur le témoignage d’un auteur, il eft indifpenfa-
ble de commencer par examiner la force de les expreffions
, non dans l’efprit de nos contemporains &
dans le nôtre, mais dans le lien & dans celui des
hommes de fon fiecle. Cet examen fondé fi fouvent
fur la connoiffance des étymologies , fait une des parties
les plus effentielles de la critique : nous exhortons
à lire, à ce fujet, l'A n critique du célébré Leclerc
; ce favant homme a recueilli dans cet ouvrage
plufieurs exemples d’ erreurs très-importantes , &
donne en même tems des réglés pour les éviter.
Je n’ai point encore parlé de l’ufage le plus ordinaire
que les favans ayent fait jufqu’ici de l’art étymologique,
& des grandes lumières qu’ils ont crû
en tirer, pour l’ éclaircifTement de l’Hiftoire ancienne.
Je ne me laifferai point emporter à leur enthou-
fiafme : j’inviterai même ceux qui pourraient y être
plus portés que moi, à lire la Démonflration évangélique,
de M. Huet; l’Explication de la Mythologie, par
Lavaur ; les longs Commentaires que l’évêque Cumberland
& le célébré Fourmont ont donnés fur le
fragment de Sanchoniathon ; YHiftoire du Ciel, de M.
Pluche, les ouvrages du P. Pezron fur les C eltes,
Y Atlantique de Rudbeck , &c. Il fera très-curieux
de comparer les différentes explications que tous ces
auteurs ont données de la Mythologie & de l’Hiftoire
des anciens héros. L’un voittous les patriarches
de l’ancien Teftament, & leur hiftoire fui v ie , oit
l ’autre ne voit que des héros Suédois ou Celtes ; un
troifieme des leçons d’Aftronomie & de Labourage,
6*c.Touspréfentent des fyftèmes affez bien liés, à-
pqp-près egalement vraiffemblables, & tous ont la même
chofe à expliquer.Onfentira probablement,avant
d’avoir fini cette leCture, combien il eft frivole de
prétendre établir des faits fur des étymologies purement
arbitraires, & dont la certitude feroit évaluée
très-favorablement en la réduifant à de fimples pof-
fibilités. Ajoûtons qu’on y verra en même tems que
ft ces auteurs s’étoient aftreints â la févérité des regles
que nous avons données, ils fe feroient épargné
bien des volumes. Après cet aCte d’impartialité, j’ai
droit d’appuyer fur l’utilité dont peuvent être les
étymologies, pour l’é clair ciffement de l’ancienne hiftoire
& de la Fable. Avant l’invention de l’Ecriture,
& depuis, dans les pays qui font reftés barbares, les
traces dès révolutions s’effacent en peu de tems ; &
il n’en refte d’autres veftiges que les noms impofés
aux montagnes, aux rivières, par les anciens ha-
bitans du pa ys , & qui fe font conl'ervés dans la langue
des conquérans.Les mélanges des langues fervent
à indiquer les mélanges des peuples, leurs courfes ,
leurs tranfplantations, leurs navigations, les colonies
qu'ils ont portées dans des climats éloignés. En ma*
tiere de conjectures, il n’y a point de cercle vicieux,
parce que la force des probabilités confifte dans leur
concert ; toutes donnent & reçoivent mutuellement:
ainfi les étymologies confirment les conjectures historiques
, comme nous avons vû que les conjectures
hiftoriques confirment les étymologies: par la même
raifon celles-ci empnmtent & répandent.une lumière
réciproque fur l’origine & la migration des arts ,
dont les nations ont fouvent adopté les termes avec
les manoeuvres qu’ils expriment. La décompofition
des langues modernes peut encore nous rendre, juf-
qu’à un certain point,des langues perdues,& nous guider
dans l’interprétation d’anciens monumens, que
leur obfcurité, fans cela, nous rendroit entièrement
inutiles. Ces foibles lueurs font précieufes , fur-tout
lorfqu’ellesfont feules : mais il faut l’avoiier ; fi elles
peuvent fervir à indiquer certains évenemens à grande
maffe, comme les migrations & les mélanges de
quelques peuples, elles font trop vagues pour fervir
à établir aucun fait circonftancié. En général , des
conjectures fur des noms me paroiffent un fondement
bien foible pour affeoir quelque affertion pofitive ;
& fi je voulois faire ufage de Y étymologie , pour
éclaircir les anciennes fables & le commencement
de l’hiftoire des nations, ce feroit bien moins pour
élever que pour détruire : loin de chercher â identifier^
force de fuppofitions,les dieux des différens peuples,
pour les ramener oii à l’Hiftoire corrompue,ou à
des fyftèmes raifonnés d’idolâtrie,foit àftronomique,
foit allégorique, la diverfitë des noms des dieux de
Virgile & d’Homere »quoique lesperfonnages foient
calqués les uns fur les autres, me feroit penler que la
plus grande partie de-ces dieux latins n’àvoient dans
l’origine rien de commun avec les dieux grecs ; que
tous les peuples affignoient aux différens effets qui
frappoient le plus leurs fens, des êtres pour les produire
& y préfider qu’on partageoit entre ces etres
fantaftiques l’empire de la nature, arbitrairement,
comme on partageoit l’année entre plufieurs mois ;
qu’on leur donnoit des noms relatifs à leurs fonctions
, & tirés de la langue du pays , parce qu’on
n’en favoit pas d’autre ; que par cette raifort lé dieu,
qui préfidoit à la Navigation s’appelloit Neptunus ,
comme la déeffe qui préfidoit aux fruits s’appelloit
Pomona ; que chaque peuple faifoit fes dieux à part,
& pour fon ufage, comme fon calendrier; que f i1
dans la fuite on a crû pouvoir traduire les noms de
ces dieux les uns par les autres , comme ceux des
mois, & identifier le Neptune des Latins avec le Po-’
feidon dés Grecs, cela vient de la perfuafion oii chacun
étoit de la réalité des liens, & de la facilité avec
laquelle on fe prêtoit à cette croyance réciproque ,
par l’efpece de courtoifie que la fuperftition d’un
peuple avoit, en ce tems là , pour celle d’un autre :
enfin j’attribuerois en partie à ces tfaduCtions & à ces
confufions de dieux, l’accumulation d’une foulé d’a-
vantures contradictoires fur la tête d’une feulé divinité
; ce qui a dû compliquer de plus en plus la Mythologie
, jufqu’à ce que les Poètes l’ayent fixée dans
des tems poftérieurs.
A l’égard de l’Hiftoire ancienne, j’exafnmeirbis
les connoiffances que les différentes nations prétendent
avoir fur l’origine du monde ; j’étudierois le
fens des noms qu’elles donnent dans léurs récits aux
premiers hommes, & à ceux dont elles rempliffent
les premières générations je verrois dans la tradition
des Germains, que Theut frit pere de Mannus ;
ce qui ne veut dire autre ehôfe'finon que Dieu créa
Vhomme ; dans le fragment dé Sanchoniathon * je
verrois, après l’air ténébreux & le eahos, l ’efprit
produire l’amour; puis naître fucceffivement les
être intelligens, les aftres , les hommes immortels ;
& enfin d’iin certain vent de la nuit, Æon & Protogo-
nos, c’eft-à-dire mot pour mot, le tems (que l’on repréfente
pourtant comme un homme), & le premier
homme ; enfuite plufieurs générations, qui defigiient
autant d’époques des inventions fucceffives des premiers
Arts. Les noms donnés aux chefs de ces générations
font ordinairement relatifs à ces Arts, le
chaffeur, le pêcheur, le bâtijjhir ; & tous ont inventé
les Arts dont ils portent lé nom. A-travers toute la
confufion de ce fragment, j’entrevois bien que le
prétendu Sanchoniathon n’a fait que compiler d’anciennes
traditions qu’il n’a pas toûjours entendues :
mais dans quelque fotirce qu’il ait p u i^ , peut - on
jamais reconnoître dans fon fragment un récit'hif-
torique ? Ces noms, dont le fens eft toûjours affu-
jetti àT l’ordre fyftématique de l’invention des A rts,
ou identique avec la chofe même qu’on raconte,
comme celui de Protogonos, préfentent fenfiblement
le caraCtere d’un homme qui* dit ce que lui ou d’autres
ont imaginé & crû vraiffemblable , & ' répugnent
à celui d’un témoin qui rend compte de ce
qu’il a vû ou de ce qu’il a entendu dire à d’autres
témoins. Les noms répondent aux caraCteres dans
les comédies , & non dans la fociété ; la tradition
des Germains eft dans le même cas ; on peut juger
par là ce qu’on doit penfer des auteurs qui ont ofé
préférer ces traditions informes, à la narration fim-
ple & circonftànciée de la Genèfe*
Les Anciens expliqüoient prefque toûjôurs les
noms des villes par le nom de leur fondateur ; mais
cette façon de nommer les villes eft-elle réellement
bien commune ? & beaucoup de villes ont-elles eu
un fondateur ? N’eft-il pas arrivé quelquefois qu’on
ait imaginé le fondateur & fon nom d’après le nom
de la ville , pour remplir le vuide que l’Hiftoire
laiffe toûjours dans les premiers tems d’un peuple?
TJ étymologie peut, dans certaines occafions, éclaircir
ce doute. Les Hiftoriens grecs attribuent la
fondation de Ninive à Ninus ; & l’hiftoire de ce
prince, ainfi que de fa femme Sémiramis, eft affez
bien circonftànciée, quoiqu’un peu romanefque.
Cependant Ninive , en hébreu, langue prefque ab-
folument la même que le chaldéen, Nineveh, eft le
participe paffif du Verbe navah, habiter ; & fuivant
cette étymologie, ce nom fignifieroit habitation , &
i l aiiroit été allez naturel pour une v ille , fur - tout
■ dans les premiers tems , où les peuples bornés à
leur territoire, ne donnoient guere un nom à la ville
, que pour la diftinguer de la campagne. Si cette
étymologie eft v ra ie , tant que ce mot a été entendu,
c’eft-à-dire jiifqu’au tems delà domination perfan-
n e , on n’a pas dû lui chercher d’autre origine, &
l ’hiftoire de Ninus n’aura été imaginée que pofté-
rieurement à cette époque. Les Hiftoriens grecs qui
nous l’ont rac.orttée , n’onf écrit effeâivement que
long-tems après ; & le foupçon que nous avons formé
s’accorde d’ailleurs très-bien avec les livres fa-
crés, qui donnent Affur pour fondateur à la ville
de Ninive. Quoi qu’il en foit de la vérité abfolue
de cette idée , il fera toûjours vrai qu’en général
le nom d’une ville a , dans la langue qu’on y parle, un
fens naturel & vraiffemblable. On eft en droit de
fufpe£ler l’exiftence du prince qu’ôn prétend luî
avoir donné fon nom , fur-tout fi cette exiftence
n’eft connue que par des auteurs qui n’ont jamais
fû la langue du pays.
On voit affez jufqu’où & comment on peut faifé
ufage des étymologies, pouf éclaircir les obfcurité»
de l’Hiftoire.
S i, après ce que nous avons dit pour montrer
l’utilité de cette etude', quelqu’un la méprifoit encore
, nous lui citerions l’exemple des Leclerc , des
Leibnitz» & de l’illuftre Freret, un des Savans qui
ont sû le mieux appliquer la Philofophie à l’érudition.
Nous exhortons auffi à lire les Mémoires de M.
Falcoriet, fur les étymologies de là langue françoifé
( Mémoires de VAcadémie des Belles- Lettres, tome
X X .} , & fur-tout les deux Mémoires que M. le
Préfident de Broffes à lûs à la même académie »
fur les étymologies ; titre trop modefte, puifqii’il s’y
agit principalement des grands objets de là théorie
générale des langues, & des raifons fuffifantes
de l’art de la pàrole. Comme l ’auteur a bien voulut
nous les communiquer, nous en eiiffions profité
plus fouvent, s’il ne fût pas entré dans notre plan
de renvoyer la plus grande partie des vûes profondes
& philofophiques dont ils font remplis, aux
articles Langues , LE T T R E S , O N O M A T O P E E , MÉT
A PH O R E , &c. Voye{ ces mots.
Nous concluerons donc cet article, en difant
avec Quintilieri : lie quis igitur tam parva fajlidiat de-
menta,. . quia interiora velut facri hujus adeunti-
bus apparebit multa rerum fubtilitas, quee non modb
acuere ingénia ,fed exercere altiffimam quoque érudition
nem pojjiii
ETYMOLOGIQUE (Art), Littérat. c’eft. l’art
de remonter à la fource des mots, de débrouiller la
dérivaifon , l’altération, èc le déguifement de ces
mêmes mots, de les dépouiller de ce qui, pour ainfi
dire, leur eft étranger * de découvrir les changemens
qui leur font arrives, & par ce mo/en de les rame«
ner à la fimplicité de leur origine.
Il eft vrai que les changemens & les altérations que
les mots ont foufferts font fi fouvent arrivés par caprice
ou par hafard, qu’il eft àifé de prendfe une conjecture
bifarre pour une analogie régulière. D ’ailleurs
il eft difficile de retourner dans les fiecles pafles,pour
fuivre les variations & les viciffitudes des langues.
Avouons encore, que la plûpart des favans qui s’attachent
à l’étude étymologique ont le malheur de fe
former des fyftèmes,fuivant lefquels ils interprètent,
d’après leur deffein particulier, les mêmes mots,
conformément au fens qui eft le plus favorable à
leurs hypothèfes.
Cependant malgré cës incortvéniens, l’art étymologique
rie doit point paffer pour un objet frivole ,
ni pour une entreprife toûjours vaine & infruétueu-
fe. Quelque incertain qu’on fuppofe cet art, il a ,
comme les autres, fes principes & fes réglés. Il fait
une partie de la littérature dont l’étude peut être
quelquefois un fecours, pour éclaircir l’origine de*
riatioris, leurs migràtions, leur commerce, & d’autres
points également ôbfcürs par leur antiquité. De
plus, cm ne fauroit débrouiller la formation des mots
qui fait le fondement de l’a r t , fi l’on n’en examine
les relations àvéc le caraCtere de l’efprit des peuples
& la difpofition de leurs orgànes ; objet, fans doute,
digrie de l’efprit phiiofophique.
Concluons que l’art étymologique ne peut être mé-*
prifé, ni par rapport à fon objet, qui fe trouve lié
avec la connoiffance de l’homme, ni par rapport aux
conjectures qu’il partage avéc tant d’autres arts né**
ceffaires à la vie.
Enfin il n’eft pas impôftîbie, au milieu de l’incerti.
tude ôt de la féchèreffe de l’étude Itymologiqm, d’y