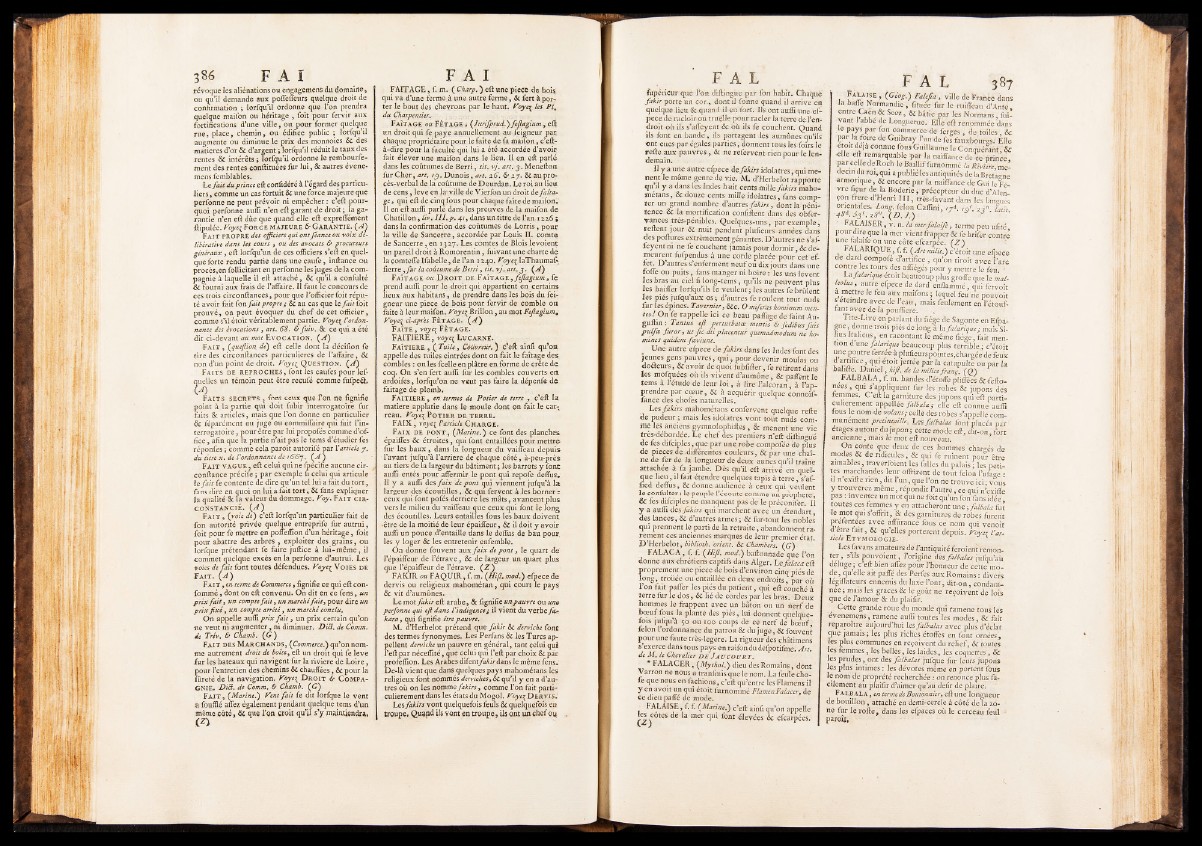
révoque les aliénations ou engagemens du domaine,
ou qu’il demande aux poffeffeurs quelque droit de
confirmation ; lorfqu’il ordonne que l’on prendra
quelque maifon ou héritage , l'oit pour fervir aux
fortifications d’une v ille , ou pour former quelque
rue, place, chemin, ou édifice public ; lorfqu’il
augmente ou diminue le prix des monnoies 8c des
matières d’or & d’argent ; lorlqu’il réduit le taux des
rentes & intérêts ; ïorfqu’il ordonne le rembourfe-
ment des rentes constituées fur lui, 8c autres evene-
mens femblables.
Le fait du prince eft eonfidéré à l’égard des particuliers
, comme un cas fortuit & une force majeure que
perfonne ne peut prévoir ni empêcher : c’eft pourquoi
perfonne aufli n’en eft garant de droit ; la garantie
n’en eft due que quand elle eft expreffément
ftipulée. V o y e { F o r c e m a j e u r e & G a r a n t ie . (A ~)
Fa i t PROPRE des officiers qui ont fiance ou voix délibérative
dans les cours , ou des avocats & procureurs
généraux, eft lorfqu’un de ces officiers s’eft en quelque
forte rendu partie dans une caufe, inftance ou
procès,en follicitant en perfonne les juges de la compagnie
à laquelle il eft attaché, & qu’il a confulté
& fourni aux frais de l’affaire. Il faut le concours de
ces trois circonftances, pour que l’officier foit réputé
avoir fait fon fait propre ; 8c au cas que le fait foit
prouvé, on peut évoquer du chef de cet officier,
comme s’il étoit véritablement partie. Voye^ l'ordonnance
des évocations , art. <58. & fuiv. 8t ce qui a été
dit ci-devant au mot E v o c a t i o n , (A )
F a i t , (queftion de) eft celle dont la décifion fe
tir e des circonftances particulières de l ’affaire, 8c
non d’un point de droit, f^oye^ Q u e s t io n . (A )
F a i t s d e r e p r o c h e s , font les caufes pour les quelles
un témoin peut être reeufé comme fufpeét,
t m
F a i t s s e c r e t s > font ceux que Fon ne lignifie
point à la partie qui doit fubir interrogatoire fur
faits 8t articles, mais que l’on donne en particulier
& féparément au juge ou commiflaire qui fait l’interrogatoire
, pour être par lui propofés comme d’office
, afin que la partie n’ait pas le tems d’étudier fes
réponfes ; comme cela paroît autorifé par l’article y.
du titre x . de l'ordonnance de \66rj . (A )
F a i t v a g u e , eft celui qui ne fpecine aucune cir-
conftance précife ; par exemple fi celui qui articule
le fait fe contente de dire qu’un tel lui a fait du tort,
fans dire en quoi on lui a fait tort, & fans expliquer
la qualité 8c la valeur du dommage. Voy. Fa i t c ir c
o n s t a n c i é . { A )
F a i t , ( v o i e d e ) c’eft lorfqu’un particulier fait de
fon autorité privée quelque entreprife fur autrui,
foit pour fe mettre en poffeffion d’un héritage, foit
pour abattre des arbres , exploiter des grains, ou
lorfque prétendant fe faire juftice à lui-même, il
commet quelque excès en la perfonne d’autrui. Les
v o ie s d e fait font toutes défendues. V o y e ^ V o ie s d e
F a i t . ( A )
Fa it , en terme de Commerce , lignifie ce qui eft con-
fommé, dont on eft convenu. On dit en ce fens, un
prix fa it, un compte fait, un marché fait, pour dire un
prix f ix é , un compte arrêté , un marché conclu.
On appelle aufli prix fait , un prix certain qu’on
ne veut ni augmenter, ni diminuer. Dict, de Comm.
de Trév. & Chamb. (G )
Fa i t d e s M a r c h a n d s , ( iCommerce.) qu’on nomme
autrement droit de boîte, eft un droit qui fe leve
fur les bateaux qui navigent fur la riviere de Loire,
pour l’entretien des chemins 8c chauffées, & pour la
fureté de la navigation, Voye{ D r o i t & C o m p a g
n i e , Dicl. de Comm. & Chamb. (G)
F a i t , (Marine.) Vent fait fe dit lorfque le v en t
a foufflé allez également pendant quelque tems d’un
même côté, 8c que l’on croit qu’il s’y maintiendra.
FAITAGE, f. m. ( Charp. ) eft une piece de bois;
qui va d’une ferme j t une autre ferme, & fert à porter
le bout des chevrons par le haut, f^oye^ les P l.
du Charpentier..
Fa ît a g e ou F ê t a g e > (Jurifprud.) fefiagium, eft
un droit qui fe paye annuellement au Seigneur pai,
chaque propriétaire pour le faîte de fa maifon, c’eft-
à-dire pour la faculté qui lui a été-accordée d’avoir
fait élever une maifon dans le lieu. Il en eft parlé
dans les coutumes de Berri, tit. vj. art. 3 . Menefton
fur Cher, art. ig. D unois, art. zG. & xy. 8c au procès
verbal de la coutume de Dourdan. Le roi au lieu
de cens, leve en la^. ville de Vierfonun droit de faîtage
, qui eft de cinq fous pour chaque faîte-de maifon.'
Il en eft aufli parlé dans les preuves de la maifon de
Chatillon, liv. I I l.p . 4/, dans un titre de l’an 1226 »
dans la confirmation des coutumes de Lorris , pour
la ville de Sancerre, accordée par Louis II. comte
de Sancerre, en 13 27» Les comtes de Blois levoient
un pareil droit à Romorentin, fuivant une charte de
la comteffe Ifabelle, de l’an 1240. Voye^ laThaumafi
lierre ,fur la coutume de Berri, lit. vj. art. 3 . (A )
Fa î t a g e ou D r o i t d e F a i t â g e , fefiagium, le
prend aufli pour le droit qui appartient en certains
lieux aux habitans, de prendre dans les bois du fei-
gneur une piece de bois pour fervir de comble ou
faîte à leur maifon. Voye^ Brillon, au mot Fefiagium;
Voye{ ci-dpres FÊTAGE. (A )
F a ît e , voyéi F ê t a g e .
FAITIERE, voye^ Lu CARNE*
Fa ît ie r e , (.Tuile , Côüvreüf. ) C’eft airifi qu’on
appelle des tuiles cintrées dont on fait le faîtage des.
combles : on les fcelle en plâtre en forme, de crête de
coq. On s’en fert aufli fur les combles couverts en
ardoifes, lorfqu’on ne veut pas faire la dépenfe de.
faîtage de plomb.
Fa î t i e r e , en'termes de Potier de terre , c’eft la
matière applatie dans le moule dont on fait le carreau.
Voye^ P o t i e r d e t e r r e .
FAIX , voye[ Farticle CHARGE.
F a i x d e p o n t , (Marine.) ce font des planches
épaiffes 8c étroites, qui font entaillées pour mettre
fur les b au x , dans la longueur du vaiffeau depuis
l’avant jufqu’à l ’arriere de chaque cô té, à-peu-près
au tiers de la largeur du bâtiment ; les barrots y font
aufli entés pour affermir le pont qui repofe deffus.
Il y a aufli des faix de pont qui viennent jufqu’à la
largeur des écoutilles, & qui fervent à les borner:
ceux qui font pofés derrière les mâts, avancent plus
vers le milieu du vaiffeau que ceux qui font le long
des écoutilles. Leurs entailles fous les baux doivent
•être de la moitié de leur épaiffeur, 8c il doit y avoir
aufli un pouce d’entaille dans le deffus de bau pour
les y loger & les entretenir enfemble.
On donne fouvent aux faix de pont, le quart dé
l’épaiffeur de l’étrave, 8c de largeur un quart plus
que l’épaiffeur de l’étrave. ( Z )
FAKIR ou FAQU1R , f. m. (Hiß, mod.) efpece de
dervis ou religieux mahométan, qui court le pays
8c vit d’aumônes.
Le mot fakir eft arabe, & fignifie unpauvre ou uns
perfonne qui efi dans l'indigence i il vient du verbe fa-,
kara, qui fignifie être pauvre.
M. a’Herbelot prétend que fakir 8c derviche font
des termes fynonymes. Les Perfans 8c les Turcs appellent
derviche un pauvre en général, tant celui qui
l’eft par néceflité, que celui qui l’eft par choix 8c par
profeflion. Les Arabes dàïent fakir dans le même fens.'
De-là vient que dans quelques pays mahométans les
religieux font nommés derviches, 8c qu’il y en a d’autres
où on les nomme fakirs, comme l’on fait particulièrement
dans les états du Mogol. V o y e ^ D e r v is .'
Les fakirs vont quelquefois feuls & quelquefois en
troupe, Quand ils vont en troupe, ils ont un chef 014
iupérieur que l’on distingue par fon habit. Chaque
fakir porte un cor., dont il fonne quand il arrive en
quelque lieu & .quand il en fort. Ils ont auflî nne -efpece
de raçtoir où truelle pour racler la terre de l’endroit
où ils s’affeyent 8c où ils fie couchent. Quand
ils font en bande, ils partagent les aumônes qu’ils
ont eues par égales, parties ; donnent tous les foirs le
refte.aux pauvres, & ne refervent rien pour le lendemain.
Il y a une autre efpece de fakirs idolâtres, qui mènent
le môme genre de vie. M. d’Herbelot rapporte
qu’il y a dans les Indes huit cents mille fakirs maho-
metans, & douze cents mille idolâtres, fans compter
un grand nombre d’autres fakirs, dont la pénitence
8c la mortification çonfifterit dans des obfer-
Vances ;tres-penibles. Quelques-uns, par exemple,
teftent jour 8c nuit pendant plufieurs années dans
des poftures extrêmement gênantes. D ’autres ne s’afi
ieyent ni ne fe couchent jamais pour dormir, 8c demeurent
fufpendüs à une corde placée pour cet e f fet.
D ’autres s’enferment neuf ou dix jours dans une
foffe ou puits, fans manger ni .boire : les uns lèvent
les bras au ciel fi long-tems, qu’ils ne peuvent plus
les baiffer lorfqu’ils le veulent ; les autres fe brident
les piés jufqu’aux o s ; d’autres fe roulent tout nuds
fur les épines. Tavernier, 8cc. O miferas homhnum menu
s ! On fe rappelle ici ce beau paffage de faint Au-
guftin : Tantus efi perturbatee mentis & fedibUsfuis
pulftz fu r or, ut fie dii placentur quemadmodum ne hermines
quidern foeviunt. -
Une autre efpece de fakirs dans les Indes font des
jeunes gens pauvres, qui, pour devenir moulas ou
do&eurs, 8c avoir de quoi fùbfifter, fe retirent dans
les mofquées où ils vivent d’aumône, 8c paffent le
tems à l’étude de leur lo i , à lire l’alcoran, à l’apprendre
par coe u r, 8c à acquérir quelque connoif-
fance des chofes naturelles.
Les fakirs mahométans confervent quelque reftè
de pudeur ; mais les idolâtres vont tout nuds comme
les anciens gymnofophiftes, & mènent une vie
très-débordée. Le chef des premiers n’eft diftingué
de fes difciples, que par une robe compofée de plus
de pièces, de .differentes couleurs, 8c par une chaîne
de fer de la longueur de deux aunes qu’il traîne
attachée à fa jambe. Des qu’il eft arrivé en-quel- '
que lieu , il fait étendre quelques tapis à terre, s’af-
ned deffus, 8c donne audience à ceux qui veillent ^
le eonfulter : le peuple l’écoute comme un prophète, :
& fes difciples ne manquent pas de le préconifen II
y a aufli des fakirs qui marchent a vec un étendart
des lances , 8c d’autres armes ; 8c fur-tout les nobles
qui prennent le parti-de la retraite, abandonnent rarement
ces anciennes marques de leur premier état.
D ’Herbelot, biblioth. orient. 8c Chamb ers. (G )
FA LA C A , f. f. (Hifi. mod.) baftonnade que l’on
donne aux chrétiens captifs dans Alger. Lefalaca eft
proprement une piece de bois d’environ cinq piés dé
long, trouée ou entaillée en deux endroits, par où
l’on fait paflèr les piés du patient, qui eft couché à
terre fur le dos, 8c lié de cordes par les bras. Deux
hommes le frappent avec un bâton ou un nerf de
boeuf fous la planté des piés, lui donnent quelquefois
jufqu’à 50 ou 100 coups de ce nerf de boeuf
félon l’ordonnance du patron & du juge, 8c fouvent
pour une faute très-legere. La rigueur des châtimens
s’exerce dans tous pays en raifon du delpotifme. Art.
de M . le Chevalier DE J AU COURT.■
* FAL ACER, (Mythol.) dieu des Romains, dont
Varron ne nous a tranfmis que le nom. La feule cho-
fe que nous en fâchions, c’eft qu’entre les Flamens il
y en avoit un qui étoit furnommé FlamenFalacer, de
ce dieu paffé de mode.
FALAISE, f. f. (Marine.) c’eft ainfi qu’on appelle
les cotes de la mer qui font élevées 8c efearpées.
î ë u î ' f s B <G{og.) W È à ville dé Crante dans
ia,Baffe Normandie, limée fur le niiffeau d‘Ante,
entre Caen & Seèz, & bâtie par les Normans . fui-
vant 1 abbe de Longuerue; Elle eft renommée dans
. Je pays par foniconimerce'-dè'ferges , de toiles, &
; çar la foire de Guibray l'un'dc fes faïutbourest Elle
' W « i<3rttlne foas Gllillàume le Conquérant, &
■ elle, eft remarquable * a r la naiffance d c ï t drincé,
par celle de Roch le Baillif furnommé la RîyUte.me-
j 'decin dufoi^qui a publiélesantiquités delaBrethgne
armoriqué, & encore par la naiffance de Gui le Fé-
| âe la Boderie P précepteur du duc d’Alen-
, ' î on fferë d’Henri I I I , très-favant dans lés langues
; orientales. Long. félon Caffini, <7 <i. ,aO x i " lata
; ■ ■
FALAISER, v. n. la mtvfàtaift, terme peu ufité
\ Pour * f e que la mer vient frapper & fe brifer contré
une falaife ou une côte efearpée. ( Z )
FALARIQUE, f. f. cV o it une efpece
de dard- eompofe d’artiliee s ’qii’on tiroit avec Tare
, contre les tours des affiégés pour y mettre le fèiï - ‘
i-a/alan jne- ctoit beaucoup plus gfoffe que le mal-
, -üolus, . autre efpéCe de dard enflammé, qui fervoit
« ffleftre le feu aux maifonsf lèquel feunériôtivoit
s eteindre avec de l’eau , mais feulement en l’étoufrant
avec de là poùflîere. ,
Tite-Live en parlant du fiége de Sàgonte en Efpâ-
gne, donne trois pies de long à la falarique; maisSi-
lms Italicus, en racontant le même fiége, fait mention
d’une falarique beaucoup plus terrible.; c’ëtoit
une poutre ferrée à plufieurspointes,chargée de feux
F a,ri 1” Cl ’ jettée par la catapulte ou par la.
baliite. Daniel, hifi. de la milice franç. (Q)
FALBALA, f. m. bandes d’étoffe pliffées &fiefto-
nees, qui s’appliquent fur les robes & jupons dés
femmes. G eft la garniture des jupons qui eft particulièrement
appellée falbala; elle eft connue aufli
fous le nom-de volans; celle des robes s’appelle communément
pretintaille. Les falbalas font placés par
étages autour du jupon ; cette mode eft, dit-on fort
ancienne j mais le mot eft nouveau.
On conte que deux de ces hommes chargés de
modes & de ridicules, & qui fe ruinent pour être
aimables, traverfoient les lalles du palais ; les petites
marchandes leur offrirent de tout félon l’ufaae :
il n’exifte rien, dit l’un, que l’on ne trouve ici; vous
y trouverez même, répondit l ’autre, ce qui n’exifte
pas : inventez un mot qui né foit qu’un fon'fans idée
toutes ces femmes y en attacheront une ; falbala fut
le mot qui s’offrit, & des garnitures de robes furent
prefentees avec affurance fous ce nom qui venoît
d’etre fait, 8c qu’elles portèrent depuis. Foyer l 'article
E t y m o l o g i e .
Les^favans amateuris de l’antiquité feroient Remonte
r , s’ils pOuvpient, l’origine des falbalas jufqu’aù
déluge ; c’eft bien affez pour l’honneur de cette mode,
qu’elle ait paffé des Perfes aux Romains : divers
lé^iflateurs ennemis du luxe-l’ont, dit-on, cbndaiiï-
nee; mais les grâces 8c le goût ne reçoivent de loi'S
que de l’amour & du plaifir.
^ Cette grande roue du monde qui famene tous les
evenemens, ramene aufli toutes les modes , 8c fait
reparoître aujourd’hui les falbalas avec plus d’éclat
que jamais; les plus riches étoffes en font ornées,
les plus communes en reçoivent du relief , & toutes
les femmes, les belles, les laides, les coquettes , 8c
les prudes, ont des falbalas jufque fur leurs jupons
les plus intimes : les dévotes même en portent fous
le nom de proprété recherchée : on renonce plus facilement
au plaifir d’aimer qu’au defir de plaire.
Fa l b a l a , en terme de Boutonnier, eft une longueur
de bouillon, attaché en demi-cercle à côté de la zô- •
ne fur le rofte, dans les elpaces où le cerceau feiil
paroît»