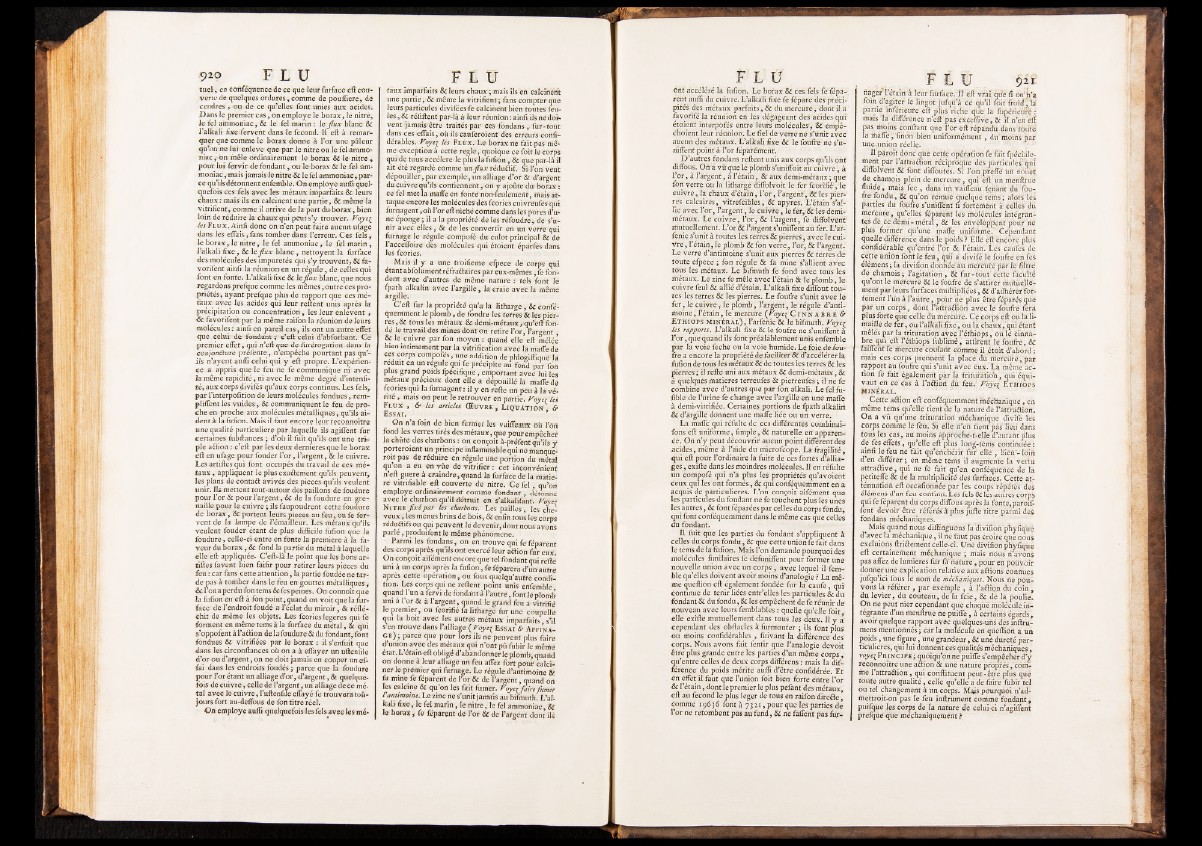
tuel-, en Coriféqnence de ce que leur furface eft cou*
verte de quelques ordures,-comme de pouffiere, dé
cendres , ou de ce qu’elles font unies aux acides;
Dans le premier ca s , on employé le borax, le nitre,
le fel ammoniac, & le fei marin : le flu x blanc ôc
l’alkali’ fixeiferverit dans le fécond, p eft à remarquer
que comme le borax donne à l’or une pâleur
qü’on>ne lui enlevé que par le nitre ou le fel ammoniac
,b nm ê le ordinairement le borax & le-nitre,
pour lui fervir de fondant, ou le borax & le-fel ammoniac
, mais jamais le nitre & le fel ammoniac, parce
qii’ilsdétonnentenfemfcle. On employé auffi quelquefois
ces ie ls avec les métaux imparfaits ôc leur9
chaux : mais'ils en calcinent une partie, & même la
vitrifient, comme il arrive de la part du borax, bien
loin de réduire la chaux qui peut fc’y trouver. Voyt^
■ les Fl u x . Ainfi donc on n’en peut faire aucun iifage
dans leis effais, fans tomber dans l’erreur. Ces fels ,
le borax , le nitre, le fel ammoniac, le fel marin,
Falkali fixe, & le flu x blanc, nettoyent la furfàce
des molécules des impuretés qui s’y trouvent, & fa-
vorifent aihfi la réunion en un régule, de celles qui
font en fonte. L’alkali fixe & le flu x blanc, que nous j
regardons prefque comme les mêmes, outre ces pro- j
priétés, ayant prefque plus de rapport que cestné-
teux avec les . acides qui leur reftent unis après1 la
précipitation ou concentration, les leur enlevent,
de favorifent par la même raifon la réunion de leurs
molécules.: ainfi en pareil cas, ils ont- un autre effet
que celui-de fondant y c’eft celui d’abforbant. Gé
premier effet, qui n’eft que de furérogation dans la-
cdnjonâture prefente,.n’empêche pourtant pas qu’ils
n’ayent anflï celui qui y eft propre. L’expérien-
ee a appris que le feu ne fe communique ni avec
la même rapidité, ni avec le même degré d’intenfi-
té,aux corps divifés qu’aux corps continus. Les fels,
par Finterpofition de leurs molécules fondues, rem-
pliffent les vuides , & communiquent le feu de proche
en proche aux molécules métalliques, qu’ils ai-,
dent à la fufion. Mais il faut encore leur reconnoître
une qualité particulière par laquelle ils agiffent fur
certaines fubftances ; d’où il fuit qu’ils ont une triple
a&ion : c’eft par les deux dernieres que le borax
eft en ufage pour fouder l’o r , l’argent, & le cuivre.
Les artiftes qui font occupés du travail de ces métaux
, appliquent le plus exaftement qu’ils peuvent,
les plans de contaâ avivés des pièces qu’ils veulent
unir. Ils mettent tout-autour des paillons de foudure
pour l’or & pour l’argent, ôc de la foudure en grenaille
pour le cuivre ; ils faupoudrent cette foudure
de borax, 8c portent leurs pièces au feu , ou fe fervent
de la lampe de l’émailleur. Les métaux qu’ils
veulent fouder étant de plus difficile fufion que la
foudure, celle-ci entre en fonte la première à la faveur
du borax, ôc fond la partie du métal à laquelle
elle eft appliquée» C ’eft-là le point que les bons artiftes
favent bien faifir pour retirer leurs pièces du
feu : car fans cette attention, la partie foudée ne tarde
pas à tomber dans le feu en gouttes métalliques ,
& l’on a perdu fontems &fes peines. On connoît que
la fufion en eft à fon point,quand on voit que la fur-
face de l’endroit foudé a l’éclat du miroir, & réfléchit
de même les objets. Les fcorie9 legeres qui fe
forment en même tems à la furface du métal, & qui
s’oppofent à Faétion de la foudure & du fondant,- font
fondues ôc vitrifiées par le borax : il s’enfuit que
dans les circonftances où on a à effayer un uftenfile
d’or ou d’argent, on ne doit jamais en couper un ef-
fai dans les endroits foudés y parce que la foudure
pour l’or étant un alliage d’or, d’argent quelquefois
de cuivre, celle de l’argent, un alliage de ce métal
avec le cuivre, Fuftenfile effayé fe trouvera toujours
fort au-defïous de fon titre réel.
On employé auffi quelquefois-les fois avec lés métaux
imparfaits & leurs chaux-j-mais ils en calcinent
une partie, & même la vitrifient;-fans compter que
leurs particules divifées fe calcinent bien toutes feules
, & réfiftent par-là à leur réunion : ainfi ils ne doivent
jamais être traités par ce=s- fondans , fur-tout
dans ces effais, où ils cauferoient des erreurs coiiff-
dérables. Voÿe% Us Flù x . Le borax ne fait-paS niê^
me exception a cette réglé,-quoique ce foitle- corps
qui de tous accéléré le plus k fufion, 8c que par-là il
ait été regardé comme wn fluio réduélif. Si-l’on veut
dépouiller, par exemple', un alliage d’or & d’argënt
du cuivre qu’ils contiennent, on y ajoûfedfr borax:
c e fol met la maffeen fonte non-feulement, mais attaque
encore les molécules des feories cuivréufosqui
furnagent ,où l’or eft niché comme dans les pores d?u-
ne éponge ; il a la propriété dé léS réfoudre ,i d'é s’u-
nir avec elles , & de les convertir en un vërfo qui
fumage le régule compofé du culot principal’ & dé
l’acceffoire dès molécules qui éfoierit épàrfos clans
les feories.
Mais il y a une troifteme efpece dé corps qùi
étant abfolument rèfraââires par eux-mêniés, fo fondent
avec d’autres de même nature : tels font le
fpath alkali'n avec Fargïlle, la-craie avec la même
argillë.
C ’eft fur là propriété qu’a: la Ktharge, ôc eorifé-
quemment le plomb , de fondre les terres & les pierres,
8c tous les métaux ôc demi-méfaux, qu5éft fon-
dé le travail des mines dont on retire l’o r , Fairgent ,
& le cuivre par fon moyen : quand elle eft mélée
J»i«n intimement par la vitrification avec la niaffede
ces corps compofés, une addition de phlogifticm-é la
réduit en un régulé qui fo précipite au fond paV fon
plus grand poids fpécifique, emportant avec lui les
métaux précieux dont elle a dépouillé la maffe dé
feories qui la furnagérit: il y en refte un peù à là vérité
, mais on peut le retrouver en partie. Fôye( les
Flux- , & les articles CÊu v r e , Liq’u à ï iô n &
Es sa i .
On n’à foin de bien fermer les vaiffeaux où Fort
fond les verres tirés des métaux, que pour empêcher
la chute des charbons : ofl conçoit à-pYéfènt qu’ils y
porteroiént un principe inflammable qui né tnanque-
roit pas de réduire en régule une portion du métal
qu’on a eu en vue de vitrifier : cet inconvénient
n’eft guere à craindre, quand- la furface dé la matière
vitrifiable eft couverte de nitre. Ce fo l , qu’on
employé ordinairement comme fondant', détonne
avec le charbon qu’il-détruit en s’alkalifant- Pty'ei
Nitre fixé par les eharfons. Les pailles, les cheveux
, les menus brins de bois, ÔC enfin tous les corps
rédaâifs ou qui peuvent le devenir, dont nous avons
parlé, produifont le même phénomène.
Parmi les fondans, on en trouvé qui fe fépatent
des corps après qu’ils ont exercé leur aâion fur eux.
On conçoit aifément encore que tel fondant qui refté
uni- à un corps après la fufion, fe féparerà d’un autre
après cette operation, ou fous quëlqù’âuftë eondi^-
tion. Les corps qui ne reftent point unis énfomblé
quand l’un a forvi de fondant à l’autré, font lë ploffifj
uni à l’or & à l’argent, quand le grand feu à Vitrifié
le premier, ou foorifié la litharge fur une coupéllé
qui la boit avec les autres métaux imparfaits s’il
s’en trouve-dans l’alliage ( Voye^ Essai & A ffinag
e ) ; parce que pour lors ils ne peuvent plus faire
d’union-avec dés métaux qùi n’ont pû fubir le mérité
état. L’étain eft obligé d’abandonner le plomb', quand
on donne à lëür alliage un feu affez fort potir calciner
le premier qui fitfnage. Le régule d’antimoine &
fa mine fe féparehl de For & de l’argent, quand1 ori
les calcine & qu’on les fait fumer. P^oye^ flairé flunitt
F antimoine. Le zmc ne s’unit jamais au bifrtutth. L’àl-
kali fixe, le fol marin, le nitre, le fel ammoniac, &
lë borax y fe féparçnt dé For de l’argént dont ils
ont accéléré la fufion. Le borax & ces fols fo fépa-,
refit auffi du cuivre. L’alkali fixe fe fépare des pféci-
pités des métaux parfaits, & du mercure, dont il a '
favorifé là réunion en les dégageant des acides qui
ét oie rît interpôfés entre leufs molécules, & empê-
choient leur réunion; Le fiel dé verre né'S’unit avec
aucun des métaux. L’alkali fixe & le fcrnfre ne s’u-
xiiffent point à Pôr fépatéirrent.
D ’autres fondans reftent unis aux corps qu’ils qnt
diffous. Ori â vu qüe le plomb s’üniffoit aü cùivre, à
For > à l’argent, à l’étain', & aux demi-métaux ; que
fort verrè. ou la lifhargé diffolvoit lè fer foorifié ,'le
cuivre, k chaux d’étâtfn, l'o r , l’argent , ôjf iés piêr-
rës calcairés, vitrefcïbles, & apyres. L’étain S’allie
avec For, l’argent, lé cû iv fe, le fer, & 'les demi-
métaux. L ë cuivre , l’br', & l ’argent, fe diffolvértt1
mutuellement. L’or & lkrgent s’uniffent au fer. L’ar-
fonic s’unit à toiïfes lëS terres & pierres, avec le cuiv
re , Fétairi, lè plomb & fon v erre, l’orj & l’argent.
Le verre d’antimoine s’unit aux pierrés & terres de
toute efpecé ; fon régule & fà mine s’àllieni: avec
tous les métaux. Le bifmuth fe fond avec totis les
métaux. Le zinc fe mêle avec l’étain & le plomb, le
cuivre foui & allié d’étain. L’alkali fixe diffout toutes
les terres & les pierres. Le foufre s’unit aveë le
fer , le cuivre, le plomb, l’argent, le régule d’anti-
ihoinë j l’étain, le mercure (fl'oye^ Ct n n a b r e &
Eth iop s minéral) , Fârferiic & lë bifmuth. Fbyei
les rapports. L’alkali.fixe Sc le foufre ne.s’uniffent à
For, que quand ils font préalablement unis enfèmble
par la voie foche ou la voie humide. Le foie de foutre
a encore la propriété dé faciliter & d’accélérer la
fiifîon de tous les métaux & de toutes les terrés & les
pierres; rl refté uni aux métaux & demi-métaux, &
à quelques1 riiatieres terreufeS & pierreufos ; il ne fo
combine avec d’autres que par fon alkali. Le folfii-
fible de l’Urine fe change avec l’argille en une maffe
à demi-vitrifiée. Certaines portions de fpath alkaliri
ôc d’argille donnent une maffe liée ou Urt verre.
La maffe qui réfulte de ces différentes combiriai-
fons eft uniforme, fimple, & naturelle en apparence.
Ori ri’y peut découvrir aucun point différent des
acides, même à l’aide du microfoope. La fragilité,
qui eft pour l’ordinaire la fuite de ces fortes d’alliag
e s , exifte dans les moindres molécules. Il en réfulte
un compofé qui n’a plus les propriétés qu’avoient
ceux qui les ont formes, & qui conféquemnlent en a
acquis de particulières. L’on conçoit aifément que
les particules du fondant ne fe touchent plus les unes
les antres, ôc font féparées par celles du corps fondu,
qui font conféquemment dans le même cas que celles
du fondant.
Il fuit que les parties du fondant s’appliquent à
celles du corps fondu, & que cette union fe fait dans
le tems de la füfion. Mais Fon demande pourquoi des
molécules fimilaires fe defuniffent pour former une
nouvelle union avec un corps, avec lequel il fem-
ble qù’elleS doivent avoir moins d’analogie ? La même
queftion eft également fondée fur la caufe, qui
Continue de tenir liées entr’elles les particules & du
fondant & du fondu, ôc les empêchent de fe réunir de'
nouveau avec leurs femblables : quelle qu’elle foit
elle exifte mutuellement dans tous les deux. Il y a
cependant des obftacles à furmonter ; ils font plus
ou moins confidérables , fuivant la différence des
corps. Nous avons fait fentir que l’analogie devoit
être plus grande entre les parties d’un même corps ,l
qu’entre celles de deux corps différens : mais la différence
du poids mérite auffi d’être confidérée. Et
én effet il faut que Fufïion foit bien forte entre l’or
ôc l’étain, dont le premier le plus pefant dés métaux
eft au fécond le plus léger de tous en raifon direâe
Comme 10636 font à y 3 i 1 , pour que les parties de
For rie retombent pas au fond, ôc ne faffërit pas furriagerTétain
à léur furfâçë.'îl ëft vrai qu’c fi on‘ îja
foin d’agiter le lingôf jÙfqü’à ce qu’il foit froid ^ M
partie jnférieufë èft plus riche qiië la fapêiîétifê:
mais‘la différèncè ri’ëft pas ëXceffiÿe & il n’en éff
Pas mbirts çbri'ftant que For èft répandu dans tbutë
la mâffé ITmbiï bien' uniformément, du’ Aïoihs par
une..union réelle.
1 1 deme que ceffo opération fe fait fpéçiâle-
mént par l ’af’tfaftiori réciproque dés pafticitlés' qûî
diffélvënt ÔC font diffôutés. Si l’ôri'preffé ùri fioitet
de. chamois plein de mercure, qui eft un mèriffi'üë
fluide , mâjs foc , dans un vaiffeau tenant'du fôu-
fré fondu, Ôc qu’on rémué quelque tëms; alors lés
parties dii fourre s’urii-flenf fî forfémé'rif à céïles' dti
mercure, qu’elles fépàfont lès ffibleculés intégràn-
tçé ce dèmi - métal, & lès érivéfop'pent'pbùr né
plus formëf qii’ùnè maffe .Uniforme. Cépéridant
quelle différence dans ,1e poids) Elle eft èhcbfë plu'i
çqnfidérablé..qù’èrifrè, Fpr.' & l’étain.' Lés caufès dé
cette Union font le Feu-, qui à divifé lè fpufré ën fes
éfémens ; là divifîbh dohhèeTàu meréUrê par le filtré
dé chamois ; l’àgitafîon, ÔC fur-tbut cette foculté
qu’ont lë mèrcÙré Ôt lé fotifre de s?attirer mutüellô-
mênt par leurs furfàces'mùttipiiéës ôc d’adhérêf fortement
l’un à l’autre, .p.bur ne plus être /éparés qüé
par un corps, dont. Fâttrâfliôri avec le foufre forà
plus forte que celle du mercure. Ce corps eft ou là li-
maiflé de fer , ou Falkalifixe, où la chaux,'quiétant
mêlés par la;trituration âyëc l’éthibps, bii lé çîrinà-
bre qui eft l’ éthiops fiibllmê, attifent le fqufre, Ôc
lâiffènt le lüerciife coùlarit; comme il etôit d’âbord :
mais ces corps prerinèrif la placé!du mëfcurë, par
rapport au foufre qùi s’unit avec eux. La même action
fo fait'également p a rla ffitiiraïiôn, qui équivaut'
éri ce cas à l’aiftipn clu'feü. Voye[ Eth Iops
MINÉRAL.
Cette aâion eft conféquèmmént mécHanique, eri
même tems qu’elle tient dé la natiirë dè I’àtffâftion.
On a vu qu’une tritufatipri méchaniqùé divifé lés
corps comme le fëù. Si ëllè ri’eri fient pas lien dans
toüs les cas, au moins âppfôcfeé-f-ëljê d’aütanf pllus
de fos effets, qii’elle eft plus long-téms continuée î
airifi le fëü né fait qu’ericHérir fur' elle , bien"- loin
d’e'ri différer ; en même tems il augmente là Vertu
attraftive, qui rie fé fait' qù’en conféquèncé de la
pètiteffe & de la multiplicité des fiirfàces. Cette at-
tériùatiôh eft occafîdririéë par les côiips répétés dés
élémens d’un feu continu. Les fols & les autres corps
qiii fe féparent du cofps diffbus après la fonte,paroifi
font devoir' être référés à pliis jufté titré parmi dès
forida'ns méchaniquès.
Mais quand nous diftîrigiibns Ia divifiôn phyfiqùé
d avec la méchanique, il rie faut pas croire que nous
excluions ftri&emenf celle-ci. Une divifidri phvfique
èft certainement méchanique ; mais nous Savons
pas affez de lumières fur fa nature, pour en ppüvdir
donner une explication relative aux avions connues
jufqu’ici fous le riorii de mechaniqüe's. Nous rie pouvons
la référèr , par exemple , à l’aélion du coin ,
du leViér, dit coùteaii, de la foie, ôc dé là poulie.
On ne peut nier ceperidant que chaqùë riidlécùlè intégrante
d’un menftiue rie puiffe, à céffairis égards ,
avoir quelque rapport a'véc quélques-üris des inftru-
mens mentionnés ; car la molécule eri qüeffiôii à un
poids, une figure, une grandeur, & une dureté particulières,
qui lui donnent ces qualités méchariiqùes,
voye{ Pr in cip e ; quoiqu’on ne puiffe s’empécfîer d’y
reconnoître une action & une naturé propres, comme
l’attraétion, qui coriftituent- peut - être plus què
foute autre qualité, celle qu’elle a dé faire fubir tel
du tel changement à un corps. M^is pourquoi n’ad-
met-troit-on pas le feu inftrument comme fondant,
puijquc les corps de la nature de celui-ci n’agiffent
prefqüè que meçhaniquemérit ?