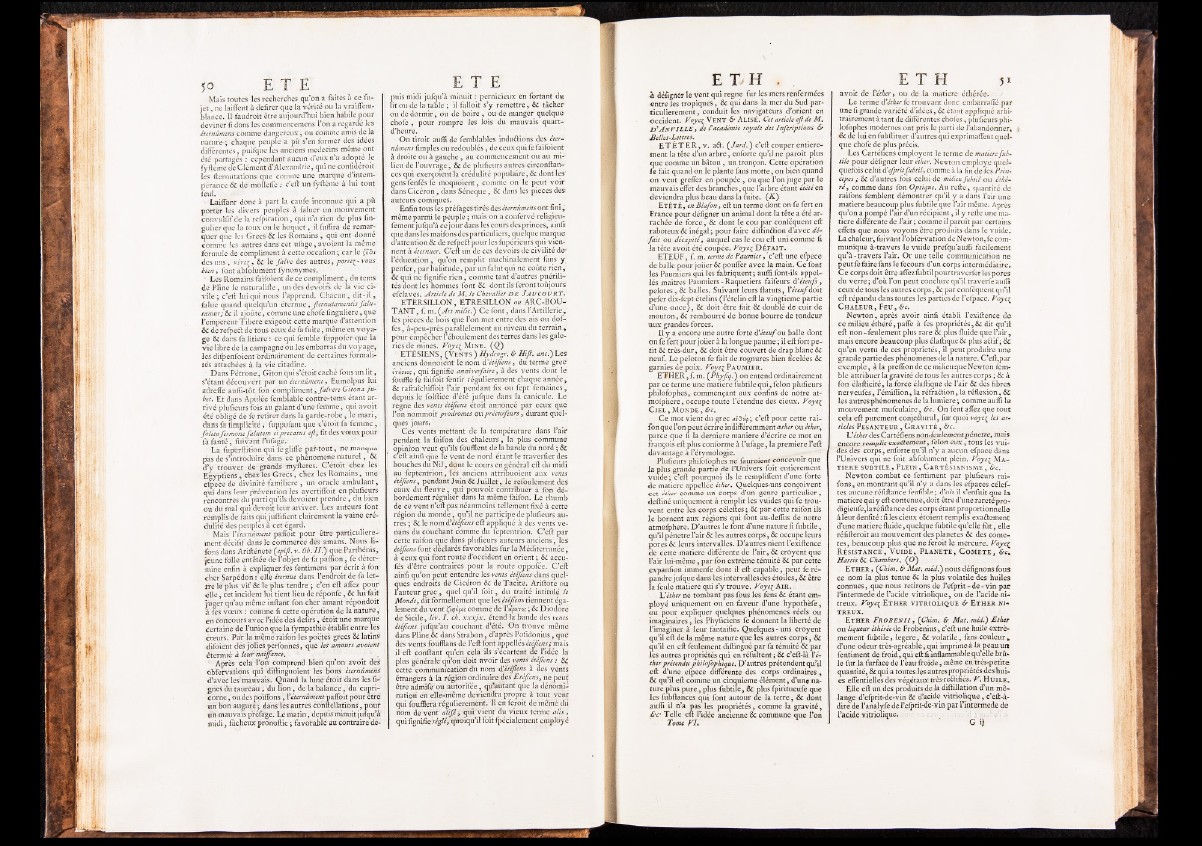
5 o E T E Mais toutes les recherches qu’on a faites à ce fu-
je t , ne laiffent à defirer que la vérité ou la vraiffem-
hlance. Il faudroit être aujourd’hui bien habile pour
deviner fi dans les commencemens l’on a regardé les
éïernûmens comme dangereux, ou comme amis delà
nature-; chaque peuple à pu s’en former des idées
différentes, puifque les anciens mede.cins même ont
été partagés : cependant aucun d’eux n’a adopte le
fyftème de Clément d’Alexandrie, qui ne confidéroit
les fier nutations' que comme une marque d’intempérance
6c dé molleffe : c’eft un fyfteme à lui tout
féul. , -
• Laiffant donc à part la caufe inconnue qui a pu
porter les divers peuples à faluer un 'mbit-vement
cbnvulfif de la refpiration, qui n’a rien de plus fin-
gulier que la toux ou le hoquet, il fuffira de remarquer
que les Grecs 6c les Romains * qui ont donné
comme les autres dans cet ufage, avoient la même
formule de compliment à cette occafion; car ie Çià-t
des uns , vive{, 6c le faire des autres, portez-vous
bien, font abfolumènt fynonymes.
• t e s Romains fàifoient de ce compliment , du tems
de Pline le naturalifie, un des devoirs de là vie civ
ile ; c’eft lui qui nous l’apprend. Chacun, d it- il,
falue quand quelqu’un éternue, Jlernutamentis falu-
tamur; 6c il ajoute, comme une chofe finguliere, que
l’empereur Tibere exigeoit cette marque d’attention
6 de refpecl de tous-ceux de fa fuite , même en voyage
6c dans fa litiere : ce qui femble fuppofer que la
vie libre de la campagne ou les embarras du voyage,;
les difpenfoient ordinairement de certaines formalités
attachées à la vie citadine.
' Dans Pétrone, Giton qui s’étoit caché fous un li t ,
s’étant découvert par un éternîanent, Eumolpus lui
adreffe aufli-tôt fon compliment, jalvere Gitona ju-
bet. Et dans Apulée femblablé contre-tems étant arrivé
plufieurs fois au galant d’unè femme, qui avoit
été obligé de fe retirer dans la garde-robe, le mari,
dans fa-iimplicité ; fuppOfant que c’étoit fa femme, -
folitofermone falutem eiprecatus ejl, fit des voeux pour
fa fanté, fuivant l’iifagë.
• La fupferftition qui fegliffe paf-tout, ne manqua
pas de s’introduire dans ce phenomene naturel, 6c
d’y trouver de-'grands myfieres. C’étoit chez les
Egyptiens.,‘chèzTfesGrecs, chez les Romains, une
efpece de divinité familière , un oracle ambulant ,
qiii dans leur prévention les avertiffoit en plufieurs
rencontres du parti qu’ils dévoient prendre, du bien
dit dit mal qui d'evoit leur arriver. Les auteurs font
remplis de faits quijuftifient clairement la vaine crédulité
des peuples à cet egard. ’ . . . i
Mais Yéternûment paffoit pour être particulièrement
décifif dans le commercé d’és amans. Nous -liions
dans Arifténete (\epijl. v. lib. I l f que Parthenis,
jeune folle entêtée de l’objet de fa pàflibn, fe détermine
enfin à expliquer fies fentimens par écrit à fon'
cher Sarpédon : ' elle éternue dans l’endroit de fa lettre
lé'plus v i f & le plus tendre ; c’en eft. affez pour-
e lle , cet incident lui tient lieu deréponfe, & lui fait
juger qu’au même inftant fon cher amant répondoit
à fès voeux : cdmme fi cette opération de la nature,'
én concours avec Pidée des defirs, ©toit une marque
ëertàirie de l’union que la fympathie établit entre lés
coeurs. Par.la mçmerâifonles poètes grecs 6c latins
difoient dés joliespèrfonhes, que k s amours avoiêni
éternué-à kurnaijfance.. -
• Après cela l’op comprend bieil qu’ort âvôit des?
obfervatidns q u i‘diftinguoient les'bons étèrhûmini
d’avec les' mauvais. Quand la luné étoit dans les lignés
du taurëàü ; 'du lion, de la balancé, du capricorne
, ou deS ppiffons, Yéternûment paffoit pour étr©
un bon auguré; .dans lès autres cohftellatiôns', pour
ün mauvais p'réfage. Le matin, depttis minuit julqu’ a
midi, fâcheux pronoftic ; favorable au contraire de-
E T E
puis midi jufqu’à minuit : pernicieux en fortant du
lit ou de la table ; il falloit s’y remettre, & tâcher
ou de dormir, ou de boire, ou de manger quelque
chofe , pour rompre les lois du mauvais quart-
d’heure.
On tiroit aufli de femblables induCtions des éter-
nûmefis fimples Ou redoublés, de ceux qui fe fàifoient
à droite ou à gauche, au commencement ou au milieu
de l’ouvrage, & de plufieurs autres circonftan-
ces qui exerçoient la crédulité populaire, 6c dont les’
gensfenfésfe moquoierit, comme on le peut voir
dans C icéron, dans Séneque, 6c dans les pièces des
auteurs comiques.
Enfin tous les préfages tirés des éternûmens ont fini,'
même parmi le peuple ; mais on a conférvé religieu-
fement jufqu’à ce jour dans les cours des princes, ainfi
que dans les maifons des particuliers, quelque marque
d’attention 6c de refpeft pour les fupérieurs qui viennent
à éternuer. C’eft un de ces devoirs de civilité de*
l’éducation, qu’on remplit machinalement fans y
penfer, par habitude, par un falut qui ne coûte rien,
6c qui ne lignifie r ien, comme tant d’autres puérilités
dont les hommes font 6c dont ils feront toujours
efclaves. Article de M. le Chevalier DE Ja ü COVRT.
ETERSILLON, ÈTRESILLON ou a r c -b o u t
a n t , f. m. {Art milit.) Ce font, dans l’Artillerie,'
lés pièces de bois que l’on met entre des ais ou dof-
fès, à-peu-près parallèlement au niveau du terrain ,
pour empêcher l’éboulement des terres dans les galeries
dè mines. Voye£ Mine. (Q)
ETÉSIENS, (Vents ) Hydrogr. & Hijl. anc.) Les
anciens donnoiént le nom d'étéjîens, du terme grec'
«T»«oç, qui lignifie anniverfaire, à des vents dont le
fouffle fe faifoit lèntir régulièrement chaque année,
& rafraîchiffoit l’air pendant fix ou fept femaines,
depuis lë folftice d’été jufque dans la canicule. Le
règne des vents étéjîens étoit annoncé par ceux que
l’on nommoif prodromes ou précurfeuts , durant quelques
jours.
Cës vents-mettant de la température dans l’air
pendant la faifon des chaleurs, la plus commune
opinion veut qu’ils foùfflent de la bande du nord ; 6c
c’ëft ainfi que le vent de nord étant le traverfier des
bouches du N il, dont le cours en général eft du midi
au feptèntrioh, les anciens attribuoient aux vents
étéjîens, pendant Juin & Juillet , le refoulement des
eaux du fleuve, qui pouvoir contribuer à fon débordement
régulier dans la même faifon. Le rhumb
de ce vent n’eft pas néanmoins tellement fixé à cette
région dii mondé, qu’il ne participe de plufieurs autres
; & le nom d’ étejiens eft appliqué à des vents ve-
nans du couchant comme du lëptentrion. C ’eft par
cette raifon qiië dans plufieurs auteurs anciens, les
étéjîens font déclarés favorables fur la Méditerranée,
à ceux qui font route d’occident en orient ; 6c accu-,
fés d’être contraires pour la route oppoiee. C ’eft
ainfi qu’on peut entendre les vents étéjîens~ dîins quelques
endroits de Cicéron 6c de Tacite. Ariftote ou
l’auteur grec., quel qu’il fo it , du traité intitulé le
Monde, dit formellement que les étéjîens tiennent éga-
lement du vent Çeipûpoç comme de Ytè^ros ; 6c Diodore
de Sicile, liv. I. ch. x x x jx . étend là bande des vents
étéjîens jufqu’au couchant d’été. On trouve même
j dans Pline. & dans Strabon, d’après Pofidonius, que
dés vents foüfflans de l’eft font àppellés étéjîens; mais
il eft confiant qu’en cela ils s’écartent de l’idée la
plus générale qu’on doit avoir d es vents étéjîens : &c
cette communication du nom $ étéjîens à des vents
étrangers à la région ordinaire des Etéjîens, ne ]>è\\i
être admïfe'où âutorifée, qu’-aûtant que la dériomi-
natiori en elle-même deviendra propre à tout vent
qui foufflerârégulièrement. Il en feroit de mêmè dû
nom de vent dlifé f qui’vienj:' du vieux terme alis ,
qui fignifierég/éi Quoiqu’il fôît fpécialement employé
E T H .
à défigner le vent qui régné fur les mers renfermées
entre les tropiques, & qui dans la mer du Sud particulièrement
, conduit les navigateurs d’orient en
■ occident. Voye^ Vent & Alisé. Cet article ejlde M .
D ’ A n VILLE y de C académie royale des Infcriptions &
Belles-Lettres-
E T Ê T E R , v . a£t. ( Jard. ) c’eft couper entièrement
la tête d’un arbre, enforte qu’il ne paroît plus
que comme un bâton, un tronçon. Cette opération
fe fait quand on le plante fans motte, ou bien quand
on veut greffer en poupée, ou que l’on juge par le
mauvais effet des branches, que l’arbre étant étêté en
deviendra plus beau dans la fuite. {K ) ETÊTÉ, e/zBlafon, eft un terme dont on fe fert en
France pour défigner un animal dont la tete a ete arrachée
de force, & dont le cou par conféquent eft
raboteux & inégal ; pour faire diftinélion d’avec défait
ou décapité; auquel cas le cou eft uni comme fi
la tête avoit été coupée. Voye£ Défait.
ETEUF, f. m. terme de Paumier, c’eft une efpece
de balle pour joiier & pouffer avec la main. Ce font
les Paumiers qui les fabriquent ; aufli font-ils appel-
lés maîtres Paumiers - Raquetiers faifeurs d ’éteufs,
pelotes, & balles. Suivant leurs ftatuts, Yéteuf doit
pefer dix-fept ételins (l’ételin eft la vingtième partie
d’une once), & doit être fait & doublé de cuir de
mouton, 6c rembourré de bonne bourre de tondeur
aux grandes forces.
Il y a encore une autre forte d’éteuf ou balle dont
on fe fert pour joiier à la longue paume ; il eft fort petit
& très-dur, & doit être couvert de drap blanc 6c
neuf. Le peloton fe fait de rognures bien ficelées 6c
garnies de poix. Voye£ Paumier.
ETHER, f. m. {Phyjîqî) on entend ordinairement
par ce terme une matière fubtile qui, félon plufieurs
philofophes, commençant aux confins de notre at-
mofphere, occupe toute l’étendue des deux. Voye^ Ciel , Monde , &c.
Ce mot vient du grec aid-tîp ; c’eft pour cette raifon
que l’on peut écrire indifféremment cether ou éther^
parce que fi la derniere maniéré d’écrire ce mot en
françois eft plus conforme à l ’ufage, la première l’eft
davantage à l’étymologie.
Plufieurs philofophes ne1 fauroient concevoir que
la plus grande partie de l’Univers foit entièrement
vuide ; c’eft pourquoi ils le rempliffent d’une forte
de matière appellée éther. Quelques-uns conçoivent
cet éther comme un corps d’un genre particulier,
deftiné uniquement à remplir les vuides qui fe trouvent
entre les corps céleftes ; 6c par cette raifon ils
le bornent aux régions qui font au-deffus de notre
atmofphere. D ’autres le font d’une nature fi fubtile,
qu’il pénétré l’air 6c les autres corps, 6c occupe leurs
pores & leurs intervalles. D ’autres nient l’exiftence
de cette matière différente de l’air , 6c croyent que
l ’air lui-même, par fon extrême ténuité 6c par cette
expanfion immenfe dont il eft capable, peut fe répandre
jufque dans les intervalles des étoiles.,.& être
la feule matière qui s’y trouve. Voye^ Air.
U éther ne tombant pas fous les fens 6c étant employé
uniquement ou en faveur d’une hypothèfe,
ou pour expliquer quelques phénomènes réels ou
imaginaires, les Phyficiens fe donnent la liberté de
l ’imaginer à leur fantaifie. Quelques - uns. croyent
qu’il eft de la même nature que les autres corps, &
qu’il en eft feulement diftingué par fa ténuité 6c par
les autres propriétés qui en réfultent ; 6c c’eft-là IV-
ther prétendu philofophique. D ’autres prétendent qu’il
eft d’une efpece différente des corps ordinaires,
6c qu’il eft comme un cinquième élément, d’une nature
plus pure, plus fubtile, 6c plus fpiritueufe que
les fubftances qui font autour de la terre, 6c dont
aufli il n’a pas les propriétés, comme la gravité,
&c’ Telle eft l’idée ancienne 6c commune que l’oii
Tome VL
E T H
avoit de Y éther y ou de la matière éthérée.
Le terme d?éther fe trouvant donc embarraffé par
une fi grande variété d’idées, 6c étant appliqué arbi*
trairement à tant de différentes chofes, plufieurs phi*
lofophes modernes ont pris le parti de l’abandonner,
6c de lui en fubftituer d’autres qui exprimaffent quel*
que chofe de plus précis.
Les Cartéfiens employent le terme de matière fubtile
pour défigner leur éther. Newton employé quelquefois
celui d’ejprit fubtil, comme à la fin de fes Principes
; 6c d’autres fois celui de milieu fubtil ou éthé-
ré y comme dans fon Optique. Au refte, quantité de
raifons femblent démontrer qu’il y a dans l’air une
matière beaucoup plus fubtile que l’air même. Après
qu’on a pompé l’air d’un récipient, il y refte une matière
différente de l’air; comme il paroît par certains
effets que nous voyons être produits dans le vuide.
La chaleur, fuivant l’obfervation de Newton, fe communique
à-travers le vuide prefqu’aufli facilement
qu’à-travers l’air. Or une telle communication ne
peut fe faire fans le fecours d’un corps intermédiaire*
Ce corps doit être affez fubtil pour traverfer les pores
du verre ; d’oii l’on peut conclure qu’il traverfe aufli
ceux de tous les autres corps, 6c par conféquent qu’il
eft répandu dans toutes les parties de l’efpace. Voye^ Chaleur, Feu, &c.
Newton, après avoir ainfi établi l’exiftence de
ce milieu éthéré, paffe à fes propriétés, 6c dit qu’il
eft non-feulement plus rare 6c plus fluide que l’air,
mais encore beaucoup plus élaftique 6c plus a&if; 6c
qu’en vertu de ces propriétés, il peut produire u n e
grande partie des phénomènes de la nature. C’eft,par
exemple, à la preflion de ce milieu que Newton femble
attribuer la gravité de tous les autres corps ; 6c à
fon élafticité, la force élaftique de l’air & des fibres
nerveufes, l’émiflïon, la réfra&ion, la réflexion, 6c
les autres phénomènes de la lumière ; comme aufli le
mouvement mufculaire, &c. On fent affez que tout
cela eft purement conjectural, fur quoi voye^ les articles
Pesanteur , Gravité , &c. .
L’éther des Cartéfiens non-feulement pénétré, mais
encore remplie exactement, félon eux, tous les vuides
des corps, enforte qu’il n’y a aucun efpace dans
l’Univers qui ne foit abfolumènt plein. Voyeç Matière
subtile,P lein, Cartésianisme, &c.
Newton combat ce fentiment par plufieurs raifons,
en montrant qu’il n’y a dans les efpaces céleftes
aucune réfiftance fenfible ; d’où il s’enfuit que la
matière qui y eft contenue, doit être d’une.rareté pro*
digieufe,la réfiftance des corps étant proportionnelle
à leur denfité : fi les deux étoient remplis exactement
d’une matière fluide, quelque fubtile qu’elle fû t , elle
réfifteroit au mouvement des planètes 6c des comètes,
beaucoup plus que ne feroit le mercure. Voyeç Résistance, Vuide, Planete, Comete, &c.
Harris & Chambers. (U) Ether , {Chim. & Mat. médî) nous défignons fous
ce nom la plus tenue 6c la plus volatile des huiles
connues, que nous retirons de l’efprit - de - vin par
l’intermede de l’acide vitriolique, ou de l’acide nitreux.
Voye^,Ether vitriolique & Ether nitrEeux.
ther Frobenil , {Chim. & Mat. médf) Ether
ou liqueur éthérée de Frobenius , c’eft une huile extrêmement
fubtile, legere, 6c volatile., fans couleur,
d’une odeur très-agréable, qui imprime à la peau un
fentiment de froid, qui eft fi inflammable qu’elle brûle
fur la furface de l’eau froide, même en très-petite
quantité, & qui a toutes les autres propriétés,des hui-
es effentielles des végétaux: très-reétifiés. V , Huile.
Elle eft un des produits'de la diftillation d’un mélange
d’efprit-de-vin & d’acide vitriolique, c’eft-à-
dire de l’analyfe de l’efprit-de-vin par l’intermede de
l’acide vitriolique.
G ij