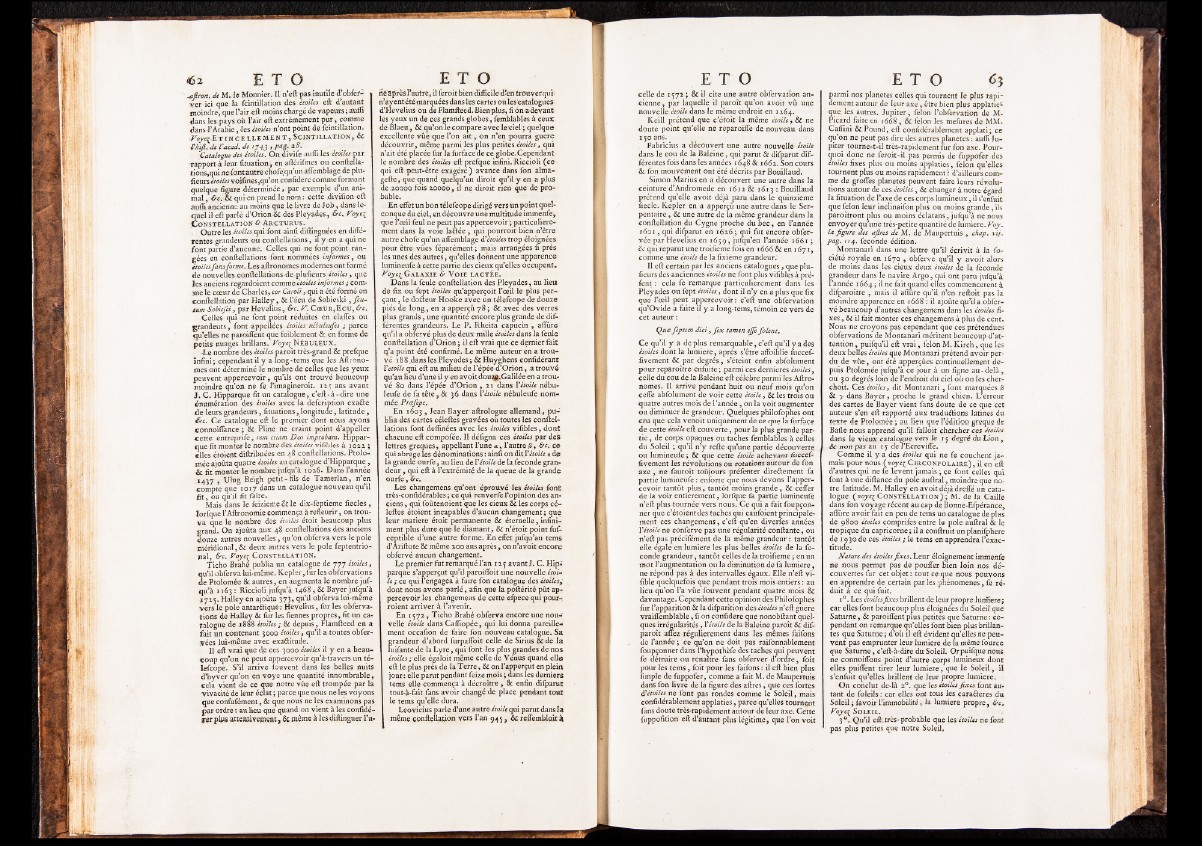
u ifiron. de M. le Monnier, Il n’eft pas inutile d’obfer-
v er ici que la fciritillation des étoiles eft d’autant
moindre, que l’air eft moins chargé de vapeurs; aufli
clans les pays où l’air eft extrêmement pur, comme
dans4’Arabie, «les étoiles n’ont point de fcintillation.
V o y e i E T IN C E L L E M E N T , SCINTILLATION , &
t h i f i . de V-acad. de 1743 -, p a g . zS-.
Catalogue des étoiles, On divife aufli les étoiles par
rapport à leur fituation, en aftérifmes ou conftellations,
qui ne=font autre chofe'qu’un aflemblàgc de plu-
fieurs voifines,qu’on confidere comme formant
quelque figure déterminée, par exemple d’un animal
, qui en prend le nom : cette ;divifion eft
aufli ancienne au moins que lé livre de Job, dans lequel
il-eft parié d’Orion-& des Pleyades., &c. Voyt^ Constellation 6* Arcturus.
Outre les «7o/7« q u i font ainfi diftinguées en différentes
grandeurs ou conftellations, il y-en a qui ne
font partie d’aucune. Celles qui ne font point rangées
en conftellations font nommées in fo rm e s , ou
c to ik sfa n sfo rm e . Les aftronomes modernesont formé
de nouvelles conftellations-de. plufieurs étoiles , que 2es anciens regardoient comme-éto iles informes ; Comme
le coeur de Charles, cor C a ro li, qui a été formé en
conftellation par Halley, & l’écu de Sobieski, feu-
tum Sobiefci-, par Hevelius, & c . V. C<eur,Ecu, & c.
Celles qui ne font point réduites en claffes ou
grandeurs, font appelées étoiles nébuleufes ; parce
qu’elles ne paroiffent que foiblement & en forme de
petits nuages brillans. Voye^ Nébuleux.
■ Le nombre des étoiles paroît très-grand & prefque
infini; cependant il y a long-tems que les Aftrono-
mes ont déterminé le nombre de celles que les yeux
peuvent appercevoir, qu’ils ont trouvé beaucoup
moindre qu’on ne fe l’imagineroit. 115 ans avant
J. C . Hipparque fit un catalogue, c’eft-à-dire une
énumération des étoiles avec la defeription exaôe
de leurs grandeurs, lituations, longitude, latitude,
<&c. Ce catalogue eft le premier dont nous ayons
connoiffance ; & Pline ne craint point d’appeller
ce tte entreprife, rem etiam D e o improbam. Hipparque
fit monter le nombre des étoiles vifibles à 1021 ;
«lies étoient diftribuées en 48 conftellations. Ptolo-
mée ajouta quatre étoiles au catalogue d’Hipparque,
& fit monter le nombre jufqu’à 1026. Dans l’année *437 , Ulug Beigh petit-fils-de Tamerlan, n’en
compte que 1017 dans un catalogue nouveau qu’il
f it , ou qu’il fit faire.
Mais dans le feizieme & le dix-feptieme fiecles,
lorfque l’Aftronomie commença à refleurir, on trouv
a que le nombre des étoiles étoit beaucoup plus
grand. On ajoûta aux 48 conftellations des anciens
douze autres nouvelles, qu’on obfervavers le pôle
méridional,& deux autres vers le pôle feptentrio- nai, & c . V oy e1 Constellation.
Ticho Brahé publia un catalogue de 777 étoiles ,
qu’ il obferva lui-même. Kepler, fur les obfervations
de Ptolomée & autres, en augmenta le nombre jufqu’à
1163 : Riccioli jufqu’à 1468, & Bayer jufqu’à
1725. Halley en ajoûta 373, qu’il obferva lui-meme
vers le pôle antarûique; Hevelius, fur les obfervalions
de Halley & fur les fiennes propres, fit un catalogue
de j 8 88 étoiles ; & depuis, Flamfteed en a
fait un contenant 3000 é to ile s , qu’il a toutes obfer-
iVées lui-même avec exactitude.
Il eft vrai que dp ces 3000 étoiles il y en a beaucoup
qu’on ne peut appercevoir qu’à-travers un té-
lefcope. S’il arrive îbuvent dans les belles nuits
d’hyver qu’on en voye une quantité innombrable,
cela vient de ce que notre vue eft trompée par la
vivacité de leur éclat ; parce que nous ne les voyons
que confufément, & que nous ne les examinons pas
par ordre : au lieu que quand on vient à les confidé-
«rer pUi$ attentivement, & même à les distinguer l’une
après l’autre, il feroit bien difficile d’en trouver qui:
n’ayent été marquées dans les cartes ou les catalogues
d’Hevelius ou de Flamfteed. Bien plus, fi on a devant
les yeux un de ces grands globes, femblables à ceux
de Blaeu, & qu’on le compare avec le’ciel ; quelque
excellente vûe que l’on ait., on n’en ‘pourra guere
découvrir, même parmi les plus petites étoiles, qui
n’ait été placée fur la furface de ce globe.Cependant
le nombre des étoiles eft prefque infini. R iccioli (ce
qui eft peut-être exagère ) avance dans fon alma-
gefte, que quand quelqu’un diroit qu’il y en a plus
de ,20000 fois 20000 , il ne diroit rien que de probable.
En effet un bon télefeope dirigé vers un point quelconque
du ciel, en découvre une multitude immenfe,
que l’oeil feul ne peut pas appercevoir!; particulièrement
dans la voie laCtée , qui pourroit bien n’être
autre chofe qu’un affemblage d’étoiles trop éloignées
jour être vûes féparément ; mais arrangées fi prés
es unes des autres, qu’elles donnent une apparence
lumineufe à cette partie des cieux qu’elles occupent,
Voye1 Galaxie & Voie lactée.
Dans la feule conftellation des Pleyades, au lieu
de fix ou fept étoiles qu’apperçoit l’oeil le plus perçant
, le doCteur Hooke avec un télefeope de douze
piés de long, en a apperçû 78 ; & avec des verres
plus grands, une quantité encore plus grande de d ifférentes
grandeurs. Le P. Rheita capucin , affûre
qu’il a oblervé plus de deux mille étoiles dans la feule
conftellation d’Orion ; il eft vrai que ce dernier fait
q’a point été confirmé. Le même auteur en a trouv
é 18 8 .dans les Pleyades ; & Huyghens confidérant
Vetoile qui eft au milieu de l ’épée d’Orion, a trouvé
qu’au lieu d’une il y en avoit dou^j, Galilée en a trouv
é 80 dans l’épée d’Orion , 2 1 dans Vetoile nébu-
leufe de fa tê te , & 36 dans l’étoile nébuleufe nora-
; mée Prafepe,
En 1603 , Jean Bayer aftrologue allemand, publia
des cartes céleftes gravées où toutes les conftellations
font defllnées avec les étoiles vifibles, dont
chacune eft compofée. Il défigna ces étoiles par deb
lettres greques, appellant l’une * , l’autre /3, &c. ce
qui abrégé les dénominations : ainfi on ditV étoile » de
la grande ourfe, au lieu de l’étoile de la fécondé grandeur
, qui eft à l’extrémité de la queue de la grande
ourfe, &c.
Les changemens qu’ont éprouvé les étoiles font
très-confidérables ; ce qui renverfe l’opinion des anciens
, qui foûtenoient que les cieux & les corps céleftes
étoient incapables d’aucun changement ; que
leur matière étoit permanente & éternelle, infiniment
plus dure que le diamant, & n’étoit point fuf*
ceptible d’une autre forme. En effet jufqu’au tems
d’Ariftote & même 200 ans après, onn’avoit encore
obfervé aucun changement.
Le premier fut remarqué l’an 125 avant J. C . Hipparque
s’apperçut qu’il paroiffoit une nouvelle étoile;
ce qui l’engagea à faire fon catalogue des étoiles
dont nous avons parlé, afin que la poftérité pût appercevoir
les changemens de cette efpece qui pour-
roient arriver à l’avenir.
En 15 7 1 , Ticho Brahé obferva encore une nouvelle
étoile dans Cafliopée, qui lui donna pareillement
occafion de faire fon nouveau catalogue. Sa
grandeur d’abord furpaffoit celle de Sirius & de la
luifante de la Ly re, qui font les plus grandes de nos
étoiles ; elle égaloit même celle de Vénus quand elle
eft le plus près de la Terre, & onl’apperçut en plein
jour : elle parut pendant feize mois ; dans les derniers
tems elle commença à décroître , & enfin difparut
tout-à-fait fans avoir changé de place pendant tout
le tems qu’elle dura.
Leovicius parle d’une autre étoile qui parut dans la
même conftellation vers l’an 945, & reffembloit à
celle de 1571 ; & il cite une autre obfervation ancienne
, par laquelle il paroît qu’on avoit vit une
nouvelle étoile dans le même endroit en 1264.
Keill prétend que c ’étoit la même étoile, & ne
doute point qu’elle ne reparoifle de nouveau dans
150 ans,
Fabricius a découvert une autre nouvelle étoile
dans le cou de la Baleine, qui parut & difparut différentes
fois dans les années 1648 & 1662. Son cours
& fon mouvement ont été décrits par Bouillaud.
Simon Marius en a découvert une autre dans la
ceinture d’Andromede en 1612 & 1613 : Bouillaud
prétend qu’elle avoit déjà paru dans le quinzième
ïîecle. Kepler en a apperçû une autre dans le Serpentaire
, & une autre de la même grandeur dans la
conftellation du Cygne proche du b e c , en l’année
1601, qui difparut en 1626 ; qui fut encore obfpr-
vée par Hevelius en 1659, jufqu’en l’année 1661 ;
Sl qui reparut une troifieme fois en 1666 & en 1671,
comme une étoile de la fixieme grandeur;
Il eft certain par les anciens catalogues, que plufieurs
des anciennes étoiles ne font plus vifibles à pré-
fent : cela fe remarque particulièrement dans les
Pleyades ou fept étoiles, dont il n’y en a plus que fix
que l’oeil peut appercevoir: c’eft une obfervation
qu’Ovide a faite il y a long-tems, témoin ce vers de
cet auteur :
Quce feptem dici , fe x tamen effe folent.
Ce qu’il y a de plus remarquable, c’eft qu’il y a des
étoiles dont la lumière, après s’être affaiblie fuccef-
fivement & par degrés , s’éteint enfin abfolument
pour reparoître enfuite; parmi ces dernieres étoiles,
celle du cou de la Baleine eft célébré parmi les Aftronomes.
Il arrive pendant huit ou neuf mois qu’on
ceffe abfolument de voir cette étoile , & les trois ou
quatre autres mois de l ’année, on la voit augmenter
ou diminuer de grandeur. Quelques philofophes ont
cru que cela venoit uniquement de ce que la furface
de cette étoile eft couverte, pour la plus grande partie
, de corps opaques ou taches femblables à celles
du Soleil ; qu’il n’y refte qu’une partie découverte
ou lumineule ; & que cette étoile achevant lùccefc
fivement les révolutions ou rotations autour de fon
axe , ne fauroit toujours préfenter directement fa
partie lumineufe : enforte que nous devons l’apper-
cevoir tantôt plus, tantôt moins grande, & ceffer
de la voir entièrement, lorfque fa partie lumineufe
n’eft plus tournée vers nous. Ce qui a fait foupçon-
ner que c’étoientdes taches qui caufoient principalement
ces changemens, c’eft qu’en diverfes années
Vétoile ne conferve pas une régularité confiante, ou
n’eft pas précifément de la même grandeur : tantôt
elle égale en lumière les plus belles étoiles de la fécondé
grandeur, tantôt celles de la troifieme ; en un
mot l’augmentation on la diminution de fa lumière,
ne répond pas à des intervalles égaux. Elle n’eft vi-
fible quelquefois que pendant trois mois.entiers: au
lieu qu’on l’a vûe fouvent pendant quatre mois &
davantage. Cependant cette opinion des Philofophes
fur l’apparition & la difparition des étoiles n’eft guere
vraiffemblable, fi on confidere que nonobftant quelques
irrégularités , l’étoile de la Baleine paroît & dif-
paroît allez régulièrement dans les mêmes faifons
de l’année ; ce qu’on ne doit pas raifonnablement
foupçonner dans Phypothèfe des taches qui peuvent
fe détruire ou renaître fans obferver d’ordre, foit
pour les tems, foit pour les faifons : il eft bien plus
fimple de fuppofer, comme a fait M. de Maupertuis
dans fon livre de la figure des aftres, que ces fortes
$ étoiles ne font pas rondes comme le Soleil, mais
confidérablement applaties, parce qu’elles tournent
fans doute très-rapidement autour de leur axe. Cette
fuppofition eft d’autant plus légitime, que l’on voit
parmi nos planètes celles qui tournent le plus rapidement
autour de leur ax e, être bien plus applaties
que les autres. Jupiter, félon l’obfervation de M-
Picard faite en 1668, & félon les mefures de MM.
Caflini &Poun d, eft confidérablement applati; ce
qu’on ne peut pas dire des autres planètes : aufli Jupiter
tourne-t-il très-rapidement lur fon axe. Pourquoi
donc ne feroit-il pas permis de fuppofer des
étoiles fixes plus ou moins applaties, félon qu’elles
tournent plus ou moins rapidement) d’ailleurs comme
de groffes planètes peuvent faire leurs révolutions
autour de ces étoiles, & changer à notre égard
la fituation de l’axe de ces corps lumineux, il s’enfuit
que félon leur inclinaifon plus ou moins grande, ils
paroîtront plus ou moins éclatans, jufqu’à ne nous
envoyer qu’une très-petite quantité de lumière. Voy.
la figure des afires de M. de Maupertuis , chap. yij.
pag. 114. fécondé édition.
Montanari dans une lettre qu’il écrivit à la fo-
ciété royale en 1670 , obferve qu’il y avoit alors
de moins dans les cieux deux étoiles de la fécondé
grandeur dans le navire A rgo , qui ont paru jufqu’à
l’année 1664 ; il ne fait quand elles commencèrent à
difparoître , mais il affûre qu’il n’en reftoit pas la
moindre apparence en 1668 : il ajoûte qu’il a obfervé
beaucoup d’autres changemens dans les étoiles fixes
, & il fait monter ces changemens à plus de cent.
Nous ne croyons pas cependant que ces prétendues
obfervations de Montanari méritent beaucoup d’attention
, puifqu’il eft v r a i, félon M. K irch , que les
deux belles étoiles que Montanari prétend avoir perdu
de vû e , ont été apperçûes continuellement depuis
Ptolomée jufqu’à ce jour à un ligne au - delà,
ou 30 degrés loin de l’endroit du ciel où on les cher-
choit. Ces étoiles, dit Montanari, font marquées j3
& y dans Ba yer, proche le grand chien. L’erreur
des cartes de Bayer vient fans doute de ce que cet
auteur s’en eft rapporté aux traductions latines du
texte de Ptolomée ; au lieu que l’édition greque de
Balle nous apprend qu’il falloit chercher ces étoiles
dans le vieux catalogue vers le i f degré du Lion ,
8e non pas au 15; de l ’Ecrevifle.
Comme il y a des étoiles qui ne fe couchent jamais
pour nous ( voye{ Circonpolaire) , il en eft
d’autres qui ne fe lèvent jamais ; ce font celles qui
font à une diftance du pôle auftral, moindre que notre
latitude. M. Halley en avoit.déjà drefle un catalogue
(voyei Constellation) ; M. de la Caille
dans fon voyage récent au cap de Bonne-Efpérance,
affûre avoir fait en peu de tems un catalogue de plus
de 9800 étoiles comprifes entre le pôle auftral & le
tropique du capricorne ; il a conllruit un planifphere
de 1930 de ces étoiles ; le tems en apprendra l ’exactitude.
Nature des étoiles fixes. Leur éloignement immenfe
ne nous permet pas de pouffer bien loin nos découvertes
fur cet objet : tout ce que nous pouvons
en apprendre de certain par les phénomènes, fe réduit
à ce qui fuit.
i° . Les étoiles fixes brillent de leur propre lunîiere;
car elles font beaucoup plus éloignées du Soleil que
Saturne, & paroiffent plus petites que Saturne : cependant
on remarque qu’elles font bien plus brillantes
que Saturne ; d’où il eft évident qu’elles ne peuvent
pas emprunter leur lumière de la même fource
que Saturne, c’eft-à-dire du Soleil. Orpuifque nous
ne connoiflons point d’autre corps lumineux dont
elles puiffent tirer leur lumière, que le Soleil, il
s’enfuit qu’elles brillent de leur propre lumière.
On conclut de-là 20. que les étoiles fixes font autant
de foleils : car elles ont tous les caraâeres du
Soleil ; favoir l’immobilité, la lumière propre, &c.
Voyeç Soleil.
30. Qu’il eft .très- probable que les étoiles ne font
pas plus petites que notre Soleil.