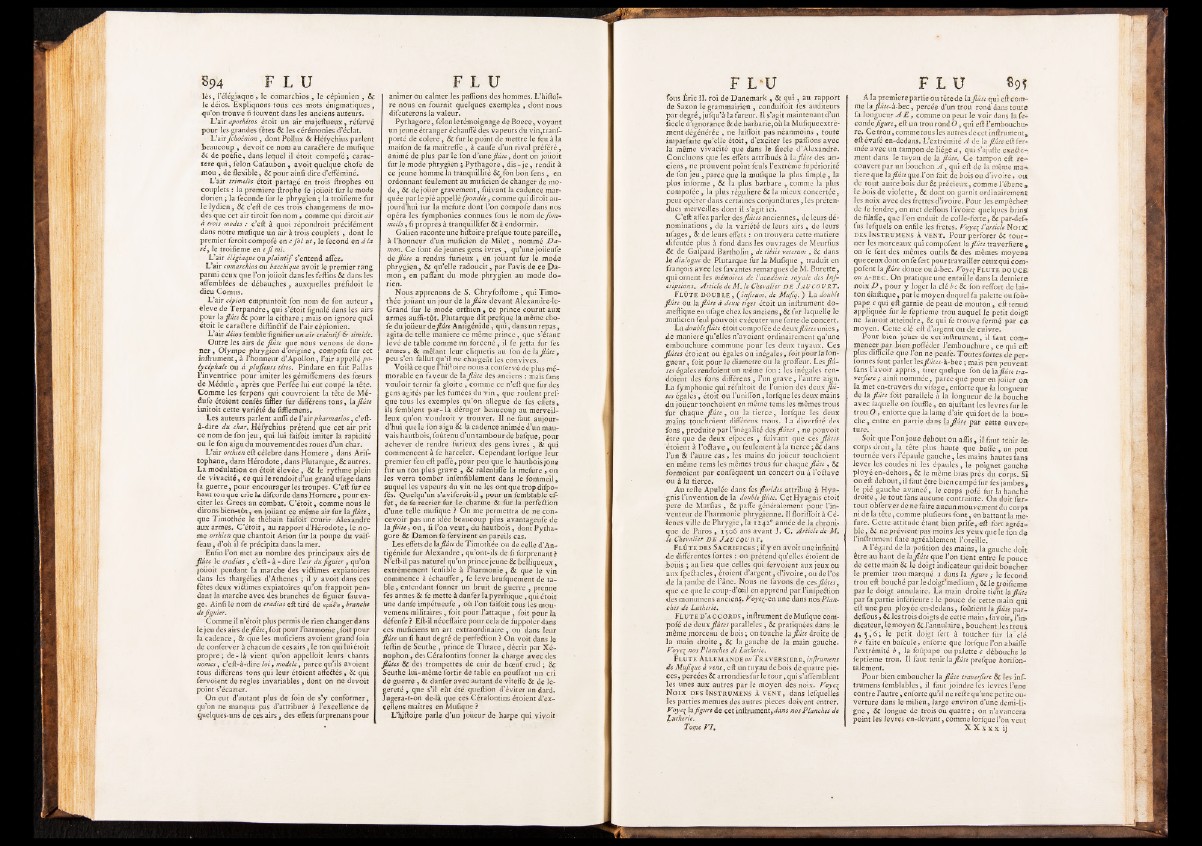
lès, l’élégiaque, le comarchios , le cépionien , 8c
le déios. Expliquons tous ces mots énigmatiques ,
qu’on trouve fi lou vent dans les anciens auteurs.
L ’air apothétos étoit un air majeftueux, réfervé
pour les gl andes fêtes & les cérémonies d’éclat.
L ’air fchoénion, dont Pollux & Héfychius parlent
beaucoup , devoit ce nom au caraâere de mufique
& de poéfie, dans lequel il étoit compofé ; caractère
qui, félon Cafaubon , avoit quelque chofe de
mou , de flexible, & pour ainfi dire d’efféminé.
L’air trimelès étoit partagé en trois ftrophes ou
couplets : la première ftropne fe joiioit fur le mode
dorien ; la fécondé fur le phrygien ; la troifieme fur
le lydien, & c’eft de ces trois changemens de modes
que cet air tiroit fon nom , comme qui diroit air
à trois modes : c’eft à quoi répondroit précifément
dans notre mufique un air à trois couplets , dont le
premier feroit compofé en c fo l ut, le fécond en dLa
ré, le troifieme en e j i mi.
L ’air élégiaque ou plaintif s’entend allez.
L air comarchios ou bacchique avoit le premier rang
parmi ceux que l’on joiioit dans les feftins & dans les
affemblées de débauches, auxquelles préfidoit le
dieu Cornus.
L ’air cépion empruntoit fon nom de fon auteur,
cleve de Terpandre, qui s’étoit fignalé dans les airs
çour la flûte 8c pour la cithare ; mais on ignore quel
ctoit le caraftere diftinôif de l’air cépionien.
L’air déios femble fignifier un air craintif & timide.
Outre les airs de flûte que nous venons de donner
, Olympe phrygien d’origine, compofa fur cet
infiniment, à l’honneur d’Apollon, l’air appellépo-
lyccphale ou à plujîeurs têtes. Pindare en fait Pallas
l ’inventrice pour imiter les eémiffemens des foeurs
de Médufe, après que Perfee lui eut coupé la tête.
'Comme les ferpens qui couvroient la tête de Médufe
étoient cenfés limer fur différens tons, la flûte
imitoit cette variété de fifflemens.
Les auteurs parlent aufli de l’airpharmatios, c’eft-
à-dire du char. Héfychius prétend que cet air prit
ce nom de fon jeu , qui lui faifoit imiter la rapidité
ou le fon aigu du mouvement des roues d’un char.
L ’air orthien eft célébré dans Homere , dans Arif-
tophane, dans Hérodote, dans Plutarque, 8c autres. ,
La modulation en étoit élevée , 8c le rythme plein j
de vivacité, ce qui le rendoit d’un grand ufage dans
la guerre, pour encourager les troupes. C ’en fur ce
haut ton que crie la difcorde dans Homere, pour exciter
les Grecs au combat. C ’étoit, comme nous le
dirons bien-tôt, en joiiant ce même air fur la flûte,
que Timothée le thébain faifoit courir Alexandre
aux armes. C ’étoit, au rapport d’Hérodote, le nome
orthien que chantoit Arion fur la poupe du vaif-
feau, d’où il fe précipita dans la mer.
Enfin l’on met au nombre des principaux airs de
flûte le cradias, c’eft - à - dire Y air du figuier, qu’on
joiioit pendant la marche des vi&imes expiatoires
dans les thargélies d’Athenes ; il y avoit dans ces
fêtes deux victimes expiatoires qu’on frappoit pendant
la marche avec des branches de figuier fauva-
ge. Ainfi le nom de cradias eft tiré de upd.S'ti, branche
de figuier.
Comme il n’étoit plus permis de rien changer dans
le jeu des airs de flûte, foit pour l’harmonie, foit pour
la cadence, & que les muficiens avoient grand foin
de conferver à chacun de ces airs, le ton qui lui étoit
propre; de-là vient qu’on appelloit leurs chants
nomes, c’eft-à-dire loi, modèle, parce qu’ils avoient
tous différens tons qui leur étoient affeôés , 6c qui
fervoient de réglés invariables, dont on ne devoit
point s’écarter.
On eut d’autant plus de foin de s’y conformer,
qu’on ne manqua pas d’attribuer à l’excellence de
quelques-uns de ces airs, des effets furprenans pour
animer ou calmer les pallions des hommes. L’hiftoî-
re nous en fournit quelques exemples , dont nous
difcuterons la valeur.
Pythagore, félon le témoignage de Boece, voyant
un jeune étranger échauffé des vapeurs du vin,tranf-
porté de colere, 8c fur le point de mettre le feu à la
maifon de fa maîtreffe , à caufe d’un rival préféré,
animé de plus par le fon d ’une flûte, dont on joiioit
fur le mode phrygien ; Pythagore, dis - je , rendit à
ce jeune homme la tranquillité & fon bon fens , en
ordonnant feulement au muficien de changer de mod
e , ôc de joiier gravement, fuivant la cadence marquée
par le pié appellé fpondée, comme qui diroit aujourd’hui
fur la mefure dont l’on compofé dans nos
opéra les fymphonies connues fous le nom de fom-
meils , fi propres à tranquillifer 8c à endormir.
Galien raconte une hiftoire prefque toute pareille,
à l’honneur d’un muficien de Milet, nommé D a-
mon. Ce font de jeunes gens ivres , qu’une joiieufe
de flûte a rendus furieux ; en joiiant fur le mode
phrygien, 8c qu’elle radoucit, par l’avis de ce Da-
mon, en paffant du mode phrygien au mode dorien.
Nous apprenons de S. Chryfoftome , qui T imothée
joiiant un jour de la flûte devant Alexandre-le-
Grand fur le mode orthien , ce prince courut aux
armes aufli-tôt. Plutarque dit prefque la même chofe
du joiieur deflûte Antigénide, qui, dans un repas,
agita de telle maniéré ce même prince, que s’étant
levé de table comme un forcené, il fe jetta fur fes
armes, & mêlant leur cliquetis au fon de la flûte ,
peu s’en fallut qu’il ne chargeât les convives.
Voilà ce que l’hiftoire nous a confervé de plus mémorable
en faveur de la flûte des anciens : mais fans
vouloir ternir fa gloire , comme ce n’eft que fur des
gens agités par les fumées du v in , que roulent prefque
tous les exemples qu’on allégué de fes effets,
ils femblent par- là déroger beaucoup au merveilleux
qu’on voudroit y trouver. Il ne faut aujourd’hui
que le fon aigu 6c la cadence animée d’un mauvais
hautbois, foûtenu d’un tambour de bafque, pour
achever de rendre furieux des gens ivres , & qui
commencent à fe harceler. Cependant lorfque leur
premier feu eft paffé, pour peu que le hautbois joue
fur un ton plus grave , 6c ralentifle la mefure , on
les verra tomber infenfiblement dans le fommeil,
auquel les vapeurs du vin ne les ont que trop difpo-
fés. Quelqu’un s’aviferoit-il, pour un femblable effet
, de fe recrier fur le charme 6c fur la perfeélion
d’une telle mufique ? On me permettra de ne concevoir
pas une idée beaucoup plus avantageufe de
la flûte , o u , fi l’on v eu t, du hautbois, dont Pythagore
6c Damon fe fervirent en pareils cas.
Les effets de laflûte de Timothée ou de celle d’An-
tigénide fur Alexandre, qu’ont-ils de fi furprenant ?
N’eft-il pas naturel qu’un prince jeune 6c belliqueux,
extrêmement fenfible à l’harmonie, & que le vin
commence à échauffer, fe leve brufquement de table
, entendant fonner un bruit de guerre , prenne
fes armes & fe mette à danfer la pyrrhique, qui étoit
une danfe impétueufe , oh l’on faifoit tous les mou-
vemens militaires, foit pour l’attaque , foit pour la
défenfe ? Eft-il néceffaire pour cela de fuppolèr dans
ces muficiens un art extraordinaire , ou dans leur
flûte un fi haut degré de perfection ? On voit dans le
feftin de Seuthe , prince de Thrace, décrit par X é-
nophon, des Céraîontins fonner la charge avec des
flûtes 6c des trompettes de cuir de boeuf erud ; 6c
Seuthe lui-même fortir de table en pouffant un cri
de guerre , & danfer avec autant de vîteffe & de le-
gereté , que s’il eut été queftion d’éviter un dard.
Jugera-t-on de-là que ces Cérafontins étoient d’ex-
çellens maîtres en Mufique ?
L’hjftolre parle d’un joiieur de harpe qui viv.oit
fous Êric IL roi de Danemark , & q u i, au rapport
de Saxon le grammairien , conduifoit fes auditeurs
par degré, jufqu’à la fureur. Il s’agit maintenant d’un
iiecle d’ignorance & de barbarie,oh la Mufique extrè-
rnent dégénérée , ne Iaiffoit pas néanmoins , toute
imparfaite qu’elle étoit, d’exciter les pallions avec
la même vivacité que dans le fiecle d’Alexândre.
Concluons que les effets attribués à la flûte des anciens,
ne prouvent point feuls l’extrême fupériorité
de fon jeu , parce que la mufique la plus fimplé, la
plus informe , 6c la plus barbare , comme la plus
compofée, la plus.régulière 6c la mieux concertée,
peut opérer dans certaines conjonctures, lès prétendues
merveilles dont il s’agit ici.
C ’eft allez parler d es flûtes anciennes, de leurs dénominations
, de la variété de leurs airs , de leurs
ufages, & de leurs effets : on trouvera cette matière
difeutée plus à fond dans les ouvrages de Meurfius
6c de Gafpard Barthôlin, de tibiis veterum , 6c dans
le dialogue de Plutarque fur la Mufique , traduit en
françois avec les favantes remarques de M. Burette,
qui ornent les mémoires de l'académie royale des Inf-
criptions. Article de M. le Chevalier D E J A V C O U R T .
F l û t e d o u b l e , ( inflrum. de Mufiq. ) La double
flûte ou la flûte à deux tiges étoit un inftrument do-
meftique en ufage chez les anciens, 6c fur laquelle le
muficien feul pouvoit exécuter une forte de concert.
La doubleflûte étoit compofée de deuxflûtes unies,
de maniéré qu’elles n’avoient ordinairement qu’une
embouchure commune pour les deux tuyaux. Ces
flûtes étoient ou égales ou inégales, foit pour la longueur
, foit pour le diamètre ou la groffeur. Lés flûtes
égales rendoient un même fon : les inégales ren-
doient des fons différens , l’un grave, l’autre aigu.
La fymphonie qui réfultoit de l’union des deux flûtes
égales, étoit ou l’uniffon, lorfque les deux mains
du joiieur touchoient en même tems les mêmes trous
fur chaque flû te , ou la tierce, lorfque les deux
mains touchoient différens trous. La diverfité des
fons, produite par l’inégalité des flûtes, ne pouvoit
être que de deux efpeces , fuivant que ces flûtes
"étoient à l ’o fta v e, ou feulement à la tierce ; 6c dans
l’un & l’autre cas, les mains du joiieur touchoient
en même tems les mêmes trous fur chaque flû te, 6c
formoient par conféqucnt un concert ou à l’ottave
ou à la tierce.
Au refte Apulée dans fes florides attribue à Hya-
gnis l’invention de la double flûte. Cet Hyagnis étoit
pere de Marfias , 6c paffe généralement pour l’inventeur
de l’harmonie phrygienne. Il florinoit à Cé-
lenes ville de Phrygie, la i242e année de la chronique
de Paros , 1506 ans avant J. C. Article de M.
le Chevalier D E J A U COU R T .
F l û t e d e s S a c r i f i c e s ; il y en avoit une infinité
de différentes fortes : on prétend qu’elles étoient de
>boiiis ; au lieu que celles qui fervoient aux jeux ou
aux fpe&acles, étoient d’argent, d’ivoire, ou de l’os
,de la jambe de l’âne. Nous ne favons de ces flûtes,
que ce que le coup-d’oeil en apprend par l’infpeftion
des monumens anciens. Voyeç-en une dans nos Planches
de Lutherie..
F l û t e d ’a c c o r d s , inftrument de Mufique compofé
de deux flûtes parallèles, 6c pratiquées, dans le
même morceau de bois; on touche la flûte droite de
la main droite, 6c la gauche de la main gauche.
Voye%_ nos Planches de Lutherie.
F l û t e A l l e m a n d e s T r a v e r s i e r e , infiniment
de Mufique a vent, e ft u n tu y a u d e b o is d e q u a t re p iè c
e s , p e r c é e s 6c a r ro n d ie s fu r le t o u r , q u i s ’a flèm b len t
le s u n e s a u x a u t r e s p a r l e m o y e n d e s n o ix . Voye^
N o ix d e s In s t r u m e n s à v e n t , d an s le fq u e lle s
le s p a r t ie s m e n u e s d e s au t res p iè c e s d o iv e n t e n t re r .
yyyt{ la figure d e c e t in ftrum en t, dans nos Planches de
^Utherie.
Torpe V I.
À la première partie ou tête de la flûte qui e$ Comme
la flûte-k-hec., percée d’un trou rond dans toute
fa longueur. A £ , comme on peut le voir dans la fe*
conde figure, eft un trou rond O , qui eft l’embouchu*
re. Ce trou, comme tous les autres de cet inftrument*
eft évafé en-dedans. L’extrémité A de la flûte eft fermée
avec un tampon de liège a , qui s’ajufte exactement
dans le tuyau de la flûte. Ce tampon eft recouvert
par un bouchon A , qui eft de la même ma-*
tiere que la flûte que.l’on fait de bois ou d’ivoire, 014
de tout autre bois dur 6c précieux, comme l ’ébene0
le bois de violette, 6c dont on garnit ordinairement
les noix avec des frettes d’ivoire. Pour les empêcher
de fe fendre, on met deffous l’ivoire quelques brins1
de filaffe, que l ’on enduit de colle-forte, ôc par-def*
fus lefquels on enfile les frétés. Voye{ l'article N o ix
d e s I n s t r u m e n s à v e n t . Pour perforer 6 c tourner
les morceaux qui compofent la flûte traverfiere *
on fe fert des mêmes outils 6c des mêmes moyens
que ceux dont onfe fert pour travailler ceux qui com*
pofent la flûte douce ou à*bec. Voye% Fl û t e d o u c e
ou a - b e c . On pratique une entaille dans la derniere
noix D , pour y loger la clé bc 6c fon reffort de laiton
élaftique, par le moyen duquel fa palette ou fou-
pape c qui eft garnie de peau de mouton, eft tenue
appliquée fur le feptieme trou auquel le petit doigt
ne fauroit atteindre, 6c qui fe trouve fermé par ce
moyen. Cette clé eft d’argent ou de cuivre.
Pour bien jouer de cet inftrument, il faut commencer
par bien pofîéder l’embouchure, ce qui eft
plus difficile que ron ne penfe. Toutes fortes de per*
fonnes font parler lesflûtes-k-bec ; mais peu peuvent
fans l’avoir appris, tirer quelque fon de la flûte traverfiere
; ainfi nommée, parce que pour en joiier on
la met en-travers du vifage, enforte que la longueur
de la flûte foit parallèle à la longueur de la bouche
avec laquelle on fouffle, en ajuftant les levres fur le
trou O , enforte que la lame d’air qui fort de la bouche
, entre en partie dans la flûte par cette ouverture.
Soit que l ’on joue debout ou aflïs, îl faut tenir le-
corps droit, la tête plus haute que baffe , un peu
tournée vers l’epaule gauche, les mains hautes fans
lever les coudes ni les épaules , le poignet gauche
ployé en-dehors, 6c le même bras près du corps. Si
on eft debout, il faut être bien campé fur fes jambes ,
le pié gauche avancé, le corps pofé fur la hanche
droite, le tout fans aucune contrainte. On doit fur-
tout obferver de ne faire aucun mouvement du corps
ni dé la tête, comme plufieurs font, en battant la me*
fure. Cette attitude étant bien prife, eft fort agréable
, 8c ne prévient pas moins les yeux que le fon de
i’inftrument flate agréablement l’oreille.
A l’égard de la pofitiori des mains, 1 â gauche doit
être au haut de la flûte que l’on tient entre le pouce
de cette main 6c le doigt indicateur qui doit boucher
le premier trou marqué 1 dans la figure ; le fécond
trou eft bouché par le doigt*medium, ôc le troifieme
parle doigt annulaire. La main droite tient la flûte
par fa partie inférieure : le pouce de cette main qui
eft une peu ployée en-dedans, foûtient la flûte par-
deffous, 6c les trois doigts de cette main, favoir, l’indicateur,
le moyen 6c l’annulaire, bouchent les trous
4 , 5*6 ; le petit doigt fert à toucher fur la^ lé
b c faite en bafcule, enforte que lorfque l’on abaiffe
l’extrémité b ,1 a foûpape ou palette c débouche le
feptieme trou. Il faut tenir la flûte prefque horifon-
talement.
Pour bien emboucher la flûte traverfiere 6c les inf-
trumens femblables, il faut joindre les levres l’une
contre l’autre, enforte qu’il ne refte qu’une petite ouverture
dans le milieu, large environ d’une demi-ligne
, 6c longue de trois ou quatre ; on n’avancera
point les levres en-devant, comme lorfque l’on veut