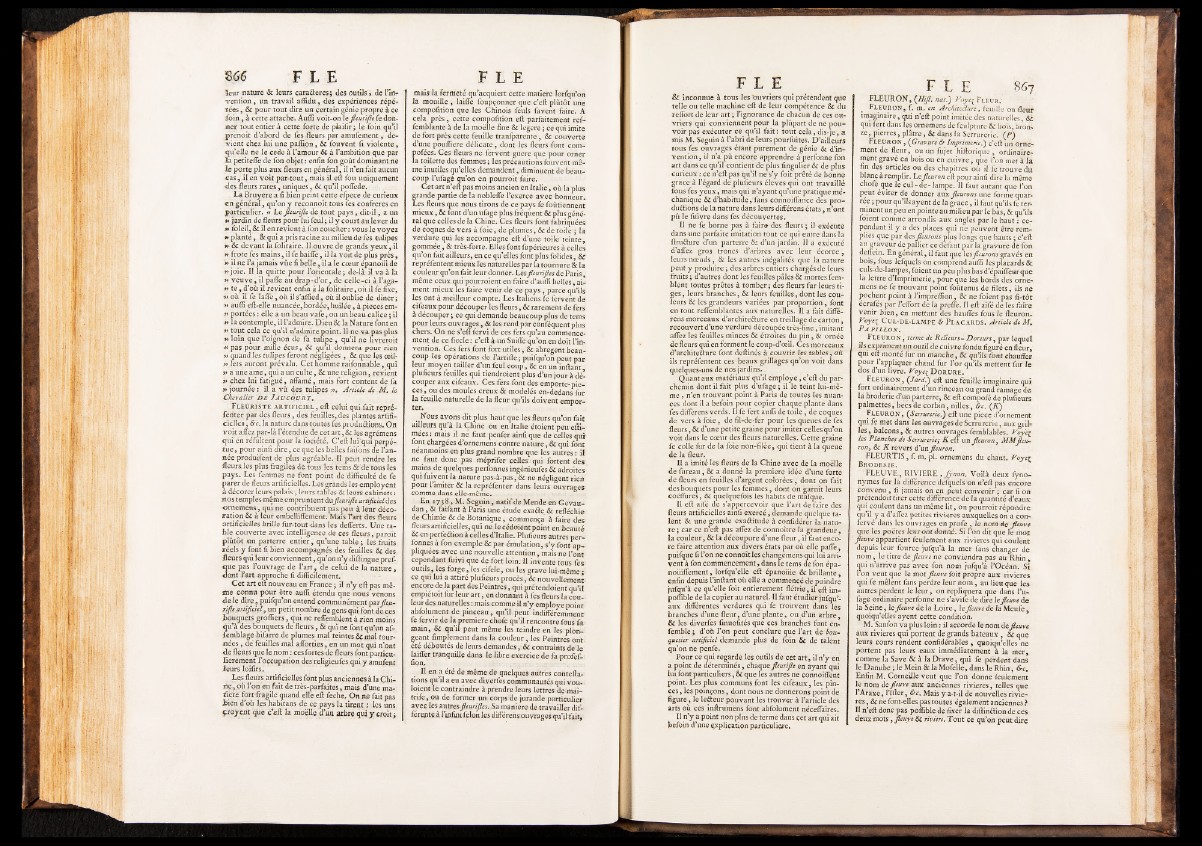
A
• p
S
il
|j|: jlll
É l
m F LE leur nature & leurs cara&eres; des outils'i. de l’in-
■ vention, un travail affidu, des expériences répétées,
& pour tout dire un- certain génie propre à ce
Foin, à cette attache. Auffi voit-on le fleurifle fie donner
tout entier à cette forte de plaifir ; le foin qu’il
prenoit d’abord de fes .fleurs par amufement, devient
chez lui une paillon, & fou vent fi violente,
•qu’elle ne le cede à l’amour & à l’ambition que par
3a petitefle de fon objets enfin ion goût dominant ne
le porte plus aux fleurs en général, il n’en fait aucun
•cas, lien voit par-tout, mais il eft fou uniquement
des fleurs rares, uniques, & qu’il poffede.
La Bruyerea fi bien peint cette efpece de curieux
en général, qu’on y reconnoît tous fes confrères en
particulier. « Le fleurifle de tout pays, dit-il, a un
w jardin de fleurs pour lui feul; il y court au lever du
*> ioleil, & il en revient à.fon coucher: vous le voyez
» planté, & qui a pris racine au milieu de fes tulipes
» & devant la folitaire. II.ouvre de grands yeux, il
» frote fes mains, il fe baiffe, il la voit de plus près,
» il ne l’a jamais vue fi belle, il a le coeur épanoui de
»joie. Il la quitte pour l’orientale; de-là il va à la
» veuve, il paffe au drap-,d’or, de celle-ci à l ’aga-
» te, d’où II revient enfin à la folitaire,où il fe fixe,
» où il fe lafi'e, où il s’aflied, où il oublie de dîner ;
» auffi efl-ellè nuancée, bordée, huilée, à pièces em-
» portées : elle a un beau vafe, ou un beau-calice ; il
» là contemple, il l’admire. Dieu & la Nature font en
» tout cela ce qu’il n’admire point. Il ne va pas plus
» loin que l’oignon de fa tuupe , qu’il ne livreroit
« pas pour , mille écus, & qu’il donnera- pour rien
» quand les tulipes feront négligées , & que les oeillets
auront ..prévalu. Cet homme raifonnable, qui
» a ùne ame, qui a un culte, & une religion, revient
» chez lui fatigué, affamé, mais fort content de fa
»journée: il a,vu des tulipes ». A rticle de M . le
C hevalier D E J a u c o u r T .
F l e u r i s t e a r t i f i c i e l , eft celui qui,fait repré-
feriter par des fleurs, des feuilles, des plantes artificielles
, & c . la nature dans toutes fes produftions. On
yoita.ffez: par-là l’étenclùe de cet art, & les agrémens
qui én féfûltënt pour la fociété. C’eft lui qui perpétue,
pour ainfi dire, ce que les belles faifôns de l’année
produifent de plus agréable. !! peut rendre les
fleurs les plus fragiles de. tous les téms &de tous les
pays. Les femmes ne font point de difficulté de fe
parer de fleurs artificielles. Les grands les employent
à décorer leurs palais -, leurs tables & leurs cabinets :
aios temples même empruntent du JleuriJIe artificiel des
ornemens , qui ne contribuent pas peu à leur décoration
& à leur embelliffement. Mais l’art des fleurs
artificielles brille fur-tout dans les defferts. Une table
couverte avec intelligence de ces fleurs, paroît
plutôt un parterre entier, qu’une table ; les fruits
réels y font fi bien accompagnés des feuilles & des.
fleurs qui leur conviennent, qu’on n’y diftingue pref-
que pas l’ouvrage de l’art, de celui de la nature,
dont l’art approche fi difficilement.
Cet art eft nouveau en France ; il n’y eft pas même
connu pour etre auffi étendu que nous venons
de le dire, puifqu’on entend communément par fie u -
rifle artificiel , un petit nombre de gens qui. font de ces
bouqpets groffiers, qui ne reffemblent à rien moins,
qu’à' des bouquets de fleurs, &qui ne font qu’un af-
iemblage bifarre de plumes mal teintes & mal tournées
, dé feuilles mal afforties, en un mot qui n’ont
de fleurs que le nom : ces fortes de fleurs font particuliérementl’occupation
des religieufes qui y amufent
leurs lôifirs.
Les fleurs artificielles font plus anciennes à la Chi-
ùe, où l’on en fait de très-parfaites, mais d’une matière
fort-fragile quand elle eft feche. On ne fait pas
bien d’où les habitans de ce pays la tirent : les uns
frayent que c’efl; la moelle d’un arbre qui y croît;
F L E màis la Fermeté qu’acquiert cette matière lorfqu’ôn
la mouille , laiffe foupçonner que c’eft plutôt une
compofition que les Chinois feuls favent faire. A
cela près, cette compofition eft parfaitement ref-
femblante à de la moelle fine & legere ; ce qui imite
de fort près cette feuille tranfparente, & couverte
d’une pouffiere délicate, dont les fleurs font com-
pofées. Ces fleurs ne fervent guère que pour orner
la toilette des femmes; les précautions fouvent même
inutiles qu’elles demandent, diminuent de beaucoup
l’ufagè qu’on en pourroit faire.
Cet art n’eft pas moins ancien en Italie, où la plus
grande partie de la nobleffe l’exerce avec honneur.
Les fleurs que nous tirons de ce pays fe foutiennent
mieux, & font d’un ufage plus fréquent & plus général
que celles de la Chine. Ces fleurs font fabriquées
de coques de vers à foie, de plumes, & de toile ; la
verdure qui les accompagne eft d’une toile teinte,
gommée, & très-forte. Elles font fupérieures à celles
qu’on fait ailleurs, en ce qu’elles font plus folides, Sc
repréfentent mieux les naturelles par la tournure & la
couleur qu’on fait leur donner. Lesfleuriftes de Paris,
même ceux qui pourroient en faire d’auffi belles, aiment
mieux les faire venir de ce pays, parce qu’ils
les ont à meilleur compte. Les Italiens fe fervent de
cifeaux pour découper les fleurs, & rarement de fers
à découper ; ce qui demande beaucoup plusde tems
pour leurs ouvrages, & les rend par conféquent plus
chers. On ne s’eft fervi de ces fers qu’au commencement
de ce fiecle : c’eft à-un Suiffe qu’on en doit l’invention.
Ces fers,font fort utiles, & abrègent beaucoup
les opérations de l’artifte ; puifqu’on peut par
leur moyen tailler d’un feul.coup, Sc en un inftant
plufieurs feuilles qui tiendroient plus d’un jour à découper
aux cifeaux. Ces fers font des emporte-pièces,
ou des moules creux & modelés en-dedans fur
la feuille naturelle de la fleur qu’ils doivent emporter.
jj Nous avons dit plus haut que les fleurs qu’on fait
ailleurs qu’à la Chine ou en Italie étoient peu efti-,
mees : mais il ne faut penfer ainfi que de celles qui
font chargées d’ornemens contre nature, & qui font
néanmoins en plus grand nombre que les autres : il
ne faut donc pas méprifer celles ; qui fortent des
mains de quelques perlonnes ingénieufes & adroites
qui fuivent la nature pas-à-pas, & ne négligent rien
pour l’imiter & la repréfenter dans leurs- ouvrages
comme dans elle-même. .
En 1738, M. Seguin, natif de Mende en Gevau-
dan , & faifant à Paris une étude exafre & refléchie
de Chimie & de Botanique, commença à faire des
fleurs artificielles, qui ne le cédoiënt point en beauté
& en perfection à celles d’Italie-Plufieurs autres per-
fonnes à fon exemple & par émulation, s’y-font ap-
pliquées avec une nouvelle attention, rnais ne l’ont
cependant fuivi que de fort loin. Il invente-tous fes
outils, les forge, les cifele., ou les grave lui-même ;
ce qui lui a attiré plufieurs procès, & nouvellement-
encore de la part des Peintres, qui prétendoient qu’il
empiétoit fur leur art, en donnant à fes fleurs la cou-:
leur des naturelles : mais comme il n’y employé point
abfolument de pinceau, qu’il, peut indifféremment
fe fervir de la première chofe qu’il, rencontre fous fa
main, & qu’il peut même, les.teindre en les plongeant
Amplement dans là couleur, les Peintres ont
été déboutés dé leurs demandes contraints de’le
laiffer tranquille dans le libre.exercice.de fa .profef-
fion/
Il en a été de même de quelques autres contefta*
tions qu’il a eu avec diverfes communautés qui vou-.
loient lê contraindre à prendre leurs lettres de<màî-
trife, ou de former un corps de jurande particulier
ayeç les autres fieurifies. Sa manierede travailler différente
à Tinfini félonies différens auyrages.qu’ilfait,
F L E
& inconnue à tous les ’ouvriers qui prétendent que
telle ou telle machine eft de leur compétence & du
reflbrt de leur art ; l’ignorance de chacun de ces ouvriers
qui conviennent pour la plupart de ne pouvoir
pas exécuter ce qu’il fait: tout cela, dis-je, a
mis M. Seguin à l’abri de leurs pourfuites. D’ailleurs
tous fes ouvrages étant purement de génie & d’invention*
il n’a pû encore apprendre à perfonne fon
art dans ce qu’il contient de plus fingulier & de plus
curieux : ce n’eft pas qu’il ne s’y foit prêté de bonne
grâce à l’égard de plufieurs éleves qui ont travaillé
fous fes yeux, mais qui n’ayant qu’une pratique mé-
chanique & d’habitude, fans connoiffance des productions
de la nature dans leurs différens états, n’ont
pu le fiiivre dans fes découvertes .
Il ne fe borne pas à faire des fleurs ; il exécute
dans une parfaite imitation tout cé qui entre dans la
ftrufture d’un parterre & d’un jardin. Il a exécuté
d’affez gros troncs d’arbres avec leur écorce,
leurs noeuds, & les autres inégalités què la nature
peut y produire ; des àrbre.s entiers chargés de leurs
fruits ; d’autres dont les feuilles pâles & mortes fem-
blent toutes prêtes à tomber ; des fleurs fur leurs tiges,
leurs branches, & leurs feuilles, dont les couleurs
& les grandeurs variées par proportion, font
en tout reffemblantes aux naturelles. Il a fait différens
morceaux d’archite&ure en treillage de carton,
recouvert d’une verdure découpée très-fine » imitant
affez les feuilles minces & étroites du pin, & ornée
de fleurs qui en forment le coup-d’oeil. Ces morceaux
d’archite&ure font deftinés à couvrir les tables ; où
ils repréfentent ces beaux grillages qu’on voit dans
quelques-uns de nos jardins..
Quantaux matériaux qu’il employé, c’eft du parchemin
dont il fait plus d’ufage ; il le teint lui-même
, n’en trouvant point à Paris de toutes les nuances
dont il a befoin pour copier chaque plante dans
fes différens verds. Il fe fert auffi de toile, de coques
de vers à foie, de fil-de-fer pour les queues de fes
fleurs, & d’une petite graine pour imiter celles qu’on
voit dans le coeur des fleurs naturelles. Cette graine
fe colle fur de la foie non-filée , qui tient à la queue
de la fleur.
Il a imité les fleurs de la Chine avec de la moelle
de fureau, & a donné la première idée d’une forte
de fleurs en feuilles d’argent colorées , dont on fait
des bouquets pour les femmes, dont on garnit leurs
coeffiires, & quelquefois les habits de mafque.
11 eft aifé de s’appercevoir que l’art de faire des
fleurs artificielles ainfi exercé, demande quelque talent
& une grande exaâitude à confidérer la nature
; car ce n’eft pas affez de connoître la grandeur,
la couleur, & la découpure d’une fleur, il faut encore
faire attention aux divers états par où elle paffe, ;
puifque fi l’on ne connoît les changemens qui lui arri- 1
vent à fon commencement, dans le tems de fon épa- :
noiiiffement, lorfqu’elle eft épanouie & brillante, :
enfin depuis l’inftant où elle a commencé de poindre
jufqu’à ce qu’elle foit entièrement flétrie, il eft im-
poflible de la copier au naturel. Il faut étudier jufqu’-
aux différentes verdures qui fe trouvent dans les
branches d’une fleur, d’une plante, ou,d’un arbre,
& les diverfes finuofités que ces branches font en-
femble ; d’où l’on peut conclure que l’art de hou-
quetier artificiel demande plus de foin 6t de talent
qu’on ne penfe.
Pour ce qui regarde les outils de cet art, il n’y en
a point de déterminés, chaque fieurifie en ayant qui
lui font particuliers, & que les autres ne connoiffent
point. Les plus communs font les cifeaux, les pinces,
les poinçons, dont nous ne donnerons point de
figure, le lefreur pouvant les trouver à l’article des
arts où ces inftrumens font abfolument néceffaires.
Il n’y a point non plus de terme dans çet art qui ait
befoin d’une explication particulière»
F L E 867 FLEURON, (Hifl. n a t y~oye^ F l e u r »
l F l e u r o n , f. m. en Architecture , { e uille ou fleur
imaginaire, qui n’eft point imitée des naturelles, &
qui fert dans les ornemens de fculpture & bois, bronze,
pierres, plâtre, & dans la Serrurerie. (P )
F l e u r o n , (Gravure & Imprimerie.) c’eft un ornement
de fleur, ou un fujet hiftorique , ordinaire;*
ment gravé en bois ou en cuivre, que l’on met à la
fin des articles ou des chapitres où il fe trouve du
blanc à remplir. Lejleuron eû. pour ainfi dire la même
chofe que le cul-de-lampe. Il faut autant que l’on
peut éviter de donner aux fleurons une forme quar-
rée ; pour qu’ils ayent de la grâce, il faut qu’ils fe terminent
un peu en pointe au milieu par le bas, & qu’ils
foient comme arrondis aux angles par le haut : cependant
il y a des places qui nè peuvent être remplies
que par des fleurons plus longs que hauts ; c’eft
au graveur de pallier ce défaut par la gravure de fon
deflein. En général, il faut que les fleurons gravés en
bois, fous lefquels on comprend auffi les placards &
culs-de-lampes, foient un peu plus bas d’épaiffeur que
la lettre d’imprimerie, pour que les bords des orne-,
mens ne fe trouvant point foûtenus de filets, ils ne
pochent point à l’impreffion, & ne foient pas fi-tôt
ecrafés par l’eftort de la preffe. Il eft aifé de les faire
venir bien, en mettant des hauffes fous le fleuron*
Vvye{ C u l - d e -l a m p e & P l a c a r d s . Article de M ,
P A PILLON.
F l e u r o n , terme de Relieurs - Doreurs , par lequel
ils expriment un outil de cuivre fondu figuré en fleur,
qui e/l monte fur un manche, & qu’ils font chauffer
pour 1 appliquer chaud fur l’or qu’ils mettent fur le
dos d’un livre. Voye^ D o r u r e .
F l e u r o n , (Jardi) è f t u n e fe u i l le im a g in a ir e q u i
fo r t o rd in a ir em e n t d ’u n r in c e a u o u g r an d r am a g e d e
l à b r o d e r ie d’u n p a r te r r e , & e ft c om p o fé d e p lu fieu r s
p a lm e t te s » b é e s d e c o r b in , n i l le s , &c. (K )
F l e u r o n , (Serrurerie.) eft une piece d’ornement
qui fe met dans les ouvrages de Serrurerie, aux grilles
, balcons, & autres ouvrages femblables. Voye^
les Planches de Serrurerie} K eft un fleuron, M M fleuron,
& K revers d’un fleuron.
FLEURTIS, f. m. pl. ornemens du chant. Voyeç
B r o d e r i e .
FLEUVE., RIVIERE, jy non. Voilà deux fyno-
nymes fur là différence ddquels’on n’eft pas encore
convenu , fi jamais on en peut convenir ; car fi on
prétendoit tirer cette différence de la quantité d’eaux
qui coulent dans un même lit, on pourroit répondre
qu’il y a d’affez petites rivières auxquelles on a con-
fervé dans les ouvrages en profe , le nom de fleuve
que les poètes leur ont donné. Si l’on dit qüé le mot
fleuve appartient feulement aux rivières qui coulent
depuis leur fource jufqu’à la mer fans changer de.
nônï, le titre de fleuve ne conviendra pas au Rhin ,
qui n’arrive pas avec fon nom jufqu’à l’Océan. Si
l’on veut que le mot fleuve foit propre aux rivières
qui fe mêlent fans perdre leur nom, au lieu que les
autres perdent le leur, on répliquera que dans l’u-
fage ordinaire perfonne ne s’avife de dire lefleuve de
la Seine, \e fleuve de la Loire, le fleuve de la Meufe ,
quoiqu’elles ayent cette condition.
M. Sanfon va plus loin : il accorde le nom de fleuve
aux rivières qui portent de grands bateaux . & que
leurs cours rendent confidérables , qyioiqu-elles ne
portent pas leurs eaux immédiatement à la mer,
comme la Save & à la Drave, qui fe perdent dans
le Danube ; le Mein & la Mofelle, dans le Rhin, &c.
Enfin M. Corneille veut que l’on donne feulement
le nom de fleuve aux anciennes rivières, telles que
l’Araxe, l’Ifter, &c. Mais y a-t-il de nouvelles rivières
, & ne font-elles pas toutes également a nciennes ?
Il n’eft donc pas poflible de fixer la diftinttion de ces
deux mots, fleuve & rivière. Tout ce qu’on peut dire