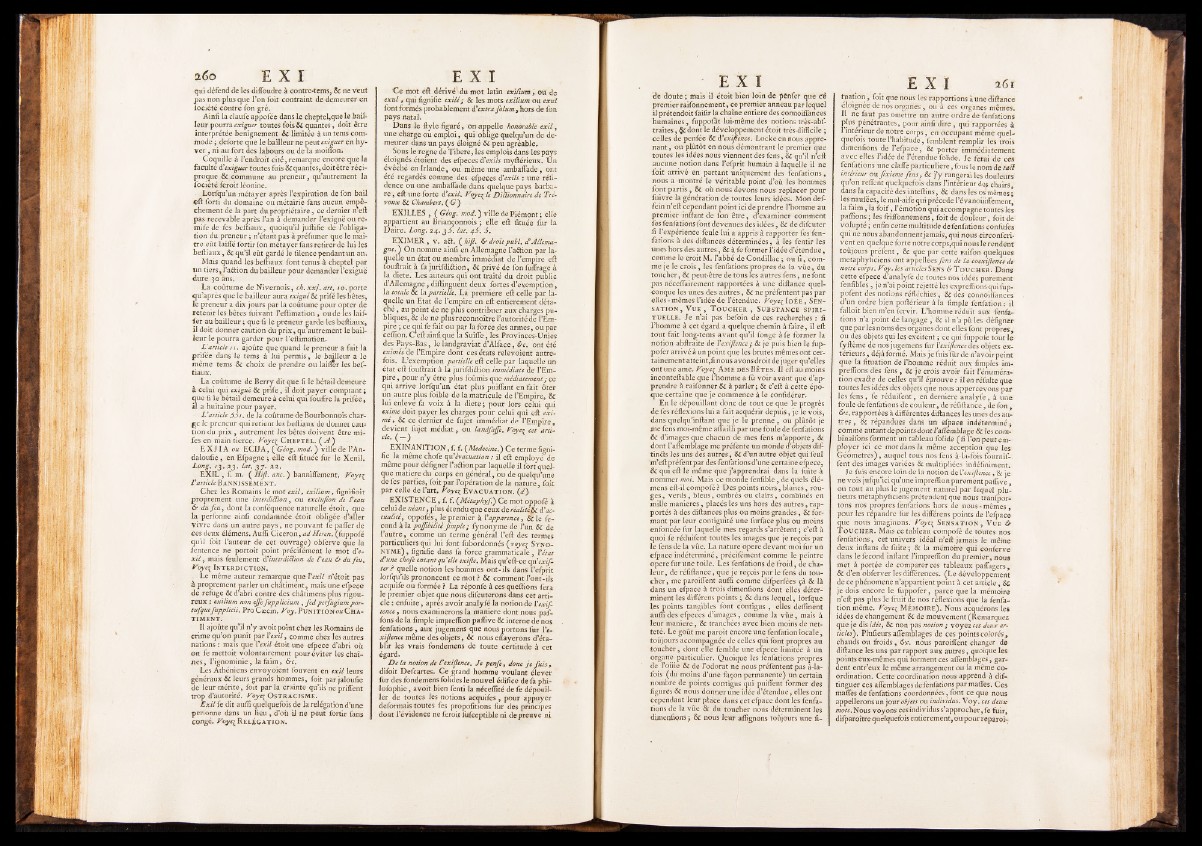
* 6o E X I Ijui défend de les diffoudre à contre-tems, ôc ne veut
pas non plus que l’on foit contraint de demeurer en
fociété contre fon gré.
Ainfi la claufe appofée dans le cheptel,que le bailleur
pourra exiguer toutes fois & quantes, doit être
interprétée benignement ôc limitée à un tems commode
; deforte que le bailleur ne peut exiguer en hy-
ver , ni au fort des labours ou de la moiffon.
Coquille à l’endroit cité, remarque encore que la
faculté d'exiguer toutes fois & quantes, doit être réciproque
& commune au preneur, qu’autrement la
jfocieté feroit léonine.
Lorfqu’un métayer après l’expiration de fon bail
eft forti du domaine ou métairie fans aucun empêchement
de la part du propriétaire, ce dernier n e ll
pas recevable après l’an à demander l’exiguë ou re-
mife de fes beftiaux, quoiqu’il juftifie de l’obligation
du preneur ; n’étant pas à pré fumer que le maître
eût laiffé lortir Ion métayer fans retirer de lui les
beftiaux, & qu’il eût gardé le iilence pendant un an.
Mais quand les beftiaux font tenus à cheptel par
un tiers ^î’aâion du bailleur pour demander l’exiguë
dure 30 àns.
La coûtume de N ivernois, ch. xx j. art. io . porte
qu’a près que le bailleur aura exiguë ôc prifé les bêtes,
le preneur a dix jours par la coûtume pour opter de
retenir les bêtes l’uivant l’eftimation, ou de les laif-
fer au bailleur ; que li le preneur garde les beftiaux,
il doit donner caution du p rix, qu’autrement le bailleur
le pourra garder pour l ’eftimation.
Larticle 11. ajoûte que quand le preneur a fait la
prifée dans le tems à lui permis, le bailleur a le
même tems ôc choix de prendre ou laifïêr les beftiaux.
La coûtume de Berry dit que fi le bétail demeure
à celui qui exiguë ôc prife, il doit payer comptant ;
que fi le bétail demeure à celui qui foufff e la prifée,
il a huitaine pour payer.
L'article à5t, de la coûtume de Bourbonnois charge
le preneur qui retient les beftiaux de donner caution
du prix , autrement les bêtes doivent être mi-
fes en main tierce. Voye^ Cheptel. ( -^ )
E X J IA ou ECIJA, ( Géog. mod. ) ville de I’An-
daloufie, en Efpagne ; elle eft fituée fur le Xenil,
Long. 13 .2 3 . lat. 3 7 . 22.
EXIL , f. m. ( Hifi. anc. ) banniffement. Voye^
l'article BANNISSEMENT.
Chez les Romains le mot exil, exilium, fignifioit
proprement une interdiction, ou exclufion de Veau
& du feu, dont la conféquence naturelle étoit, que
la perfonne ainfi condamnée étoit obligée d’aller
vivre dans un autre pa ys, ne pouvant fe paffer de
ces deux élémens. Aufli Cicéron, adHeren. (fuppofé
qu’il foit l’auteur de cet ouvrage) obferve que la
lentence ne portoit point précilément le mot d'e-
x i l , mais feulement d’interdiction de Veau & du feu«
Voye^ Interdiction.
Le même auteur remarque que Y exil n’étoit pas
à proprement parler un châtiment, mais une efpece
de refuge ôc d’abri contre des châtimens plus rigoureux
: exilium non ejfe fupplicium , fed perfugium por-
tufquefupplicii. ProCæcin. Voy. Punition ou C hâtiment.
Il ajoûte qu’il n’y avoit point chez les Romains de
crime qu’on punît par Y exil, comme chez les autres
nations : mais que Yexil étoit une efpece d’abri oii
on fe mettoit volontairement pour éviter les chaînes
, l’ignominie, la faim, &c.
Les Athéniens envoyoient fouvent en exil leurs
généraux ôc leurs grands hommes, foit par jaloufie
de leur mérite, foit par la crainte qu’ils ne priffent
trop d’autorité, Voye[ OSTRACISME.
E x il fe dit aufli pertonne dans un qliueeul q,u de’fooùis idl en lea preeluégt aftoiortni rd ’fuannes congé. yoyt{ Relégation.
E X I C e mot eft dérivé du mot latin exilium > ou de
exu l, qui lignifie exilé; & les mots exilium ou exul
font formés probablement d’extra folum, hors de fon
pays natal.
Dans le ftyle figuré, on appelle honorable e x il,
une charge ou emploi, qui oblige quelqu’un de demeurer
dans un pays éloigné Ôc peu agréable.
Sous le régné de Tibere, les emplois dans les pays
éloignés étoient des efpeces d'exils myftérieux. Un
évêché en Irlande, ou même une ambaflade, ont
ete regardes comme des efpeces d'exils : une réfi-
dence ou une ambaflade dans quelque pays barbare
, eft une forte d'exil. Voyt^ le Dictionnaire de Trévoux
ÔC Charniers, ( G )
EXILLES , ( Gëog. mod. ) v ille de Piémont ; elle
appartient au Briançonnois ; elle eft fituée fur la
Daire. Long. 2 4 .3 6. lat. 45. 6.
EXIMER , v . aft. ( hifi. & droitpubl. <TAllemagne.
) On nomme ainfi en Allemagne l’a&ion par laquelle
un état ou membre immédiat de l’empire eft
louftrait à fa jurifdiûion, ôc privé de fon fuffrage à
la diete. Les auteurs qui ont traité du droit public
d’Allemagne, diftinguent deux fortes d’exemption,
la totale ôc la partielle. La première eft celle par laquelle
un Etat de l’empire en eft entièrement détaché
, au point de ne plus contribuer aux charges publiques,
ôc de ne plusreconnoître l’autorité de l’Empire
; ce qui fe fait ou par la force des armes, ou par
ceflion. C ’eft ainfi que îa Suiffe, les Provinces-Unies
des Pays-Bas, le landgraviat d’Alface, &c. ont été
eximés de l’Empire dont ces états relevoient autre-
. fois. L ’exemption partielle eft celle par laquelle un
état eft fouftrait à la jurifdiétion immédiate de l’Empire
, pour n’y être plus foûmis que médiatement ; ce
qui arrive lorfqu’un état plus puiffant en fait ôter
un autre plus foible de la matricule de l’Empire, ôc
lui enleve fa voix à la diete ; pour lors celui qui
exime doit payer les charges pour celui qui eft exi-
mé, ôc ce dernier de fujet immédiat de l’Empire,
devient fujet médiat, ou landfajfe. Vcye^ cet arti-
cle. ( - )
EXINANITION, f. f. (Medecine.) Ce terme lignifie
la même chofe qu’évacuation : il eft employé de
même pour défigner l’a&ionpar laquelle il fort quelque
matière du corps en général, ou de quelqu’une
de fes parties, foit par l’opération de la nature, foit
par celle de l’art. Voye.1 Evacuation. (d )
EXISTENCE, f. f. (Métaphyf.) C e mot oppofé à
celui de néant, plus étendu que ceux de réalité&c d’actualité,
oppofés, le premier à Y apparence, & le fécond
à la poffibilité fimple; fynonyme de l’un ôc de
l’autre, comme un terme général l’eft des termes
particuliers qui lui font fubordonnés (voye^ Synonyme)
, lignifie dans fa force grammaticale, Y état
<Vune chofe entant qu'elle exifie. Maisqu’eft-ce qu'exif-
ter? quelle notion les hommes ont-ils dans l’efprit
iorfqu’ils prononcent ce mot? ôc comment l’ont-ils
acquife ou formée ? La réponfe à ces queftions fera
le premier objet que nous difcuterons dans cet article
: enfuite, apres avoir analyfé la notion de Yexif-
tence, nous examinerons la maniéré dont nous paf-
fons de la fimple impreftion paflîve ôc interne de nos
fenfations, aux jugemens que nous portons fur IV
xifience même des objets, ôc nous efl'ayerons d’établir
les vrais fondemens de toute certitude à cet
égard.
De la notion de l'ex'fience. Je penfe, donc je fu is ,
difoit Defcartes. Ce grand homme voulant élever
fur des fondemens folides le nouvel édifice de fa phi-
lofophie, avoit bien fenti la néceflité de fe dépouiller
de toutes les notions acquifes, pour appuyer
déformais toutes fes propofitions fur des principes
dont l’évidence ne feroit fufceptible ni de preuve ni
E X I
de doute ; mais il étoit bien loin de pfinfer que cè
premier raifonnement, ce premier anneau par lequel
il prétendoit faifir la chaîne entière des connoiffances
humaines, fuppofât lui-même des notions très-abf-
traites, §cdont le développement étoit très-difficile ;
celles de penfée ôc d'exifience. Locke en nous apprenant
, ou plutôt en nous démontrant le premier que
toutes les idées nous viennent des fens, ôc qu’il n’eft
aucune notion dans l’efprit humain à laquelle il ne
foit arrivé en partant uniquement des fenfations,
nous a montré le véritable point d’où les hommes
font partis , & où nous devons nous replacer pour
fuivre la génération de toutes leurs idées. Mon def-
fein n’eft cependant point ici de prendre l’homme au
premier inftant de Ion être, d’examiner comment
fes fenfations font devenues des idées, & de difeuter
li l’expérience feule lui a appris à rapporter fes'fenfations
à des diftances déterminées, à les fentir les
unes hors des autres, & à fe former l’idée d’étendue,
comme le croit M. l’abbé de Condillac ; ou f i , comme
je le crois, les fenfations propres de la vue , du
toucher, ôc peut-être de tous les autres fens, ne font
pas néceffairement rapportées à une diftance quelconque
les unes des autres, & ne préfentent pas par
elles - mêmes l’idée de l’étendue. Voye1 Id é e , Sens
a t i o n , V u e , T o u c h e r , Su b s t a n c e s p ir i t
u e l l e . Je n’ai pas befoin de ces recherches : fi
l ’homme à cet égard a quelque chemin à faire, il eft
tout fait long-tems avant qu’il fonge à fe former la
notion abftraite de Yexifîence ; & je puis bien le fup-
pofer arrivé à un point que les brutes mêmes ont certainement
atteint,fi nous avons droit de juger qu’elles
ont une ame. Voye^ À m e des Bê t e s . II eft au moins
inconteftable que l’homme a fû voir avant que d’apprendre
à raifonner & à parler; & c’eft à cette époque
certaine que je commence à le confidérer.
En le dépouillant donc de tout ce que le progrès
de fes réflexions lui a fait acquérir depuis, je le vois,
dans quelqu’inftànt que je le prenne , ou plûtôt je
me fens moi-même affailli par une foule de fenfations
ôc d’images que chacun de mes fens m’apporte, &
dont l’affemblàge me préfente un monde d’objets difi
tinéls les uns des autres, ôc d’un autre objet qui feul
'm’eft préfentpar des fenfations d’une certaine efpece,
ôc qui eft le même que j’apprendrai dans la fuite à
nommer moi. Mais ce monde fenfible, de quels élémens
eft-il compofé ? Des points noirs, blancs, rouges
, verds, bleus, ombrés ou clairs, combinés en
mille maniérés, placés les uns hors des autres, rapportés
à des diftances plus ou moins grandes, ôc formant
par leur contiguité une furface plus ou moins
enfoncée fur laquelle mes regards s’arrêtent ; c’eft à
quoi fe réduifent toutes les images que je reçois par
le fens de la vûe. La nature opéré devant moi fur un
efpace indéterminé, précifément comme le peintre
opéré fur une toile. Les fenfations de froid, de chaleur,
de réfiftance, que je reçois par le fens du toucher
, me paroiflent aufli comme difperfées çà & là
dans un efpace à trois dimenfions dont elles déterminent
les différens points ; ôc dans lequel, iorfque
les points tangibles font contigus , elles deflment
aufli des efpeces d’images, comme la v û e , mais à
leur maniéré, ôc tranchées avec bien moins de netteté.
Le goût me paroît encore une fenfation locale,
toûjours accompagnée de celles qui font propres au
toucher, dont elle femble une elpece limitée à un
organe particulier. Quoique les fenfations propres
de l’oiiie ôc de l’odorat ne nous préfentent pas à-la-
fois (du moins d’une façon permanente) un certain
nombre de points contigus qui puiffent former des
figures ôc nous donner une idée d’étendue, elles ont
cependant leur place dans cet efpace dont les fenfations
de la vûe & du toucher nous déterminent les
dimenfions ; 6c nous leur afiignons toûjours une fi-
E X I a6r tpation, foit que nous les rapportions à une diftance
eloignee de nos organes, ou à ces organes mêmes.
Il ne faut pas omettre un autre ordre de fenfations
plus pénétrantes, pour ainfi dire, qui rapportées à
1 inferieur de notre corps, en occupant même quelquefois
toute l’habitude, femblent remplir les trois
dimenfions de l’efpace, ôc porter immédiatement
avec elles l’idée de l’étendue folide. Je ferai de ces
fenfations une claffe particulière, fous le nom de tact
intérieur ou Jîxiemc fens, ôc j’y rangerai les douleurs
qu’on reflent quelquefois-dans l’intérieur des chairs
dans la capacité des inteftins, & dans les os mêmes;
les naufées, le mal-aife qui précédé l’évanoüiflement,
la faim, la fo if , l’émotion qui accompagne toutes les
paflïons ; les friflonnemens, foit de douleur, foit de
volupté ; enfin cette multitude de fenfations confufes
qui ne nous abandonnent jamais, qui nous circonfcri-
vent en quelque forte notre corps,qui nous le rendent
toujours préfent, & que par cette raifon quelques
inetaphyficiens ont appellées Jëns de la coexifience de
notre corps. Voy. les articles Sens 6*Toucher. Dans
cette efpece d analyfe de toutes nos idéés purement
fenfibles, je n’ai point rejetté les expreflions quifup-
pofent des notions réfléchies , & de s connoiflances
d’un ordre bien poftérieur à la fimple fenfation : il
falloit bien m’en fervir. L’homme réduit aux fenfations
n’a point de langage ^ & il n’a pû les défigner
que parles noms des organes dont elles font propres,
ou des objets qui les excitent ; ce qui fuppolè tout le
fyftème de nos jugemens fur Yexifience des objets extérieurs
, déjà formé. Mais je fuis fûr de n’avoir peint
que la fituation de l’homme réduit aux fimples im-
preflîons dès fens , ôc je crois avoir fait l’énumération
exatte de celles qu’il éprouve : il en refuite que
toutes les idées des objets que nous appercevons par
les fens , fe réduifent, en derniere analyfe, à une
foule de fenfations de couleur, de réfiftance, de fon ,
&c. rapportées à différentes diftances les unes des autres
, & répandues dans un efpace indéterminé,
comme autant de points dont l ’affemblage & les com-
binaifons forment un tableau folide ( fi l’on peut employer
ici ce mot dans la même acception que les
Géomètres), auquel tous nos fens à-la-fois fournif-.
fent des images variées & multipliées indéfiniment.
Je fuis encore loin de la notion de Yexifience, & je
ne vois jufqu’ici qu’une impreflion purement paflive ,
ou tout au plus le jugement naturel par lequel plu-
fieurs métaphyficiens prétendent que nous tranfpor-
tons nos propres fenfations fiors de nous - mêmes ,
pour les répandre fur les différens points de l’efpace
que nous imaginons. Voye1 Sensation, Vue & T oucher. Mais ce tableau compofé de toutes nos
fenfations, cet univers idéal n’eft jamais le même
deux inftans de fuite; & la mémoire qui eonferve
dans le fécond inftant l’impreflîon du premier, nous
met à portée de comparer ces tableaux paflagers,
& d’en obferver les différences. (Le développement
de ce phénomène n’appartient point à cet article, &c
je dois encore le fuppofer, parce que la mémoire
n’eft pas plus le fruit de nos réflexions que la fenfation
même. Voye^ Mémoire). Nous acquérons les
idées de changement & de mouvement (Remarquez
que je dis idée, ÔC non pas notion ; voyez ces deux articles).
Plufieurs affemblages de ces points colorés ,
chauds ou froids, &.c. nous paroiflent changer dé
diftance les uns parrapport aux autres, quoique les
points eux-mêmes qui forment ces affemblages, gardent
entr’eux le même arrangement ou la même coordination.
Cette coordination nous apprend à dif-
tinguer ces affemblages de fenfations parmaffes. Ces
maffes de fenfations coordonnées, font ce que nous
appellerons un jour objets ou individus. V oy. ces deux
/nott.Nous voyons ces individus s’approcher, fe fuir,
difparoître quelquefois entièrement, ou pour reparoî