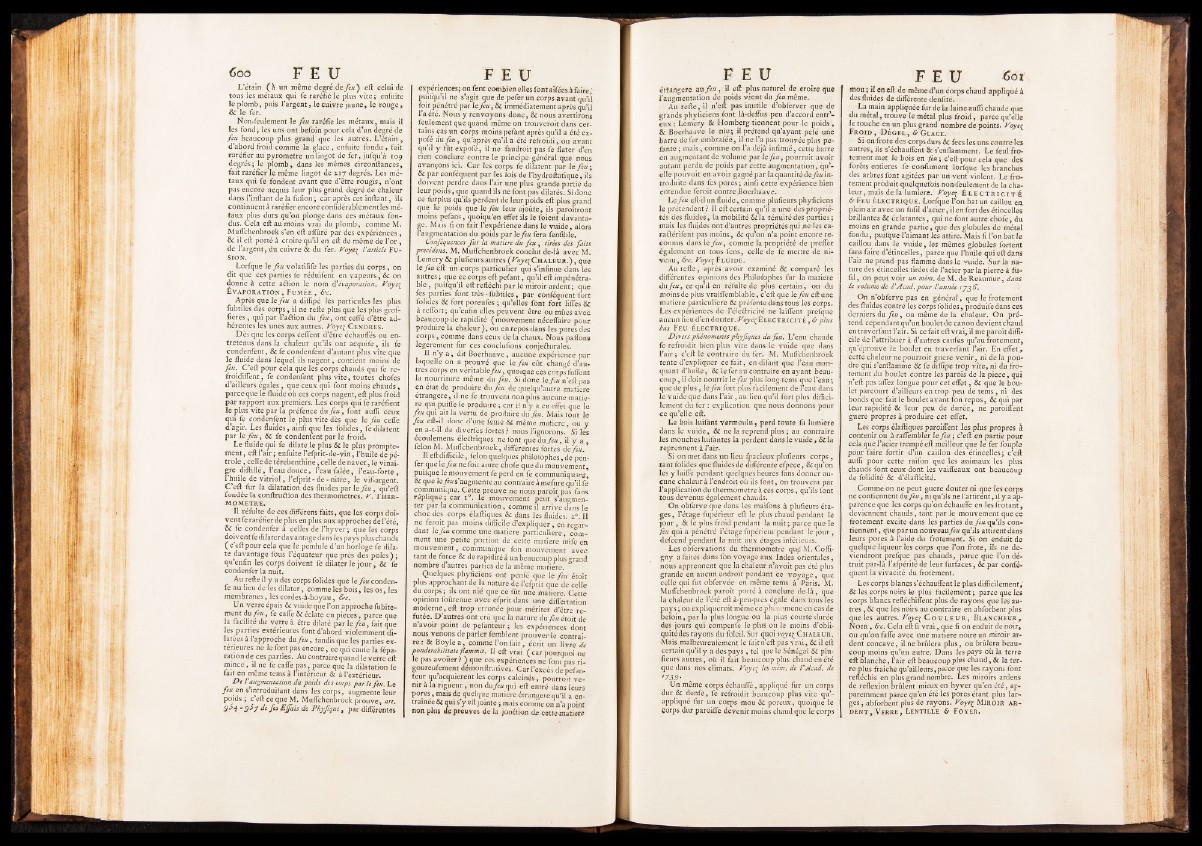
L ’étain ( à un même degré de feu') eft celui de
tous les métaux qui fe raréfie le plus vite ; enfuite
le plomb, puis l’argent, le cuivre jaune, le rouge,
& le fer.
Non-feulement le feu raréfie les métaux, mais il
les fond; les uns ont befoin pour cela d’un degré de
feu beaucoup plus grand que les autres. L’étain ,
d’abord froid comme la glace, enfuite fondu , fait
raréfier au pyrometre un lingot de fer, jufqu’à 109
degrés ; le plomb, dans les mêmes circonftances,
fait raréfier le même lingot de 1 17 degrés. Les métaux
qui fe fondent avant que d’être rougis, n’ont
pas encore acquis leur plus grand degré de chaleur
dans l’inftant de la fufion ; car après cet inftant, ils
continuent à raréfier encore confidérablementles métaux
plus durs qu’on plonge dans ces métaux fondus.
Cela eft au moins vrai du plomb, comme M.
Muflchenbroek s’en eft affiné par des expériences ,
& il eft porté à croire qu’il en eft de même de l’or ,
de l’argent, du cuivre & du fer. Voy*{ L'article F u s
i o n .
Lorfque le feu volatilife les parties du corps, on
dit que ces parties fe réduifent en vapeurs,‘ & on
donne à cette aâion le nom d’évaporation. Foyea^
É v a p o r a t i o n , F u m é e , &c.
Après que le feu a diflipé les particules les plus
fubtiles des corps, il ne refte plus que les plus grof-
fieres, qui par l’aôion du feu , ont ceffé d’être adhérentes
les unes aux autres. Voye{ C e n d r e s .
Dès que les corps ceffent d’être échauffés ou entretenus
dans la chaleur qu’ils ont acquife, ils fe
condenfent, & fe condenfent d’autant plus vite que
le fluide dans lequel ils nagent, contient moins de
feu. C’eft pour cela que les corps chauds qui fe re-
froidiffent, fe condenfent plus v ite , toutes chofes
d’ailleurs égales, que ceux qui font moins chauds,
parce que le fluide où ces corps nagent, eft plus froid
par rapport aux premiers. Les corps qui fe raréfient
le plus vite par la préfence du fe u , font aufli ceux
qui fe condenfent le plus vite dès que le feu ceffe
d’agir. Les fluides, ainfi que les folides, fe dilatent
par le fe u , & fe condenfent par le froid.
Le fluide qui fe dilate le plus & le plus promptement
, eft l’air ; enfuite l’efprit-de-vin, l’huile de pétrole
, celle de térébenthine, celle de navet, le vinaigre
diftillé, l’eau douce, l’eau falée, i’eau-forte ,
l’huile de vitriol, l’efprit - de - nitre, le vif-argent.
C ’eft fur la dilatation des fluides par le feu , qu’eft
fondée la conftruftion des thermomètres. V. T h e r m
o m è t r e .
Il réfulte de ces différens faits, que les corps doivent
fe raréfier de plus en plus aux approches de l’été,
& fe condenfer à celles de l’hy ver ; que les corps
doivent fe dilater davantage da ns les pays plus chauds
( c’eftpour cela que le pendule d’un horloge fe dilate
davantage fous l’équateur que près des pôles ) ;
qu’enfin les corps doivent fe dilater le jour, & fe
condenfer la nuit.
Au refte il y a des corps folides que le feu conden-
fe au lieu de les dilater, comme les bois, les os, les
membranes, les cordes-à-boyau, &c.
Un verre épais & vuide que l’on approche fubite-
ment du feu , fe caffe & éclate en p ièces, parce que
la facilité du verre à être dilaté par le feu , fait que
les parties extérieures font d’abord violemment dilatées
à l’approche du feu , tandis que les parties extérieures
ne le font pas encore, ce qui caufe la fépa-
rationde ces parties. Au contraire quand le verre eft
mince, il ne fe cafte pas, parce que la dilatation fe
fait en même tems à l’intérieur & à l’extérieur.
De l'augmentation du poids des corps par le feu. Le
feu en s inrroduifant dans les corps, augmente leur
poids ; c’eft ce que M. Muflchenbroek prouve, art.
"2*7 dt f es EJfeis de Phyjîque, par différentes
expériences; on fient combien elles font aifées à faire,1
puifqu’il ne s’agit que de pefer un corps avant qu’il
foit pénétré par le feu , 6c immédiatement après qu’il
l’a été. Nous y renvoyons donc, & nous avertirons
feulement que quand même on trouveroit dans certains
cas un corps moins pefant après qu’il a été ex-
pole au feu , qu’après qu’il a été refroidi, ou avant
qu’il y fût expofé, il ne faudroit pas fe flater d’en
rien conclure contre le principe général que nous
avançons ici. Car les corps fe dilatent par le feu ;
& par conféquent par les lois de l’hydroftatique, ils
doivent perdre dans l’air une plus grande partie de
leur poids, que quand ils ne font pas dilatés. Si donc
ce furplus qu’ils perdent de leur poids eft plus grand
que le poids que le feu leur ajoûte, ils paroîtront
moins pefans, quoiqu’en effet ils le foient davantage.
Mais fi on fait l’expérience dans le vuide, alors
l’augmentation du poids par le feu fera fenfible.
Confequences fur la matière du feu , tirées des faits
precédens. M. Muflchenbroek conclut de-là avec M.
Lemery & plufieurs autres (V o y e^C haleur.) , que
le feu eft un corps particulier qui s’infinue dans les
autres ; que ce corps eft pefant, qu’il eft impénétrable
, puilqu’il eft réfléchi par le miroir ardent ; que
fes parties font très - fubtiles, par conféquent fort
folides & fort poreufes ; qu’elles font fort lifles &
à reffort ; qu’enfin elles peuvent être ou mûes avec
beaucoup de rapidité (mouvement néceflaire pour
produire la chaleur), ou en repos dans les pores des
corps, comme dans ceux de la chaux. Nous paflons
legerement fur ces conclufions conje&urales.
Il n’y a , dit Boerhaave, aucune expérience par
laquelle on a prouvé que le feu eût changé d’autres
corps en véritable/««, quoique ces corps fuffent
la nourriture même du feu. Si donc le feu n’eft pas
en état de produire du feu de quelqu’autre matière
étrangère , il ne fe trouvera non plus aucune matière
qui puiffe le produire ; car il n’y a en effet que le
feu qui ait la vertu de produire du feu. Mais tout le
feu eft-il donc d’une feule 6c même matière, ou y
en a-t-il de diverfes fortes? nous l’ignorons. Si les
écoulemens éle&riques ne font que du feu , il y a ,
félon M.^Muflchenbroek, différentes fortes de feu.
Il eft difficile, félon quelques philofophes, de pen-
ferque le feu ne foit autre chofe que du mouvement,
puifque le mouvement fe perd en fe communiquant,
& que le feu s’augmente au contraire à mefure qu’ilfe
communique. Cette preuve ne nous paroît pas fans
réplique ; car i° . le mouvement peut s’augmenter
par la communication, comme il arrive dans le
choc des corps élaftiques & dans les fluides. z°. Il
ne feroit pas moins difficile d’expliquer, en regardant
le feu comme une matière particulière, comment
une petite portion de cette matière mife en
mouvement, communique fon mouvement avec
tant de force & de rapidité à un beaucoup plus grand
nombre d autres parties de la même matière.
Quelques phyficiens ont penfé que le feu étoit
plus approchant de là nature de l’efprit que de celle
du corps ; ils ont nié que ce fût une matière. Cette
opinion foûtenue avec efprit dans une differtation
moderne, eft trop erronée pour mériter d’être refutée.
D ’autres ont crû que la nature du feu étoit de
n’avoir point de pefanteur ; les expériences dont
nous venons deparler femblent prouver le contraire
: & B o y le a , comme l’on fa it, écrit un livre de
ponderabilitate flammoe. II eft vrai ( car pourquoi me
le pas avoiier? ) que ces expériences ne font pas ri-
goureufement démonftratives. Car l’excès de pefanteur
qu’acquierent les corps calcinés, pourroit venir
à la rigueur, non du feu qui eft entré dans leurs
pores, mais de quelque matière étrangère qu’il a entraînée
& qui s’y eft jointe ; mais comme on n’a point
non plus de preuves de la jonûion de cette matière
étrangère au fe u , il eft plus naturel de croire que
l’augmentation de poids vient du feu me me.
Au refte, il n’eft pas inutile d’obferver que de
grands phyficiens font là-defîiis peu d’accord entr’-
eux : Lemery & Homberg tiennent pour le poids ,
& Boerhaave le nie:; il prétend qu’ayant pefé une
barre de fer .embraféë, il ne l’a pas trouvée plus pe-
fante ; mais, comme pri l’a déjà infinité, cette barre
en augmentant de volume par le feu, «pourroit avoir
autant perdu de poids par cètte augmentation, qu’elle
pouvoit en avoir gagné par la quantité de ^ « in troduite
dans fe s pores ; ainfi cette expérience bien
entendue feroit contre Boerhaave.
Le feu eft-il un fluide, comme plufieurs phyficiens
le prétendent ? Il eft certain qu’il a une des propriétés
des fluides , la mobilité & la ténuité des parties ;
mais les fluides ont d’autres propriétés qui ne des ca-
raftérifent pas moins, ôc qu’on n’a point encore reconnus
dans le feu, -comme la propriété de prefler
également en tous fens, celle de fe mettre de niveau,
&c. Vbye^ F l u i d e .
Au refte, après avoir examiné & comparé lés
différentes opinions des Philofophes fur la matière
du feu, ce qu’il en réftilte de plus certain, ou dii
moins de plus vraiffemblable, c’eft que le feu eft Une
matière particulière & préfente dans tous les corps.
Les expériences de •l’éle&ricité ne Iaiffent prefque
aucun lieu d’en douter. Voyv($L l e c t r i c i t è , & plus
bas Feu ÉLECTRIQUE.
Divers phénomènes phyjîques du Jeu. L’eau chaude
fe refroidit bien plus vîte dans le vuide que dans
l’air ; c’eft le contraire du fer. M. Muflchenbroek
tente d’expliquer c e fait, en difant que l’ eau manquant
d’huile, & le fer au contraire en ayant beaucoup
, il doit nourrir le feu plus lông-fems que l’eau;
que de plus, le feu fort plus facilement de l’eau dans
le vuide que dans l’air , au lieu qu’il fort plus difficilement
du fer : explication que nous donnons pour
ce qu’elle eft.
Le bois luifant vermoulu, perd toute fia lumière
dans le vuide, & ne la reprend plus ; au contraire
les mouches luifantes la perdent dans le vuide, & la
reprennent à l’air.
Si on met dans un lieu fpacieux plufieurs corps ,
tant folides que fluides de différente efpece, & qu’on
les y laiffe pendant quelques heures fans donner aucune
chaleur à l’endroit où ils font, on trouvera par
l’application du thermomètre à ces corps, qu’ils font
tous devenus également chauds.
On obferve que dans les maifons à plufieurs étages
, l’étage fupérieur eft le plus chaud pendant le
jour , & le plus froid pendant la nuit ; parce que le
feu qui a pénétré l’étage fupérieur pendant le jour,
defeend pendant la nuit aux étages inférieurs.
Les obfervations du thermomètre qujî M. Coffi-
gny a faites dans fon voyage aux Indes orientales,
nous apprennent que la chaleur n’a voit pas été plus
grande en aucun endroit pendant ce vo y ag e , que
celle qui fut obfervée en même tems à Paris. M.
Muflchenbroek paroît porté à conclure de-là, que
la chaleur de l’été eft à-peu-près égale dans tous les
pays ; on expliqueroit même ce phénomène en cas de
befoin, par la plus longue ou la plus courte durée
des jours qui compenfe le plus ou le moins d’obliquité
des rayons du foleil. Sur quoi voyei C h a l e u r .
Mais .malheureufement le fait n’eft pas v ra i, & il eft
certain qu’il y a des pays , tel que le Sénégal & plufieurs
autres, où il fait beaucoup plus chaud en été
que dans nos climats. Voyeç les mém. de l'Acad, de
‘ 739- A
Un même corps échauffé, appliqué fur un corps
dur & denfe, fe refroidit beaucoup plus vîte qu’~
appliqué fur un corps mou & poreux, quoique le
corps dur paroiffe devenir moins chaud que le corps
mou ; il en eft de même d’un corps chaud appliqué à
des fluides de différente denfrté.
La main appliquée fur.de iadaine auffi chaude que
du métal, trouve le métal plus froid, parce qu’elle
le touche en un plus grand nombre de points. Voyez
F r o i d , D é g e l , & G l a c e . -
Si onfrote des corps durs & fecs les uns contre le.s
autres, ils s’échauffent & s’enflamment. Le feul frôlement
met le bois en feu-, c’eft pour cela que des
forêts entières -fe confirment lorfque les branches
des arbres font agitées par un vent violent. Le frôlement
produit quelquefois nonfieulement de la chaleur,
mais de la lumière. Voyes^ ' É l e c t r i c i t é
d* F e u é l e c t r i q u e . Lorfque l’on batun caillou eu
plein air avec un fufil d’acier, ilen fortdes étincelles
brillantes & éclatantes, qui ne font autre chofe, du
moins en grande partie, que des globules de métal
fondu, puilque l’aimant les attire. Mais fi l’on bat le
caillou dans le vuide, les mêmes globules fortertt
fans faire d’étincelles, parce-que l’huile qui eft dans
l’air ne prend pas flamme dans le vuide. Sur la nature
des étincelles tirées de l’acier par la pierre à fufil
, on peut voir un mém. de M. de Reaumur, dans
Le volume de l'Acad, pour l'année /yj 6.
On n’obferye pas en général, que le frotement
des fluides contre les corps folides, produife dans ces
derniers du feu , ou même de la chaleur. On prétend
cependant qu’un boulet de canon devient chaud
en traverfant l’air. Si ce fait eft vrai, il me paroît difficile
de l’attribuer à d’autres caufes qu’au frotement,
qu’éprouve le boulet en traverfant l’air. En effet ,
cette chaleur ne pourroit guère venir, ni delà poudre
qui s’enflamme & fe diffipe trop vîte, ni du fro-
tement.du boulet contre les parois de la piece, qui
n’eft pas aflez longue pour cet effet, 6c que le boulet
parcourt d’ailleurs en trop peu de tems, ni des
bonds que fait le boulet avant fon repos, & qui par
leur rapidité & leur peu de durée, ne paroiflent
guere propres à produire cet effet.
Les corps élaftiques paroiflent les plus propres à
contenir ou à raflembler le feu ; c’eft en partie pour
cela que l’acier trempé eft meilleur que le fer foupte
pour faire fortir d’un caillou des étincelles ; c ’eft
aufli pour cette raifon que les animaux les plus
chauds font ceux dont les vaiffeaux ont beaucoup
de folidité 6c d’élafticité.
Comme on ne peut guere douter ni que les corps
ne contiennent du feu, ni qu’ils ne l’attirent, il y a apparence
que les corps qu’on échauffe en les frotant,
deviennent chauds, tant par le mouvement que ce
frotement excite dans les parties du feu qu’ils contiennent
, que par un nouveau feu qu’ils attirent dans
leurs pores, à l ’aide du frotement. Si on enduit de
quelque liqueur les corps que l’on frote, ils ne deviendront
prefque pas chauds, parce que l’on détruit
par-là l’afpérité de leur furfaces, 6c par conféquent
la vivacité du frotement.
Les corps blancs s’échauffent le plus difficilement,'
& les corps noirs le plus facilement ; parce que les
corps blancs refléchiffent plus de rayons que les autres
, 6c que les noirs au contraire en abforbent plus
que les autres. Voye^ C o u l e u r , B l a n c h e u r ,
N o i r , &c. Cela eft fi v ra i, que fi on enduit de noir,
ou qu’on fafle avec une matière noire un miroir ardent
concave, il ne brûlera plus, ou brûlera beaucoup
moins qu’un autre. Dans les pays où la terre
eft blanche, l’air eft beaucoup plus chaud, & la terre
plus fraîche qu’ailleurs,parce que les rayons font
réfléchis en plus grand nombre. Les miroirs ardens
de reflexion brûlent mieux en hyver qu’en été, apparemment
parce qu’en été les pores étant plus larges
, abforbent plus de rayons. Voye^ M i r o i r a r d
e n t , . V e r r e , L e n t i l l e & F o y e r .