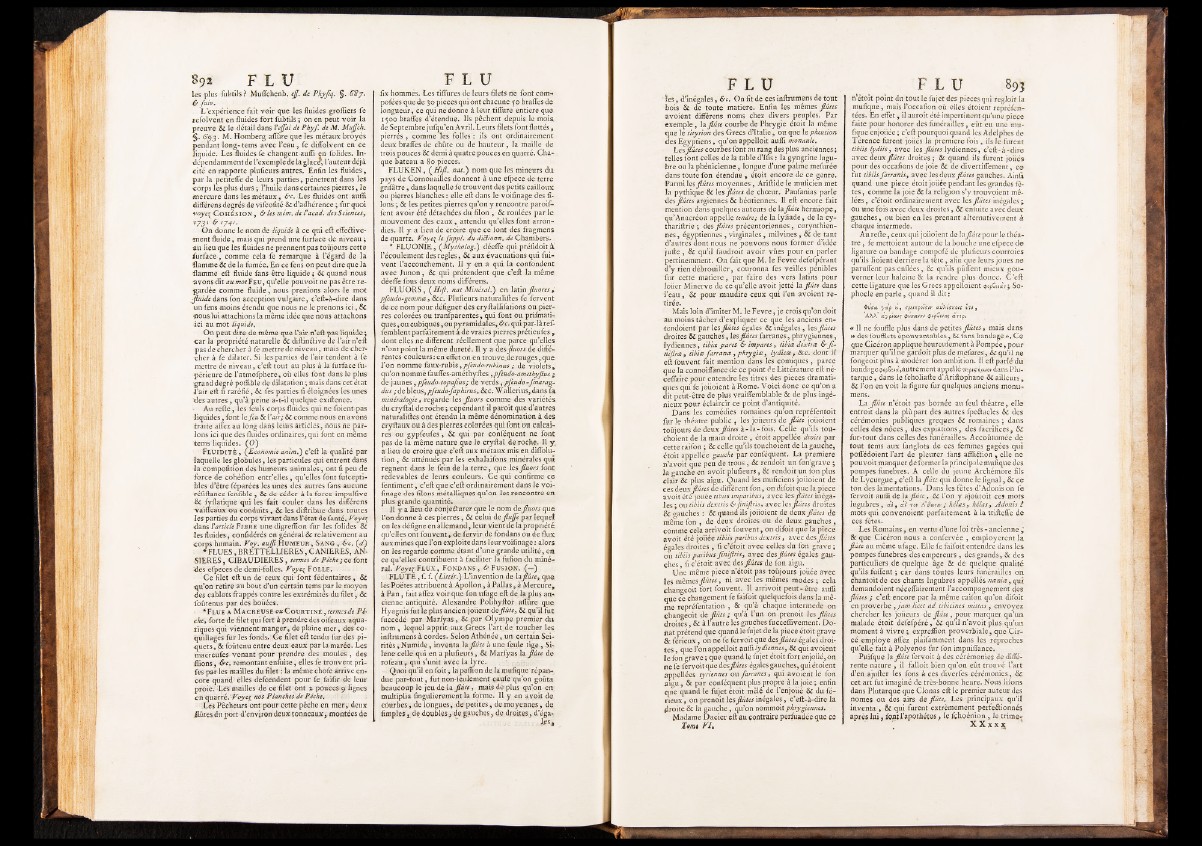
les plus fubtik? Muffchenb. eff. de Phyflq. § . CS y.
& fuiv.
L ’expérience fait voir que les fluides .grofîiers fe
refolvent en fluides fort fubtils ; on en peut voir la
preuve & le détail dans Vejfai de P hyf de M-. Muflch.
65)3. M. Homberg affûre que les métaux broyés
pendant long-tems avec l’eau , fe diflolvent en ce
liquide. Les fluides fe changent aufli en folides. Indépendamment
de l’exemple de la glace, l ’auteur déjà
cité en rapporte plulieurs autres. Enfin les fluides,
par la petiteffe de leurs parties, pénètrent dans les
■ corps les plus durs ; l’huile dans certaines pierres, le
mercure dans les m étaux, &c. Les fluides ont aufli
diflerens degrés de vifeofité & d’adhérence ; fur quoi
voye[ COHESION, & les mém. de Üacad. desSciences,
1731 & 1741. . . .
On donne le nom de -liquide à ce qui eft effectivement
fluide, mais qui prend une furface de niveau ;
au lieu que les fluides ne prennent pas toujours cette
furface, comme cela fe remarque à l’égard de la
flamme & de la fumée. En ce fens on peut dire que la
flamme eft fluide fans être liquide ; & quand nous
-avons dit aumot Feu, qu’elle pouvoit ne pas être regardée
comme fluide, nous prenions alors le mot
fluide dans fon acception vulgaire, c’eft-à-dire dans
un fens moins étendu que nous ne le prenons ic i, &
■ nous lui attachions la même idée que nous attachons
ic i au mot liquide.
On peut dire de même que l'air n’eft- pas liquide ;
ca r la propriété naturelle & diftinétive de l’air n’eft
pas de chercher à fe mettre de niveau, mais de cher>-
-cher à fe dilater. Si les parties de l’air tendent à fe
mettre de niveau, c’eft tout au plus à la furface fu-
périeure de l’atmofphere , où elles font dans le plus
grand degré poflible de dilatation ; mais dans cet état
■ l’air eft fi raréfié, & fes parties fi éloignées les unes
des autres, qu’à peine a-t-il quelque exiftence.
- Au réfte, les feuls corps fluides qui ne foient-pas
liquides, font le feu & l’air; & comme nous en avons
traité affez au long dans leurs articles, nous ne parlons
ici que des fluides ordinaires, qui font en même
tems liquides. (O)
F l u i d i t é , (Economieanim,') c’eft la qualité par
laquelle les globules, les particules qui entrent dans
la compofition des humeurs animales^, ont fi peu de
force de cohéfion entr’elies, qu’elles font fulcepti-
bles d’être féparées les unes des autres fans aucune
réfiftance fenfible, & de céder à la force impulfive
& fyflatique qui les fait couler dans les diflerens
vaiffeaux ou conduits, & les diftribue dans toutes
le s parties du corps vivant dans l’état de fanté. f^oyeç
dans l’article F i b r e une digreflîon fur les folides &
les fluides, confidérés en général & relativement au
corps humain. Voy. <*k^,Hu-meur , S a n g , & c , (d)
* FLUES, BRETTELLIERES, CANIERES, AN- 61ERES, GIBAUDIERES, termes de Pèche; ce font
■ des efpeces de demi-folles. Voye^ F o l l e . •
Ce filet eft un de ceux qui font fédentaires , &
qu’on retire au bout d’un certain tems par le moyen
des cablots frappés contre les extrémités du filet, &
foutenus par des boiiées.
* F l u e a M a c r e u s e o a C o u r t in e ^termesde P i chet
forte de filet qui fort à prendre des oifeaux aquatiques
qui viennent manger, de plaine mer, des coquillages
fur lés fonds» Ce filet eft tendu fur des piquets
, & foûtenu entre deux eaux par la marée. Les
niacreufes venant pour prendre des moules , des
fiions, &c. remontant enfuite, elles fe trouvent pri-
fes par les mailles du filet : 4a même chofe arrive en»
core quand'elles defcëndent pour fe feifir de leur
proie. :Lés mailles de ce filet ont 2 pouces 9 lignes
cnaymrré.‘-Voye^ nos Planches de Pêche. ■ ■
Les Pêcheurs ont pour cette pêche en mer j deux
j&ûtesdu port d’environdeux-tonneaux, montées de
iix hommes. Les tiffures de leurs filets ne font com-*
pofées que de 30 pièces qui ont chacune çobraffesde
longueur, ce qui né donne à leur tifliire entière que
1500 brades d’étendue. Ils pêchent depuis le mois
de Septembre jufqu’en Avril. Leurs filets font flottés ,
pierrés, comme les folles : ils ont ordinairement
deux braffes de chute ou de hauteur, la maille de
trois pouces & demi à quatre pouces en quarré. Chaque
bâteau a 80 pièces....
FLUK.EN, ( Hift. nat.) nom que les mineurs du
pays de Cornoiiailles donnent à une efpece de terre
grifâtre, dans laquelle fe trouvent des petits cailloux
ou pierres blanches : elle eft dans le voifinage des filons
; & les petites pierres qu’on y rencontre paroif-
fent avoir été détachées du filon , & roulées par le.
mouvement des eaux, attendu qu’elles font arrondies.
Il y a lieu de croire que ce font des fragmens
de quartz. Voyeç le fuppl. du diclionn. de Chambers.
* FLUONIE, (Mytholog.) déefle qui préfidoità
l’écoulement des réglés, & aux évacuations qui fui-
vent l’accouchement. Il y en a qui la confondent
avec Junon, & qui prétendent que c’eft la même
déefle fous deux noms diflerens.
FLUORS, ( Hijl. nat Minéral.) en latin fluorés,
pfeudo-gemma& c . Plufieurs naturaliftes fe fervent
de ce nom pour défigner des cryftallifations ou pierres
colorées ou tranfparentes, qui font ou prifmati-,
ques, ou cubiques, ou pyramidales, &c. qui par-là ref-
lemblent parfaitement à de vraies pierres prétieufes,
dont elles ne different réellement que parce qu’elles
n’ont point la même dureté. Il y a des fluors de différentes
couleurs : en effet on en trou ve.de rouges, que
l’on nomme faux-rubis, pfeudo-rubinus ; de violets ,
qu’on nommé fauffes-améthyftes tpfeudo-ametkyflus ;
de jaunes, pfeudo-topafius ; de verds, pfeudo-f'marag-
dus ; de bleus, pfeudo-Japhirus, & c . "Wallerius, dans fe
minéralogie, regardé les fluors comme des variétés
du cryftal de roche ; cependant il paroît que d’autres
naturaliftes ont étendu la même dénomination à des
cryftaux ou à des pierres colorées qui font ou calcaires
ou gypfeufes; , & qui par conféqüeijt ne font;
pas de la même nature que le cryftal dé roché.. Il y,
a lieu de croire que c’eft aux métaux mis en diffolu-
tion, & atténués par les exhalaifons minérales qui
régnent dans le fein de la terre, que les fluors font,
redevables de leurs couleurs. Ce qui confirme ce
fentiment, c’eft que c’eft ordinairement dans le voi-
finage des filons métalliques qu’on les rencontre en
plus, grande quantité;
I l y a l i e u d e c o n j e f t u r e r q u e l e n o m d e fluors q u e
l ’ o n d o n n e à c e s p i e r r e s , & c e l u i d e fluffe p a r l e q u e l
o n l e s d é f i g n e e n a l l e m a n d , l e u r v i e n t d e l a p r o p r i é t é
q u ’ e l l e s o n t f o u v e n t , d e f e r v i r d e f p n d a n s o u d e f l u x
a u x m in e s q u e l ’o n e x p l o i t e d a n s l e u r v o i f i n a g e : a l o r s
o n l e s r e g a r d e c o m m e é t a n t d ’ u n e g r a n d e u t i l i t é , e n
c e q u ’ e l l e s c o n t r i b u e n t à f a c i l i t e r l a f u f i o n f lu m i n é r
a l . Voye^. F l u x , F o n d a n s , & F u s i q n . (-A)
FLÛ TE, f. f. ( Littér.) L’invention de laflûte, que
les Poètes attribuent à Apollon, à Pallas, à Mercure,
à Pan, fait aflez voir que fon ufage eft de la plus an.
erenne antiquité. Alexandre Polihyftof affûre que
Hya^nis fut le plus ancien joueur d e flûte, & qu’il fut
fuccedé par Marfyas, & par Olympe premier du
nom , lequel apprit aux jGrecs l’art de toucher les
inftrumens à cordes. Selon Athénée, un, certain Sei-
ritès, Numide, inventa la flûte à une feule tig e, Si-,
lene cellé qui en a plufieurs, & Marfyas la flûte de
rofeau,- qui s’unit avec la lyre.
Quoi q.u’il en foit j la paflîon de là mufique répandue
pa rtout, fut non-feulement çaufe qu’on goûta
beaucoup le jeu de la flûte, mais dé plus qu’on en
multiplia fingulierement la forme. Il y en avoit de
eriurbes , de longues, de'petites, de moyennes, de
Amples j_.de doubles,, de gauches, de droites., d’éga*
ï le s , d’inégales, &c. On fit de ces inftrumens de tout
bois & de toute matière. Enfin les mêmes flûtes
avoient diflerens noms chez divers peuples. Par
exemple, h flûte courbe de Phrygie étoit la même
que le tityrion des Grecs d’Italie, ou que le pheution
des Egyptiens, qu’on appelloit aufli monaule.
Les flûtes courbes font au rang des plus anciennes ;
telles font celles de la table d’Ifis : la gyngrine lugubre
ou la phénicienne, longue d’une palme mefurée
dans toute fon étendue , étoit encore de ce genre.
Parmi les flûtes moyennes, Ariftide le muficien met
la pythique & \es fhues de choeur. Paufanias parle
des flûtes argiennes &c béotiennes. Il eft encore fait
mention dans quelques auteurs de la flûte hermiope,
qu’Anacréon appelle tendre; de la lyfiade, de la cy-
thariftrie ; des flûtes précentoriennes, corynthien-
nes, égyptiennes, virginales, milvines, & de tant
d’autres dont nous ne pouvons nous former d’idée
jufte , & qu’il faitdroit avoir vûes pour en parler
pertinemment. On fait que M. le Fevre defefpérant
d’y rien débrouiller, couronna fes veilles pénibles
fur cette matière, par faire des vers latins pour
loiier Minerve de ce qu’elle avoit jetté la flûte dans
l ’eau, & pour maudire ceux qui l’en avoient retirée.
Mais loin d’imiter M. le Fevre, je crois qu’on doit
au moins tâcher d’expliquer ce que les anciens en-
tendoient par les flûtes égales & inégales, les flûtes
droites & gauches, les flûtes farranes, phrygiennes,
lydiennes, tibia pares & impares, tibia dextra & f l-
niflra , tibia farrana , phrygia , lydicce , &c. dont il
eft fouvent fait mention dans les comiques , parce
que la connoiffance de ce point de Littérature eft né-
ceffaire pour entendre les titres des pièces dramatiques
qui fe joiioient à Rome. Voici donc ce qu’on a
dit peut-être de plus vraiffemblable & de plus ingénieux
pour éclaircir ce point d’antiquité.
Dans les comédies romaines qu’on repréfentoit
fur le théâtre public , les joiieurs de flûte joiioient
toûjours de deux flûtes à- la -fo is . Celle qu’ils tou-
choient de la main droite , étoit appellée droite par
cette raifon ; & celle qu’ils touchoient de la gauche,
étoit appellée gauche par conféquent. La première
n’avoit que peu de trous , & rendoit un fon'grave ;
la gauche en avoit plufieurs, & rendoit un fon plus
clair &c plus aigu. Quand les muficiens joiioient de
ces deux flûtes de différent fon, on difoit que la piece
avoit été joiiée tibiis imparibus, avec les flûtes inégales
; ou tibiis dextris & (inijlris, avec les flûtes droites
& «auches : & quand ils joiioient de deux flûtes de
même fon , de deux droites ou de deux gauches,
comme cela arrivoit fouvent, on difoit que la pièce
avoit été joiiée tibiis paribus dextris, avec des flûtes
égales droites , fi c’étoit avec celles du fon grave ;
ou tibiis paribus flniflris, avec des flûtes égales gauches
fi c’étoit avec des flûtes de fon aigu.
Une même piece n’étoit pas toûjours joiiée avec
les mêmes flûtes, ni avec les mêmes modes ; cela
changeoit fort fouvent. Il arrivoit peut-être aufli
que ce changement fe faifoit quelquefois dans la même
repréfentation , & qu’à chaque intermede on
changeoit de flûte ; qu’à l’un on prenoit les flûtes
droites, & à l’autre les gauches fucceflivement. Do-
nat prétend que quand le fujet de la piece étoit grave
& férieux, on ne fe feryoit que des flûtes égales droites
, que l’on appelloit aufli lydiennes, & qui avoient
le fon grave ; que quand le fujet étoit fort enjoiié, on
nefe fervoit que desflûtes égales gauches, qui étoient
appellées syriennes ou farranes, qui avoient le fon
aigu, & par conféquent plus propre à la joie ; enfin
que quand le fujet étoit mêlé de l’enjoiié & du férieux
, on prenoit les flûtes inégales, c’eft-à-dire la
droite & la gauche, qu’on nommoit phrygiennes.
Madame Dacier eft au contraire perfuadee que ce
Tm t VI%
ft’étoit point du tout le fujet des pièces qui regloit la
mufique, mais l’occafion où elles étoient repréfen-
tées. En effet, il auroit été impertinent qu’une pièce
faite pour honorer des funérailles, eût eu une mufique
enjouée ; c’eft pourquoi quand les Adelphes de
Térence furent joiiés la première fois, ils lé furent
tibiis lydiis, avec les flûtes lydiennes, c’eft-à-dire
avec deux flûtes droites ; & quand ils furent joiiés
pour des occafions de joie & de divertiffement, ce
fut tibiis farranis, avec les deux flûtes gauches. Ainfi
quand une piece étoit joiiée pendant les grandes fêtes
, comme la joie & la religion s’y trouvoient mêlées,
c’étoit ordinairement avec les flûtes inégales j
ou une fois avec deux droites, & enluite avec deux
gauches, ou bien en les prenant alternativement à
chaque intermede.
Au refte, ceux qui joiioient de la flûte pour le théâtre
, fe mettoient autour de la bouche une efpece de
ligature ou bandage compofé de plufieurs courroies
qu’ils lioient derrière la tête, afin que leurs joues ne
paruffent pas enflées, & qu’ils pûffent mieux gouverner
leur haleine & la rendre plus douce. C ’eft
cette ligature que les Grecs appelloient yopGuàv ’, Sophocle
en parle, quand il dit :
Qus-ct y a. p u, ffjulr.poi&/v avXi&KOiç tri ,
AAAC aypiatç (pvacuei fpopCtiaç i-np.
« Il ne fouflle plus dans de petites flûtes, mais dans
» des foufflets épouvantables, Sc tans bandage ». C e
que Cicéron applique heureufement à Pompée, pour
marquer qu’il ne gardoit plus de mefures, & qu’il ne
fongeoit plus à modérer fon ambition. II eft parlé du
bandage<pop£«à,autrement appellé Tnpiç-ô/x/ov dans Plutarque
, dans le feholiafte d’Ariftophane & ailleurs,
& l’on en voit la figure fur quelques anciens monii-
mens.
La flûte n’étoit pas bornée au feul théâtre, elle
entroit dans la plupart des autres fpeftacles & des
cérémonies publiques greques & romaines ; dans
celles des noces, des expiations , des facrifices,
fur-tout dans celles des funérailles. Accoûtumée de
tout tems aux fanglots de ces femmes gagées qui
pofledoient l’art de pleurer fans affliûion , elle ne
pouvoit manquer de former la principale mufique des
pompes funèbres. A celle du jeune Archémore fils
de Lycurgue, c’eft la flûte qui donne le fignal, & ce
ton des lamentations. Dans les fêtes d’Adonis on fe
fervoit aufli de la flûte, & l’on y ajoûtoit ces mots
lugubres, a i , àï tov A’VW/i' ; hélas, hélas, Adonis l
mots qui convenaient parfaitement à la trifteffe de
ces fêtes.
Les Romains, en vertu d’une loi très - ancienne ÿ
& que Cicéron nous a confervée , employèrent la
flûte au même ufage. Elle fe faifoit entendre dans les
pompes funèbres des empereurs , des grands, & des
particuliers de quelque âge & de quelque qualité
qu’ils fuffent ; car dans toutes leurs funérailles on
chantoit de ces chants lugubres appellés noenia, qui
demandoient néceffairement l’accompagnement des
flûtes ; c’eft encore par la même raifon qu’on difoit
en proverbe ,jam licet ad tibicines mittas, envoyez
chercher les joiieurs de flûte, pour marquer qu’un
malade étoit defefpéré, & qu’il n’avoit plus qu’un
moment à vivre ; expreflion proverbiale, que Cir-
cé employé affez plaifamment dans fes reproches
qu’elle fait à Polyenos fur fon impuiffance.
Puifque la flûte fervoit à des cérémonies de différente
nature , il falloit bien qu’on eût trouvé l’art
d’en ajufter les fons à ces diverfes cérémonies, &
cet art fut imaginé de très-bonne heure. Nous liions
dans Plutarque que Clonas eft le premier auteur des
nomes ou des airs de flûte. Les principaux qu’il
inventa , & qui furent extrêmement perfectionnés
après lu i, font l’apothétos, le fchoénion, le trime?