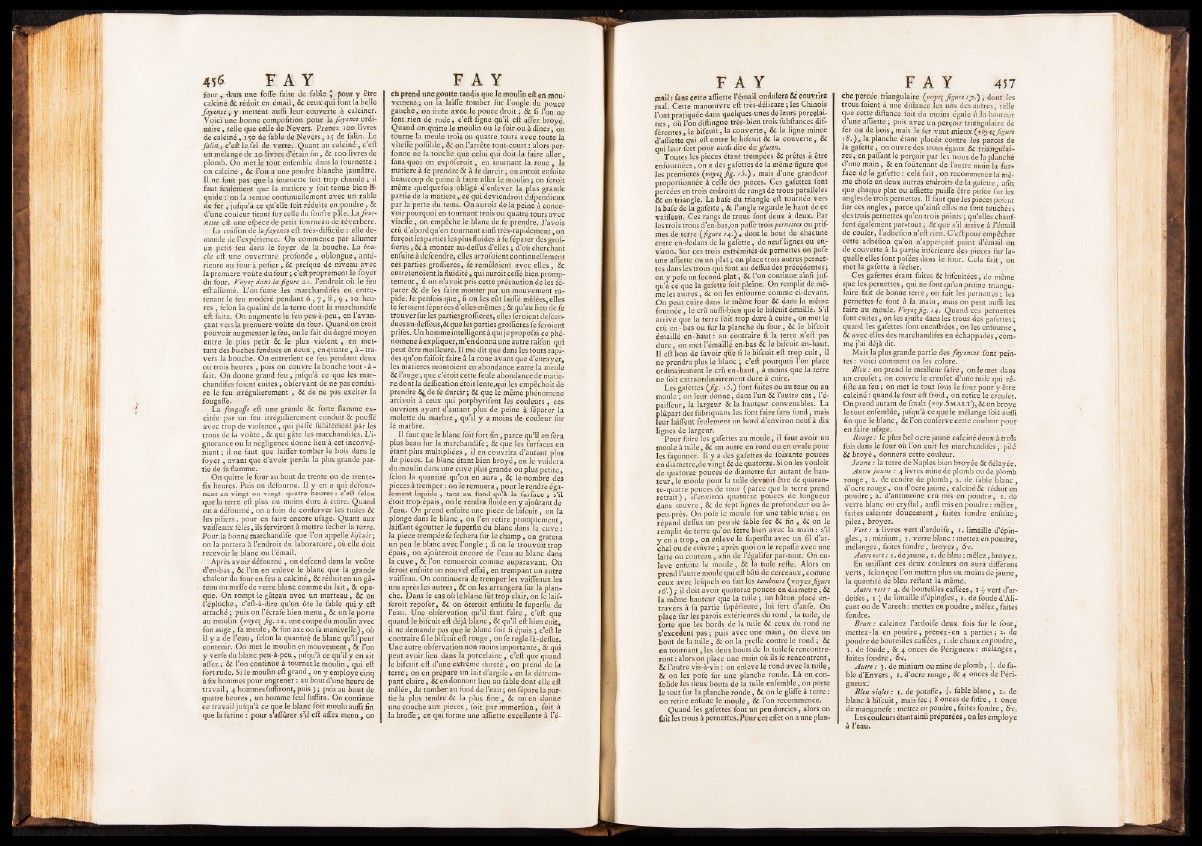
four , datte une Foffe faite de fable J pour y être
calciné & réduit en émail, 6c ceux qui font la belle
fayençc , y mettent auffi leur couverte à calciner;
Voici une .bonne compofition pour l&fayence ordinaire
, telle que celle de Nevers. Prenez ioo livres
de calciné ,ir 50 de fable de Nevers, 25 de falin. Le
falin^y c’eft le.fel de verre. . Quant au calciné,. c’eft
un mélange de 20 livres d’étain fin, & 100 livres de
plomb. On met le tout enfemble dans la fournette ;
on. calciné , 6c l’on a une poudre blanche jaunâtre.
Il ne faut pas que la fournette foit trop chaude ; il
faut feulement que la matière y foit tenue bien liquide::!
on la remué continuellement avec un rable
de fer jufqu’à ce qu’elle foit réduite en poudre, &
d’une couleur tiçant fur celle du foufre pâle. La four*
nette eft une efpece de petit fourneau de réverbere.
■ La citiffon de la fayence eft très-difficile : elle demande
def’expérience. On commence par allumer
un petit- feu dans le foyer de la bouche* La bouche
efl une ouverture profonde , qblongue, antérieure
au four a. potier , & prefque de niveau avec
la première voûte, dufour ; e’eft proprement le foyer
du four. Voyt^ dans la figure 2.1. l’endroit où le feu
efl allumé. L’on fume les marchandifes en entretenant
le feu modéré pendant 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 heures
, félon la qualité de la terre dont la marchandife
efl faite. On augmente le feu peu-à-peu, en l’avançant
vers la première voûte du four. Quand on croit
pouvoir augmenter, le feu, on le fait du degré moyen
entre le plus petit &: le plus violent , en mettant
des bûches fendues en deux , en quatre, à - travers
la bouche. On entretient ce feu pendant deux
ou trois heures , puis on couvre la bouche tout - à -
fait. On donne grand feu , jufqu’à ce que les marchandifes
foient cuites, obfervant de ne pas conduire
le feu irrégulièrement , & de ne pas exciter la
fougafle.
La fougafle efl une grande 6c forte flamme excitée
par un feu irrégulièrement conduit & pouffé
avec trop de violence, qui paffe fubitement par les
trous de la voûte, & qui gâte les marchandifes. L’ignorance
ou la négligence donne lieu à cet inconvénient
; il ne faut que laiffer tomber le bois dans le
foyer , avant que d’avoir perdu la plus grande partie
de fa flamme.
On quitte le four au bout de trente ou de trente-
fix heures. Puis on défourne. Il y en a qui défour-
nent en vingt ou vingt-quatre heures : c’efl félon
que la terre efl plus ou moins dure à cuire. Quand
on a défourné, on a foin de conferver les tuiles &
les piliers, pour en faire encore ufage. Quant aux
vaiffeaux fêlés, ils ferviront à mettre fecher la terre.
Pour la bonne marchandife que l’on appelle bifcuit ;
on la portera à l’endroit du laboratoire, où elle doit
recevoir le blanc ou l’émail.
Après avoir défourné , on defcend dans la voûte
d’en-bas, 6c l’on en enleve le blanc que la grande
chaleur du four en feu a calciné, 6c réduit en un gâteau
ou maffe de verre blanc comme du lait, & opaque.
On rompt le gâteau avec un marteau, 6c on
l’épluche, c’eft-à-dire qu’on ôte le fable qui y efl
attaché ; puis on l’écrafe bien menu, 6c on le porte
au moulin (yoye{ fig. 22. une coupe du moulin avec
fon auge, fa meule, & fon axe ou fa manivelle), où
il y a de l’eau, félon la quantité de blanc qu’il peut
contenir. On met le moulin en mouvement, & l’on
y verfe du blanc peu-à-peu, jufqu’à ce qu’il y en ait
affez ; 6c l’on continue à tourner le moulin, qui efl
fort rude. Si le moulin efl grand, on y employé cinq
à fix hommes pour engrener : au bout d’une heure de
travail, 4 hommesfuffiront, puis 3 ; puis au bout de
quatre heures, un homme feul fuffira. On continue
ce travail jufqu’à ce que le blanc foit moulu auffi fin
que la farine : pour s’affûrer s’il efl allez menu, on
eh prend une goutte tandis que. le moulih efl en mou-»'
ventent; on la laide tomber fur l’ongle du pouce
gaucher , 0n frote avec de pouce droit ; 6c fi l’on ne
fent rien de rude, c’efl figne qu’il efl affez broyé.
Quand on quitte le moulin ou le foir ou à dîner, qn
tourne la meule trois ou quatre tours avec toute la
vîteffe poffible , ,&c on l’arrête tout-court : alors per-
fonne ne la touche que celui qui doit la faire aller,
fans quoi on expoferoit, en tournant la roue , la
matiere à fé prendre & à fe durcir ; on auroit enfuite
beaucoup de peine à faire aller le.moulin; on feroit
même quelquefois -obligé d’enlever la plus grande
partie de la matière, ce qui deviéndroit difpendieux
par la perte du tems. Qn auroit de la peine à concevoir
pourquoi en tournant trois ou quatre tours avec
vîteffe, on empêche le blanc de fe prendre. J’avois
crû d’abord qu’en tournant ainfi très-rapidement, on
forçoit les parties les plus fluides à fe féparer des grof-
fieres yôc.à monter au-deffus d’elles ; d’où cherchant
enfuite à defcendre, elles arrofoient continuellement
ces parties groffieres, feremêloient avec elles , 6c
entretenoient la fluidité, qui auroit. ceffé bien promptement
, fi on n’a voit pris cette précaution de les féparer
6c de les faire monter par un mouvement rapide.
Je penfois que, fi on les eût laiffé mêlées, elles,
fe feroient féparées d’elles-mêraes ; & qu’au lieu de fe
trouver fur les partiesgroffieres, elles feroient defcen-
dues au-deffous,& que les parties groffieres fe feroient
prifes. Ün homme intelligent à qui je propofai ce phénomène
à expliquer, m’en donna une autre raifon qui
peut être meilleure. Il me dit que dans les tours rapides
qu’on faifoit faire à la roue avant que d’enrayer,
les matières montôient en abondance entre la meule
& l’auge ; que c’étoit cette feule abondance de matie-
rejdont la déification étoit lente,qui les empêchoit de
prendre $^de fe durcir; & que le même phénomène
arrivoit à ceux qui porphyrifent les couleurs , ces
Ouvriers ayant d’autant plus de peine à féparer la
molette du marbre, qu’il y a moins de couleur fur
le marbre.
Il faut que le blanc foit fort fin, parce qu’il en fera
plus beau fur la marchandife ; 6c que les furfaces en
étant plus multipliées , il en couvrira d’autant plus
de pièces. Le blanc étant bien b royé, on le vuidera
du moulin dans une cuve plus grande ou plus petite,
félon la quantité qu’on en aura , 6c le nombre des
pièces à tremper : on le remuera, pour le rendre également
liquide , tant au fond qu’à la furface ; s’il
étoit trop épais, on le rendra fluide en y ajoûtant de
l’eau. On prend enfuite une piece de bifcuit, on la
plonge dans le blanc , on l’en retire promptement,
laiflant égoutter le fuperflu du blanc dans la cuve :
la piece trempée fe fechera fur le champ, on gratera
un peu le blanc avec l’ongle ; fi on le trouvoit trop
épais, on ajoûteroit encore de l’eau au blanc dans
la cu v e , & l’on remueroit comme auparavant. On
feroit enfuite un nouvel effai, en trempant un autre
vaiffeau. On continuera de tremper les vaiffeaux les
uns après les autres, 6c on les arrangera fur la plan*
che. Dans le cas où le blanc fût trop clair, on le laif-
feroit repofer, 6c on ôteroit enfuite le fuperflu de
l’eau. Une obfervation qu’il faut fa ire , c’èft que
quand le bifcuit eff déjà blanc, 6c qu’il eft bien cuit,
il ne demande pas que le blanc foit fi épais ; c’eft le
contraire fi le bifcuit eft rouge, onfe réglé là-deffus.
Une autre obfervation non moins importante, & qui
peut avoir lieu dans la porcelaine , c’eft que quand
le bifcuit eft d’une extrême dureté , on prend de la
terre; on en prépare un lait d’argile, en la détrempant
claire, & en donnant lieu au fable dont elle eft
mêlée, de tomber au fond de l’eau ; on fépare la partie
la plus tendre & la plus fine , & on en donne
une couche aux pièces, foit par immerfion, foit à
la broffe ; ce qui forme une alfiette excellente à l’émail
: fans cette affiette l’émail ondulera 6c couvrira
mal. Cette manoeuvre eft très-délicate ; les Chinois
l’ont pratiquée dans quelques-unes de leurs porcelaines
où l ’on diftingue très-bien trois fubftances différentes
, le bifcuit, la couverte, & la ligne mince
d’affiette qui eft entre le bifcuit 6c la couverte, 6c
qui leur fert pour ainfi dire de gluten.
Toutes les pièces étant trempées 6c prêtes à être
enfournées, on a des gafettes de la même figure que
les premières (yoyeifig. / i . ) , mais d’une grandeur
proportionnée à celle des. pièces. Ces gafettes font
percées en trois endroits de rangs de trous parallèles
& en triangle. La bafe du triangle eft tournée vers
la bafe de la gafette, & l’angle regarde le haut dé ce
vaiffeau. Ces rangs de trous font deux à deux-. Par
les trois trous d’en-bas,on paffe trois pernettes ou prif-
mes de terre (figure 14.') , dont le bout de chacune
entre en-dedans de la gafette, de neuf lignes ou environ.
Sur ces trois extrémités de pernettes on p.ofe
une affiette ou un plat ; on place trois autres pernettes
dans les trous qui font au-deffus des précédentes ;
on y pofe un fécond p lat, 6c l’on continue ainfi jufqu’à
ce que la gafette foit pleine. On remplit de même
les autres, 6c on les énfourne comme ci-devant.
O n peut, cuire dans le même four 6c dans la même
fournée, le crû auffi-bien que le bifcuit émaillé. S’il
arrive que la terre foit trop dure à cuire, on met le
crû en-bas ou fur la planche du four, 6c le. bifcuit
émaillé en-haut: au contraire fi la terre n’eft pas
dure, on met l’émaillé en-bas 6c le bifcuit en-haut.
Il eft bon de favoir que fi le bifcuit eft trop cu it, il
ne prendra plus le blanc ; c’eft pourquoi l’on place
ordinairement le crû en-haut ,.à moins que la terre
ne foit extraordinairement dure à cuire.
Les gafettes {fig. .) font faites ou au tour ou au
moule ; on leur donne, dans l’urt & l’autre ca s , l’é-
paiffeur, la largeur & la haute.ur convenables. La
plûpart des fabriquans les font faire fans fond, mais
leur laiffertt feulement un bord d’environ neuf à dix
lignes de largeur.
Pour faire les gafettes au moule, il faut avoir un
moule à tuile, 6c un autre en rond ou en ovale pour
les façonner. Il y a des gafettes de foixante pouces
en diamètre,de vingt 6c de quatorze. Si on les vouloit
de quatorze pouces de diamètre fur autant de hauteur,
le moule pour la tuile dev*oit être de quarante
quatre pouces de tour (parce que la terre prend
retrait ) , d’environ quatorze pouces de longueur
dans oeuvre, & de fept lignes de profondeur ou à-
peu-près. On pofe le moule fur une table unie ; on
répand deffus un peu de fable fee & fin , & on le
remplit de terre qu’on ferre bien avec la main : s’il
y en a trop, on enleve le fuperflu avec un fil d’ar-
chal ou de cuivre ; après quoi on le repaffe avec une
latte ou couteau, afin de l’égalifer par-tout. On enleve
enfuite le moule, 6c la tuile refte. Alors on
prend l’autre moule qui eft bâti de cerceaux, comme
ceux avec lefquels on fait les tambours (voyez figure
#6'.) ; il doit avoir quatorze pouces en diamètre, 6c
la même hauteur que la tuile ; un bâton placé en-
travers à fa partie fupérieure, lui fert d’anfe. On
place fur les parois extérieures du rond, la tuile, de
forte que les bords de la tuile 6c ceux du rond ne
s’excedent pas ; puis avec une main, on éleve un
bout de la tuile, & on la preffe contre le rond ; 6c
en tournant, les deux bouts de la tuile fe rencontreront
: alors on place une main où ils fe rencontrent,
& l’autre vis-à-vis : on enleve le rond avec la tuile,
& on les pofe fur une planche ronde. Là on con-
iblide les deux bouts de la tuile enfemble, on porte
le tout fur la planche ronde, & on le gliffe à terre :
on retire enfuite le moule, 6c l’on recommence.
Quand les gafettes font un peu durcies, alors on
fait les trous à pernettes. Pour cet effet on a une plan.
che percée triangulaire (voye{ figure /y.') , dont■ les
trous foienç à une diftanee les uns des autres., telle
que cette diftanee foit. du moins égale .à Ta hauteur
d’une affiette ; puis avec un perçoir triangulaire dé
fer ou de bois, mais ,1e fer vaut mieux{r.ôyeçfigure
/£.), la planche étant placée contre les. parois de
la gafette, on Ouvre des. trous égaux & triahgulai*
res, en paffantle perçoir pat les trous d elà planché
d’une main, & en foûtenant de Pautte main la fur-
face de la gafette : cela fait, on recommencera blême
chofe en deux autres endroits de là gafette afin
que chaque plat ou affiette puiffe être pofée fur les
angles de trois pernettes. Î1 faut que les pièces pofent
fur ces angles, parce qu’àihfi elles ne font touchées
des trois pernettes qu’en trois points ; qu’elles chauffent
égalèment par-tout; & qu e s’il arrive à l’émail
de couler, l’adhéfion n’eft rien. .C’eftpbur empêcher
cette adhéfion qu’on n’apperçoit point d’émail ou
de couverte à la partie inférieure des piece? ftir laquelle
elles font pofées dans le four. Cela fa it, on
met là gafette à lécher.
Ces gafettes étant faites 6c b ifcu itéesd e même
que les pernettes, qui ne font qu’un prifrne triangulaire
fait de bonne terre, on fait les pernettes ; les
pernettes fe font à la main, mais on peut auffi les
faire au moule. V?yc{fig. > 4» Quand ces pernettes
font cuites, on les ajûfte dans les trous des gafettes ;
quand les gafettes font encadrées, on les enfourne,
& avec elles des marchandifes en échappades,comme
j’ai déjà dit.
Mais la plus grande partie des fayences font peintes
: voici comment on les colore. ■
Bleu: on prend le meilleur fafre, on le met dans
un creufet ; on couvre le creufét d’une tuile qui ré-
fifte au feu ; on met le tout; fous le four pour y être
calciné ; quand le four eft froid, on retire le creufet.
On prend autant de fmalt (rôy.SM a i t ) , & on btoye
le tout enfemble, jufqn’à Ce que le mélange foit auffi
fin que le blanc, & l’on conferve cette couleur pour
en faire ufage..
Rouge : le plus bel ocre jaune calciné deux à trois
fois dans le four où l ’on cuit les marchandifes, pilé
& b royé, donnera cette couleur.
Jaune : la terre de Naples b ienbtoyée & délayée.
Autre jaune : 4 livres mine de plomb ou de plomb
rouge, 2. de cendre de plomb, 2, de fable blanc ,
d’ocre rouge, ou d’ocre jaune, calciné & réduit en
poudre; 2. d’antimoine crû mis en poudre, 1. de
verre blanc ou cry ftal, auffi mis en poudre : mêlez,
faites calciner doucement, faites fondre enfuite ;
pilez, broyez.
Vert: 2 livres vertd’ardoife, 1. limaille d’épingles
, 1. minium, 1. verre blanc : mettez en poudre,
mélangez, faites fondre, broyez, &c.
Autre vert : 1. de jaune, 1. de bleu : mêlez , broyez.
En unifiant ces deux couleurs on aura différens
verts, félon que l’on mettra plus ou moins de jaune,
la quantité de bleu reliant la même.
Autre vert : 4. de bouteilles calfées , 1 - vert d’ar-
doifes , i { - de limaille d’épingles, 1. de foude d’Ali-
cant ou de Varech : mettez en poudre, m êlez, faites
fondre.
Brun : calcinez l’ardoife deux fois fur le four,-
mettez-lâ en poudre, prenez-en 2 parties; 2. de
poudre de bouteilles caffées, 1. de chaux en poudre,
1. de foude, & 4 onces de Périgueux : mélangez,
faites fondre, &c.
Autre : 3. de minium ou mine de plomb, 7. de fable
d’Envers, 1. d’ocre rouge, & 4 onces de Périgueux.'
Bleu violet: 1. depotafle, T fable blanc, 2. de
blanc à bifcuit, mais fec ; 8 onces de fafre, 1 once
de manganefe : mettez en poudre, faites fondre, &c.
Les couleurs étant ainfi préparées, on les employé
à l’eau.