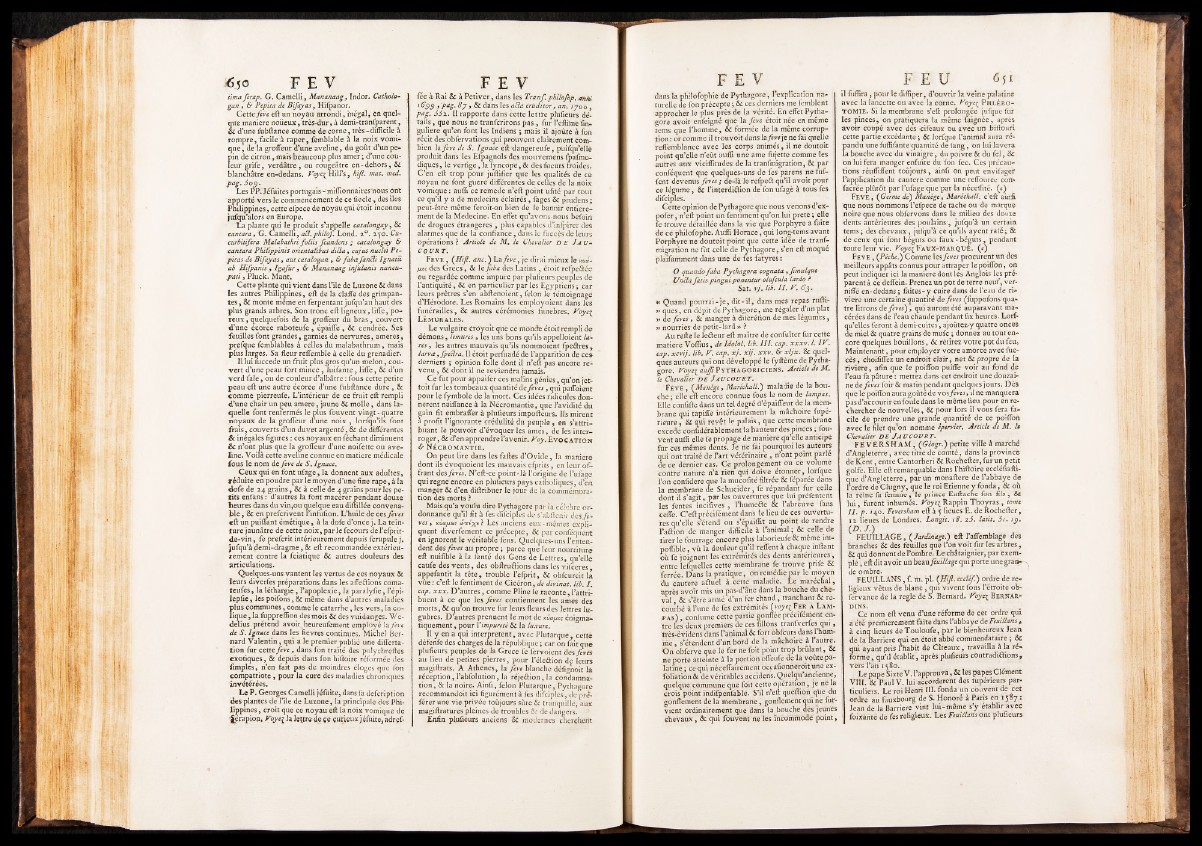
Sßso F E V tima ferap. G. Camelli, Mananaag, Indor. Catholo- ;
gan, & Pepita de Bifayas, Hifpanor.
Cette feve eft un noyau arrondi, inegal, en quelque
maniéré noiieux, très-dur, à demi-tranfparent,
& d’une fubftance comme de-corne, très - difficile à
rompre,"facile à râper, femblable à la noix vomique,
de'la groffeur d’une'aveline, du goût d’un pe-
pin de citron., maisbeaucoup plus amer ; d’une couleur
grife, verdâtre, ou rougeâtre en - dehors,, &
blanchâtre en-dedans. Fby^ Hill’s , hiß. mut. med.
pag.Socf. ' |
Les PP. Jéfuites portugais - miffionnaites'nôus ont
apporté vers le commencement de ce fiecle, des îles
Philippines, cette efpece de noyau qui ëtoit inconnu
jufqu’alors en Europe.
La plante qui le produit s’appelle catalongày, &
tantara , G . Camelli, acl.pkitof. Lond. i ° . 1)0. Çû-
curbitifera Malabathri foliis fcundens ; catalongay &
eantara Philippinis orienta'tibus dicta, cujus nuclti Pepitas
de Bifayas , aut catalogan , & faba fancti Ignatü
ab Hifpanis , Igafur , & Mananaag infulanis nuncu-
pati, Pluck. Mant.
Cette plante qui vient dans l’île de Luzone & dans
les autres Philippines, eft de la claffe des grimpantes
, & monte même en ferpentant jufqü’au haut des
plus grands arbres. Son tronc eft ligneux, lifte, poreux
, quelquefois de la grofleur du bras, couvert
d’une écorce raboteufe , épaiffe , & cendrée. Ses
feuilles font grandes, garnies de nervures, ameres,
prçfque femblables à celles du malabathrum, mais
plus larges. Sa fleur reffemble à celle du grenadier.
11 lui luccede un finit plus gros qu’un melon, couvert
d’une peau fort m ince, luifante, liffe, & d’un
verd fale, ou de couleur d’albâtre : fous cette petite
peau eft une autre écorce d’une fubftance dure, &
comme pierreufe. L’intérieur de ce fruit eft rempli
d’une chair un peu amere, jaune & m olle, dans laquelle
font renfermés le plus fouvent vingt - quatre
noyaux de la grofleur d’une noix , lorfqu’ils font
frais, couverts d’un duvet argenté, & de différentes
& inégales Agîmes : ces noyaux en féchant diminuent
6c n’ont plus que la grofleur d’une noifette ou aveline.
Voilà cette aveline connue en matière médicale
fous le nom de feve de S. Ignace.
Ceux qui en font u fage, la donnent aux adultes,
réduite en poudre par le moyen d’une fine râpe, à la
dofe de 24 grains, & à celle de 4 grains pour les petits
enfans : d’autres la font macérer pendant douze
heures dans du vin,ou quelque eau diftillée convenable
, & en prefcrivent î’infufion. L’huile de ces feves
eft un puiffant émétique, à la dofe d’once j. La teinture
jaunâtre de cette noix, par le fecours de l’efprit-
de-vin, fe prefcrit intérieurement depuis fcrupule j.
jufqu’à demi-dragme, & eft recommandée extérieurement
contre la fciatique & autres douleurs des
articulations.
Quelques-uns vantent les vertus de ces noyaux &
leurs diverfes préparations dans les affeftions coma-
teufes, la léthargie, l ’apoplexie, la paralyfie, I’épi-
lepfie, les poifons, & même dans d’autres maladies
plus communes, comme le catarrhe, les vers, la colique
, la fuppreffion des mois & des vuidanges. ¥ e -
delius prétend avoir^heureufement employé la feve
de S. Ignace dans les fievres continues. Michel Bernard
V alentin, qui a le premier publié une differta-
tion fur cette feve , dans fon traité des polychreftes
exotiques, & depuis dans fon hiftoire réformée des
iimples, n’en fait pas de moindres éloges que fon
compatriote , pour la cure des maladies chroniques
invétérées.
Le P. Georges Camelli jéfuite, dans fa defeription
des plantes de l’île de Luzone, la principale des Philippines
, croit que ce noyau eft la noix vomique de
‘Serapion, Voye^ la lettre de ce curieux jéfuite, adr ef-
F E V fée à Rai & à Petiver, dans les Tranf philofop.mu
1fyÿ-,'pdg. 8y , & dâns les acta èrüditor , an-, lyoo ,
pag. J i z . Il rapporte dans cette lettre plufieurs dé»
tails, que nous ne tranfc'rifons pas , fur l ’efti'me Singulière
qu’ en font les Indiens ; mais il ajoute à fon
récit des übfervations qui prouvent clairement combien
la feve de S. Ignace eft danger eufe, puifqu’ellè
produit dans les Efpagnols des mouvemens fpafmo-
diques, le vertige, la fyncope, & desfueurs froides,
C ’en eft trop pour juftifier que les qualités de ce
noyau ne font guere différentes de celles de la noix
vomique : auffi ce remede n’ eft point ufitê par tout
ce qu’il y a de médecins éclairés, fages & prudens ;
peut-être même feroit-on bien de le bannir entièrement
de la Medecine. En effet qu’avons-nous befoiii
de drogues étrangères , plus capables d’infpirer deâ
alarmes que de la confiance, dans le fuccès de leurs
opérations ? Article de M . le Chevalier d e J A l i -
CO U R T .
F e v e , (Hift- nnc. ) La feve, je dirai mieux le W -
fxeç des Grecs, & le faba des Latins , étoit refpe&ée
ou regardée comme impure par plufieurs peuples dé
l’antiquité, & en particulier par les Egyptiens ; car
leurs prêtres s’en abftenoient, félon le témoignage
d’Hérodote. Les Romains lés employoient dans les
funérailles, & autres cérémonies funèbres. F ’oye^
L é m u r a l e s .
Le vulgaire crôÿoit que ce monde étoit rempli de
démons, lémures, les uns bons qu’ils appèlloient lares
, les autres mauvais qu’ils nommoient fpeélres ,
latvce , fpectra. Il étoit periuadé de l’apparition de ces
derniers ; opinion folle dont il n’eft pas encore revenu
, 6c dont il ne reviendra jamais.
C e fut pour appaifer ces malins génies, qu’on jet-
toit fur les tombeaux quantité de feves, qui paffoient
pour le fymbole de la mort. Ces idées ridicules donnèrent
naiffance à la Nécromantie, que l’avidité du
gain fit embraffer à plufieurs impofteurs. Ils mirent
a profit l’ignorante crédulité du peuple, en s’attribuant
le pouvoir d’évoquer les âmes, de les interroger
, & d’en apprendre l’avenir. Voy. E v o c a t i o n
& N é c r o m a n t i e .
On peut lire dans les faftes d’Ov id e , la manier®
dont ils évoquoient les mauvais efprits, en leur offrant
des feves. N’eft-ce point-là l’origine de l’ufage
qui régné encore en plufieurs pays catholiques, d’en
manger & d’en diftribuer le jour de la commémoration
des morts ?
Mais qu’a voulu dire Pythagore par la célébré ordonnance
qu’il fît à fes difciples de s’abftenir des fe ves,
Kva/xùv Les anciens eux-mêmes expliquent
diverfement ce précepte, & par conféquent
en ignorent le véritable fens. QuelqUes-uns l’entendent
des feves au propre ; parce que leur nourriture
eft nuifible à la fanté des Gens de Lettres, qu’elle
caufe des vents, des obftruftions dans les vifeeres ,
appefantit la tête, trouble l’efprit, 6c obfcurcit la
vue : c’eft le fentiment de Cicéron, de divinat. lib. I .
cap. xxx. D ’autres, comme Pline le raconte, l’attribuent
à ce que les feves contiennent les âmes des
morts, & qu’on trouve fur leurs fleurs des lettres lugubres.
D ’autres prennent le mot de uvapos énigmatiquement
, pour Vimpureté & la luxure.
Il y en a qui interprètent, avec Plutarque, cettè
défenfe des charges de la république ; car on fait que
plufieurs peuples de la Grece fe fer voient d es feves
au lieu de petites pierres, pour l’éle&ion de leurs
magiftrats. A Athènes, la feve blanche défignoit là
réception, l’abfolution, la réjeûion,la condamnation,
& la noire. Ainfi, félon Plutarque, Pythagore
recommandoit ici figurément à fes difciples, de préférer
une vie privée toûjours sûre & tranquille, aux
magiftratures pleines de troubles 6c de dangers. •’
Enfin plufieurs anciens 6c modernes cherchent
F E V
dans la philofophie de Pythagore, l’explication naturelle
de fon précepte ; & ces derniers me femblent
approcher le plus près de la vérité. En effet Pytha-
:gore avoit enfeigné que la feve étoit née en même (
tems que l’homme, & formée de la même corruption
: o r comme il trouvbit dans la feve je ne fai quelle
Teflemblance avec les corps animés, il ne doutoit
point qu’elle n’eût auffi une ame fujette comme les
autres aux viciffitudes de latranfmigration, & par
conféquent que quelques-uns de fes parens ne fuf-
fent devenus feves ; de-là le refpeft qu’il avoit pour
ce légume, & l’interdiéfion de fon ufagè à tous fes
difciples.
Cette opinion de Pythagore que nous venons d’ex-
pofer, n’eft point un fentiment qu’on lui prete ; elle
fe trouve détaillée dans la vie' que Porphyre a faite
de cë philofophe. Auffi Horace, qui long-tems avant
Porphyre ne doutoit point que cette idée de tranf-
migration ne fût celle de Pythagore, s’en eft moqué
plàifariïment dans une de les fatyres :
O quando faba Pythagoree cognata , fmulque
Uncta fatis pingui ponentur olufcula lardo ?
Sat, vj. lib. I I . y . C j .
« Quand pourrai-je, d it- il, dans mes repas rufti- >
» ques, en dépit de Pythagore, me régaler d’un plat
» dé feves, & manger à dil’crétion de mes légumes,
» nourries de petit-lard à f '
Au refte le le fleur eft maître de confulter fur cette
matière Voffius, de îdqlol. lib. III. cap. xxxv. I. i F .
cap. xcvïj. lib. V. cap. x j. xij. xxv. & xljx . & quelques
auteurs qui ont développé le fyftème de Pythagore.
Voye{ aujji PYTHAGORICIENS. Article de M.
le Chevalier DE JAU COURT.
Feve , ( Manège, Maréchall.') maladie de la bouche
; elle eft encore connue fous le nom de lampas.
Elle confifte dans un tel degré d’épaiffeur dé la membrane
qui tapiffe intérieurement la mâchoire fupé-
rieure, & qui revêt le palais, que cette membrane
excede confidérablement la hauteur des pin ces ; fou-
vent auffi elle fe propage de maniéré qu’elle anticipe
fur cèS mêmes dents. Je ne fâi pourquoi les auteurs
qui ont traité de l’art vétérinaire , n’ont point parlé
de ce dernier cas. Ce prolongement ou cë volumé
contre nature n’à rien qui doive étonner, lorfque
l’on confidere que la muçofité filtrée & féparée dans
la membrane de Schücidér, fe répandant fiir celle
dont il s’agit, par les ouvertures que lui préfentent
les fentes incifivëS , l’htimeâe & 1 abreuve fans
ceffe. C ’eft précifément dans le lieu de ces ouvertures
qu’elié s’étend ou s’épaiffit au point de rendre
l’afîiôn. de manger difficile à l’animal ; & celle de
tirer le fourrage encore plus laboneufe & meme im-
poffible, vu la douleur qu’il relient à chaque inftant
où fe joignent les extrémités des dents antérieures ,
entre lefqüelles cette membrane fe trouve prifë &
ferrée. Dans la pratique, oh remédie paf le moyen
du cautère aÛuél à cettê maladie. Le maréchal,
après avoir mis un pàS-d’ âfte dans la bouche du che-
vàl & s’être armé d’un fer chaud, tranchant & recourbé
à l’Une de fes extrémités (yoyc^FER A L amp
as ) ,.confume cette partie gonflée precifenient entre
les deux premiers de ces filions tranfverfes q u i,
très-évidëns dans l’animaî & fort ôbfcurs ^ h s l’homme
, s’étendent d’un bord de là machojrë à 1 autre.
O n obferVe que lé fer ne foit point trop brûlant, &
rie porte atteinte à la portion pffeufé de làypiitë.pa-
latine ; ce qui néceffairement bccafionheroit'unè exfoliation
& de véritabléis accidens. Quelqu’àncienne,
quelque commune que foit cèfte opefâtiqri, je ne la
crois point indifpehfable. S’il n’eft queftiôn qiie du
gonflement de la membrane, gonflement qui ne fur-
vient ordinairement que dans la, bouche dès jeunes
chevaux, & qui fouvent ne les incommodé point,
F E U 6 5 1
il fuffira, pour le diffiper, d’ouvrir la veine palatine
avec la lancette ou avec la corne, f^oye^ Phlébotom
ie . Si la membrane s’ eft prolongée jufque fur
les pinces, on pratiquera la même laignée, après
avoir coupé avec des cifeaux ou avec un biftouri
cette partie excédante ; & lorfque l’animal aura répandu
une fuffifante quantité de fang, on lui lavera
la'bouche avec du vinaigre, du poivre & du fe l, Sc
on lui fera manger enfuite du fon fec. Ces précautions
réuffiffent toûjours, ainfi on peut envifager
l’application du cautere comme une reffource con-
facrée plûrôt par rufage que par la néceffité. (*)
Fe v e , ( Germe de) Mdnégc, Maréchall. c’eft ainfi
que nous nommons l’efpecè de tache ou de marque
noire que nous obfervons dans le milieu des douze
dents antérieures des poulains , jufqu’à un certain
tems ; des chevaux, jufqu’à cê qu’ils ayent rafé ; &
de ceux qui font béguts oh faux - béguts, pendant
toute leur vie. Fbyc^FAdx-Ma r q u é , (e)
F e v e , (Pêche.) Comme lés feves procurent un des
meilleurs appâts connus pour attraper lepoiffon, on
peut indiquer ici la maniéré dont les Anglois les préparent
à ce deffein. Prenez un pot de terre neuf, ver*
nifle en-dedans ; faites-y cuire dans de l’eau de rivière
une certaine quantité de feves (fuppofons quatre
litrons de feves), qui auront été auparavant macérées
dans de l’eau chaude pendant fix heures. Lorf-
qu’elles feront à demi-cuites, ajoûtez-y quatre onces
de miel & quatre grains de mufe ; donnez au tout encore
quelques bouillons, & rètirez votre pot du feu*
Maintenant, pour employer votre amorce avec fuccès
, choififfez un endroit clair, net & propre de la
riviere, afin que le poiffon puiffe voir au fond de
l’eau fa pâture : mettez dans cet endroit une douzaine
de feves foir & mâtin pendant quelques jours. Dès
que le poiffon aura goûté de vos feves, il ne manquera
pas d’accourir en foule dans le même lieu pour en rechercher
de nouvelles, & pour lors il vous fera facile
de prendre une grande quantité de ce poiffon
avec le filet qu’on nomme èpervier. Article de M. U
Chevalier D E J A U C O U R T .
F E V E RS H AM , ( Géogr.) petite ville à marché
d’Angletefre, avec titre dé comté, dans la province
de K en t, entre Cantorberi & Rochefter, fur un petit
golfe. Elle eft remarquable dans l’hiftoire ecclëfiafti-
que d’Anglèterre, par un monaftere de l’abbaye de
l’ordre de Clugny, que lé roi Etienne y fonda, & où
la féine fa femme, le prince Euftacne fon fils , &
lu i, lurent inhumés. Voye^Rappin Thoyras , tome
I I . p. '140. Feversham eft à 5 lieUes E. de Rochefter,
12 lieuès de Londres. Longit. 18. 2J. latit. 5i. tÿ.
(D . J .)
FEUILLAGE, ( Jarditiage.) eft l’affemblage des
branches & des feuilles que l’on voit fur les arbres,
& qui donnent de Pômbre. L e châtaignier, par ëxem-
plé -, ëft dit avoir un beau feuillage qui porte une gran*
de ombre.
FEUILLANS, f. m. pl. (Hïjl. ecctéf.) ordre de religieux
vêtus de blanc, qui vivent fous l’étroite ob-
fervâhcô d'è la réglé de S. Bernard. Voyt\ B e r n a r -
i D IN 'S . '
Ce nom eft venu d’une réformé de cet ordre qui
à été premièrement faite dans l’abbaye de Fèuïttans ,
j à cinq lieues de Toulôufe, pàr le bienheureux Jean
de lâ Barrière qui en étoit abbé comméndataire ; &
qui ayant pris l habit de Cîteâux, travailla à la reforme,
qu’ il établit, après plufieurs coutradiÜions,
; vers l’âh ï ç;8o.
Le pàpè Sixte V . l’approuva, & les papes Clément
: V lî l. & Paul V. lui accordèrent dés lùpérieurs par-
j ticuliers. Le roi Henri III. fonda un couvent de cet
ordre àu fauxbourg de S. Honore à Paris en ï 587 *
1 Jean de la Barrière vint lui-mêmé s’y établir avec
• foixànte de fes religieux. Lès Ftuillarts Ont plufieurs