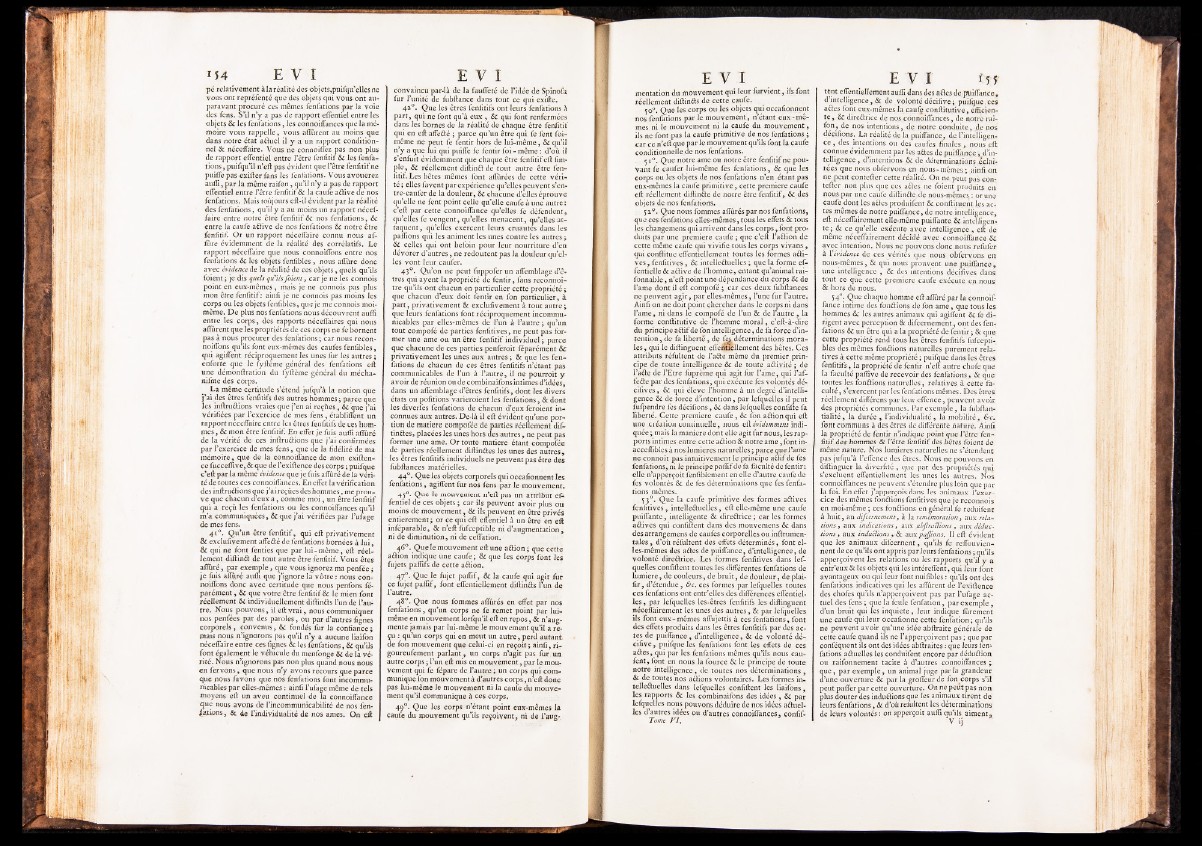
pé relativement à la réalité des obj ets,puifqu’élles ne
vous ont repréfenté que des objets qui vous, ont auparavant
procuré ces mêmes fenfations par la voie
des fens. S’il n’y a pas de rapport effentiel entre les
objets & les fenfations, les connoiffances que la mémoire
vous rappelle, vous affûrent au moins que
dans notre état aduel il y a un rapport conditionnel
& néceflaire. Vous ne connoiffez pas non plus
de rapport effentiel entre l’être fenfitif & les fenfations
, puifqu’il n’eft pas évident que l’être fenlitif ne
puiffe pas exifter fans les fenfations. Vous avouerez
aufli, par la même raifon, qu’il n’y a pas de rapport
effentiel entre l’être fenfitif & la caufe adive de nos
fenfations. Mais toujours eff-il évident par la réalité
des fenfations, qu’il y a au moins un rapport nécef-
faire entre notre être fenfitif & nos fenfations, &
entre la caufe adive de nos fenfations &c notre être
fenfitif. Or un rapport néceflaire connu nous affaire
évidemment de la réalité des corrélatifs. Le
rapport néceflaire que nous connoiffons entre nos
fenfations 8c les objets fenfibles, nous afluré donc
avec évidence de la réalité de ces objets, quels qu’ils
foient ; je dis quels qu'ils foient, car je ne les connois
point en eux-mêmes, mais je ne connois pas plus
mon être fenfitif: ainfi je ne connois pas moins les
corps ou les objets fenfibles, que je me connois moi-
même. De plus nos fenfations nous découvrent aufli
entre les corps, des rapports néceffaires qui nous
aflurent que les propriétés de ces corps ne fe bornent
pas à nous procurer des fenfations ; car nous recon-
noiffons qu’ils font eux-mêmes des caufes fenfibles,
qui agiffent réciproquement les unes fur les autres ;
enforte que le fyftème général des fenfations eft
une démonftration du fyftème général du mécha-
nifinie des corps.
La même certitude s’étend jufqu’à la notion que
j’ai des êtres fenfitifs des autres hommes ; parce que
les inftrudions vraies que j’en ai reçùes, & que j’ai
vérifiées par l’exercice de mes fens, établiflent un
rapport neceffaire entre les êtres fenfitifs de ces hommes
, & mon être fenfitif. En effet je fuis aufli afluré
de la vérité de ces inftrudions que j’ai confirmées
par l’exercice de mes fens, que de la fidélité de ma
mémoire, que de la connoiffance de mon exiften-
ce fucceflive, & que de l’exiftence des corps ; puifque
c’eft par la même évidence que je fuis afluré de la vérité
de toutes ces connoiffances. En effet la vérification
des inftrudions que j’ai reçues des hommes, me prouv
e que chacun d’eux a , comme moi, un être fenfitif
qui a reçû les fenfations ou les connoiffances qu’il i
m’a communiquées, & que j’ai vérifiées par l’ulage
de mes fens.
41?,. Qu’un être fenfitif, qui eft privativement
& exclufivement affedé de fenfations bornées à lui,
ôc qui ne font fenties que par lui-même, eft réellement
diftind de tout autre être fenfitif. Vous êtes
afluré, par exemple , que vous ignorez ma penfée ;
je luis afluré aufli que j’ignore la vôtre : nous connoiffons
donc avec certitude que nous penfons fé-
parément, 6c que votre être fenfitif 6c le mien font
réellement 6c individuellement diftinds l’un de l’autre.
Nous pouvons, il eft v ra i, nous .communiquer
nos penfées par des paroles, ou par d’autres fignes
corporels, convenus, 6c fondés fur la confiance ;
mais nous n’ignorons pas qu’il n’y a aucune liaifon
néceflaire entre ces fignes 6c les fenfations, 6c qu’ils
font également le véhicule du menfonge 6c de la vérité.
Nous n’ignorons pas non plus quand nous nous
en feryons, que nous n’y avons recours que parce
que nous favons que nos fenfations font incommunicables
par elles-mêmes : ainfi l’ufage même de tels
moyens eft un aveu continuel de la connoiffance
que nous avons de l’incommunicabilité de nos fen-
^ations, 6c de l’individualité de nos âmes. On eft
. convaincu par-là de la fauffeté de l’idée de Spinofâ
fur l’unité de fubftance dans tout ce qui exifte.
41°. Que les êtres fenfitifs ont leurs fenfations à
part, qui ne font qu’à eux , 6c qui font renfermées
dans les bornes de la réalité de chaque être fenfitif
qui en eft affedé ; parce qu’un être qui fe fent loi-
même ne peut fe fentir hors de lui-même, 6c qu’il
n’y a que lui qui puiffe fe fentir foi - même : d’où il
s’enfuit évidemment que chaque être fenfitif eft fim*
pie, 6c réellement diftind de tout autre être fenfitif.
Les bêtes mêmes font allurées de cette vérité
; elles favent par expérience qu’elles peuvent s’en-
tre-caufer de la douleur, ôc chacune d’elles éprouve
qu’elle ne fent point celle qu’elle caufe à une autre ;
c’eft par cette connoiffance qu’elles fe défendent ,
qu’elles fe vengent, qu’elles menacent, qu’elles attaquent
, qu’elles exercent leurs cruautés dans les
pallions qui les animent les unes contre les autres ;
6c celles qui ont befoin pour leur nourriture d’en
dévorer d’autres, ne redoutent pas la douleur qu'elles
vont leur caufer.
430. Qu’on ne peut fuppofer un affemblage d’ê+
très qui ayent la propriété de fentir, fans reconnoî-
tre qu’ils ont chacun en particulier cette propriété ;
que chacun d’eux doit fentir en fon particulier, à
part, privativement 8c exclufivement à tout autre ;
que leurs fenfations font réciproquement incommunicables
par elles-mêmes de l’un à l’autre ; qu’un
tout compofé de parties fenfitives, ne peut pas former
une ame ou un être fenfitif individuel ; parce
que chacune de ces parties penferoit féparément 6c
privativement les unes aux autres ; 8r que les fenfations
de chacun de ces êtres fenfitifs n’étant pas
communicables de l’un à l’autre, il ne pourrait y
avoir de réunion ou de combinaifonsintimes d’idées,
dans un affemblage d’êtres fenfitifs, dont les divers
états ou pofitions varieroient les fenfations, & dont
les diverles fenfations de chacun d’eux feroient inconnues
aux autres. De-là il eft évident qu’une portion
de matière compofée de parties réellement dif-
tindes, placées les unes hors des autres, ne peut pas
former une ame. Or toute matière étant compofée
de parties réellement diftindes les unes des autres ,
les êtres fenfitifs individuels ne peuvent pas être des
fubftances matérielles.
440. Que les objets corporels qui occafionnent les
fenfations, agiffent fur nos fens par le mouvement;
450. Que le mouvement n’eft pas un attribut effentiel
de ces objets ; car ils peuvent avoir plus ou
moins de mouvement, 6c ils peuvent en être privés
entièrement ; or ce qui eft effentiel à un être en eft
inféparable, & n’eft fufceptible ni d’augmentation,
ni de diminution, ni de ceffation.
46°. Que le mouvement eft une ad ion; que cette
adion indique une caufe ; 6c que les corps font les
fujets paflifs de cette adion.
47°. Que le fujet paflif, 6c la caufe qui agit fur
ce fujet paflif, font effentiellement diftinds l’un de
l’autre.
48°. Que nous fommes affùrés en effet par nos
fenfations, qu’un corps ne fe remet point par lui-
même en mouvement lorfqu’il eft en repos, 8c n’augmente
jamais par lui-même le mouvement qu’il a reçu
: qu’un corps qui en meut un autre, perd autant,
de fon mouvement que celui-ci en reçoit ; ainfi, ri-
goureufement parlant, un corps n’agit pas fur un
autre corps ; l’un eft mis en mouvement, par le mouvement
qui fe fépare de l’autre ; un corps qui communique
fon mouvement à d’autres corps, n’eft donc
pas lui-même le mouvement ni la caufe du mouvement
qu’il communique à ces corps.
490. Que les corps n’étant point eux-mêmes la
caufe du mouvement qu’ils reçoivent, ni de l’augmentatioh
du mouvement qui leur furvient, ils font
réellement diftinds de cette caufe.
50®. Que les corps ou les objets qui occafionnent
nos fenfations par le mouvement , n’étant eux-mêmes
ni le mouvement ni la caufe du mouvement,
ils ne font pas la caufe primitive de nos fenfations ;
car ce n’eft que par le mouvement qu’ils font la caufe
conditionnelle de nos fenfations.
. 51°. Que notre ame ou notre être fenfitif ne pouvant
fe caufer lui-même fes fenfations-, 8c que les
corps ou les objets de nos fenfations n’en étant pas
etix-mêmes la caufe primitive, cette première caufe
eft réellement diftinde de notre être fenfitif, & des
.objets de nos fenfations.
5 z°. Que nous fommes aflïirés par nos fenfations,
que ces fenfations elles-mêmes, tous les effets & tous
les changemens qui arrivent dans les corps, font produits
par une première caufe ; que c’eft l’adion de
cette même caufe qui vivifie tous les corps vivans ,
qui conftitue effentiellement toutes les formes adi-
v e s , fenfitives , ôc intelleduelles ; que la forme ef-
fentielle 6c adive de l’homme, entant qu’animal rai-
fonnable, n’eft point une dépendance du corps 6c de
l’ame dont il eft compofé ; car ces deux fubftances
ne peuvent agir, par elles-mêmes, l’une fur l’autre.
Ainfi on ne doit point chercher dans le corps ni dans
l’ame, ni dans le compofé de l’un 6c de l’autre , la
forme conftitutive de l’homme moral, c’eft-à-dire
du principe ad if de fon intelligence, de fa force d’intention
, de fa liberté, de déterminations morale
s , qui le diftinguent eflentiellenient des bêtes. Ces
attributs réfultent de l’ade même du premier principe
de toute intelligence 6c de toute adivité ; de
l’ade de l’Etre fuprème qui agit fur l’ame, qui l’af-
fede par des fenfations, qui exécute fes volontés dé-
cifives, 6c qui éleve l’homme à un degré d’intelligence
6c de force d’intention, par lefquelles il peut
lufpendre fes décifions, 6c dans lefquelles confifte fa
liberté. Cette première caufe, 6c fon adionqui eft
une création continuelle, nous eft évidemment indiquée
; mais la maniéré dont elle agit fur nous, les rapports
intimes entre cette adion 6c notre ame, font in-
acceflibies à nos lumières naturelles ; parce que l’ame
ne connoît pas intuitivement le principe ad if de fes
fenfations, ni le principe paflif de fa faculté de fentir :
elle n’apperçoit fenfibïement en elle d’autre caufe de
fes volontés 6c de fes déterminations que fes fenfations
mêmes.
53°. Que la caufe primitive des formes adives
fenfitives, intelleduelles, eft elle-même une caufe
puiffante, intelligente 6c diredrice ; car les formes
adives qui confinent dans des mouvemens 6c dans
des arrangemens de caufes corporelles ou inftrumen-
tales, d’oit réfultent des effets déterminés, font elles
mêmes des ades de puiffance, d’intelligence, de
volonté diredrice. Les formes fenfitives dans lefquelles
confiftent toutes les différentes fenfations de
lumière, de couleurs, de bruit, de douleur, de plai-
f ir , d’étendue, &c. ces formes par lefquelles toutes
ces fenfations ont entr’elles des différences effentiel-
le s , par lefquelles les-êtres fenfitifs les diftinguent
néceffairement les unes des autres, 8c par lefquelles
ils font eux-mêmes affujettis à ces fenfations, font
des effets produits dans les êtres fenfitifs par des actes
de puiffance , d’intelligence, 8c de volonté dé-
cifive, puifque les fenfations font les effets de ces
ades, qui par les fenfations mêmes qu’ils nous cau-
fent, font en nous la fource 6c le principe de toute
notre intelligence, de toutes nos déterminations,
6c de toutes nos adions volontaires. Les formes intelleduelles
dans lefquelles confiftent les liaifons,
les rapports 6c les combinaifons des idées , 6c par
lefquelles nous pouvons déduire de nos idées aduel-
les d’autres idées ou d’autres connoiffances, confif-
Tome y i%
tent effentiellement aufli dans des ades de puiffance ,
d’intelligence, 8c de volonté décifive; puifque.ces
ades font eux-mêmes la caufç conftitutive, efficient
e , 6c diredrice de nos connoiffances, de notre raifon,
de nos intentions , de notre conduite , jip nos
décifions. La réalité de .la puiffance, de l’intelligence
, des intentions ou des caufes finales, nous
connue évidemment par les ades de puiffance y d’intelligence
, d’intentions 6c de déterminations éc lairées
que nous obfervons en nous-mêmes ; ainfi on
ne peut contefter cette réalité. On ne peut pas eor^
tefter non plus que ces ades ne foient produits en
nous par une caufe diftinde de nous-mêm,es. : or une
caufe dont les ades produisent 6c conftitueiît les ac-.
tes mêmes de notre puiffance, de notre intelligence,
eft néceffairement elle-mcme puiffante 6c intelligente
; 8c ce qu’elle exécute avec intelligence , eft de
même néceffairement décidé avec connoiffance 6c
avec intention. Nous ne pouvons donc nous refufer
à Vevidence de ces vérités que nous, obfervons en
nous-mêmes, Ôc qui nous prouvent une pqiffance,
une intelligence , 6c des intentions décifiyes dans
tout ce que cette première caufe exécute .en nous
6c hors de nous.
54°. Que chaque homme eft afluré par la cqnnoif-
fance intime des fondions de fon ame, que tons les
hommes ôc les autres animaux qui agiffent 6c fe dirigent
avec perception 6c difeernement, ont des fenfations
6c un être qui a la propriété de fentir ; 8c que
cette propriété rend tous les êtres fenfitifs fufcepti-,
blés des mêmes fondions naturelles purement relatives
à cette même propriété ; puifque dans les êtres
fenfitifs, la propriété de fentir n’eft autre chofe que
la faculté paflive de recevoir des fenfations , & que
toutes les fondions naturelles, relatives à cette faculté
, s’exercent par les fenfations mêmes. Des êtres
réellement différens par leur effence, peuvent avoir
des propriétés communes. Par exemple, la fubftan-
tialité, la durée , l’individualité , la mobilité, &c.
font communs à des êtres de différente nature. Ainfi
la propriété de fentir n’indique point que l’être fenfitif
des hommes & l’être fenfitif des bêtes foient de
même nature. Nos lumières naturelles ne s’étendent
pas jufqu’à l’effence des êtres. Nous ne pouvons en
diftinguer la diverfité, que par des propriétés qui
s’excluent effentiellement les unes les autres. Nos
connoiffances ne peuvent s’étendre plus loin que par
la foi. En effet j’apperçois dans les animaux l’exercice
des mêmes fondions fenfitives que je reconnois
en moi-même ; ces fondions en générai fe reduifent
à huit, au difeernement, à la rememoration, aux relations
, aux indications, aux abftraclions, aux déductions,
aux inductions , & aux pajjions. Il eft évident
que les animaux difeernent, qu’ils fe reffouvien-
nent de ce qu’ils ont appris par leurs fenfations ; qu’ils
apperçoivent les relations pu les rapports qu’il y a
entr’eux 8c les objets qui les intéreffent, qui leur font
avantageux ou qui leur font nuifibles : qu’ils ont des
fenfations indicatives qui les aflurent de l’exiftence
des chofes qu’ils n’apperçoivent pas par l’ufage actuel
des fens ; que la feule fenfation, par exemple ,
d’un bruit qui les inquiété, leur indique fûrement
une caufe qui leur occafionne cette fenfation; qu’ils
ne peuvent avoir qu’une idée abftraite générale de
cette caufe quand ils ne l’apperçoivent pas ; que par
conféquent ils ont des idées abftraites : que leurs fem
fations aduelles les conduifent encore par dédudion
ou raifonnement tacite à d’autres connoiffances ;
que, par exemple, un animal juge parla grandeur
d’une ouverture 8c par la groffeur de fon corps s’il
peut paffer par cette ouverture. On ne peut pas non
plus douter des indudions que les animaux tirent dé
leurs fenfations, 8c d’où relultcnt le$ déterminations
de letirs volontés : on apperçoit aufli qu’ils aiment