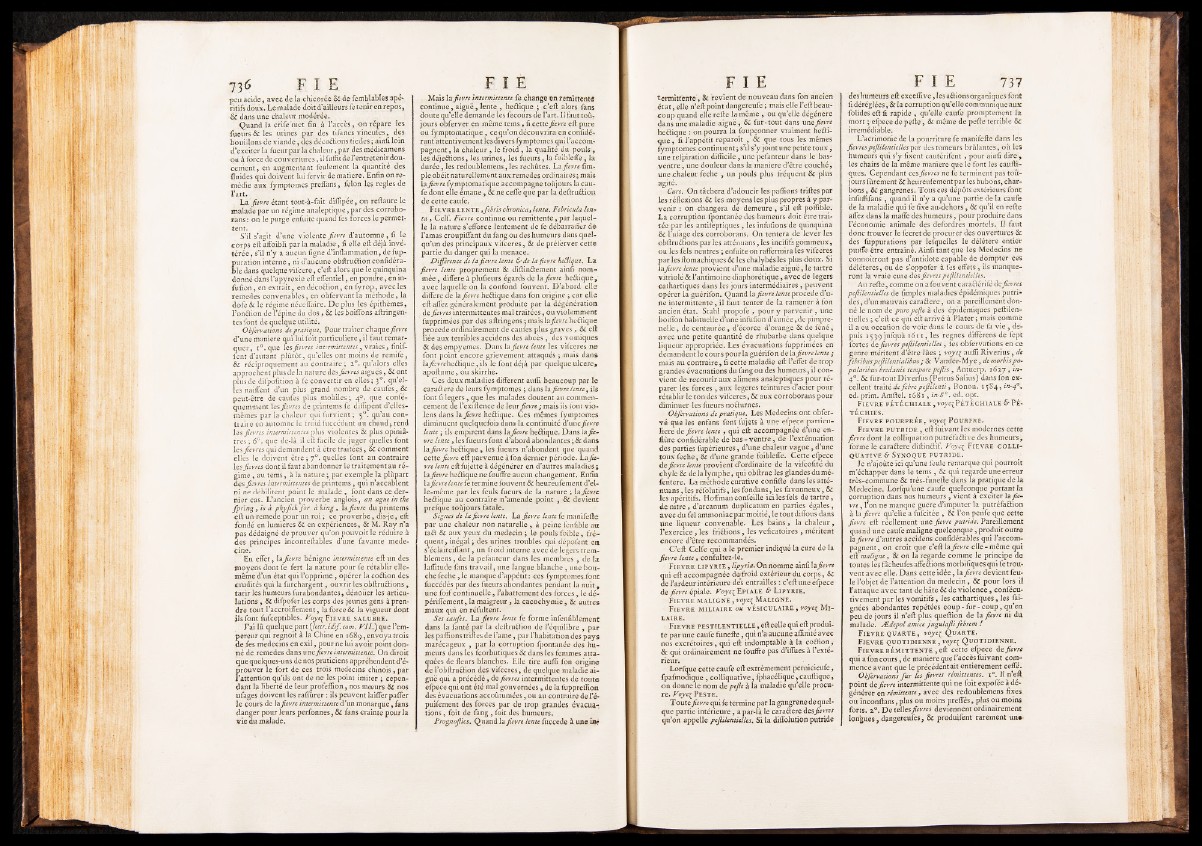
736 F I E peu acide, avec de la:chicorée 6 cde femblablesapé*
ritifs doux. Le malade doit d’ailleurs le tenir en repos,
êc dans une chaleur modérée.
Quand la enfemet fin à l’accès , on répare les
fueurs& les urines par des tifanes vineules, des
bouillons de viande, des décollions tietles ; ainfi loin
d’exciter la lueur par la chaleur, par des médicamens
ou à force de couvertures, il 1 uffic de l’entretenir doucement,
en augmentant feulement la quantité des
fluides qui doivent lui fervir de matière. Enfin on remédie
aux fymptomes preffans, félon les réglés de
l’art.
La fievre étant tout-à-fait diffipée, on reftaure le
malade par un régime analeptique, par des corrobo-
rans : on le purge enfuite quand fes forces le permet-:
tent.
S’il s’agit d’une violente jievre d’automne, fi le
corps eft affoibli par la maladie, fi elle eft déjà invétérée
, s’il n’y a aucun figne d’inflammation, defup-
puration interne, ni d’aucune obftrudion confidéra-
ble dans quelque vilcere, c’eft alors que le quinquina
donné dans l’apyrexie eft effentiel, en poudre, en in-
fufion, en extrait, en déco&ion, en fyrop, avec les
remedes convenables, en obfervant la méthode, la
dofé & le régime néceffaire. De plus les épithèmes,
l’onûion de l’épine du dos, 6c les boiflons aftringen-
tes font de quelque utilité.
Obfervations de pratique. Pour traiter chaque fievre
d’une maniéré qui lui foit particulière, il faut remarquer,
i° . que \es fievres intermittentes, vraies, finif-
fent d’autant plutôt, qu’elles ont moins de remife,
&: réciproquement au contraire ; 2°. qu’alors elles
approchent plus de la nature des fievres aiguës, 6c ont
plus de difpofition à fe convertir en elles; 30. qu’elles
naiffent d’un plus grand nombre de caufes, &
peut-être de caufes plus mobiles ; 40. que confé-
quemment les fievres de printems fe diflîpent d’elles-
mêmes par la chaleur qui furvient ; 50. qu’au contraire
en automne le froid fuccédant au chaud, rend
les fievres intermittentes plus violentes & plus opiniâtres
; 6°. que de-là il eft facile de juger quelles font
les fievres qui demandent à être traitées, 6c comment
elles le doivent être ; 70. quelles font au contraire
les fievres dont il faut abandonner le traitement au régime
, au tems, à la nature ; par exemple la plupart
des fievres intermittentes de printems, qui n’accablent
ni ne débilitent point le malade , font dans ce dernier
cas. L’ancien proverbe anglois, an agueinthe
fpring y is à phyjîckfor à king , la fievre du printems
eft un remede pour un roi ; ce proverbe, dis-je, eft
fondé en lumières 6c en expériences, & M. Ray n’a
pas dédaigné de prouver qu’on pouyoit le réduire à
des principes inconteftables d’une favante médecine.
En effet, la fievre bénigne intermittente eft un des
moyens dont fe fert la nature pour fe rétablir elle-
même d’un état qui l’opprime, opérer la coôion des
crudités qui la furchargent, ouvrir les obftru&ions ,
tarir les humeurs furabondantes, dénoiier les articulations
, 8c difpofer les corps des jeunes gens à prendre
tout l’accroiffement, la force 8c la vigueur dont
ils font fufceptibles. Voye^ F i e v r e s a l u b r e .
J’ai lu quelque part Qettr.édif. tom. VII.') que l’empereur
qui reghoit à la Chine en 1689, envoya trois
de fes médecins en ex il, pour ne lui avoir point donné
de remedes dans une jievre intermittente. On diroit
que quelques-uns de nos praticiens appréhendent d’éprouver
le fort de ces trois médecins chinois, par
l ’attention qu’ils ont de ne les point imiter ; cependant
la liberté de leur profeflion, nos moeurs 8c nos
ufages doivent les raffûrer : ils peuvent laiffer paffer
le cours de la fievre intermittente d ’un monarque, fans
danger pour leurs perfonnes, 8c fans crainte pour la
vie du malade.
F I E Mais la fievre intermittente fe change en rémittente
continue, aiguë, lente , heûique ; c ’eft alors fans
doute qu’elle demande les fecours de l’art. Il faut tou,
jours obferver en même tems , fi cette fievre eft pure
ou fymptomatique, ce qu’on découvrira en confidé-
rant attentivement les divers fymptomes qui l’accompagnent,
ta chaleur , le froid , la qualité du pouls ,
le$ déjeâions, les urines, les fueurs, la foibleffe, la
durée, les redoublemens, les rechutes . La fievre fim-
ple obéit naturellement aux remedes ordinaires ; mais
la fievre fymptomatique accompagne toûjours la cau-
fe dont elle émane, 8c ne ceffe que par la deftruélion
de cette caufe.
F i e v r e LENTE yfebris chronicay lenta. Febricula len-
ta y Celf. Fievre continue ou rémittente, par laquelle
la nature s’efforce lentement de fe débarraffer de
l’amas croupiffant du fang ou des humeurs dans quelqu’un
des principaux vifeeres, & de préferver cette
partie du danger qui la menace.
Différence de la jievre lente & de la fievre hectique. La
jievre lente proprement & diftinélement ainfi nommée
, différé à plufieurs égards de la fievre he&ique
avec laquelle on la confond fouvent. D ’abord elle
diffère de la fievre heûique dans fon origine ; car elle
eft allez généralement produite par la dégénération
de fievres intermittentes mal traitées, ou violemment
fupprimées par des aftringens ;maislai/£m'che£tique
procédé ordinairement de caufes plus graves , 6c eft
liée aux terribles accidens des abcès , des vomiques
& des empyemes. Dans la fievre lente les vifeeres ne
font point encore grièvement attaqués ; (mais dans
la/kvr«he£lique,ils le font déjà par quelque ulcéré,
apoftume, ou skirrhe.
Ces deux maladies different aufïi beaucoup par le
cara&ere de leurs fymptomes ; dans la fievre Lente, ils
font fi légers, que les malades doutent au commencement
de l’exiftence de leur fievre ; mais iis font vio-
lens dans la fievre heôique. Ces mêmes fymptomes
diminuent quelquefois dans la continuité d’une fievre
lente ; ils empirent dans la fievre heâique. Dans la fievre
lente, les fueurs font d’abord abondantes ; & dans
la fievre heétique, les fueurs n’abonjdent que quand
cette fievre eft parvenue à fon dernier période. La fievre
lente eft fujette à dégénérer en d’autres maladies ;
la fievre heélique ne fouffre aucun changement. Enfin
la fievre lente fe termine fouvent 8c heureufement d’elle
même par les feuls fueurs de la nature ; la fievre
he&ique au contraire n’amende point , 8c devient
prefque toûjours fatale.
Signes de la fievre lente. La fievre lente fe manifefte
par une chaleur non naturelle , à peine fenfible au
taû 8c aux yeux du médecin ; le pouls foible, fréquent,
inégal ; des urines troubles qui dépofent eu
s’éclairciffant, un froid interne avec de légers trera-
blemens, de la pefanteur dans les membres , de la
lafîitude fans travail, une langue blanche, une bouche
feche, le manque d’appétit: ces fymptomesdont
fuccédés par des fueurs abondantes pendant la nuit ,
une foif continuelle, l’abattement des forces, le dé-
périffement, la maigreur , la cacochymie, & autres
maux qui en réfultent.
Ses caufes. La fievre lente fe forme infenfiblement
dans la fanté par la deftru&ion de l’équilibre , par
les pallions triftes de l’ame, par l’habitation des pays
marécageux , par la corruption fpontanée des humeurs
dans les feorbutiques 8c dans les femmes attaquées
de fleurs blanches. Elle tire aufli fon origine
de l’obftru&ion des vifeeres, de quelque maladie aiguë
qui a précédé, de fievres intermittentes de toute
efpece qui ont été mal gouvernées, de la fuppreflion
des évacuations accoûtumées, ou au contraire del’é-
puifement des forces par de trop grandes évacua-,
tions, foit de fang , foit des humeurs.
Frognojlics, Quand la fievre lente fuccede à une in?
F I E termittentè , & revient de nouveau dans fon ancien
éta t, elle n’eft pointdangereufe ; mais elle I’eft beaucoup
quand elle refte la même , ou qu’elle dégénéré
dans une maladie aiguë, 8c fur-tout dans une fievre
heûique : on pourra la foupçonner vraiment heûi-
q u e , fi l’appétit reparoît , 8c que tous les mêmes
fymptomes continuent ; s’il s’y joint une petite tou x,
une refpiration difficile, une pefanteur dans le bas-
ventre, une douleur dans la maniéré d’être couché,
une chaleur feche , un pouls plus fréquent 8c plus
agité. -
Cure. On tachera d’adoucir les pallions triftes par
les réflexions 8c les moyens les plus propres à y parvenir
: on .changera de demeure , s’il eft poffible.'
La corruption fpontanée des humeurs doit être traitée
par les antileptiques , les infufions de quinquina
8c l’ufage des corroborans. On tentera de lever les
obftruôions par les atténuans, les incififs gommeux,
ou les fels neutres ; enfuite on raffermira les vifeeres
par lesftomachiques 8c les chalybés les plus doûx. Si
lafievre lente provient d’une maladie aiguë, le tartre
vitriolé & l’antimoine diaphorétique, avec de légers
cathartiques dans les jours intermédiaires , peuvent
opérer la guérifon. Quand la fievre lente procédé d’une
intermittente, il faut tenter de la ramener à fon
ancien état. Stahl propofe , pour y parvenir , une
boiffon habituelle d’une infufion d’aunée,de pimpre-
nelle, de centaurée, d’écorce d’orange & de féné,
avec une petite quantité de rhubarbe dans quelque
liqueur appropriée. Les évacuations fupprimées en
demandent le cours pour la guérifon de la fievre lente ;
mais au contraire, fi cette maladie eft l’effet de trop
grandes évacuations du fang ou des humeurs, il convient
de recourir aux alimens analeptiques pour réparer
les forces , aux legeres teintures d’acier pour
rétablir le ton des vifeeres, 8c aux corroborans pour
diminuer les fueurs no&urnes.
Obfervations de pratique, Les Médecins ont obfer-
v é que les enfans font fujets à une efpece particulière
de fievre lente , qui eft accompagnée d’une enflure
confidérable de bas - ventre, de l’exténuation
des parties fupérieures, d’une chaleur vague, d’une
toux feche, 8c d’une grande foibleffe. Cette efpece
de fievre lente provient d’ordinaire de la vifeofité du
chyle 8c delà lymphe, qui obftrue les glandes dumé-
fentere. La méthode curative confifte dans les atténuans
, les réfolutifs, les fondans, les favonneux, 8c
les apéritifs. Hoffman confeille ici les fels de tartre,
de n itre, d’arcanum duplicatüm en parties égales,
avec du fel ammoniac par moitié, le tout diffous dans
une liqueur convenable. Les bains, la chaleur,
l ’exercice, les fri&ions, les veficatoires , méritent
encore d’être recommandés.
C ’eft Celfe qui a le premier indiqué la cure de la
fievre lente , cohfultez-le.
F i e v r e l i p y r i e , lipyria. On nomme ainfi lafievre
qui eft accompagnée derfroid extérieur du corps, 8c
de l’ardeur intérieure dés entrailles : c’eft une efpece
de fievre épiale. A’qyeçEPiALE & L i p y r i e .
F i e v r e m a l i g n e ,voyei M a l i g n e .
F i e v r e m i l i a i r e ou v é s i c u l a i r e , voye^ Mi-
LAIRE.
F i e v r e p e s t i l e n t i e l l e , eft celle qui eft produite
par une caufe funefte, qui n’a aucune affinité avec
nos excrétoires, qui eft indomptable à la coflion ,
& qui ordinairement ne fouffre pas d’iffues à l’exte-
rieur.
Lorfque cette caufe eft extrêmement pernicieufe,
fpafmodique , colliquative, fphacélique, cauftique,
on donne le nom de pefle à la maladie qu’elle procur
é . Voye^ P e s t e .
Toute fievre qui fe termine par la gangrené de quelque
partie intérieure, a par-là le caraftere desfievres
qu’on appelle pejlilentielles. Si la diffolution putride
F I E 737
deshumeurs eft exceflîve, les a étions organiques font
fi déréglées, & la corruption qu’elle communique aux
folides eft fi rapide , qu’elle caufe promptement’ la
mort ; efpece de pefte, & même de pelle terrible 6c
irrémédiable.
L’acrimonie de la pourriture fe manifefte dans les
fievres pejlilentielles par des tumeurs brûlantes, pii les
humeurs qui s’y fixent cautérifent-, pour ainfi dire ,
les chairs de la même maniéré que le font les caufti-
ques. Cependant ces fievres ne fe .terminent pas tout-
jours fûrement 8c heureufement par les bubons, charbons,
8c gangrenés. Tous ces dépôts extérieurs font
infuffifans , quand il n’y a qu’une partie de la caufe
de la maladie qui fe fixe au-dehors, 6c qu’il en refte
affez dans la maffe des humeurs, pour produire dans
l’économie animale des defordres mortels. Il faut
donc trouver le fecret de procurer des ouvertures &
des fuppurations par lesquelles le délétère entier
puifle être entraîné. Ainfi tant que les Médecins ne
connoîtront pas d’antidote capable de dompter ces
délétères, ou de s^oppofer à fes effets, ils manque-,
ront la vraie cui e des fievres pejlilentielles.
Au refte, comme on a fouvent carâ&érifé de fievres
pejlilentielles de fimples maladies épidémiques putrides
, d’un mauvais caradere, on a pareillement donné
le nom de pure pejle à des épidémiques peftilen-
tielles ; c’eft ce qui eft arrivé à Plater ; mais comme
il a eu occafion de voir dans le cours de fa v ie , depuis
iç j^jufquà 16 1 1 , les régnés différens de fept
fortes àz fievres pejlilentielles , fes obfervations en ce
genre méritent d’être lues ; voyeç aufli R iverius, de
febribuspejlilentialibus ; & Vander-Mye, demorbispo-
pularibus bredanis tempore pejlis , Antuerp. 1627 , in-
4°. 6c fur-tout Diverfus (Petrus Salius) dans fon excellent
traité de febrepejlilenti, Bonon. 1584, in-40'.
ed. prim. Amftel. 16 81 , in-8°. èd. opt.
Fievre p é t é ch ial e , voye^PÉTÉcHiALE & Pét
é ch ie s .
Fievre pou rprée, voye^ Pourpre.
Fievre putrid e , eft fuivantles modernes cette
fievre dont la colliquation putréfa&ive des humeurs,
forme le caradere diftindif. Voye^ Fievre c o l l i-
QÜATIVE & SYNOQUE PUTRIDE.
Je n’ajoûte ici qu’une feule rèmarque qui pourroit
m’échapper dans le tems, 6c qui regarde une erreur
très-commune 6c très-funefte dans la pratique de la
Medecine. Lorfqu’une caufe quelconque portant la
corruption dans nos humeurs , vient à exciter la fievre
, l’on ne manque guère d’imputer la putréfadion
à la fievre qu’elle a fufeitée , 6c l’on penfe que cette
fievre eft réellement une fievre putride. Pareillement
quand une caufe maligne quelconque, produit outre
la jievre d’autres accidens confidérabies qui l’accompagnent
, on croit que c’eft la jievre elle - même qui
eft maligne, & on la regarde comme le principe de
toutes les fâcheufes affedions morbifiques qui fe trouvent
avec elle. Dans cette idée, la fievre devient feule
l’objet de l’attention du médecin, 6c pour lors il
l’attaque avec tant de hâte 6c de violence, confécu-
tivement par les vomitifs, les cathartiques, les fai-
gnées abondantes repétées coup - fur - coup, qu’en
peu de jours il n’eft plus queftion de la fievre ni du
malade. Ædepol amice jugulajli febrem !
Fievre q u a r t e , voyeç Q uarte.
Fievre quotidienne , voye^ Q uot idienne.
Fievre r ém it t en t e , eft cette efpece de fievre
qui a fon cours, de maniéré que l’accès fuivant commence
avant que le précédent ait entièrement ceffe.
Obfervations fur les fievres rémittentes, i° . Il n’eft,
point de fievre intermittente qui ne foit expofée à dégénérer
en rémittente, avec des redoublemens fixes
ou inconftans, plus ou moins preffés, plus ou moins
forts. 2°. D e telles fievres deviennent ordinairement
longues, dangereufes, 6c produifent rarement un*