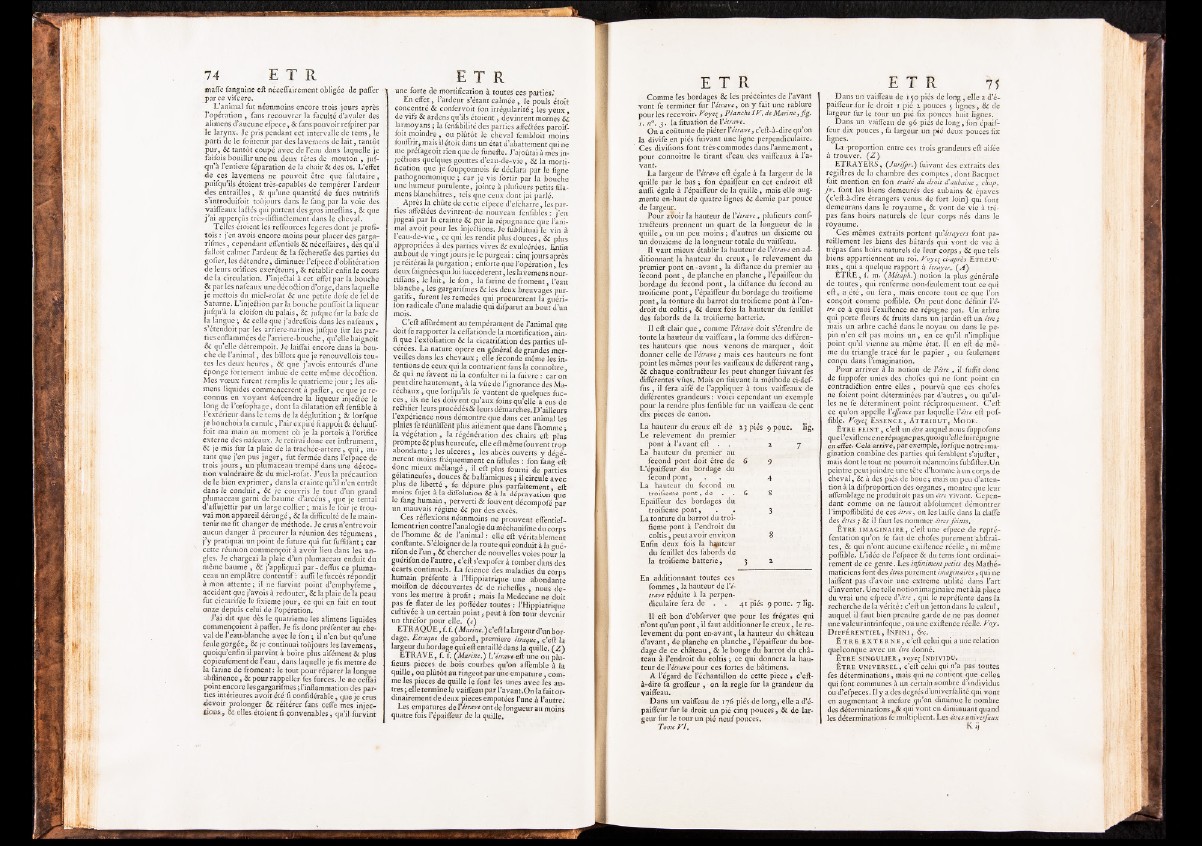
74 E T R
maffe fanguine eft néceflairement obligée de paffer
parce vifeere.
L’animal fut néanmoins encore trois jours après
l’opération , fans recouvrer la faculté d’avaler des
alimens d’aucune efpece, & fans pouvoir rcfpirer par
le larynx. Je pris pendant cet intervalle de tems, le
parti de le foûtenir par des lavemens de lait, tantôt
pur, & tantôt coupé avec de l’eau dans laquelle je
faifois bouillir une ou deux têtes de mouton , juf-
qu’à. Fentiere réparation de la chair & des os. L’effet
de ces lavemens ne pouvoit être que fahitaire,
puifqu’ils étoient très-capables de tempérer l’ardeur
des entrailles, & qu’une quantité de fucs nutritifs
s’introduifoit toujours dans le fang par la voie des
vaiffeaux laûcs qui partent des gros inteftins, & que
j ’ai apperçûs très-diftinûement dans le cheval.
Telles étoient les reffources legeres dont je profitais
: j’en avois encore moins pour placer des garga-
rifines, cependant effentiels &néceffaires, dès qu’il
falloit calmer l’ardeur & la féçhereffe des parties du
gofier, les détendre, diminuer l’efpece d’oblitération
de leurs orifices excréteurs, & rétablir enfin le cours
de la circulation. J’injeftai à cet effet par la bouche
& par les nafeaux une décottion d’orge, dans laquelle
je mettois du miel-rofat & une petite dofe de fel de
Saturne. L’injè&ion par la bouche pouffoit la liqueur
jufqu’à la cloifon du palais, & jufque fur la baie de
la langue ; & celle que j’adreffois dans les nafeaux,
s’étendoit par les arriere-narines jufque fur les parties
enflammées de l’arriere-bouche, qu’çlle baignoit
& qu’elle détrempoit. Je laiffai encore dans la bouche
de l’animal, des billots que je renouvellois toutes
les deux heures , & que 'j’avois entourés d’une
épongé fortement imbue de cette même décoftion.
Mes voeux furent remplis le quatrième jour ; les ali-
mens liquides commencèrent à paffer, ce que je reconnus
en voyant defeendre la liqueur injeâée le
long de l ’oefophage, dont la dilatation eft fenfible à
l’extérieur dans ie tems de la déglutition ; & lorfque
je bouchois la canule, l’air expiré frappoit & échauf-
foit ma main au moment oit je la portois à l’orifice
externe des nafeaux. Je retirai donc cet inftrument,
& je mis fur la plaie de la trachée-artere , qui, autant
que j’en pus juger, fut fermée dans Fefpace de
trois jours, un plumaceau trempé dans une décoction
vulnéraire & du miel-rofat. J’eus la précaution
de le bien exprimer, dans la crainte qu’il n’en entrât
dans le conduit, & je couvris le tout d’un grand
plumaceau garni de baume d’arcéus , que je tentai
d’affujettir par un large collier ; mais le foir je trouv
ai mon appareil dérangé, & la difficulté de le maintenir
me fit changer de méthode. Je crus n’entrevoir
aucun danger à procurer la réunion des tégumens,
j-’y pratiquai un point de future qui fut fuffifant; car
cette réunion comtriençoit à avoir lieu dans les angles.
Je chargeai la plaie d’un plumaceau enduit du
même baume , & j’appliquai par-deffus ce plumaceau
un emplâtre c'ontentif : auffi le fuccès répondit
à mon attente ; il ne furvint point d’emphyfeme,
accident que j’avois à redouter, & la plaie de la peau
fut cicatrifée le fixieme jour, ce qui en fait en tout
onze depuis celui de Fopération.
J’ai dit que dès le quatrième les alimens liquides
commençoient à paffer. Je fis donc préfenter au cheval
de l’eau-blanche ayec le fon ; il n’en but qu’une
feule gorgée, & je continuai toujours les lavemens,
quoiqu’enfin il parvînt à boire plus aifément & plus
copieufement de l’eau, dans laquelle je fis mettre de
la farine de froment : le tout pour réparer la longue
abftinence, & pour rappeller fes forces. Je ne ceffai
point encore les gargarifmes ; l’inflammation des parties
intérieures avoit été fi confidérable, que je crus
Revoir prolonger & réitérer fans ceffe mes injec-
tioos. f & elles étoient fi convenables, qu’il furvint
E T R
■ 'I une forte de mortification à toutes’ ces parties.'
En effet, l’ardeur s’étant calmée , le pouls étoît
; concentré & confervoit fon irrégularité ; les y e u x ,
de vifs & ardens qu’ils étoient, devinrent mornes ôc
larmoyans j la fenfibilité des parties affrétées paroifi
foit moindre, ou plutôt le cheval fembloit moins
■ fouffrir, mais il étoit dans un état d’abattement qui ne
; me préfageoit rien que de funefte. J’ajoutai à mes in-
■ jeétions quelques gouttes d’eau-de-vie, & la morti-
fiçation que je foupçonnois fe déclara par le ligne
pathognomonique ; car je vis fortir par la bouche
une humeur purulente, jointe à plufieurs petits fila-
mens blanchâtres, tels que ceux dont jai parlé.
Apres la chute de cette efpece d’efeharre, les parties
affrétées devinrent»-de nouveau fenfibles : j’en
jugeai par la crainte & par la répugnance que l’animal
avoit pour les injeftions. Je fubftituai le vin à
l’eau-de-vie, ce qui les rendit plus douces, & plus
appropriées à des parties vives & exulcérées. Enfin
au bout de vingt jours je le purgeai : cinq jours après
je réitérai la purgation ; enforte que l’opération, les
deux fàignées qui lui fuccéderent, les lavemens nour-
riflans, le lait, le fon , la farine de froment, l’eau
blanche, les gargarifmes & les deux breuvages purgatifs,
furent les remedes qui procurèrent la guéri-
fon radicale d’une maladie qui difparut au bout d’un
mois.
C ’efl: aflïirément au tempérament de l’animal que
doit fe rapporter la ceffationde la mortification, ain-
fi ^flue l’exfoliation & la cicatrifation des parties ulcérées.
La nature opéré en général de grandes merveilles
dans les chevaux ; elle fécondé même les intentions,
de ceux qui la contrarient fans la connoître,
& qui ne lavent ni la confulter ni la fuivre : car on
peut dire hautement, à la vue de l’ignorance des Maréchaux
, que lorfqu’ils fe vantent de quelques fuccès
, ils ne les doivent qu’aux foins qu’elle a eus de
reétifier leurs procédés & leurs démarches. D ’ailleurs
l’expérience nous démontre que dans cet animal les
plaies fe réunifient plus aifément que dans l’homme ;
la végétation , la régénération des chairs eft plus
prompte & plus heureùfe, elle eft même fou vent trop
abondante ; les ulcérés, les abcès ouverts y dégénèrent
moins fréquemment en fiftules : fon fang eft
donc mieux mélangé , il eft plus fourni de parties
gelatmeufes, douces & balfamiques il circule avec
plus de liberté , fe dépure plus parfaitement eft
moins fujet à la diffolution & à la dépravation que
le fang humain, perverti & fouvent décompofé par
un mauvais régime & par des excès.
Ces réflexions néanmoins ne prouvent effentiel-
lementrien contre l’analogie du-méchanifme du corps
de l’homme & de l’animal : elle eft véritablement
confiante. S’éloigner de la route qui conduit à la guér
i^ 11 de l’un , & chercher de nouvelles voies pour la
guérifon de l’autre, c’eft s’expofer à tomber dans des
écarts continuels. La fcience des maladies du corps
humain préfente à l’Hippiatrique une abondante
moiflbn de découvertes & dericheffes , nous devons
les mettre à profit ; mais la Medecine ne doit
Pas.fe^flater de les pofféder toutes : l’Hippiatrique
cultivée à un certain point,- peut à fon tour devenir
un thréfor pour elle. (e)
ETR AQ UE, f. f. (Marine.) c’eft la largeur d’un bor-
dage. E traque de gabord, première étraquey c’eft la
largeur du bordage qui eft entaillé dans la quille. ( Z )
ETRAVE, f. f. (Marine.) U étrave eft une ou plufieurs
pièces de bois courbes qu’on aflemble à la
quille, ou plûtôt au ringeot par une empature, comme
les pièces de quille le font les unes avec les autres
; elle termine le vaifleau par l’avant.On la fait ordinairement
de deux pièces empâtées l’une à l’autre;
Les empatures deY étrave ont de longueur au moins
quatre fois l’épaiffeur de la quille.
E T R
Comme les bordages & lés préceintes dé l’avant
vont fe terminer fur l'étrave, on y fait une rablure
pour les recevoir. Voye^, Planche IV . de Marine, fig.
j . n°. j . la fituation de V/étrave.
On a coûtume de piéter Y étrave, c’eft-à-dire qu’on
la divife en pies fuivant une ligne perpendiculaire.
Ces divifions font très-commodes dans l’armement,
pour connoître le tirant d’eau des vaiffeaux à l’avant.
La largeur de Y étrave eft égale à la largeur de la
quille par le bas ; fon épaiffeur en cet endroit éft
auffi égale à l’épaiffeur de la quille, mais elle augmente
en-haut de quatre lignes & demie par pouce
de largeur.
Pour avoir la hauteur de Vétrave, plufieurs conf-
trufreurs prennent un quart de la longueur de la
quille, ou un peu moins ; d’autres un dixième ou
un.douzième de la longueur totale du vaifleau.
Il vaut mieux établir la hauteur de Yétrave en additionnant
la hauteur du creux, le relèvement du
premier pont en-avant, la diftance du premier au
fécond pont, de planche en planche, l’épaifleur du
bordage du fécond pont, la diftance du fécond au
troifieme pont, l’épaifleur du bordage du troifieme
pont, la tonture du barrot du troifieme pont à l’endroit
du coltis, & deux fois la hauteur du feuillet
des fabords de la troifieme batterie.
II eft clair que, comme Yétrave doit s’étendre de
toute la hauteur du vaifleau, la fomme des différentes
hauteurs que nous venons de marquer, doit
donner celle cfe Y étrave ; mais ces hauteurs ne font
point les mêmes pour les vaiffeaux de différent rang,
& chaque conftruéteur les peut changer fuivant fes
différentes vues. Mais en fuivant la méthode ci-dcf-
fus , il fera aifé de l’appliquer à tous vaifleaux de
différentes grandeurs : voici cependant un exemple
pour la rendre plus fenfible fur un vaifleau de cent
dix pièces de canon.
La hauteur du creux eft dé 13 piés 9 pçue
Le relèvement du premier
pont à l’avant eft . . 2
La hauteur du premier au
fécond pont doit être de 6 9
L ’épaifleur du bordage du
fécond pont, 4
La hauteur du fécond au
troifieme pont, de . . 6 8
Epaifleur des bordages du
troifieme pont, . . 3
La tonture du barrot du troifieme
pont à l’endroit du
coltis, peut avoir environ 8
Enfin deux fois la hauteur
du feuillet des fabords de
la troifieme batterie, 3 2
En additionnant toutes ces
fommes, la hauteur de l’é-
travè réduite à la perpendiculaire
fera de . . 41 piés 9 pouc. 7 lig.
Il eft bon d’obferver que pour les frégates qui
. n’ont qu’un pont, il faut additionner le creux, le relèvement
du pont en-avant, la hauteur du château
d’avant, de planche en planche, l’épaifleur du bordage
de ce château, & le bouge du barrot du château
à l’endroit du coltis ; ce qui donnera la hauteur
de Vétrave pour ces iortes de bâtimens.
A l’égard de l’échantillon de cette piece, c’eft-
à-dire fa grofleur , on la réglé fur la grandeur du
vaifleau.
Dans un vaifleau de 176 piés de long, elle a d’é-
paiffeur fur le droit un pié cinq pouces, & de largeur
fur le tour un pié neuf pouces.
Tome V I .
• lig.
7
E T R 7*
Dans un vaifleau de i 50 piés de long, elle a d’é-
paiffeur fur le droit 1 pié 2 pouces 5 lignes, & de
largeur fur le tour un pié fix pouces huit lignes.
Dans un vaifleau de 96 piés de long, fon épaif-
feur dix pouces, fa largeur un pié deux pouces fix
lignes.
La proportion entre ces trois grandeurs eft aifée
à trouver. (Z )
ETRAYERS, (Jurifpr.) fuivant des extraits des
regiftres de la chambre des comptes, dont Bacquet
fait mention èn fon traité du droit d'aubaine , chap,
jv . font les biens demeurés des aubains &c épaves
(c’eft-à-dire étrangers venus de fort loin) qui font
demeurans dans le royaume, & vont de vie à tré
pas fans hoirs naturels de leur corps nés dans le
royaume.
Ces mêmes extraits portent qu'étrayers font pareillement
les biens des bâtards qui vont de vie à
trépas fans hoirs naturels de leur corps, & que tels
biens appartiennent au roi. RES Voyeç ci-après Etrejü- , qui a quelque rapport à étrayer. (A)
Ê TR E , i. m. (Métaph.) notion la plus générale
de toutes, qui renferme non-feulement tout ce qui
eft, a é té, ou fera, mais encore tout ce que l’on
conçoit comme poffible. On peut donc définir IV-
tre ce à quoi l’exiftence ne répugne pas. Un arbre
qui porte fleurs & fruits dans un jardin eft un être;
mais un arbre caché dans le noyau ou dans le pépin
n’en eft pas moins u n , en ce qu’il n’implique
point qu’il vienne au même état. Il en eft de même
du triangle tracé fur le papier , ou feulement
conçu dans l’imagination.
Pour arriver à la notion de Y être , il fuffit donc
de fuppofer unies des chofes qui ne font point en
contradiâion entre elles , pourvu que ces chofes
ne foient point déterminées par d’autres, ou qu’elles
ne fe déterminent point réciproquement. C ’eft
ce qu’on appelle Yejjence par laquelle Y être eft poffible.
Voyei Essence, Attribut, Mode.
Etre feint , c’eft un être auquel nous fuppofons
que l’exiftence ne répugnepas,quoiqu'cllelinrépugne
en effet. Cela arrive, par exemple, lorfque notre imagination
combine des parties qui femblent s’ajufter,
mais dont le tout ne pourroit néanmoins fubfifter.Un
peintre peut joindre une tête d’homme à un corps de
cheval, & à des piés de bouc ; mais un peu d’attention
à la difpropôrtion des Organes, montre que leur
affemblage ne produiroit pas un être vivant. Cependant
comme on ne fauroit abfolument démontrer
l ’impoffibilité de ces êtres, on les laiffe dans la claffe
des êtres ; & il faut nommer êtres feints,. Être imaginaire, c’eft une efpece de repré-
fentation qu’on fe fait de chofes purement abftrai-
tes, & qui n’ont aucune exiftenqe réelle, ni même
poffible. L’idée de l’efpaçe & du tems font ordinai-
. rement de ce genre. Les infiniment petits des Mathématiciens
font des êtres purement imaginaires, qui ne
laiffent pas d’avoir une extreme utilité dans l’art
d’inventer. Une telle notion imaginaire met à la place
du vrai une efpece d’être , qui le repréfente dans la
recherche de la vérité c’eft un jetton dàns le calcul,
auquel il faut bien prendre garde de.ne pas donner
une valeur intrinfeque, où une exiftençe réelle. Voy. Différentiel, Infini, &c. Ê tre e x t e r n e , c ’eft celui qui a une relation
. quelconque avec un être donné. ÊÊtre singulier, voye1 Individu* . tre universel, e’eft celui qui n’a pas toutes
fes déterminations , mais qui ne contient que celles
qui font communes à un certain nombre d’individus
ou d’efpeces. Il y a des degrés d’univerfàlité qui vont
en augmentant à mefure qu’on diminue le nombre
des déterminations qui vont en diminuant quand
les déterminations fe multiplient..Les êtres univerfaux
K i j